Scanner corporel à ondes millimétriques
Un scanner corporel à ondes millimétriques est un type de scanner corporel destiné à assurer la sûreté dans les aéroports en permettant d'inspecter les passagers et de détecter les objets interdits dissimulés sous les vêtements sans avoir recours à la fouille corporelle. Il utilise la technologie des ondes radio millimétriques qui sont des rayonnements térahertz dénommés « rayons T ». Ils ont la propriété de pouvoir s'arrêter à la surface de la peau et de permettre de voir à travers les vêtements, faisant apparaitre le corps en trois dimensions. Grâce à cette technologie, tout est visible et on distingue parfaitement la silhouette, les volumes et les formes.
Leur apparition dans les aéroports a provoqué l'inquiétude de certaines associations, jugeant que l'image très détaillée fournie par ce type de scanner est trop intrusive.
Ce type de scanner est aussi utilisé dans certains ports (ex parking du Terminal Eurotunnel de Coquelles, en France) pour détecter des présences humaines (migrants) dans les camions en partance pour le Royaume-Uni.
Cependant, les ondes millimétriques s'arrêtant au niveau de la peau, un scanner corporel serait incapable de détecter un explosif caché à l'intérieur du corps, dans le rectum ou dans des implants mammaires par exemple1.
Apparition dans les aéroports
Début 2010, les scanners corporels étaient déjà utilisés aux États-Unis dans 19 aéroports ainsi que dans de rares palais de justice et prisons. En Europe, le projet d'utiliser ce type de scanner avait été abandonné fin 2008, après que l'Union européenne ait émis certaines réserves, certains eurodéputés jugeant « disproportionné de soumettre tous les passagers à ce type de contrôle au nom de la lutte contre le terrorisme »2.
La situation a changé après la tentative d'attentat manqué du , quand Umar Farouk Abdulmutallab, un jeune étudiant nigérian de 23 ans, avait tenté de faire exploser en plein vol un Airbus A330 entre Amsterdam et Détroit. Quelques aéroports internationaux européens ont alors décidé d'expérimenter les scanners corporels, afin de pouvoir contrer de nouvelles technologies indétectables avec les moyens habituellement utilisés3,4,2.
Le terroriste a réussi à déjouer les systèmes de sécurité de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol pourtant jugés très sérieux, en utilisant une nouvelle technique. Il a avoué avoir collé le long de sa cuisse de la poudre de penthrite, un explosif très puissant, afin de passer les contrôles. Puis a tenté de la faire exploser en y mélangeant un liquide inflammable contenu dans une seringue, en se cachant dans les toilettes de l'avion. Sa tentative n'a provoqué qu'une explosion minime et un début d'incendie vite maîtrisé par les passagers. Selon un expert, l'explosif était en quantité largement suffisante pour faire sauter l'avion et l'attentat a été évité grâce à un problème de détonateur5.
Les deux composants utilisés lors de cette tentative d'attentat ne peuvent être détectés par les portiques de sécurité classiques. Des experts ont alors suggéré que l'utilisation de scanners corporels aurait pu éviter ce genre d'attentat2.
Impact sur la santé
Contrairement aux rayons X qui ionisent la matière et sont dangereux à hautes doses, les rayonnements térahertz, dénommés « rayons T », sont peu énergétiques et non ionisants, ce qui les rend à priori peu nocifs6,7.
En France, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a demandé une enquête sur les risques sanitaires liés à l'utilisation de scanners corporels à ondes millimétriques dans les aéroports. L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) a estimé qu'il n'y avait « pas de risque avéré pour la santé des personnes » sur la base des prescriptions réglementaires du décret n°2002-775 (relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques). Elle recommandait d'instaurer un « contrôle régulier des appareils mis sur le marché » et de « compléter ces contrôles par des mesures régulières in situ pour les appareils en opération, attestant de leur bon fonctionnement »8. Dans ses recommandations, l'ANSES précise toutefois le manque d'études et la méconnaissance actuelle des effets de ces ondes électro-magnétiques sur le corps humain, et fait une déclaration qui modère fortement son propos sur l'innocuité de ces appareils9.
Notes et références
- Bérénice Dubuc, « Contre les explosifs dans le rectum, la fouille au corps et les détecteurs de métaux ne servent à rien » [archive], 20 minutes, 5 octobre 2009.
- « Attentat raté: les scanners corporels pourraient envahir les aéroports » [archive], 24 heures, Agence France-Presse, 29 décembre 2009.
- « Tentative d'attentat contre un avion américain » [archive], le Figaro (avec agences), 26 décembre 2009.
- Jean-Marc Leclerc, « L'attentat manqué met en alerte les aéroports » [archive], le Figaro, 28 décembre 2009.
- « Attentat raté du vol 253: «aucune indication» d'un complot plus large » [archive], Libération, le 27 décembre 2009.
- Olivier Dessibourg, « Voir à travers la matière grâce aux rayons T » [archive], le Temps, 16 janvier 2010.
- « Scanner corporel à ondes millimétriques : pas de rayons X » [archive], le Nouvel Observateur, 22 février 2010.
- « Expérimentation d'un scanner corporel à l'aéroport de Roissy » [archive], le Nouvel Observateur, Associated Press, 22 février 2010.
- « Scanners corporels » [archive], sur Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, (consulté le )
Articles connexes
Imagerie par résonance magnétique
Pour les articles homonymes, voir IRM et MRI.
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est une technique d'imagerie médicale permettant d'obtenir des vues en deux ou en trois dimensions de l'intérieur du corps de façon non invasive avec une résolution en contraste1 relativement élevéea.
L'IRM repose sur le principe de la résonance magnétique nucléaire (RMN)2 qui utilise les propriétés quantiques des noyaux atomiques pour la spectroscopie en analyse chimiqueb. L'IRM nécessite un champ magnétique puissant et stable produit par un aimant supraconducteur qui crée une magnétisation des tissus par alignement des moments magnétiques de spin. Des champs magnétiques oscillants plus faibles, dits « radiofréquence », sont alors appliqués de façon à légèrement modifier cet alignement et produire un phénomène de précession qui donne lieu à un signal électromagnétique mesurable. La spécificité de l'IRM consiste à localiser précisément dans l'espace l'origine de ce signal RMN en appliquant des champs magnétiques non uniformes, des « gradients », qui vont induire des fréquences de précession légèrement différentes en fonction de la position des atomes dans ces gradients. Sur ce principe qui a valu à ses inventeurs, Paul Lauterbur et Peter Mansfield le prix Nobel de physiologie ou médecine en 2003, il est alors possible de reconstruire une image en deux dimensions puis en trois dimensions de la composition chimique et donc de la nature des tissus biologiques explorés.
En imagerie médicale, l'IRM est principalement dédiée à l'imagerie du système nerveux central (cerveau et moelle épinière), des muscles, du cœur et des tumeurs. Grâce aux différentes séquences, on peut observer les tissus mous avec des contrastes plus élevés qu'avec la tomodensitométrie ; en revanche, l'IRM ne permet pas l'étude des corticales osseuses (tissus « durs ») trop pauvres en hydrogène, ni donc la recherche fine de fractures où seul l'œdème péri-lésionnel pourra être observé.
L'appareil IRM est parfois désigné sous le nom de « scanner », ce qui en français prête à confusion avec le tomodensitomètre. Contrairement à ce dernier (et à d'autres techniques d'imagerie comme la TEP), l'examen IRM n'est pas invasif et n'irradie pas le sujet. Cela en fait donc un outil de prédilection pour la recherche impliquant la personne humaine, et notamment en neurosciences cognitives. À partir des années 1990, la technique d'IRM fonctionnelle, qui permet de mesurer l'activité des différentes zones du cerveau, a en effet permis des progrès importants dans l'étude des fondements neurobiologiques de la pensée.
Image IRM d'une
tête humaine en pondération T1, en coupe
sagittale. La tête est vue de profil, regardant vers la gauche. On y voit le
cerveau en gris clair entouré de
liquide cérébrospinal (en noir), la
boîte crânienne et le
cuir chevelu ; sur d'autres coupes, on peut voir les
globes oculaires et, au niveau du
plan médian, différentes structures du
névraxe (face interne d'un
hémisphère cérébral,
corps calleux,
cervelet) ainsi que d'autres parties de l'anatomie (
langue,
fosses nasales,
etc.)
Histoire
Le principe de l'IRM repose sur le phénomène de résonance magnétique nucléaire (RMN), c'est-à-dire portant sur le couplage entre le moment magnétique du noyau des atomes et le champ magnétique externe, décrit par Félix Bloch et Edward Mills Purcell en 1946. Au début des années 1970, les nombreux développements qu'a connus la RMN, notamment en spectroscopie, laissent entrevoir de nouvelles applications de cette technique. Ainsi, Raymond Vahan Damadian propose dès 1969 d'utiliser la RMN dans un but médical et appuie sa proposition avec la démonstration que la spectroscopie RMN permet la détection de tumeurs3.
En 1973, un progrès important est accompli : s'inspirant des méthodes de reconstruction d'images utilisées en tomodensitométrie, Paul Lauterbur réalise pour la première fois une « imagerie » (qu'il baptise Zeugmatographie) basée sur la RMN en utilisant le principe des gradients qui permettent de capturer l'image d'une « coupe virtuelle » d'un objet en deux dimensions4. Simultanément mais de façon indépendante, Peter Mansfield propose une méthode similaire et introduit en 1977 la technique d'imagerie échoplanaire permettant la capture de nombreuses images en un temps relativement court. Le premier objet connu du grand public à avoir été étudié par IRM est un poivron, après un essai sur deux tubes capillaires.
Installation d'une unité d'IRM
Dans les années qui suivent, la technique évolue rapidement notamment grâce aux progrès réalisés en informatique et en électronique qui permettent de mettre en œuvre des méthodes numériques coûteuses en temps de calcul. Ainsi en 1975, Richard R. Ernst propose d'utiliser la transformée de Fourier pour analyser le codage en fréquence et en phase du signal IRM.
Les premières images de tissus humains seront produites en 1975 par Mansfield ; en 1977 sera réalisée la première image d'un corps humain vivant par Damadian qui dirigera ensuite la fabrication des premiers appareils commerciaux.
La principale innovation dans le domaine de l'IRM viendra avec la reprise par Seiji Ogawa des travaux de Linus Pauling et Charles Coryell sur le magnétisme de l'hémoglobine. En effet, le signal IRM émis par le sang oxygéné diffère du signal du sang désoxygéné. Cette propriété permit donc à Ogawa, John Belliveau et Pierre Bandettini de réaliser en 1992 les premières images du cerveau en fonctionnement : en réponse à des stimulations visuelles, ils purent mesurer une augmentation du débit sanguin cérébral dans les aires visuelles du lobe occipital. La mesure de cette réponse hémodynamique est à la base du fonctionnement de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, un outil central des neurosciences cognitives contemporaines.
Après plusieurs années d'évolution, l'IRM est donc devenue une technique puissante du domaine de l'imagerie médicale, lequel est sans cesse en développement. En reconnaissance de « leurs découvertes concernant l'imagerie par résonance magnétique », Peter Mansfield et Paul Lauterbur furent récompensés par le Prix Nobel de physiologie ou médecine en 2003.
En France, il y avait 592 appareils au ; le délai d'attente moyen était alors de 32 jours5. En 2016, il y avait 839 appareils pour un délai d'attente moyen de 30 jours. En 2017, malgré un accroissement à 906 appareils, le délai d'attente était remonté à 34 jours6,7.
Le centre européen NeuroSpin est en passe de devenir le plus grand centre au monde d'imagerie par résonance magnétique. L'un de ses objectifs est d'élucider le « code neural8 », autrement dit, comprendre comment l’information est codée dans le cerveau.
Technologie
Tunnel de l'aimant
Machine IRM en
géométrie fermée 3 teslas fabriquée par
Philips, une
antenne de tête est installée en bout de table. On remarque également une sorte de conduit semblable à celui d'une cheminée au-dessus de l'anneau : il s'agit du panneau de pénétration de la salle par lequel passent les différents câbles électriques, le système de refroidissement ainsi que le conduit d'évacuation de l'hélium gazeux en cas de
quench.
Il ne concerne que les imageurs fermés, c'est le tunnel dans lequel est introduit le patient. Il a des fonctions de confort (comme l'éclairage et la ventilation) et des moyens de communication entre le personnel soignant et le patient (microphone et haut-parleurs). Son diamètre varie très légèrement en fonction des constructeurs et des modèles mais est approximativement de 60 cm.
Aimant
L'aimant est au cœur du fonctionnement de l'appareil IRM. Son rôle est de produire le champ magnétique principal appelé B0 qui est constant et permanent. L'unité de mesure de l'intensité du champ magnétique est le tesla, dont le symbole est T. Cette valeur fait référence à l'intensité de ce champ principal.
En 2007, dans le domaine de l'imagerie médicale de routine, les intensités du champ magnétique utilisé sont comprises entre 0,1 et 7 teslas, avec des intensités supérieures à 17 teslas9 pour l'étude de spécimens murins ou autres petits animaux, et jusqu’à 11,7 teslas pour les études précliniques et cliniques sur l'humain.
Remarque : 1,6 T équivaut à 30 000 fois le champ magnétique terrestre.
On distingue selon l'intensité :
- bas champ : < à 0,5 T ;
- moyen champ : entre 0,5 T et 1 T ;
- haut champ : > à 1 T.
Le champ magnétique statique doit être uniforme dans la section du tunnel. La valeur du champ magnétique statique est mesurée et uniformisée par calibration (transducteur à effet Hall) à l'isocentre de l'aimant et doit couvrir toute la longueur de l'antenne de réception. Les tolérances sont extrêmement critiques particulièrement à haut champ et en spectrométrie. Le champ magnétique diminue à mesure que l'on s'éloigne de cet isocentre : on parle alors de champ magnétique résiduel. La répartition des lignes de champ dépend de la puissance du champ magnétique mais également de la présence d'un blindage autour de l'aimant (voir chapitre sur le blindage de champ magnétique).
Les principales qualités pour un aimant sont :
- un champ magnétique d'intensité élevée afin d'améliorer le rapport signal sur bruit ;
- une bonne stabilité temporelle (le champ magnétique doit être le plus permanent possible) ;
- une bonne homogénéité du champ (par exemple : 0,2 partie par million ppm dans une sphère de 36 cm de diamètre ce qui correspond au diamètre moyen d'une antenne émission/réception crânienne : c'est la fenêtre minimale d'homogénéité de champ que doit obtenir le constructeur pour pouvoir vendre son appareil dans la plupart des pays).
Ces qualités sont recherchées parmi les trois types d'aimants disponibles sur le marché : l'aimant permanent, l'aimant résistif et l'aimant supraconducteur. Aujourd'hui c'est l'aimant supraconducteur qui est le plus répandu.
L'augmentation des champs magnétiques permet une amélioration importante de la qualité des images obtenues par IRM mais certaines personnes s'interrogent sur l'influence de champ magnétique de grande intensité sur le corps humain. Toutefois rien, en 2007, ne met en évidence un quelconque effet néfaste sur l'organisme si ce n'est quelques « vertiges » dus à l'induction de faibles courants électriques dans certaines structures nerveuses par les impulsions de radiofréquence. Dans tous les cas, même à champ faible, la présence d'objets ferromagnétiques constituent une contre-indication à l'IRM.
Aimant permanent
Il est constitué d'une structure ferromagnétique qui produit un champ magnétique permanent sans consommation d'énergie. Ces aimants, autrefois très lourds (jusqu'à 90 tonnes avec les ferrites), se sont allégés avec l'arrivée des alliages à base de terre rares (Bore-néodyme-fer). Un aimant aux terres rares de 0,3 T corps entier ne pèse que 10 tonnes. Un 0,4 T pèse 13 tonnes. Bien que l'on puisse faire des aimants permanents de 1 T, il est économiquement difficile d'aller beaucoup plus haut que 0,4 tesla. Leurs avantages principaux sont l'absence de courant de Foucault, une fiabilité exceptionnelle, une architecture ouverte et un champ vertical perpendiculaire au grand axe du patient, ce qui améliore les performances des antennes. Les systèmes IRM réalisés autour d'aimants permanents ont longtemps fait l'objet de développements limités. Ce n'est plus le cas. Depuis quelques années, ces systèmes se sont hissés à de très bons niveaux de performances. Plus de 8 000 systèmes ont été installés dans le monde entier en majorité aux États-Unis et au Japon, de plus en plus en Europe et plus lentement en France. Ils sont devenus moins coûteux, très fiables et efficaces, et la Haute Autorité de santé en France en a reconnu l'intérêt dans un rapport de 10 et en préconise l'utilisation en France. Ils constituent également le meilleur choix pour les pays ne possédant pas l'infrastructure technique et logistique permettant de faire fonctionner un système supraconducteur dans de bonnes conditions.
L’utilisation d'un aimant permanent n'est pas sans danger ou problème car ce qui en fait la qualité (la grande stabilité et uniformité de son très puissant champ magnétique) en fait aussi le défaut puisqu'il sera impossible de suspendre le champ magnétique en cas d'urgence (on ne pourra pas appliquer la procédure de quench évoquée ci-dessous dans la section sur les aimants supraconducteurs). L'utilisation de l'appareil se fait donc avec des précautions préalable strictes (y compris par un examen radiographique classique préalable pour détecter des corps métalliques implantés dans des corps mous tels que les vaisseaux sanguins, ou résiduels de certains accidents). Cela nécessite également une surveillance du local d'examen contre la présence ou l'introduction de matériels ferromagnétiques susceptibles d'être projetés contre l'appareil, ou de causer des blessures graves. De plus, avec le temps, des poussières ferromagnétiques peuvent s'accumuler sur l'aimant et y persister, ce qui va progressivement en altérer l'uniformité du champ créé. L'environnement de l'appareil doit donc être tenu très propre, y compris l'air ambiant qui doit être filtré contre la présence de fumées polluantes, puisque le nettoyage de l'aimant sera très difficile ou nécessitera la reconformation du champ magnétique par adjonction d'écrans ou d'aimants complémentaires de correction. L’autre difficulté réside dans le transport et la livraison de l'aimant jusqu'au lieu où il sera déployé, les aimants de cette puissance faisant l'objet de mesures de sécurité spécifiques qui leur interdit par exemple le transport par avion si leur champ ne peut être totalement confiné dans l’emballage ou sa structure de protection et de pose dans l’appareil.
Aimant résistif
Cet aimant est constitué d'un bobinage de cuivre traversé par un courant électrique produisant un champ magnétique en son centre. Ce type d'aimant est assez peu utilisé depuis l'apparition des aimants supraconducteurs.
Il est assez peu coûteux à la fabrication et ne nécessite pas de liquide cryogénique de refroidissement (contrairement aux aimants supraconducteurs). De plus, le champ magnétique peut être annulé en quelques secondes en stoppant le courant (mais il faut attendre la stabilisation du champ lors de la remise sous tension).
Malheureusement, le champ magnétique maximum atteint à peine 0,5 T et reste très sensible aux variations de température. De plus, on constate des problèmes d'homogénéité du champ et une consommation électrique très importante pour alimenter la bobine en courant et pour alimenter les compresseurs du circuit de refroidissement afin de compenser l'effet Joule provoqué par la résistivité de la bobine.
Aimant supraconducteur
En 2008[réf. souhaitée], c'est le type d'aimant le plus répandu. L'aimant supraconducteur utilise le principe de supraconductivité : lorsque certains métaux ou alliages sont soumis à des températures proches du zéro absolu, ils perdent leur résistivité si bien que le passage d'un courant électrique se fait sans perte, donc sans production de chaleur.
L'aimant supraconducteur utilisé en IRM est constitué d'un bobinage de niobium-titane (Nb-Ti) baigné constamment dans de l'hélium liquide (près de −269 °C) qui en assure l'état supraconducteur. La résistance électrique nulle ainsi atteinte permet de créer des intensités de champ magnétique très élevées. La bobine est encastrée dans une matrice en cuivre qui sert de puits de chaleur afin de la protéger en cas de perte accidentelle de la supraconductivité (le quench).
Enfin, le système est entouré d'un écran refroidisseur (circuit d'air ou d'eau glacée) qui aide à maintenir l'hélium liquide à très basse température. Le tout est finalement enveloppé d'un espace de vide limitant les échanges thermiques avec l'extérieur. L'appareil est donc peu sensible aux variations de température ambiante.
Tout cet appareillage rend les appareils à aimant supraconducteur très coûteux à l'achat mais aussi à l'utilisation, du fait de leur consommation importante en hélium cryogénique. La supraconductivité permet néanmoins une consommation électrique moyenne ou faible : si elle n'est pas négligeable lors de la mise en courant des bobinages, elle devient ensuite quasi nulle une fois le régime permanent stable établi.
Les bobinages supraconducteurs étant parcourus par des courants beaucoup plus élevés, ils emmagasinent sous forme magnétique une énergie beaucoup plus élevée. Elle devient même considérable pour les bobines de grandes dimensions à 3 T ou plus. Ces équipements sont alors dotés d'équipements sophistiqués et fiables pour pouvoir la dissiper en toute sécurité en cas de quench.
Géométrie de l'aimant
Il existe deux types d'IRM (en pratique, on appelle IRM la technique comme l'appareil ou imageur) : l'IRM à champ fermé et l'IRM à champ ouvert.
Champ fermé
L'IRM « fermée » est la configuration la plus répandue et la plus connue à l'heure actuelle. Il s'agit d'un tunnel de 60 cm de diamètre pour 2 mètres de long pour les plus anciens et 1,60 mètre de long pour les plus récents.
De nouveaux systèmes sont apparus récemment, utilisant des tunnels plus larges jusqu'à 75 cm de diamètre. Ces systèmes parfois très abusivement qualifiés de « systèmes ouverts » restent des systèmes fermés, bien que leur capacité à accueillir des personnes obèses soit améliorée.
Champ ouvert
Un imageur IRM de type ouvert à aimant permanent.
L'IRM « ouverte » est apparue après l'IRM fermée. Très peu répandue à ses débuts, la technologie des IRM ouvertes s'améliorant, on leur trouve des avantages dans la médecine humaine notamment pour les personnes qui ne pouvaient pas bénéficier de ce type d'imagerie en espace clos pour des raisons pratiques ou pour éviter une anesthésie générale. On compte parmi ces personnes :
- les individus obèses dont le diamètre de l'abdomen ou l'envergure des épaules dépasse le diamètre interne du tunnel ;
- les individus claustrophobes ;
- les enfants ne pouvant pas rester seuls plusieurs minutes dans l'IRM sans bouger ;
- les femmes enceintes.
Une application récente des modèles ouverts est l'IRM interventionnelle.
Toutefois, les capacités d'intensité de champ magnétique offertes par ce type d'IRM restent habituellement inférieures (0,3 à 0,4 T pour les aimants permanents[réf. souhaitée]) aux conformations fermées. Cependant, il existe actuellement plusieurs systèmes ouverts utilisant une technologie à supraconducteur, ayant des champs à 1 T et 1,2 T11,12,13. Ces systèmes haut champ ouverts sont plus difficiles à fabriquer et donc plus chers.
Bobines de gradient de champ magnétique
Il s'agit de trois bobines métalliques enfermées dans un cylindre en fibres de verre et placées autour du tunnel de l'aimant. On les nomme respectivement : bobine X, bobine Y et bobine Z.
Le passage d'un courant électrique dans ces bobines crée des variations d'intensité du champ magnétique dans le tunnel, de façon linéaire dans le temps et dans l'espace. En fonction de sa géométrie, chaque bobine fait varier le champ magnétique selon un axe spécifique :
- la bobine X selon l'axe droite-gauche ;
- la bobine Y selon l'axe avant-arrière ;
- la bobine Z selon l'axe haut-bas.
Elles permettent notamment de sélectionner une épaisseur et un plan de « tranche » ou coupe (transversal, frontal, sagittal ou oblique) et de déterminer la localisation spatiale des signaux dans ce plan.
En sélectionnant une de ces bobines, on peut faire varier ces paramètres :
- la pente ou intensité : elle est de l'ordre de quelques dizaines de milliteslas par mètre (mT/m) et varie selon les imageurs ; son rôle est de contrôler l'épaisseur de chaque coupe ;
- le rapport de montée en puissance : elle correspond à la pente maximale atteinte par mètre et par milliseconde ; son rôle est la gestion de la rapidité d'acquisition ;
- Remarque : les commutations rapides de champ magnétique par les bobines de gradients produisent des courants de Foucault, eux-mêmes à l'origine de petits champs magnétiques.
Correcteurs de champ magnétique
Les correcteurs de champ magnétique ou shim sont des dispositifs qui servent à compenser les défauts d'inhomogénéité du champ magnétique principal B0 qui peuvent résulter de facteurs liés à l'environnement ou tout simplement de la présence du patient dans le tunnel.
Les correcteurs de champ sont disposés le long de l'aimant. Il en existe deux types pouvant être présents tous les deux dans une même machine.
Shim passif
Ce sont des plaques ferromagnétiques. Elles permettent un réglage grossier du champ magnétique, dans le cas d'un environnement perturbateur stable.
Shim actif
Ce sont des bobines résistives ou supraconductrices, dans lesquelles passe un courant électrique. Les shims actifs permettent un réglage fin et dynamique, lors de la présence de structures mobiles proches de l'imageur ou du patient dans le tunnel. Ils effectuent une compensation automatique à chaque fois que le champ magnétique devient hétérogène.
- Remarque : L'homogénéité du champ magnétique est vérifiée à chaque maintenance du système. Les bobines de shim sont alors calibrées finement (on parle de shimming) par un technicien ou ingénieur spécialisé.
Antennes
Ce sont des bobinages de cuivre, de formes variables, qui entourent le patient ou la partie du corps à explorer. Le principe de mesure est le même que pour les capteurs inductifs, à savoir la mesure d'une tension induite par la variation du flux.
Elles sont capables de produire et/ou capter le signal de radiofréquence (R.F.). Elles sont accordées pour correspondre à la fréquence de résonance de précession des protons qui se trouvent dans le champ magnétique :
- F p = ( γ 2 π ) ⋅ B o

- F p
 = Fréquence de précession
= Fréquence de précession - γ
 = Rapport gyromagnétique
= Rapport gyromagnétique - B o
 = Intensité du champ magnétique principal
= Intensité du champ magnétique principal
Ce qui donne dans le cas du noyau de l'hydrogène (proton) :
- pour un champ de 0,5 T : onde R.F. de 21,3 MHz ;
- pour un champ de 1 T : onde R.F. de 42,6 MHz ;
- pour un champ de 1,5 T : onde R.F. de 63,9 MHz.
Les antennes sont très variables et peuvent être catégorisées de trois manières différentes :
- selon leur géométrie : volumique et surfacique ;
- selon leur mode de fonctionnement : émettrice-réceptrice ou réceptrice seule (on parle aussi de réceptrice pure) ;
- selon l'association ou non de différents éléments d'antennes : linéaire, en quadrature de phase ou en réseau phasé.
Le terme « antenne » est cependant critiqué par certains scientifiques, considérant que le signal détecté en IRM ne résulte pas d'une émission cohérente spontanée d'ondes électromagnétiques par les tissus, mais d'un phénomène d'induction en champ proche14,15.
Antennes volumiques
Une antenne volumique est une antenne au centre de laquelle est positionné le segment à examiner. Elle est :
- soit émettrice-réceptrice : c'est un cylindre de bobinage métallique qui émet un signal R.F. approprié (sous la forme d'impulsions régulières) vers des protons de la région à explorer ; ceux-ci entrent alors en résonance ; puis l'antenne reçoit la réponse de ces protons, au moment de la restitution de l'énergie ;
- soit réceptrice simple : elle est constituée de plusieurs antennes réceptrices plates montées en réseau phasé autour d'une structure cylindrique ; c'est, dans ce cas, une autre antenne (l'antenne dite Corps ou Body intégrée à l'appareil lui-même) qui s'occupe de l'émission du signal R.F.
- Remarque : L'émission et la réception du signal se font de façon homogène dans tout le volume entouré par l'antenne.
Exemples d'antennes volumiques :
- L'antenne corps : il s'agit d'une antenne émettrice-réceptrice, elle est située autour du tunnel de l'aimant (non visible sur une installation en utilisation mais il est possible de la visualiser au cours des maintenances). Son diamètre est à peu près de 65 cm. Elle permet l'étude de régions anatomiques étendues (allant jusqu’à 50 cm de long).
- L'antenne tête : il s'agit d'une antenne émettrice-réceptrice ou réceptrice simple. Il s'agit d'une antenne modulaire de diamètre de 25 à 30 cm qui est adaptée à l'exploration de l'encéphale mais peut également être utilisée pour l'exploration comparative des extrémités chez l'adulte (main, poignet, pied et cheville) ou de l'abdomen des jeunes enfants.
- L'antenne genou : il s'agit d'une antenne émettrice-réceptrice ou réceptrice simple. Il s'agit d'une antenne modulaire de 22 cm de diamètre (peut varier). Elle est adaptée à l'exploration du genou, mais aussi du pied et de la cheville.
On peut aussi citer : l'antenne poignet, l'antenne épaule, l'antenne jambes…
Antennes surfaciques
Une antenne surfacique est une antenne plane positionnée au contact de la région à explorer. Elle est réceptrice simple et ne peut donc que recevoir le signal restitué par les protons, c'est l'antenne corps qui émet l'impulsion R.F. initiale.
En tant qu'antenne linéaire (utilisée seule), elle ne permet l'examen que de petits champs d'exploration. C'est pour cette raison qu'elle est souvent couplée à d'autres antennes surfaciques (en quadrature de phase ou en réseau phasé).
Elle procure un très bon rapport signal sur bruit dans la région d'intérêt à condition de son bon positionnement (le plus proche possible de la zone d'exploration).
Associations d'antennes
Comme nous l'avons vu précédemment, les antennes peuvent être utilisées seules ou en association afin d'avoir un rendu optimum et permettre le diagnostic :
- L'antenne linéaire : c'est une antenne surfacique utilisée seule et placée parallèlement au champ magnétique B0. Il y a donc réception du signal émis par le patient, uniquement lorsque ce signal passe devant l'antenne.
- L'antenne en quadrature de phase : c'est un ensemble de deux antennes surfaciques disposées autour d'une même région mais dans des plans différents. Chaque antenne reçoit un signal de la même région mais à des moments différents. Les deux signaux se regroupent alors sur un même canal de traitement pour former l'image finale. Ce principe augmente le rapport signal sur bruit et par conséquent la qualité de l'image. On peut aussi utiliser ce gain de signal pour diminuer le temps d'acquisition pour une qualité d'image, cette fois-ci, inchangée. Il est évident que les coûts d'achat de ce type d'antenne est bien plus élevé que pour une antenne linéaire.
- Les antennes en réseau phasé : c'est un ensemble de plusieurs antennes de surface de petit diamètre, disposées côte à côte. Chaque antenne possède son propre canal de réception du signal et produit l'image de la région anatomique en regard de laquelle elle se trouve. Les différentes images sont ensuite combinées par des algorithmes informatiques pour former l'image terminale. Ce principe procure un très haut rapport signal sur bruit et permet un large champs d'exploration (jusqu’à 48 cm), mais est bien plus onéreux que les deux autres types d'antennes précédemment décrites16.
- Remarque: il existe des antennes dites « HDE » (haute densité d'éléments) ce sont des antennes qui contiennent plus de deux bobines appelées « éléments d'antenne » qui peuvent être comme des petites antennes élémentaires. Cependant les antennes HDE sont très onéreuses (pour l'exemple une « antenne-genou » 8 éléments coûte près de 25 000 €).
Blindages
En IRM, on parle de blindages pour certains dispositifs destinés au confinement des champs magnétiques produits par la machine et à l'isolement de celui-ci des champs magnétiques extérieurs qui viendraient perturber l'acquisition.
Il existe deux blindages dans une installation IRM :
Blindage des ondes de radiofréquence
Il est assuré par la cage de Faraday constituée d'un maillage de cuivre qui recouvre presque* toutes les parois de la salle de l'aimant et étanche aux ondes R.F. Cependant cette « cage » n'est visible qu'au niveau de la vitre de contrôle (aspect sombre du verre) et le cadre de la porte (de petites lamelles de cuivre), les plaques de cuivre étant cachées dans les murs, le plafond et le sol :
- elle empêche les ondes R.F. produites par le système de sortir de la salle de l'aimant ;
- elle empêche les ondes R.F. extérieures (produites par tout appareil électronique et objet métallique en mouvement) d'entrer dans la salle d'examen.
- (*) Dans toutes les salles IRM il existe ce que l'on appelle un panneau de pénétration, c'est un lieu de passages du circuit de refroidissement et des câbles transportant les informations entre la salle de l'aimant et le local technique, celui-ci fait un trou dans la cage de Faraday. Cependant ce passage est spécialement conçu pour ne laisser passer aucune onde R.F.
En outre, il existe un autre type de cage de Faraday. Miniaturisée, elle n'est utilisée que rarement pour certaines acquisitions notamment l'exploration des membres inférieurs, et ce, afin d'éviter l'artéfact de repliement (Aliasing) du membre controlatéral. Ce dernier est entouré par une petite cage de Faraday et ne peut donc répondre aux impulsions de radiofréquences. De nouvelles parades technologiques et des solutions d'anti-repliements rendent son utilisation très sporadique.
Blindage de champ magnétique
Il a pour rôle de rapprocher les lignes de champ au plus près de l'aimant et notamment de faire rentrer la ligne de 0,5 mT dans la salle d'examen.
- Remarque: on parle de la « ligne des 0,5 mT » ou « des 5 gauss ». C'est la limite au-delà de laquelle il y a dysfonctionnement ou dérèglement d'un pacemaker
Il existe deux types de blindages de champ magnétique selon les appareils :
- un blindage passif : c'est un ensemble de poutrelles d'acier ou de fer doux, entourant l'aimant. Ce dispositif est très lourd ;
- un blindage actif : c'est un bobinage métallique inversé placé aux deux extrémités du bobinage de champ principal B0. Au passage du courant électrique dans les spires inversées, il se produit un contre-champ magnétique dont les lignes de champ viennent s'opposer à celles de B0.
Le périmètre du champ magnétique est appelé champ magnétique résiduel. La taille du champ magnétique résiduel dépend de la puissance du champ magnétique et du fait que le système soit blindé ou non. Pour un IRM de 1,5 T non blindé, un champ supérieur à 0,5 mT s'étend jusqu’à près de 12 mètres de l'isocentre et de 9,5 mètres de part et d'autre de l'aimant (Il est à noter que la cage de Faraday n'a aucune action de blindage contre le champ magnétique) ; avec blindage ce champ est réduit à 4 mètres de l'isocentre et 2,5 mètres de part et d'autre de l'aimant.
- Remarque : En raison du contre-champ du blindage actif, le champ magnétique est plus intense à l'entrée du tunnel et sous les capots qu'au centre de l'appareil (les intensités peuvent être presque doublées). Cette propriété peut être cause de vertiges et de sensations de fourmillement à l'entrée du tunnel lors de l'émission des ondes de radiofréquence, dues à de petits courants de Foucault induits dans certaines structures nerveuses. Il est important de respecter les consignes de sécurité et ne pas former de « boucle » avec les membres ce qui augmenterait l'intensité de ces courants et pourrait provoquer des brûlures ou/et de plus grands étourdissements.
Quench
Le Quench se définit par un passage brutal de l'hélium liquide à l'état gazeux volatil qui s'échappe alors de la cuve.
La raison accidentelle principale de ce phénomène est un défaut dans le système d'isolation thermique dû à la présence de micropores dans les joints, voire un non contrôle du niveau d'hélium et du bouclier thermique d'azote liquide (c'est la cause accidentelle la plus fréquente du « quench »).
Il y a un réchauffement de l'hélium liquide qui passe alors à l'état gazeux, avec un risque de voir l'évaporation s'accélérer avec la diminution du pourcentage d'hélium liquide présent en cuve.
- Remarque : Ce dysfonctionnement peut avoir des origines très diverses : panne dans le circuit d'eau glacée due à un dépôt important de calcaire, défaillance dans les compresseurs provoquant l'arrêt de la tête froide, ou une augmentation de pression dans l'aimant…
Le quench peut être aussi provoqué volontairement par le personnel de santé : en effet la propriété supraconductrice des IRM modernes fait que le champ magnétique principal reste même s'il n'y a plus d'apport de courant dans la bobine. Tout changement de la valeur du champ statique doit être opéré avec une procédure très stricte et toute variation rapide du champ statique engendre des courants de Foucault importants. Ceux-ci réchauffent les cuves de l'aimant et augmentent considérablement la consommation d'hélium, ceci peut conduire à un phénomène d'emballement qui évapore la masse d'hélium existant et conduit au « quench » et surtout au réchauffement du filament supraconducteur qui peut être détruit et brûlé.
Ainsi pour stopper le champ magnétique, il faut attendre plusieurs heures (voire journées) pour que la très faible résistance de la bobine diminue l'intensité du champ magnétique. En cas de danger immédiat pour une personne se trouvant dans la salle d'examen — par exemple, un individu coincé entre l'aimant et un gros objet ferromagnétique (brancard, bonbonne d'oxygène, cireuse…), il y a un risque de fracture voire d'asphyxie pour celui-ci et la puissante force d'attraction empêche de dégager la personne sans porter atteinte à son intégrité physique — on déclenche alors le quench :
L'hélium liquide passe à l'état gazeux, la bobine principale se réchauffe avec perte de la supraconductivité et reprise de la résistivité de la bobine. À terme, il y a remise en place de l'effet Joule (dissipation de l'énergie sous forme de chaleur) et l'intensité du champ magnétique chute progressivement.
L'hélium gazeux produit doit normalement s'échapper vers l'extérieur des locaux grâce à un conduit situé au-dessus de l'aimant. Si cette évacuation ne se fait pas correctement, l'hélium gazeux s'échappe dans la salle d'examen. Il y a alors un risque important d'asphyxie et de brûlure par le froid pour le patient présent dans le tunnel, ainsi qu'un risque de confinement de la salle : impossibilité d'ouvrir la porte de la salle selon son sens d'ouverture.
- Remarque : L'hélium gazeux n'est pas un gaz toxique pour l'organisme. Son inconvénient, dans ce cas, est sa détente du passage liquide à l'état gazeux pour finalement remplacer le dioxygène de l'air. En effet pour 1 litre d'hélium liquide on obtient près de 700 litres d'hélium gazeux ; un véritable problème lorsqu'on sait que la cuve d'un IRM contient (lorsqu'elle est pleine) de 1 650 à 1 800 litres d'hélium liquide.
Lorsqu'un quench se produit, il arrive que la totalité de l'hélium présent en cuve s'échappe. Dans ce cas l'appareil IRM ne peut plus être utilisé dans l'immédiat : il faut refroidir la cuve avant de la remplir à nouveau, puis relancer le champ magnétique jusqu’à atteindre sa complète stabilité. Il faut ensuite recalibrer le shim actif et procéder à des tests sur fantômes. Ces opérations sont très coûteuses en temps et en argent : dans un ordre d'idée, on peut estimer son coût à plus de 40 000 euros sans compter les pertes potentielles dues à l'impossibilité de pratiquer des examens pendant le temps de remise en service qui dure, environ, deux semaines.
Rappels de RMN
Représentation visuelle du spin d'un proton dans à un champ magnétique constant B0 puis soumis à une onde radiofréquentielle B1. Visualisation des temps de relaxation T1 et T2.
La résonance magnétique nucléaire exploite le fait que les noyaux de certains atomes (ou plutôt isotopes atomiques) possèdent un moment magnétique de spin. C'est en particulier le cas de l'atome d'hydrogène 1 que l'on retrouve en grande quantité dans les molécules qui composent les tissus biologiques comme l'eau (H2O) et les molécules organiques. En RMN (tout comme en IRM), on place les atomes que l'on veut étudier dans un champ magnétique constant. On peut alors imaginer les spins des noyaux atomiques comme des toupies tournant sur elles-mêmes autour de leur axe et effectuant un mouvement rapide de précession autour de l’axe du champ magnétique (mouvement appelé précession de Larmor). Cette fréquence de précession est exactement proportionnelle à l’intensité du champ magnétique (qui est de quelques teslas pour les appareils d'IRM actuels). On applique alors à ces atomes une onde électromagnétique à une fréquence bien particulière dite fréquence de résonance ou fréquence de Larmor. En effet, pour que le champ oscillant de l’onde électromagnétique puisse avoir un effet notable sur les spins, il faut que sa fréquence soit ajustée au mouvement de précession de ces spins (phénomène de résonance). La fréquence de Larmor étant différente pour des isotopes atomiques différents (à cause d’un rapport gyromagnétique différent), un choix judicieux de cette fréquence permet de cibler quels atomes on va détecter. En IRM, on utilise principalement les atomes d'hydrogène dont la fréquence de résonance est autour de 42 MHz/T, ce qui correspond à la gamme des ondes radio. En effet, l'atome d'hydrogène qui est constitué d'un seul proton, est très abondant dans les tissus biologiques et en outre, son moment magnétique nucléaire est relativement fort, ce qui fait que la résonance magnétique de l'hydrogène donne lieu à un phénomène de résonance très net et facile à détecter.
Même s'il s'agit en réalité de phénomènes quantiques, on peut se représenter, de façon imagée, que sous l'effet du champ magnétique statique, les moments magnétiques de spin vont progressivement s'aligner dans une direction initialement parallèle à celui-ci et donner lieu à une aimantation globale dans la direction du champ B 0  , dite direction longitudinale. Par habitude, on note cette direction de la lettre z
, dite direction longitudinale. Par habitude, on note cette direction de la lettre z  . et on note l'aimantation longitudinale résultant de l'addition de tous ces moments magnétiques, M
. et on note l'aimantation longitudinale résultant de l'addition de tous ces moments magnétiques, M  . En fait, seule une très faible proportion (environ 0,001 %) des moments magnétiques nucléaires s'aligne dans la direction z
. En fait, seule une très faible proportion (environ 0,001 %) des moments magnétiques nucléaires s'aligne dans la direction z  , la très grande majorité ne possède pas une orientation stable en raison de l'agitation thermique, néanmoins cette petite proportion de spins qui « s'alignent » est suffisante pour être détectée, c'est pourquoi on néglige le reste des moments magnétiques des 99,999 % restant qui statistiquement se compensent les uns les autres.
, la très grande majorité ne possède pas une orientation stable en raison de l'agitation thermique, néanmoins cette petite proportion de spins qui « s'alignent » est suffisante pour être détectée, c'est pourquoi on néglige le reste des moments magnétiques des 99,999 % restant qui statistiquement se compensent les uns les autres.
Lorsque l'on applique l'onde magnétique radiofréquence oscillante à la fréquence de Larmor, on va entraîner les moments magnétiques qui vont alors s'écarter progressivement de l'axe z  pour aller se placer perpendiculairement à leur axe de départ un peu comme un parapluie qui s'ouvrirait mais en plus les spins continuent leur rotation autour de l'axe z
pour aller se placer perpendiculairement à leur axe de départ un peu comme un parapluie qui s'ouvrirait mais en plus les spins continuent leur rotation autour de l'axe z  . C'est ce qu'on appelle un mouvement de précession.
. C'est ce qu'on appelle un mouvement de précession.
L'onde magnétique oscillante, notée B 1  va donc avoir comme rôle de faire « basculer » les moments magnétiques de spin pour les placer dans un plan perpendiculaire à la direction du champ statique B 0
va donc avoir comme rôle de faire « basculer » les moments magnétiques de spin pour les placer dans un plan perpendiculaire à la direction du champ statique B 0  . C'est ce qu'on appelle l'excitation : plus celle-ci dure longtemps et plus la proportion de moments magnétiques qui auront basculé sera importante et donc plus l'aimantation longitudinale (dans la direction z
. C'est ce qu'on appelle l'excitation : plus celle-ci dure longtemps et plus la proportion de moments magnétiques qui auront basculé sera importante et donc plus l'aimantation longitudinale (dans la direction z  ) diminuera.
) diminuera.
Lorsqu'on interrompt le champ oscillant, les moments magnétiques qui se sont écartés de leur axe initial vont revenir vers la direction z  sans cesser de tourner. On peut alors mesurer ce mouvement de rotation des spins sous la forme d'un signal oscillant qui a la même fréquence que l'onde excitatrice. C'est ce signal, dit de précession, qu'on mesure en RMN et en IRM au moyen d'une antenne réceptrice.
sans cesser de tourner. On peut alors mesurer ce mouvement de rotation des spins sous la forme d'un signal oscillant qui a la même fréquence que l'onde excitatrice. C'est ce signal, dit de précession, qu'on mesure en RMN et en IRM au moyen d'une antenne réceptrice.
Relaxation longitudinale (T1)
Au fur et à mesure que les moments magnétiques retrouvent la direction du champ statique z  , le signal oscillant qu'ils émettent va en diminuant, jusqu'à disparaître quand tous les moments magnétiques sont de nouveau alignés longitudinalement, c'est-à-dire dans la direction z
, le signal oscillant qu'ils émettent va en diminuant, jusqu'à disparaître quand tous les moments magnétiques sont de nouveau alignés longitudinalement, c'est-à-dire dans la direction z  . Le temps que mettent les moments magnétiques nucléaires à retrouver leur alignement longitudinal (c'est-à-dire sur la direction z
. Le temps que mettent les moments magnétiques nucléaires à retrouver leur alignement longitudinal (c'est-à-dire sur la direction z  ) est baptisé temps de relaxation longitudinal et est noté T1.
) est baptisé temps de relaxation longitudinal et est noté T1.
En notant M z ( ∞ )  la valeur à l'équilibre de l'aimantation longitudinale (lorsque tous les spins sont alignés), on peut donner la loi d'évolution de la « repousse » de l'aimantation longitudinale après avoir appliqué une excitation qui aurait fait basculer tous les moments magnétiques au temps t = 0
la valeur à l'équilibre de l'aimantation longitudinale (lorsque tous les spins sont alignés), on peut donner la loi d'évolution de la « repousse » de l'aimantation longitudinale après avoir appliqué une excitation qui aurait fait basculer tous les moments magnétiques au temps t = 0  : M z ( t ) = M Z ( ∞ ) . ( 1 − e − t T 1 )
: M z ( t ) = M Z ( ∞ ) . ( 1 − e − t T 1 ) 
Ce phénomène de relaxation (c'est-à-dire de retour à l'équilibre) suit donc une dynamique exponentielle, il faudrait alors un temps infini pour que tous les spins se retrouvent alignés, c'est pourquoi on définit comme temps T1 le temps mis pour retrouver 63 % de l'aimantation longitudinale à l'équilibre.
Ce temps de relaxation T1 dépend de l'agitation moléculaire dans le tissu que l'on observe. Il suit une courbe en U inversé : si l'agitation moléculaire est très faible, les atomes d'hydrogène mettront du temps à revenir à l'équilibre (c'est le cas des tissus durs comme les os). Si l'agitation des molécules d'eau est très forte, comme c'est le cas dans les liquides comme le liquide céphalorachidien, la repousse est aussi lente. En revanche, si l'agitation est modérée (c'est-à-dire avec une constante de temps autour de la fréquence de Larmor) comme dans la graisse ou dans la substance blanche, alors le temps T1 est relativement court. Ces différents T1 tournent autour de 1 seconde pour un champ B 0  de 3 teslas.
de 3 teslas.
Relaxation transversale (T2)
Par ailleurs, l'agitation moléculaire contribue aussi à un autre phénomène : alors qu'en théorie les moments magnétiques devraient tous tourner de façon cohérente autour de l'axe z  , c'est-à-dire avec une différence de phase constante, l'agitation moléculaire va faire que les atomes ne vont pas être dans un environnement physico-chimique constant et donc leur fréquence de Larmor ne va pas être non plus parfaitement égale à la fréquence de Larmor théorique. Par conséquent, les différents moments magnétiques vont avoir tendance à se déphaser. Cela se traduit par une diminution du signal lié à leur rotation synchrone au cours du temps, dit temps de relaxation transversale noté T2.
, c'est-à-dire avec une différence de phase constante, l'agitation moléculaire va faire que les atomes ne vont pas être dans un environnement physico-chimique constant et donc leur fréquence de Larmor ne va pas être non plus parfaitement égale à la fréquence de Larmor théorique. Par conséquent, les différents moments magnétiques vont avoir tendance à se déphaser. Cela se traduit par une diminution du signal lié à leur rotation synchrone au cours du temps, dit temps de relaxation transversale noté T2.
Ce temps T2 mesure la disparition de l'aimantation transversale, c'est-à-dire de l'aimantation résultant du fait que les moments magnétiques sont synchrones dans leur rotation dans le plan transversal, perpendiculaire à B 0  , où ils ont été amenés par l'onde excitatrice oscillante B 1
, où ils ont été amenés par l'onde excitatrice oscillante B 1  . Là encore, il s'agit d'un phénomène qui suit une loi exponentielle (décroissante cette fois) : M ( t ) = M 0 . e − t T 2
. Là encore, il s'agit d'un phénomène qui suit une loi exponentielle (décroissante cette fois) : M ( t ) = M 0 . e − t T 2 
Inhomogénéités de champ (T2*)
Dans un système idéalisé, tous les noyaux précessent à la même fréquence. Cependant, dans les systèmes réels, les inhomogénéités du champ magnétique principal conduisent à une dispersion des fréquences de résonance autour de la valeur théorique (effet d' off-resonance). Au cours du temps, ces irrégularités accentuent le déphasage de l'aimantation transversale et la perte de signal.
La relaxation transversale observée est donc décrite par un temps T2*, généralement beaucoup plus petit que le T2 « vrai » :
1 T 2 ∗ = 1 T 2 + 1 T 2 ′ 
où T2' décrit la perte de signal résultant exclusivement des inhomogénéités du champ magnétique principal. Pour les molécules statiques, cette décohérence est réversible et le signal peut être récupéré en effectuant une expérience d'écho de spin.
Codage spatial grâce aux gradients
La localisation spatiale des atomes est obtenue en ajoutant un gradient directionnel sur le champ magnétique de base ( B 0  ) grâce aux bobines de gradient de champ magnétique. La relaxation des protons sera alors modifiée par la variation du champ magnétique. Des techniques de traitement du signal utilisant les algorithmes de transformées de Fourier rapides permettent alors de localiser l'origine du signal.
) grâce aux bobines de gradient de champ magnétique. La relaxation des protons sera alors modifiée par la variation du champ magnétique. Des techniques de traitement du signal utilisant les algorithmes de transformées de Fourier rapides permettent alors de localiser l'origine du signal.
La résolution spatiale est liée à l'intensité du champ magnétique (de nos jours, en 2006, les appareils utilisent un champ de 1 à 3 teslas) et de la durée de l'acquisition (en général une dizaine de minutes). On atteint actuellement une résolution de l'ordre du millimètre.
Pondérations
En modifiant les paramètres d'acquisition IRM, notamment le temps de répétition entre deux excitations et le temps d'écho, temps entre le signal d'excitation et la réception de l'écho, l'utilisateur peut modifier la pondération de l'image, c’est-à-dire faire apparaître les différences de temps T1 et de temps T2 des différents tissus d'un organisme. Les tissus ayant des temps T1 et T2 différents en fonction de leur richesse en atome d'hydrogène et en fonction du milieu dans lequel ces derniers évoluent, peuvent renvoyer des signaux différents si l'on arrive à mettre en évidence ces différences de temps. Pour cela, on teste la réponse des atomes après des excitations particulières.
Des tissus différents ont des T1 différents. Après stimulation de radiofréquence avec un temps de répétition court, on ne laisse pas le temps aux atomes d'hydrogène de certains tissus de revenir en position d'équilibre alors que, pour d'autres atomes d'hydrogène d'autres tissus, le temps est suffisamment long pour qu'il y ait un retour à l'équilibre. Lorsque l'on mesure l'état d'énergie des atomes des tissus, on note des écarts d'état entre ces différents atomes. Si on laissait un temps trop long, tous les atomes auraient le temps de revenir en position d'équilibre et l'on ne noterait plus de différences entre différents tissus.
Des tissus différents ont des T2 différents. Après stimulation par un temps d'écho long, on retrouve des décroissances d'énergie d'amplitude plus importante entre les tissus. Les différences de T2 étant plus discriminants si le temps d'écho est long.
Pondération T1
Les paramètres de la pondération :
- temps d'écho : TE = 10 à 20 ms (ms = millisecondes)
- temps de répétition : TR = 400 à 600 ms
En utilisant un temps de répétition court et un temps d'écho court (neutralise les différences de temps T2), on obtient un contraste d'image pondérée en T1, pondération dite « anatomique » : en pondération T1 sur le cerveau, la substance blanche apparaît plus claire que la substance grise. Le liquide céphalorachidien, situé entre la substance grise et l'os apparaît lui nettement plus foncé.
Ces séquences sont également utilisées après injection de produit de contraste, pour caractériser une anomalie17,18.
Pondération T2
Les paramètres de la pondération :
- temps d'écho : TE > 80 ms
- temps de répétition : TR > 2 000 ms
En utilisant un temps de répétition long (neutralise les différences de temps T1) et un temps d'écho long, on obtient un contraste d'image dite pondérée en T2, dite aussi pondération « tissulaire » : L'eau et l'œdème apparaissent en hyper signal.
Densité protonique
Les paramètres de la pondération :
- temps d'écho : TE = 10 à 20 ms
- temps de répétition : TR > 2 000 ms
En utilisant un temps de répétition long (2 000 ms à 3 000 ms) et un temps d'écho court (inférieur à 30 ms), on obtient un contraste d'image de pseudo densité protonique (Tissus > liquide > graisse). Seul les éléments tissulaires à faible densité protonique, comme les ménisques, seront en hyposignal par rapport aux liquides libres témoins d'une pathologie articulaire sous-jacente. En utilisant un temps de répétition plus long (5 000 ms) et un temps d'écho court (inférieur à 30 ms), on obtient un contraste d'image de vraie densité protonique (Liquide>Tissus>graisse).
Séquences
Écho de spin
Séquence SE classique
La séquence IRM la plus classique est sans doute la séquence écho de spin. Cette dernière se décompose en :
- une impulsion 90° dite d'excitation.
- une période de déphasage dans le plan transverse des protons pendant TE/2.
- une impulsion 180°, dite d'inversion.
- un rephasage pendant TE/2.
- la lecture du signal (lecture de l'écho de spin).
Cette séquence permet les pondérations T1, T2 et de densité protonique. Elle n'est plus utilisée car le temps d'acquisition est beaucoup trop long car il faut compter environ 50 minutes pour l'acquisition d'une coupe sur une matrice de 256².
Séquence TSE/FSE rapide
TSE pour Turbo Spin Echo et FSE pour Fast Spin Echo (le nom de la séquence dépend des constructeurs mais le principe est identique).
La technique associe la méthode écho de gradient et écho de spin pour une acquisition plus rapide mais plus sensible aux artefacts.
Le principe de ces techniques reste basé sur un angle d'impulsion radiofréquence (généralement 40°) appelé angle de Ernst intermédiaire entre la séquence SE et IR avec des temps de répétitions plus courts (300 ms) , cette technique appliquée à haut champ permet d'éviter certains artefacts dus aux spins mobiles.
Inversion-Récupération
Séquence IRT1 ou FLAIRT1 ou TRUET1
On envoie une impulsion à 180°, puis on attend un délai T pendant lequel ML (proportionnel à l'intensité longitudinale) a augmenté. Après T, on envoie une impulsion à 90°, qui provoque un basculement de ML, on obtient ainsi un courant mesurable et donc un signal lié à T1.
Séquence STIR
(= Short Tau Inversion Recovery)
Les séquences STIR ont pour but d'annuler le signal de la graisse.
Séquence FLAIR ou FLAIR T2
Il s'agit d'une séquence en inversion-récupération pondérée T2 sur laquelle on a « supprimé » le signal de l'eau libre (et donc du liquide céphalorachidien), qui apparaît alors en hyposignal, en adaptant le temps d'inversion. Cette séquence est très utilisée dans l'exploration cérébrale (notamment du cortex et des parois ventriculaires), l'œdème, la nécrose ou encore la gliose.
Écho de gradient
Gradient de diffusion
Les techniques de gradient de diffusion consistent à mesurer le mouvement brownien des molécules d'eau dans les tissus. Cela permet d'en déduire des informations sur les inhomogénéités des tissus et notamment de la substance blanche du tissu nerveux. Pour ce faire, les mesures de la diffusion sont effectuées sur un plus ou moins grand nombre de directions (de 6 à plus d'une centaine) qui permettent de calculer des tenseurs de diffusion dans chaque voxel. À partir de là, il est possible de définir la direction moyenne des fibres qui passent dans chacun des voxels et de reconstruire la trajectoire des principaux faisceaux de fibres grâce à des algorithmes de tractographie déterministes ou probabilistes. Cette direction moyenne est donnée par la direction propre associée à la plus grande valeur propre du tenseur de diffusion. Le plus souvent, les algorithmes déterministes interpolent les directions de chaque voxel contigu en fonction du degré d'anisotropie (mesuré par la fraction d'anisotropie) et de l'angle formé par deux directions moyennes de voxels jouxtants.
Saturation des graisses (ou fatsat)
La Fat Sat est une technique permettant de supprimer le signal de la graisse en IRM.
C'est une méthode qui utilise la légère différence de fréquence de résonance des protons des atomes d'hydrogène présents dans la graisse par rapport à ceux de la molécule d'eau. Cette différence est d'environ 220 Hz(à 1,5 Tesla). On envoie donc une radiofréquence dirigée spécifiquement sur la fréquence de la graisse afin de la saturer avant de recueillir le signal de la coupe.
Avantages :
- méthode utilisable en pondération tant T1 que T2 ;
- permet de mieux mettre en évidence les prises de produit de contraste en pondération T1.
Inconvénients :
- Très sensible aux inhomogénéités de champ, la différence de fréquence de résonance étant très ténue, si le champ magnétique a une valeur trop variable, la Fat Sat ne fonctionnera pas bien. Ce problème se pose souvent en cas de corps étrangers métalliques trop proches ou même en cas d'homogénéité limitée de l'aimant.
Artefacts
L'IRM, comme toutes les autres techniques d'imagerie médicale, n'échappe pas à la constitution de fausses images : les artéfacts.
Les artéfacts sont des images observables qui n'ont, pour la plupart, pas à proprement parler de réalité anatomique. Ils peuvent être évités ou minimisés en modifiant certains paramètres d'acquisitions ou de reconstructions. Cependant certains d'entre eux sont utiles pour le diagnostic.
Artefacts de mouvement
L’artefact de mouvement est un des artefacts les plus fréquemment rencontrés. Comme son nom l'indique, il se constitue lorsqu'il y a translation dans l'espace du segment étudié au cours de l'acquisition. Il y a deux types de mouvements rencontrés :
- les mouvements périodiques : Ce sont les mouvements de la respiration, les battements cardiaques et les flux sanguins ;
- les mouvements apériodiques : Ce sont les mouvements du patient, les mouvements oculaires, la déglutition, le péristaltisme digestif et le flux du liquide cérébrospinal.
Ils ont pour conséquence la dispersion du signal : image floue de la structure en mouvement.
Mais aussi (en particulier pour les mouvements périodiques) des erreurs de localisation du signal : des images « fantômes » ou ghosting ; en effet lorsqu'il y a mouvement au cours de différents codages de phase, plusieurs valeurs de codage et donc plusieurs localisations seront attribuées à un même proton.
Ces erreurs de localisations ne sont visibles que dans le sens de la phase car entre deux échantillonnages de codage de phase il peut se passer quelques secondes au cours desquelles un mouvement a lieu. En revanche entre deux échantillonnages de codage de fréquence seules quelques millisecondes se passent, un mouvement d'amplitude significative durant ce laps de temps très court est donc peu probable.
Cette propriété est importante car elle permet de modifier les paramètres en fonction de la zone d'intérêt diagnostic de l'examen. Par exemple : Lorsque le rachis est étudié en coupes axiales, le codage de phase peut être paramétré en droite-gauche afin d'éviter que le ghosting du flux sanguin de l'aorte ne vienne se projeter dessus. Les techniques de présaturations permettent de saturer les spins mobiles et d'éviter leurs artefacts sur l'acquisition d'image statique (cf respiration abdominale ou passage de gros troncs vasculaires ou du LCR dans la région spinale surtout à partir de 1.5 Tesla)) dans la zone d'examen.
Artefacts de champ magnétique
Artefact de susceptibilité magnétique métallique
Artefact de susceptibilité magnétique
Artefact d'hétérogénéité globale du champ magnétique principal
Artefact de non linéarité d'un gradient de champ magnétique
Artefacts d'impulsions de radiofréquence
Les antennes émettrices, qui excitent les protons du tissu à imager, possèdent un profil d'excitation limité dans l'espace. Le signal reçu est donc inhomogène, et les zones les plus proches de l'antenne apparaîtront en hyper-signal.
Artefact d'impulsions de radiofréquence croisées
Artefact de croisement de coupe
Artefact d'interférences aux radiofréquences extérieures
Cet artefact est du aux interférences des radiofréquences émises par des appareils extérieurs : GSM, 3G, radio, etc.
Artefact d'hétérogénéité des impulsions de radiofréquence
Artefacts de reconstruction d'image
Ce sont les artefacts liés au problème de numérisation du signal (échantillonnage). Ainsi, si un pixel intersecte plusieurs objets, son niveau de gris sera une combinaison des niveaux de gris issus de chacun des objets traversés.
Artefact de déplacement chimique
Artefact de repliement
Afin de générer une image 2D, l'IRM impose une phase et une fréquence de résonance aux spins (voir plus haut) qui dépend de leur position. Nous savons que la phase est 2pi périodique, ainsi les zones de l'espace codées avec une phase de 2pi+phi et phi se chevaucheront.
Artefact de troncature (phénomène de Gibbs)
Il est lié à des interactions entre les protons et leur environnement, source d’apparition de faux contours.
Applications
Angio-IRM
L'angio-IRM ou ARM est utilisée pour visualiser les artères afin de mettre en évidence des anomalies telles que les sténoses, dissections, fistules, les anévrismes et artérite. Les artères cérébrales, cervicales, rénales, iliaques, pulmonaires et l'aorte sont les artères les mieux étudiées par cette technique.
L'angio-IRM fait appel aux séquences en échos de gradient ultrarapides avec injection de chélates de gadolinium en intra-veineuse19. D'autres séquences, comme l'angiographie par temps de vol (TOF-MRA)20 ou par contraste de phase (PC), permettent aussi de visualiser les fluides en mouvement sans injection de marqueur particulier.
IRM cardiaque
Cholangio-IRM
L'étude des voies biliaires et pancréatiques par l'IRM de manière non invasive est une nouvelle approche des bilans d'imagerie des pathologies hépato-pancréatico-biliaires.
IRM fonctionnelle (IRMf)
Une coupe d'une IRM fonctionnelle du cerveau.
Cliquer ici pour une animation allant du haut de la tête vers le bas.
La méthode la plus utilisée actuellement est celle basée sur l’aimantation de l’hémoglobine contenue dans les globules rouges du sang. L’hémoglobine se trouve sous deux formes :
- les globules rouges oxygénés par les poumons contiennent de l’oxyhémoglobine (molécule non active en RMN) ;
- les globules rouges désoxygénés par le métabolisme des tissus contiennent de la désoxyhémoglobine (active en RMN car fortement paramagnétique).
En suivant la perturbation du signal de RMN émis par cette molécule, il est donc possible d’observer l’afflux de sang oxygéné, qui chasse le sang désoxygéné. Lorsqu'une zone du cerveau augmente son activité, un afflux de sang oxygéné lui parvient grâce à un mécanisme combinant la dilatation des vaisseaux sanguins à divers autres mécanismes mal élucidés, ce qui répond ainsi à la demande de consommation locale en dioxygène des cellules actives : c'est le signal BOLD. En faisant l’acquisition d’images pondérées T2* à une cadence rapide (environ une image toutes les secondes, voire moins), il est possible de suivre en direct, sous forme de film, les modulations de débit sanguin liées à l’activité cérébrale, par exemple lors d'une tâche cognitive.
IRM paramétrique
Cette méthode consiste à mesurer par IRM des paramètres hémodynamiques ou de perméabilité des vaisseaux capillaires, dont les calculs dérivent d'un modèle mathématique appliqué aux données d'imagerie obtenues dans des conditions particulières. En général il s'agit de séquences dites dynamiques car avec une résolution temporelle élevée, permettant de suivre l'évolution de l'intensité de signal après injection d'un produit de contraste paramagnétique. Cette méthode permet de calculer le flux et le volume sanguin d'un tissu, et la perméabilité des capillaires (microvaisseaux) de ce tissu. Cette méthode semble très prometteuse en cancérologie pour déterminer quand une tumeur est cancéreuse, mais reste utilisée de façon très marginale compte tenu du haut niveau technique nécessaire. Actuellement[Quand ?], seules les universités américaines disposent de tels équipements.
Imagerie du tenseur de diffusion
L’imagerie du tenseur de diffusion (DTI) est une technique basée sur l'IRM qui permet de visualiser la position, l’orientation et l’anisotropie des faisceaux de matière blanche du cerveau.
Spectroscopie RMN
Il permet l'étude de la présence et concentration de certains métabolites. Son application est encore rare, il demande des IRM de haut-champ (1,5 Tesla minimum et 3 Tesla pour obtenir des pics bien différenciés) et des formations spécifiques pour les radiologues.
Cependant la technique semble très prometteuse notamment en oncologie, par exemple, il permet de faire la différence entre récidive locale et nécrose post-radiothérapique dans un stade précoce avec une précision que, seule, une biopsie (invasive et parfois risquée) peut égaler.
Un examen IRM anatomique dure en général de 15 à 30 minutes. Un ensemble complet d'examens prend souvent entre une demi-heure et une heure pleine. L'examen est absolument sans douleur. Le patient est allongé sur une table d'examen motorisée. Au cours de l'acquisition, il ne doit pas bouger : la table se déplace automatiquement pour le faire passer dans l'antenne. Les seules gênes à en attendre sont le bruit notable et la sensation d'enfermement (le corps étant dans un tube ouvert) pouvant poser quelques problèmes chez certains claustrophobes. En général, le ou les manipulateurs en électroradiologie médicale restent en contact constant avec le patient.
L'examen IRM se réalise sur un patient en pyjama ; il doit retirer montres, bijoux, ceinture, clés, cartes bancaires, à puce ou magnétique, pièces de monnaie, etc. c'est-à-dire tout élément métallique qui pourrait être attiré par l'aimant. Les accompagnants (parents s'il s'agit d'enfants) doivent également se séparer de ces accessoires pour pénétrer dans la salle de l'appareil d'imagerie.
Indications
IRM du genou, coupe sagittale en écho de gradient pondération T2; mise en perspective du ligament croisé postérieur.
L'imagerie par résonance magnétique a l'avantage d'apporter une bonne visualisation de la graisse, de l'eau, donc de l'œdème et de l'inflammation avec une bonne résolution et un bon contraste.
En particulier, l'IRM permet d'imager la fosse sous-tentorielle de l'encéphale, dont l'exploration est difficile en CT-scan à cause d’artefact de durcissement de faisceaux.
Cette imagerie n'est pas adaptée à l'étude des tissus pauvres en protons comme les tendons et le tissu osseux.
Les éléments anatomiques étudiés par l'IRM :
- le cerveau et la moelle épinière :
-
- diagnostic des maladies neurologiques inflammatoires (sclérose en plaques),
- la fosse postérieure du cerveau est particulièrement bien visible par l'IRM (ce qui n'est pas le cas par le scanner cérébral),
- le rachis : hernie discale et toutes les pathologies disco-somatiques, lésions traumatiques du rachis et de la moelle, la spondylodiscite infectieuse ;
- les viscères digestifs et pelviens ainsi que les muscles ;
- les articulations et les structures adjacentes (hanches, genoux, ménisques, ligaments croisés), notamment chez les sportifs ;
- les processus tumoraux, même osseux ;
- les gros vaisseaux comme l'aorte et ses branches (artères rénales, iliaques), les vaisseaux cérébraux et cervicaux sont étudiés pour le bilan de maladie athéromateuse, des dissections, sténoses (artérite oblitérante des membres inférieurs). L'artère pulmonaire peut être analysée par l'ARM dans le cadre de l'embolie pulmonaire ;
- les malformations artério-veineuses mais aussi les malformations cardiaques congénitales (tétralogie de Fallot, atrésie pulmonaire, transposition des gros vaisseaux) ;
- les arbres hépatobiliaire et pancréaticobiliaire sont étudiés dans certaines pathologies hépatiques (CBP) et pancréatiques (tumeur du pancréas, insuffisance pancréatique exocrine) (cholangio-IRM) ainsi que le système porte (en ARM).
Contre-indications
Les contre-indications21 au passage d'examen IRM sont :
- la présence de métaux susceptibles de se mobiliser dans le corps22 :
-
- clips vasculaires cérébraux surtout chez les patients opérés d'un anévrisme cérébral,
- corps étranger métallique ferromagnétique intra-oculaire ou dont la mobilisation exposerait le patient à des blessures (séquelle d'accident de chasse, accident de meulage…),
- valves cardiaques non compatibles, ce qui est le cas de la valve Starr-Edwards pré 6000. La plupart des valves cardiaques sont compatibles avec l'examen IRM,
- Les clips caves inférieurs, clips de trompe de Fallope ou stents coronaires nécessitent une précaution d'emploi. Les différentes prothèses (hanche, genou) ne sont pas des contre-indications,
- on respectera, malgré une compatibilité avérée, un délai après chirurgie. Celui-ci se situant généralement entre 3 et 6 semaines après la pose du matériel. Ce délai correspond au temps nécessaire pour que les différents tissus de l'organisme adhèrent au matériel et le « stabilisent »,
- en revanche, il n'y a pas de délai postchirurgical après ablation de matériel, mais attention aux agrafes chirurgicales ;
- les dispositifs biomédicaux :
-
- stimulateur cardiaque et défibrillateur cardiaque non compatibles dont le fonctionnement peut être altéré par le champ magnétique et conduire à des troubles du rythme cardiaque potentiellement mortels. Les modèles les plus récents sont compatibles avec l'IRM mais il faut s'assurer que l'ensemble « stimulateur cardiaque + sondes » le soit. Même dans ce cas, la présence de ce matériel génère de nombreux artéfacts gênant l'imagerie proche du dispositif ;
- pompe à insuline ;
- neurostimulateur ;
- dispositifs transdermiques (patchs)23. Certains de ces dispositifs possèdent un mince halo métallique de protection dans leurs couches superficielles qui peut être cause de brûlures. C'est le cas par exemple de Nitriderm TTS, Scopoderm TTS et Neupro qui contiennent de l'aluminium24 ;
- l'état du patient :
-
- impossibilité de rester allongé (insuffisance cardiaque ou respiratoire avec orthopnée) ;
- impossibilité de rester immobile (patient pusillanime, enfants, troubles psychiatriques). Les examens d'imagerie peuvent le cas échéant être réalisés sous prémédication, voire sous anesthésie générale. Il convient alors d'utiliser le seul matériel d'anesthésie homologué pour entrer dans la salle d'IRM ;
- la claustrophobie, qui peut faire l'objet des mesures citées précédemment ;
- l'allergie au gadolinium ou à son chélateur/ligandc ou encore à l'excipientd est rare. Cependant, le produit est très toxique en cas d'extravasation (nécrose des tissus). Il n'existe pas d'interaction connue avec d'autres médicaments ;
- insuffisance rénale (uniquement en cas d'injection de produit de contraste) ;
- la grossesse, en dehors d'indication formelle. Il n'a jamais été démontré d'effet délétère des champs magnétiques sur le fœtus. Mais, par précaution, seules les indications mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel de la mère sont validées. En cas d'injection de gadolinium : il y a un passage lent de la barrière placentaire (constaté uniquement sur spécimen murin) ;
- allaitement : en cas d'injection de gadolinium uniquement : excrétion faible dans le lait maternel (constaté uniquement sur spécimen murin), recommandation de traite et élimination du lait pendant 24 à 48 heures suivant l'injection.
Effets indésirables
Avec les précautions ci-dessus, l'imagerie par résonance magnétique est non invasive (excepté, s'il y a indication, l'injection de produit de contraste) et sans irradiation.
L'effet du haut champ magnétique et du champ oscillant reste discuté25. Chez les personnes travaillant en IRM (et donc exposés durablement), il est décrit un goût métallique dans la bouche, des vertiges26.
L'examen n'est pas contre-indiqué chez la femme enceinte mais des lésions de l'ADN de certaines cellules de patients soumis à une IRM cardiaque ont été décrits27 sans que les conséquences en soient claires.
Notes et références
Notes
- L'IRM a une meilleure résolution en contraste que le scanner et le scanner a une meilleure résolution spatiale que l'IRM, il faut donc considérer ces deux examens comme complémentaires.
- Le terme « nucléaire »(du latin : nucleus « noyau ») renvoie donc simplement au fait que cette technique repose sur les propriétés des noyaux atomiques mais n'a pas de lien avec les processus de fission nucléaire qui produisent les rayonnements ionisants dont les effets peuvent être dangereux sur la santé. Le nom complet de l'IRM devrait donc en réalité être « IRMN », « imagerie par résonance magnétique nucléaire » mais pour ne pas effrayer les patients qui associent souvent, et à tort, le mot « nucléaire » avec la radioactivité[réf. nécessaire], on omet souvent le terme « nucléaire » pour parler simplement d'IRM.
- Une réaction allergique au produit de contraste en IRM est dans la grande majorité des cas due à une intolérance du chélateur (molécule cage) et non au gadolinium. De plus, les différents fabricants de PdC utilisent des chélateurs différents, DTPA-Gd (Magnevist) ou DOTA-Gd (Dotarem) sont deux exemples. Ceci permet de renouveler un examen avec injection en utilisant une autre marque s'il y a eu réaction avec la première
- Le plus souvent, il s'agit de méglumine, la réaction d'allergie à cet excipient est extrêmement rare
Références
- « Scanner ou IRM, est-ce la même chose ? » [archive].
- « Les origines de l'IRM : la résonance magnétique nucléaire » [archive], un article CultureSciences-Chimie de l’École normale supérieure-DGESCO.
- (en) Timeline of MRI [archive].
- (en) MRI — a new way of seeing [archive], réédition de l'article original de Paul Lauterbur initialement paru dans le journal Nature en 1973.
- « IRM : les délais d'attente stagnent à 32 jours en France » [archive], .
- « Cartes. Quel délai d'attente pour passer une IRM près de chez vous ? » [archive], sur ouest-france.fr, Ouest-France, (consulté le )
- « Etude Cemka Eval 2017 » [archive], sur calameo.com (consulté le ).
- [PDF] Neurospin 24-nov-2006 [archive].
- « NeuroSpin - Un centre de RMN en champ intense » [archive du ], .
- [PDF]« Évaluation des IRM dédiées et à champs modéré < 1 T » [archive], Haute Autorité de santé, juin 2008.
- (en) Exemple de modèle d'IRM ouvert à 1.2t [archive].
- (en) PRWeb, CorTechs Labs and Hitachi Announce Support of Hitachi 1.2T, 1.5T and 3.0T MRI Scanners for NeuroQuant [archive], 25 juillet 2017.
- (en) Lisa Campi, What patients want to know about MRI machines. 1.2T, 1.5T, 3T - whats the difference? [archive], Shields Health Care Group Blog.
- (en) « Nature of MR signal » [archive], sur Questions and Answers in MRI (consulté le ).
- (en) D.I. Hoult, « The origins and present status of the radio wave controversy in NMR », Concepts in Magnetic Resonance Part A, vol. 34A, no 4, , p. 193–216 (ISSN 1546-6086 et 1552-5023, DOI 10.1002/cmr.a.20142, lire en ligne [archive], consulté le ).
- Denis Hoa Antennes en réseau phasé et imagerie parallèle [archive].
- Exemple d'image [archive]
- Exemple d'image [archive].
- « IRM hépatique » [archive], par Mauro Oddone, de l'hôpital Gaslini à Gênes en Italie.
- (en) Gao X, Uchiyama Y, Zhou X, Hara T, Asano T, Fujita H, « A fast and fully automatic method for cerebrovascular segmentation on time-of-flight (TOF) MRA image », J Digit Imaging, vol. 24, no 4, , p. 609-25. (PMID 20824304, PMCID PMC3138936, DOI 10.1007/s10278-010-9326-1) modifier
- Mousseaux E Les contre-indications à l'IRM STV 1999 ; 11(9) :694-698
- « http://www.med.univ-rennes1.fr/cerf/edicerf/BASES/BA004_idx.html »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • http://www.med.univ-rennes1.fr/cerf/edicerf/BASES/BA004_idx.html" rel="nofollow" class="external text">Google • Que faire ?) Cours sur l'IRM de l'université de Rennes 1 Section Effets des champs magnétiques sur les patients et les personnels.
- Rapport à l'AFSSAPS par la direction de l'évaluation des dispositifs médicauxPDD [archive] erreur modèle {{Lien archive}} : renseignez un paramètre «
|titre= ».
- revue prescrire no 281 mars 2007 Dispositifs transdermiques contenant de l'aluminium : risques de brûlures.
- (en) Effets sur la santé de champs statiques et de scanners IRM [archive] - résumé par GreenFacts d'un rapport de l'OMS de 2006.
- (en) Franco G, Perduri R, Murolo A, Health effects of occupational exposure to static magnetic fields used in magnetic resonance imaging: a review [archive], Med Lav, 2008;99:16-28.
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Bibliographie
- B. Kastler, D. Vetter, Z. Patay et P. Germain, Comprendre l'IRM Manuel d'auto-apprentissage, 6e édition, 2006. (ISBN 2-294-05110-6) (édition antérieure : 5eédition, 2003 (ISBN 2-294-01411-1))
- (en) Haacke, E Mark, Brown, Robert F, Thompson, Michael et Venkatesan, Ramesh, Magnetic resonance imaging : Physical principles and sequence design, New York, J. Wiley & Sons, (ISBN 0-471-35128-8)
- (en) Lee SC, Kim K, Kim J, Lee S, Han Yi J, Kim SW, Ha KS et Cheong C, « One micrometer resolution NMR microscopy », J. Magn. Reson., vol. 150, no 2, , p. 207–13 (PMID 11384182, DOI 10.1006/jmre.2001.2319, Bibcode 2001JMagR.150..207L)
- (en) P Mansfield, NMR Imaging in Biomedicine : Supplement 2 Advances in Magnetic Resonance, Elsevier, , 364 p. (ISBN 978-0-323-15406-2, lire en ligne [archive])
- (en) Eiichi Fukushima, NMR in Biomedicine : The Physical Basis, Springer Science & Business Media, , 180 p. (ISBN 978-0-88318-609-1, lire en ligne [archive])
- (en) Bernhard Blümich et Winfried Kuhn, Magnetic Resonance Microscopy : Methods and Applications in Materials Science, Agriculture and Biomedicine, Wiley, , 604 p. (ISBN 978-3-527-28403-0)
- (en) Peter Blümer, Spatially Resolved Magnetic Resonance: Methods, Materials, Medicine, Biology, Rheology, Geology, Ecology, Hardware, Wiley-VCH, (ISBN 9783527296378)
- (en) Zhi-Pei Liang et Paul C. Lauterbur, Principles of Magnetic Resonance Imaging : A Signal Processing Perspective, Wiley, , 416 p. (ISBN 978-0-7803-4723-6)
- (en) Franz Schmitt, Michael K. Stehling et Robert Turner, Echo-Planar Imaging : Theory, Technique and Application, Springer Berlin Heidelberg, , 662 p. (ISBN 978-3-540-63194-1)
- (en) Vadim Kuperman, Magnetic Resonance Imaging : Physical Principles and Applications, Academic Press, , 182 p. (ISBN 978-0-08-053570-8, lire en ligne [archive])
- (en) Bernhard Blümich, NMR Imaging of Materials, Clarendon Press, , 541 p. (ISBN 978-0-19-850683-6)
- (en) Jianming Jin, Electromagnetic Analysis and Design in Magnetic Resonance Imaging, CRC Press, , 282 p. (ISBN 978-0-8493-9693-9, lire en ligne [archive])
- (en) Imad Akil Farhat, P. S. Belton, Graham Alan Webb et Royal Society of Chemistry (Great Britain), Magnetic Resonance in Food Science : From Molecules to Man, Cambridge, Royal Society of Chemistry, , 227 p. (ISBN 978-0-85404-340-8, lire en ligne [archive])
Articles connexes
Radiographie
Pour les articles homonymes, voir Radio.
Radiographie pulmonaire numérisée.
La radiographie est une technique d'imagerie de transmission, par rayons X dans le cadre de la radiographie X, ou par rayons gamma en gammagraphie.
Les rayons X sont des ondes électromagnétiques de hautes fréquences de l'ordre de 1016 Hz à 1020 Hz et qui pénètrent la matière condensée (solides et liquides). Elle permet d'obtenir un cliché dont le contraste dépend à la fois de l'épaisseur et du coefficient d'atténuation des structures traversées.
Par extension, l'image obtenue et son support portent aussi le nom de « radiographie ». L'abréviation du terme radiographie est fréquemment employée, on parle alors de « radio » par apocope.
La radiographie est utilisée en radiologie médicale, en radiologie industrielle et en radiothérapie. La radiographie standard correspond à la radiographie d'une région d'intérêt dont la réalisation obéit à un protocole reconnu de manière internationale1,2.
La radiographie s'oppose à l'autoradiographie qui est une technique d'imagerie d'émission.
Les radiographies argentiques se lisent idéalement sur un négatoscope.
Histoire
-
-
Photographie de la première radiographie de l'histoire prise le sur la main d'Anna Bertha Röntgen, la femme du découvreur des rayons X.
-
Dispositif pour la radiographie (vers 1900)
-
Cabinet de radiographie vétérinaire du Laboratoire central vétérinaire de Dijon (ici le , avec un chien allongé sur le plateau).
-
Équipement de radiographie de terrain, dit « Bedside technique » [Seconde Guerre mondiale]
Les progrès scientifiques du XIXe siècle amenèrent tout d'abord à la découverte de sources lumineuses très intenses, comme la lumière oxhydrique ou celle émise par la combustion du magnésium3. Il devint alors possible pour la première fois de voir à travers le corps, grâce à la transmission de telles lumières. Le docteur Richarson s'en servit pour étudier les mouvements du cœur4, ce qui était désormais réalisable sans dissection, simplement en observant son ombre. Mais du fait des propriétés trop peu pénétrantes des rayonnements de la lumière visible, cette technique ne pouvait être effectuée que sur des sujets très jeunes4, avec une poitrine de faible épaisseur.
C'est surtout la découverte des rayons X, réalisée en 1895 par Wilhelm Röntgen5, qui marqua réellement le commencement de l'imagerie de transmission. Ce scientifique allemand, éminent professeur de physique, étudiait à l'époque les rayons cathodiques à l'aide d'un tube de Crookes. En même temps qu'il utilisait cet instrument, il s'aperçut que cela provoquait la fluorescence d'un écran de platino-cyanure de baryum, placé pourtant à deux mètres du tube. Il en conclut qu'un autre type de rayonnement, encore inconnu, provoquait ce phénomène. Il le baptisa de la lettre symbolisant l'inconnue en mathématique, le rayon X.
Afin d'étudier les propriétés de ce nouveau rayonnement, Röntgen plaça divers objets entre le tube et l'écran : du papier, du verre, du plomb, du platine. Il constata que les rayons X étaient extrêmement pénétrants, mais avaient la propriété d'interagir avec la matière, d'autant plus s'il s'agissait d'une matière très dense comme le plomb. Il remarqua également que les rayons X étaient capables d'impressionner des plaques photographiques, tout comme la lumière visible. Ainsi, il eut l'idée de réaliser la toute première radiographie de l'histoire, celle de la main de son épouse, Anna Bertha Röntgen.
À la publication de sa découverte, ce fut une révolution presque instantanée puisque les premiers services de radiologie ouvrirent au début de l'année 1896 ; en 1897 en France grâce à Antoine Béclère. Pour sa découverte, Röntgen reçut le tout premier prix Nobel de physique en 1901. Dans l'intérêt de la médecine, il ne déposa pas de brevet sur sa découverte. Au début du XXe siècle et jusque dans les années 1920, la radiographie se développa considérablement et pas uniquement en médecine. Elle devint une attraction que l'on proposait dans les foires, ou une façon de connaître sa pointure dans les magasins de chaussures. Quand on s'aperçut de la dangerosité des rayonnements ionisants à forte dose, elles furent fortement diminuées et l'exposition à ces radiations fut réservée aux patients pouvant en tirer un avantage diagnostique ou thérapeutique.
Depuis cette prise de conscience, les techniques et les appareils de radiographie n'ont cessé de se perfectionner, que ce soit au niveau du générateur de rayons X, des systèmes de détection, ou des instruments additionnels utilisés. Cette optimisation a pour but de diminuer au maximum la dose délivrée tout en gardant une qualité d'image radiographique permettant un diagnostic efficace.
Production des rayonnements
Pour la production des rayons X, un transformateur haute tension est nécessaire pour transformer la tension du fournisseur d'électricité de l'ordre de 100 V, en une tension électrique de l'ordre de 100 kV. De plus, la haute tension alternative est transformée en une haute tension continue à l'aide d'un pont de diodes.
Illustration de l'effet talon lors de la production des rayons X.
Les rayons X sont produits par un tube à rayons X. C'est un tube sous vide composé d'un filament chauffé alimenté par le courant continu de haute tension. L'intensité de ce courant (en mA) multipliée par le temps de pose (durée d'application du courant en s), sera directement lié au nombre de photons produits. En radiologie, ce paramètre correspond à la charge du tube en mAs. La haute tension est appliquée entre ce filament (cathode) et une cible (anode). Les électrons sont accélérés par cette tension et viennent bombarder l'anode. Celle-ci est composée d'un élément de fort numéro atomique afin de privilégier les interactions par rayonnement de freinage. Ces interactions électroniques produisent un spectre continu de rayons X dont l'énergie maximum correspond à l'énergie cinétique des électrons, donc à la tension appliquée. En médecine, on parle ainsi de kilovoltage (kV) pour qualifier le spectre en énergie des rayons X utilisés. Mais la plus grande part de l'énergie cinétique des électrons est convertie en chaleur au niveau du foyer thermique ce qui peut contribuer à le détériorer malgré le système de refroidissement. Pour cela, l'anode est souvent constituée d'un grand et d'un petit foyer. Le grand foyer a l'avantage de mieux dissiper la chaleur lors de clichés nécessitant beaucoup de mAs mais est à l'origine d'un plus grand flou géométrique au niveau de l'image. Tous ces paramètres sont réglables au niveau du pupitre de commande : kilovoltage, milliampères, temps de pose, taille du foyer. Un posemètre peut être placé en amont du détecteur de façon à asservir le temps de pose voire les milliampères. Il est réglé de façon que le détecteur reçoive la quantité optimale de photons, en prenant en compte les contraintes de radioprotection du patient.
Les rayons X sont produits au niveau du foyer de l'anode dans toutes les directions. Mais du fait de l'angle de l'anode, davantage de photons sont transmis selon une direction perpendiculaire au foyer thermique que selon les autres directions. Cela est du au fait que les photons produits dans la cible ont une plus grande distance à traverser pour en sortir s'ils sont émis dans des directions quasi parallèles au foyer thermique, ils sont alors plus atténués. Ce phénomène, appelé effet talon, conduit à une légère hétérogénéité du faisceau de rayons X. Le tube est blindé de façon à ne laisser sortir les rayons X qu'au niveau de la fenêtre de sortie, seule partie non blindée du tube. Néanmoins, les rayons X doivent traverser les parois du tube sous vide et le circuit de refroidissement de l'anode. Cette filtration inhérente modifie le spectre de rayons X car les photons de basse énergie sont davantage atténués. Un filtre additionnel, souvent en aluminium, est utilisé en radiologie pour davantage encore filtrer les rayons X de basse énergie qui exposeront inutilement le patient sans contribuer à l'image. Un diaphragme est utilisé pour donner une forme rectangulaire de taille réglable au faisceau de rayons X. Il est également possible de se servir d'un cône localisateur pour lui donner une forme circulaire. Un cas particulier est celui de l'Imagerie volumétrique par faisceau conique (ou Cône beam) qui grâce à une projection conique du rayonnement produit une image précise des tissus minéralisés (dents, cartilages, os) de la tête ou de petites parties du corps poignets, chevilles) ou de la dispersion d'un produit de contraste avec possibilité de constituer un modèle 3D de la partie du corps observée.
En radiothérapie, des radiographies appelées images portales sont effectuées à l'aide des accélérateurs linéaires d'électrons produisant des rayons X jusqu'à 25 MV.
Certaines radiographies industrielles de pièces métalliques d'épaisseur importante ne peuvent être réalisées qu'avec des photons de haute énergie, parfois de l'ordre du MeV. Les installations nécessaires à la production de rayons X de telles énergies sont encombrantes, les rayons gamma sont alors préférés. Les intervenants peuvent ainsi se déplacer en entreprise apportant avec eux un projecteur de source gamma pour réaliser des gammagraphies.
Formation de l'image radiographique
L'atténuation des photons lors d'une radiographie dépend des structures traversées. Les photons diffusés sont atténués par la grille antidiffusante avant d'atteindre le détecteur.
Les informations provenant des différentes structures traversées par le faisceau de rayonnements sont projetées sur un même plan pour former l'image. Par conséquent, il est souvent nécessaire de réaliser deux projections, à différentes incidences, pour pouvoir localiser une structure dans les trois dimensions de l'espace. Par exemple, en médecine, il s'agit fréquemment d'incidences de face et de profil. La loi d'atténuation des photons explique l'atténuation différentielle du faisceau à travers différentes structures, ce qui est à l'origine du contraste radiographique.
- I = I 0 ⋅ e − ∫ x 0 x m a x μ ( Z ( x ) , E ) d x

L'objet à radiographier, placé entre les positions x 0  et x m a x
et x m a x  , à distance de la source pour que l'on puisse considérer qu'il est soumis à faisceau homogène I 0
, à distance de la source pour que l'on puisse considérer qu'il est soumis à faisceau homogène I 0  de photons X ou gamma. Au fur et à mesure que le faisceau de photons traverse l'objet, il est atténué en fonction de l'épaisseur d x
de photons X ou gamma. Au fur et à mesure que le faisceau de photons traverse l'objet, il est atténué en fonction de l'épaisseur d x  traversée et du coefficient d'atténuation μ
traversée et du coefficient d'atténuation μ  . Ce coefficient d'atténuation dépend de l'énergie E
. Ce coefficient d'atténuation dépend de l'énergie E  du photon et du numéro atomique Z de la structure rencontrée à la profondeur x
du photon et du numéro atomique Z de la structure rencontrée à la profondeur x  . L'organisme humain possède des tissus comme les os, très opaques aux photons, possédant donc un coefficient d'atténuation très élevé. Cela vient du fait que le tissu osseux est composé d'éléments de numéro atomique élevé comme le calcium. Le corps est aussi composé de tissus mous, peu opaques aux rayons X. Parmi eux, on différencie les organes de densité hydrique car composés essentiellement d'eau (muscles, foie) des densités graisseuses dont le coefficient d'atténuation est légèrement plus faible. Enfin, le poumon étant essentiellement composé d'air, il est qualifié d'organe de densité aérique. En effet le tissu pulmonaire, comme l'air, laisse passer la quasi-totalité des rayonnements. À la sortie du patient, le faisceau de photons n'est plus homogène mais est caractéristique des tissus traversés, on parle d'image radiante I
. L'organisme humain possède des tissus comme les os, très opaques aux photons, possédant donc un coefficient d'atténuation très élevé. Cela vient du fait que le tissu osseux est composé d'éléments de numéro atomique élevé comme le calcium. Le corps est aussi composé de tissus mous, peu opaques aux rayons X. Parmi eux, on différencie les organes de densité hydrique car composés essentiellement d'eau (muscles, foie) des densités graisseuses dont le coefficient d'atténuation est légèrement plus faible. Enfin, le poumon étant essentiellement composé d'air, il est qualifié d'organe de densité aérique. En effet le tissu pulmonaire, comme l'air, laisse passer la quasi-totalité des rayonnements. À la sortie du patient, le faisceau de photons n'est plus homogène mais est caractéristique des tissus traversés, on parle d'image radiante I  . Ces photons interagissent avec le détecteur, y déposant une énergie représentative des tissus traversés. Selon le mode de fonctionnement du détecteur, cette énergie sera utilisée pour produire l'image. La forte différence de coefficient d'atténuation entre les os et les autres tissus, crée un fort contraste de l'image, ce qui fait des rayons X un excellent outil d'imagerie osseuse. Pour obtenir une image d'organes n'ayant pas une densité spécifique, il est possible d'apporter in situ un produit de contraste de forte densité. C'est le cas pour l'imagerie des vaisseaux (injection intraveineuse d'iode), pour l'imagerie du système digestif (ingestion ou injection de baryte, à base de baryum), pour l'imagerie des articulations, ou arthroscopie (injection intra-articulaire d'iode) ou encore par exemple pour l'imagerie du système de reproduction de la femme, ou hystéroscopie (injection d'iode).
. Ces photons interagissent avec le détecteur, y déposant une énergie représentative des tissus traversés. Selon le mode de fonctionnement du détecteur, cette énergie sera utilisée pour produire l'image. La forte différence de coefficient d'atténuation entre les os et les autres tissus, crée un fort contraste de l'image, ce qui fait des rayons X un excellent outil d'imagerie osseuse. Pour obtenir une image d'organes n'ayant pas une densité spécifique, il est possible d'apporter in situ un produit de contraste de forte densité. C'est le cas pour l'imagerie des vaisseaux (injection intraveineuse d'iode), pour l'imagerie du système digestif (ingestion ou injection de baryte, à base de baryum), pour l'imagerie des articulations, ou arthroscopie (injection intra-articulaire d'iode) ou encore par exemple pour l'imagerie du système de reproduction de la femme, ou hystéroscopie (injection d'iode).
L'atténuation des photons en radiologie médicale provient essentiellement de deux types d'interactions : l'effet photoélectrique et la diffusion Compton. Lors d'une radiographie, en l'absence de diffusion Compton, les photons sont soit transmis à travers le patient soit absorbés par effet photoélectrique, en fonction des tissus traversés. Sur un grand nombre de photons incidents, le contraste de l'image est alors idéal. En pratique, certains photons sont diffusés par effet Compton, ils changent donc de trajectoire et peuvent ainsi interagir sur une zone du détecteur pour laquelle ils ne sont pas représentatifs des tissus traversés. Les photons diffusés diminuent donc la qualité de l'image. Pour pallier cette détérioration de l'image radiante, on utilise dans certaines conditions une grille antidiffusante ou la technique air-gap (voir plus bas : Qualité de l'image).
Amplificateur de luminance principalement utilisé pour l'imagerie vasculaire dynamique.
Radiographie avec « soustraction » des tissus (combinaison linéaire de deux images à différents niveaux d'énergie, combinée selon un coefficient qui rend les tissus mous invisibles).
Idem, avec « soustraction » des os (combinaison linéaire de deux images à différents niveaux d'énergie, combinée selon un coefficient qui rend l'os invisible).
Systèmes de détection
Dans certains systèmes dits indirects, l'information relative à l'exposition du détecteur aux photons est contenue sous forme d'une image latente (virtuelle). Celui-ci doit subir une opération spécifique afin de transformer cette image latente en une image réelle. Des systèmes directs, plus modernes, permettent de transformer instantanément l'information reçue par le détecteur en image. Chaque détecteur est caractérisé par sa courbe sensitométrique, qui définit l'exposition du détecteur nécessaire à l'obtention d'un certain niveau de gris sur l'image.
Couple écran-film
La radiographie analogique utilise comme détecteur le couple écran-film. Le film photographique fut le premier détecteur à être utilisé en radiographie, dès la découverte des rayons X. Il est sensible à la lumière et aux rayons X dans une moindre mesure. Il contient une émulsion contenant des cristaux d'halogénure d'argent (souvent de bromure d'argent). Ces cristaux, soumis aux photons, se dissocient en ions par effet photolytique créant ainsi une image latente. C'est donc un système d'imagerie indirect.
- A g B r + p h o t o n → A g + + B r −

L'image latente est transformée en image réelle après plusieurs étapes se déroulant dans l'obscurité ou sous une lumière inactinique. La révélation est réalisée en plongeant le film dans une solution basique qui réduit les ions argent positifs en argent métallique. La fixation de l'image est obtenue en plongeant le film dans une solution acide permettant de stopper ces réactions de réduction. Après lavage et rinçage du film pour éliminer les différents réactifs, les zones du film les plus irradiées contiennent l'argent métallique et sont les plus opaques à la lumière. Les zones non-irradiées du film sont transparentes et apparaissent blanches si on le place sur un négatoscope. Avec l'arrivée des nouveaux détecteurs, cette habitude a été conservée. Ainsi, en radiographie, les images sont présentées de façon que les zones les plus exposées soient noires et les zones les moins exposées soient blanches.
Pour améliorer la sensibilité du film aux rayonnements très pénétrants que sont les rayons X ou gamma, il est couplé à des écrans renforçateurs, disposés de part et d'autre du film. Ils sont constitués de sels fluorescents qui convertissent les rayons X en photons lumineux. Le couple écran film est disposé à l'abri de la lumière, dans une cassette qui est placée derrière l'objet à radiographier. Le couple écran-film possède une courbe sensitométrique d'allure sigmoïde ce qui oblige à exposer ce détecteur à une quantité précise de photons (latitude d'exposition) pour obtenir un contraste satisfaisant.
Le couple-écran film, seul détecteur analogique, est resté longtemps une référence en radiographie du fait de son excellente résolution spatiale et de sa bonne sensibilité. Néanmoins, il est de moins en moins utilisé, au profit des systèmes de détection numériques qui permettent de délivrer des doses moins importantes au patient tout en conservant une qualité d'image suffisante à un diagnostic.
Écran radioluminescent à mémoire
La radiographie informatisée ou Computed Radiography (CR) utilise comme système de détection l'écran radioluminescent à mémoire (ERLM). Le film est alors remplacé dans la cassette par un ERLM, c'est-à-dire un écran au phosphore. L'image latente obtenue est alors activée par un balayage laser et numérisée à l'aide d'un scanner spécial.
Capteur plan
La radiographie numérique directe ou Direct Radiography (DR) utilise comme détecteur le capteur plan (diodes assurant la conversion directe lisible par circuit électronique), dernier cri de l'imagerie médicale directe. Dans ce dernier cas, l'image générée par les rayons X au niveau de la couche d'iodure de césium est transformée en signaux électriques par une matrice de photo-transistors (2 048 × 1 536 pixels pour une surface de détection de 40 × 30 cm) qui a l'avantage de ne présenter aucune distorsion géométrique (effet coussin) contrairement aux amplificateurs de luminance qui utilisent des lentilles / miroirs pour focaliser l'image sur le capteur. De plus, le faible poids et l'encombrement réduit de ces équipements de dernière génération permettent leur intégration dans le matériel de radiothérapie, autorisant entre autres le positionnement précis du patient sur la table de traitement grâce à un logiciel spécifique comparant les images obtenues en temps réel (pas de développement de film) avec des images de références prises lors de la planification du traitement.
Amplificateur de brillance
L'amplificateur de brillance est, en radiologie, utilisé dans divers domaines, tant en radiographie dite conventionnelle qu'en radiologie interventionnelle.
Souvent abrégé « ampli de brillance » et parfois nommé « tube intensificateur d'image », cet appareil permet en plus de réaliser des radiographies, de suivre en temps réel l'image radiologique et donc de visualiser un mouvement ; ce que ne peuvent pas faire les systèmes à couple écran-film ou à écran radioluminescent à mémoire.
Dans une salle de radiologie, l'ampli de brillance est généralement placé sous la table d'examen et en face du tube à rayons X.
Système EOS
Fondé sur des détecteurs à haute sensibilité, les chambres à fils, le système de radiographie biplane basse dose EOS utilise une faible dose de rayons X pour obtenir simultanément deux images orthogonales. Ces images peuvent ensuite servir à la reconstruction surfacique 3D de groupes osseux (colonne vertébrale, bassin et/ou membres inférieurs) à l'aide de logiciels spécialisés6.
Imagerie en champ sombre
Elle bénéficie de progrès récents fondés sur les interférences de rayons X observée grâce à des filtres en silicium et analysés par des modèles d'interférences pour déduire des données sur le contraste de phase qui révèle la qualité interne des matériaux (os, organes, tissus mous…) traversés par les rayons X, en fournissant des détails et nuances auparavant inaccessibles. Cette imagerie pourrait notamment améliorer la détection de l'ostéoporose et de certains cancers ou problèmes de calcification, et la mesure de leur gravité. La même méthode améliorera la détection des explosifs ou armes dans des bagages à main, comme des défauts ou corrosions de structures fonctionnelles (métallurgie, plasturgie…). Les chercheurs espèrent pouvoir rapidement adapter les équipements de radiographie existants dans les aéroports7.
Radiographie du
thorax de profil en inspiration sur film.
Qualité de l'image
Les principaux critères de qualité d'une image radiographique sont le contraste, le grain et la netteté8.
Le contraste de l'image radiante dépend du coefficient d'atténuation, l'épaisseur des structures rencontrées et de l'énergie des photons incidents. Les photons sont d'autant plus pénétrants qu'ils sont de forte énergie. Une augmentation du kilovoltage rend donc les photons plus pénétrants vis-à-vis de toutes les structures traversées, ce qui a pour effet de réduire le contraste9. Une augmentation du kilovoltage à mAs fixes augmente la dose reçue au patient et la quantité de photons reçue par le détecteur. Mais accompagnée d'une diminution des mAs, une augmentation du kilovoltage permet de réduire la dose au patient tout en conservant la même quantité de signal au niveau du détecteur. Seul le contraste est affecté par cette optimisation de radioprotection. Le contraste est aussi détérioré par la présence de rayonnement diffusé. Minimiser la proportion de rayonnement diffusé est possible en réduisant le volume diffusant (en limitant le champ irradié avec les diaphragmes ou en limitant l'épaisseur traversée par compression), en utilisant une grille antidiffusante ou avec la technique air-gap10. Le contraste final de l'image dépend également de la courbe sensitométrique du détecteur.
Le grain ou moutonnement ou bruit de l'image correspond à la non-uniformité de l'image lorsque le détecteur est directement irradié par un faisceau homogène de photons, il est alors possible d'observer des grains. Cela est lié à la fois au bruit quantique des photons arrivant au détecteur, à la distribution des éléments sensibles au sein du détecteur (cristaux de bromure d'argent pour les films) et à toute autre source de bruit de la chaîne de détection. Le bruit est souvent comparé à l'intensité du signal mesuré. Le rapport signal sur bruit est ainsi un indicateur de la qualité d'une image.
La netteté de l'image s'oppose au flou. On distingue plusieurs origines de flou : le flou du foyer (géométrique), le flou du détecteur et le flou cinétique11. Le fait que le foyer optique ne soit pas ponctuel crée dans l'image un flou géométrique, dépendant des distances entre le foyer, l'objet visualisé et le détecteur. Le flou du détecteur est lié à la résolution spatiale du détecteur. Enfin, le flou cinétique est dépendant des mouvements entre la source, l'objet et le détecteur pendant la réalisation de la radiographie. En médecine, ce flou est lié aux mouvements fortuits ou physiologiques du patient. Afin de réduire au minimum ce flou, il est possible de diminuer le temps de pose. Un certain flou dû au rayonnement diffusé peut aussi être observé sur l'image sur les zones de transition entre différentes structures10.
L'image radiographique, pour être interprétée, doit contenir des informations sur l'objet visualisé et les conditions dans lesquelles elle a été réalisé. Cela permet par exemple de pouvoir différencier la droite de la gauche sur l'image radiographique d'un objet symétrique. Avec l'arrivée de la radiologie numérique, l'image est devenue un fichier informatique, dans lequel toutes ces informations sont stockables. En médecine, la présence d'informations comme le nom du patient est une obligation médico-légale. Des normes ont donc été établies pour les systèmes d'information de radiologie (SIR) et les systèmes d'information hospitaliers (SIH). La plus utilisée est la norme DICOM qui est un modèle orienté objet pour le stockage et l'échange de données d'imagerie médicale.
Applications
En imagerie médicale ou vétérinaire, la radiographie est utilisée pour le diagnostic de diverses pathologies. Ce type d'examen peut également permettre de contrôler la bonne délivrance d'un traitement lors d'interventions invasives ou dans le cadre des traitements par radiothérapie. L'industrie fait également appel à cette technique pour contrôler la qualité des pièces produites, lors de contrôles non destructifs, en particulier des pièces de fonderie12. La radiographie possède un grand nombre d'autres applications, notamment l'imagerie radioscopique de sûreté dans le domaine de la sûreté aéroportuaire, dans les contrôles douaniers ou encore la radioscopie de sûreté dans l'analyse du contrôle de la correspondance. L'archéologie ou l'histoire de l'art utilise la radioscopie pour contrôler des œuvres d'art (différentes couches de peintures sur les toiles), ou l'intérieur d'un contenant sans avoir à l'ouvrir.
Exposition médicale
Résultats d’une étude sur les doses délivrées aux patients adultes lors des actes radiographiques. Cette enquête a été menée par l’IRSN et l’InVS, en France, entre 2008 et 2009, auprès de 50 services de radiologie d’établissements du secteur public13.
| Nom de l'acte radiographique |
Nombre moyen de clichés par acte |
Produit dose surface moyen par acte
(mGy.cm2) |
Dose efficace14 moyenne par acte
(mSv) |
| Radiographie du thorax |
1,2 |
280 |
0,05 |
| Radiographie de l'abdomen sans préparation |
1,4 |
4 517 |
1,115 |
| Radiographies du rachis lombaire |
2,7 |
11 221 |
2,0 |
| Radiographie du bassin |
1,2 |
4 048 |
0,75 |
| Radiographie de la hanche |
1,8 |
2 341 |
0,20 |
Ces résultats sont à comparer avec l'exposition moyenne de la population française qui est de 3,7 mSv par an, dont 2,4 mSv proviennent de l'exposition naturelle, 1,3 mSv provient des examens médicaux et environ 0,03 mSv est lié aux rejets des centrales et aux essais nucléaires16.
Recyclage des radiographies
Les radiographies devenues inutiles ou de personnes décédées faites par des procédés argentiques contiennent des sels d'argent toxiques (environ 10 kg d'argent par tonne d'images). Les radiographies numériques n'en contiennent pas ou en contiennent peu, mais peuvent également être recyclées. En France, les centres de radiologie, les pharmacies et les déchetteries doivent accepter de les récupérer pour les envoyer vers une filière spécialisée de retraitement (Rhône-Alpes argent, Recycl-M et certaines ONG, tel l'ordre souverain de Malte, en extraient l'argent). Une fois l'argent extrait, la matière plastique en est recyclée ou fait éventuellement l'objet d'une valorisation thermique17.
À partir des années 1950 en URSS, la censure contre les vinyles occidentaux conduit les stiliaguis (« zazous » soviétiques) à utiliser des radiographies pour enregistrer la musique occidentale (jazz, rock) à l'aide de phonographes18,19. Ces supports sont nommés « ribs » (côtes) ou « bones » (os)20.
Notes et références
- E. Montagne, F. Heitz, Imagerie médicale : Tome 1, Radiologie conventionnelle standard, Heures de France, 3e édition, 2009, (ISBN 978-2-853-85310-1).
- (en)Kenneth L. Bontrager, John P. Lampignano, Bontrager's Handbook of Radiographic Positioning and Techniques, Mosby/Elsevier, 2009, (ISBN 978-0-323-05630-4).
- Cosmos, revue encyclopédique hebdomadaire des progrès des sciences, volume 25, 1864 (livre numérique Google [archive]).
- (en)British Association for the Advancement of Science. Science anglaise, son bilan au mois d'août 1868 : réunion à Norwich de l'Association britannique pour l'avancement des sciences (Livre numérique Google [archive]).
- Nucleus : un voyage au cœur de la matière, Ray Mackintosh (Livre numérique Google [archive]).
- EOS : Tout le corps en 3D, journal du CNRS [archive].
- Bulletin ADIT [archive] (Ambassade de France au Danemark).
- Henri Nahum, Traité d'imagerie médicale, Tome 1, Flammarion, 2004 (ISBN 2-257-15580-7).
- Une augmentation du kilovoltage réduit le contraste dans la mesure où les photons sont suffisamment pénétrants pour qu'une part d'entre eux soit transmise à travers l'objet. Initialement, si les photons ne sont pas assez énergétiques, ils ne sont pas transmis à travers l'objet, le contraste est donc nul dans l'objet, l'image ne donne aucune information sur les structures traversées. Dans ces conditions, une augmentation du kilovoltage permet une transmission des photons, une création de l'image et donc une augmentation du contraste.
- J.-P. Dillenseger, E. Moerschel, Guide des technologies de l'imagerie médicale et de la radiothérapie, Éditions Masson, 2009 (ISBN 978-2-294-70431-4).
- Jean Dutreix, Biophysique des radiations et imagerie médicale, Éditions Masson, 1997 (ISBN 2-225-85490-4).
- « Nouvelles images de référence en radiographie numérique » [archive], sur MetalBlog,
- IRSN, Rapport DRPH/SER no 2010-12, Doses délivrées aux patients en scanographie et en radiologie conventionnelle, 52 p. (lire en ligne [archive]), p. 26
- Les facteurs de pondération tissulaire utilisés pour le calcul de la dose efficace sont issus de la publication 103 de la CIPR.
- Valeur calculée avec les testicules considérés en dehors du champ d'irradiation.
- Bilan de l'état radiologique de l'environnement français en 2009[PDF] [archive], IRSN, 2011.
- Futura-sciences, Questions-réponses ; Le recyclage des radiographies [archive], 12 octobre 2010.
- « Soviet Groove – la « décadanse » soviétique » [archive], sur http://www.lecourrierderussie.com/ [archive], Le Courrier de Russie, (consulté le ).
- Sophie Marchand, « Contre la censure : des vinyles sur radio » [archive], sur http://www.novaplanet.com/ [archive], Radio Nova, (consulté le ).
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Radiologie médicale
Radiographie montrant une fracture distale de l'avant bras.
Dr Macintyre's X-Ray Film (1896)
La radiologie dans le domaine médical, désigne l'ensemble des modalités diagnostiques et thérapeutiques utilisant les rayons X, ou plus généralement utilisant des rayonnements. Mais la radiologie, dans son sens plus commun, désigne la spécialité médicale exercée par un médecin radiologue en France, ou radiologiste au Canada. Un établissement de santé peut donc abriter un service de radiologie. En médecine, on parle de radiologie conventionnelle pour désigner les examens diagnostiques utilisant un tube à rayons X classique servant à réaliser des images bidimensionnelles, radiographiques ou fluoroscopiques. La radiologie conventionnelle comprend la radiologie standard qui concerne les examens radiographiques standards, dont la réalisation obéit à des protocoles reconnus de manière internationale1.
Les chirurgiens-dentistes et les vétérinaires peuvent également pratiquer la radiologie dans le cadre de leur exercice professionnel.
Spécialité médicale
La radiologie, en tant que spécialité médicale, concerne les domaines suivants : la radiologie conventionnelle, la mammographie, la tomodensitométrie (scanner X), la radiologie interventionnelle, l'imagerie par résonance magnétique et l'échographie2,3.
Radiologie conventionnelle
Il s'agit des examens radiologiques utilisant la technologie radio la plus « basique ». Un tube à rayon X et une plaque radiologique. Le résultat de cet examen est une radiographie (d'un membre, pulmonaire...).
Mammographie
La mammographie est une technique radiographique adaptée à l'imagerie des seins. Du fait de la particularité de cet examen, un équipement spécifique est utilisé. En effet, le sein possède un faible contraste aux rayons X et les structures recherchées sont parfois de très petite taille. Un système de compression du sein est utilisé afin d'améliorer le contraste de l'image. De plus, le générateur de rayons X utilisé est spécifique, il fonctionne à faible tension, avec une charge (mAs) relativement importante et un petit foyer optique. Cet examen diagnostique est particulièrement utilisé dans le cadre du dépistage du cancer du sein.
Tomodensitométrie
Radiologie interventionnelle
La radiologie interventionnelle désigne l'ensemble des actes médicaux réalisés par des radiologues et sous contrôle radiologique, permettant le traitement ou le diagnostic invasif de nombreuses pathologies. Le principe de la radiologie interventionnelle est donc d’accéder à une lésion située à l’intérieur de l’organisme pour effectuer un acte diagnostique (prélèvement par exemple) ou thérapeutique (visant à soigner, réparer, refermer...).
Imagerie par résonance magnétique
L'utilisation des champs magnétiques statiques et dynamiques (radiofréquences) permet aussi dans des conditions particulières d'exciter les atomes d'hydrogène et en retour de coder une image de leur répartition dans les tissus, permettant une étude des organes internes sans irradiation de l'organisme.
Échographie
Échographie Doppler d'une femme attendant des jumeaux par le
Dr Renaldo Faber à la clinique des femmes de l'université Karl Marx à Leipzig.
L'échographie consiste en l'utilisation des ultrasons pour étudier les organes internes sans risque d'irradiation contrairement à la radiologie. Ces ultrasons produits par un cristal piézo-électrique au niveau de la sonde, pénètrent à travers les organes « mous » et donnent lieu en retour à des échos, enregistrés par la même sonde et analysés par l'appareil pour former une image, en tenant compte des variations de vitesse sur leur parcours en fonction de la densité des tissus traversés, mais ils sont arrêtés par l'os et diffractés par l'air ce, qui limite les possibilités d'étude aux organes « pleins ». L'échographie est donc particulièrement intéressante chez la femme enceinte et chez l'enfant ou l'adulte jeune pour éviter le recours aux rayonnements ionisants. Mais le perfectionnement du traitement du signal (Doppler, couleur, perfusion, élastométrie...) en étend tous les jours, les indications, d'autant que l'appareil est léger et mobile.
Médecin spécialiste en radiologie
Rôle du radiologue
En France, l'échographie est le seul type d'examen réalisé (acquisition de l'image) uniquement par le médecin (radiologue ou autre spécialiste après une formation adaptée). Les autres examens d'imagerie sont effectués pour ce qui concerne l'acquisition de l'image, par le manipulateur en radiologie, placé sous la responsabilité du médecin radiologue, ou bien par le chirurgien-dentiste, habilité à réaliser et à analyser des radiographies dentaires, rhumatologue ou cardiologue..., ayant bénéficié d'une formation spécifique pour la technique (radiologie interventionnelle) et comme le radiologue d'une formation pour la « radioprotection du patient » renouvelable tous les dix ans. Les fonctions principales du radiologue sont d'adapter les modalités d'examens à l'indication en fonction des renseignements donnés par le médecin prescripteur, de réaliser ou faire réaliser l'acquisition des images avec l'aide du manipulateur, de réaliser l'interprétation des images, de dicter un compte-rendu qui répond à la question posée par le clinicien et de recevoir le patient pour lui donner le résultat de sa réflexion sur le problème soulevé. Dans certains cas, s'il estime que l'examen n'est pas justifié ou qu'un autre examen avec un rapport bénéfice / risque est mieux adapté, le radiologue peut refuser sa réalisation. Cela est d'autant plus vrai pour les examens exposant aux rayons X, en vertu des principes de radioprotection. Le rôle du manipulateur, en dehors de l'acquisition de l'image comporte l'accueil, l'information, l'installation et la surveillance du patient au cours de l'examen et ensuite la gestion des images à l'aide de consoles de reconstruction et d'archivage. Mais c'est le médecin qui reste responsable de la réalisation de l'examen et de son exploitation.
D'après les données de santé disponibles, en France les médecins radiologues sont ceux qui « effectuent presque exclusivement des actes de radiologie (91 %), suivis des ophtalmologues (4 %). Parmi les autres professions de santé, les chirurgiens-dentistes pratiquent également beaucoup d’actes de radiologie (24 503 millers d’actes). Cette activité atteint 37 % de l’activité des radiologues »4.
Formation du radiologue
En France
Le radiologue est un docteur en médecine titulaire du diplôme d'études spécialisées en radiodiagnostic et imagerie médicale (DESRIM). Ce DES est accessible par les épreuves classantes nationales en fin de sixième année des études de médecine et dure cinq ans, soit un total de onze années d'études pour devenir médecin spécialiste en radiologie. Il peut être secondé dans sa tâche par des manipulateurs en électroradiologie médicale.
D'autres médecins peuvent exercer la radiologie dans la limite de leur spécialité, notamment les oto-rhino-laryngologistes, les rhumatologues, les chirurgiens-maxillo-faciaux, les chirurgiens oraux, etc.
Le chirurgien-dentiste pratique également la radiologie en cabinet dentaire, limitée à la sphère orofaciale. Six à neuf années d'études en odontologie sont nécessaires, suivant la spécialité, pour décrocher le doctorat en chirurgie dentaire et pouvoir exercer la profession de chirurgien-dentiste.
Le vétérinaire utilise la radiologie en cabinet sur les différentes espèces qu'il peut soigner. Sept à dix années d'études vétérinaires sont nécessaires, suivant la spécialité, pour décrocher le doctorat vétérinaire.
Au Québec
Le radiologue (ou radiologiste, terme également accepté), est un docteur en médecine titulaire d’un diplôme d’études spécialisées post-doctorales en radiologie diagnostique. Il s’agit d’une formation de cinq ans, faisant suite donc aux cinq années de médecine requises préalablement. À noter qu’au Québec, avant l’entrée à l’université, l’étudiant doit avoir acquis un diplôme d’études collégiales en sciences de la nature, d’une durée de deux ans5.
Autres domaines de la radiologie médicale
Radiologie dentaire
Appareil de radiographie dentaire dans un hôpital au Bénin
Orthopantogramme, aussi nommé panoramique dentaire
La radiologie est quotidiennement pratiquée en cabinet dentaire par le chirurgien-dentiste à des fins d'analyse diagnostique ou d'examens complémentaires en odontologie6.
Les appareils de radiographie dentaire admis en cabinet dentaire sous la responsabilité du chirurgien-dentiste sont les suivants :
- les appareils de radiographie endobuccale, appareils de radiographie panoramique avec ou sans dispositif de tomographie volumique à faisceau conique ;
-
-
La radiographie périapicale
les appareils de téléradiographie crânienne ;
- les appareils de tomographie volumique à faisceau conique (Cone beam computed tomography CBCT) (à l’exclusion des scanners) ;
- les appareils mobiles/transportables et portatifs de radiologie dentaire6.
Le type de cliché radiographique dentaire dépend de l'indication. On distingue :
Le cliché radiographique est réalisé par le chirurgien-dentiste à l'aide d'un film argentique ou d'un capteur numérique intra-buccal ou extra-buccal suivant la nature de l'examen7.
Utilisation médico-légale
Radiographie et première mondiale d'une échographie d'un orque au Marineland d'Antibes.
La médecine médico-légale peut aussi recourir aux techniques radiologiques. La radiographie et la tomodensitométrie sont par exemple utilisées pour vérifier la mort cérébrale de patients8 ou encore pour identifier des cadavres9.
Radiologie vétérinaire
Les examens de radiologie sont utilisés par les vétérinaires qui possèdent leur propre matériel de radiographie dans les petits cabinets. Les zoos possèdent même des scanners X et de appareils d'imagerie par résonance magnétique adaptés aux animaux de grande taille. Les appareils hospitaliers de tomodensitométrie et d'IRM étant généralement adaptés à des patients de moins de 150 kilogrammes, les personnes souffrant d'obésité sont parfois invitées à aller passer leur examen dans des zoos10.
Figures célèbres de la radiologie
- Wilhelm Röntgen, physicien allemand, découvre en 1895 les rayons X. Pour étudier leur transmission à travers l'organisme, Röntgen réalise le premier cliché radiographique de l'histoire le 11.
- Otto Walkhoff, dentiste allemand, réalise la première application médicale de la radiologie en accomplissant une radiographie dentaire, en 11.
- Antoine Béclère, jeune médecin lors de la découverte des rayons X, comprend rapidement l'intérêt que peut en tirer la médecine. Dès 1897, il installe à ses propres frais un appareil de radioscopie à l'hôpital de Tenon alors que ce dernier n'est pas encore relié à l'électricité. Il est le premier président de la Société française de radiologie. Il participe à l'intégration de la radiologie dans le service de santé des armées à partir de 191412.
- Georges Haret, médecin radiologue, pionnier dans l'utilisation médicale de la radiographie en France. Il a reçu la Légion d'honneur pour ses travaux.
- Marie Curie, physicienne française, lauréate avec son mari d'un prix Nobel de physique en 1903 pour leur étude des radiations et lauréate du prix Nobel de chimie en 1911. Lors de la Première Guerre mondiale, elle participe à la conception d'appareils de radiographie mobiles destinés à être utilisés le plus près possible des zones de combat13. Elle part elle-même sur le front pour réaliser des radiographies des soldats blessés, indispensables aux chirurgiens pour localiser les balles et éclats d'obus.
- Joseph Brau, médecin radiologue de l'armée française, résistant durant l'occupation, déporté en camp de concentration.
- Guy Tavernier, physicien belge qui découvrit en 1948 l'évolution réelle de la courbe de la dose d'irradiation dans un organisme caractérisée par la Crête de Tavernier.
- Godfrey Hounsfield et Allan MacLeod Cormack, inventeurs dans les années 1970 du premier scanner. Ils ont reçu le prix Nobel de médecine en 1979 pour leurs travaux.
- Georges Charpak, physicien français, inventeur de la chambre à fils qui lui a valu le prix Nobel de physique en 1992. Ses travaux sur les détecteurs ont donné lieu notamment à un système d'imagerie 3D à basse dose appelé EOS.
- Charles Vaillant
- Georges Chicotot
Notes et références
- E. Montagne, F. Heitz, "Imagerie médicale : Tome 1, Radiologie conventionnelle standard", Heures de France, 3e édition, 2009, (ISBN 978-2-853-85310-1)
- Les examens en pratique [archive] - Site de la Société française de radiologie.
- Les examens effectués en radiologie médicale [archive] - Site de l'Association des radiologistes du Québec.
- (tableau statistique de la base Ecosanté [archive] et présentation IRDES [archive])
- « Facultés de médecine » [archive], sur Collège des médecins du Québec (consulté le )
- http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/chirurgiens-dentistes/securisez-votre-exercice/materiel-et-materiaux/radiologie-dentaire-et-radioprotection/2-declaration-et-utilisation-des-installations-de-radiologie-dentaire.html [archive]
- http://amdg.ch/examens-diagnostiques-2/examens-radiographiques/ [archive]
- Décret no 96-1041 du 2 décembre 1996 relatif au constat de la mort préalable au prélèvement d'organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) pour identifier des cadavres.
- Identification médico-légale : détermination du sexe et de l'âge par étude tomodensitométrique de la paroi thoracique antérieure [archive] - Présentation aux Journées Françaises de Radiologie 2007
- Jasper Copping Obèses, faites-vous scanner au zoo [archive], Courrier international / The Sunday Times, .
- http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhad/iahd_08f.htm [archive]
- J.- J. Ferrandis et A. Ségal, « L’essor de la radiologie osseuse pendant la guerre de 1914-1918 », Rhumatologie Pratique, octobre 2009 (journées d’histoire des maladies des os et des articulations) (lire en ligne [archive]).
Voir aussi
Article connexe
Échographie
Échographie d'un fœtus de neuf semaines.
L'échographie est une technique d'imagerie employant des ultrasons. Elle est utilisée de manière courante en médecine humaine et vétérinaire, mais peut aussi être employée en recherche et dans l'industrie.
Terminologie
Le mot « échographie » provient de la nymphe Écho dans la mythologie grecque qui personnifiait ce phénomène et d'une racine grecque Graphô (écrire). Il se définit donc comme étant « un écrit par l'écho ». Le terme « échographie » désigne aussi bien l'acte médical que l'image qui en découle, abrégé au féminin en « une écho ».
L'appareil permettant l'échographie est un « échographe ». Les appareils modernes comportent tous une fonction Doppler. C'est pourquoi on parle d'« échographie Doppler » (abrégée en « écho-doppler »).
Le médecin, le manipulateur en électroradiologie médicale, ou la sage femme qui pratique une échographie est un « échographiste ».
Histoire
L'échographie moderne est le fruit de plus de 200 ans de recherche scientifique multidisciplinaire, associant physiciens, mathématiciens, biologistes, médecins, électroniciens et informaticiens. En effet, en 1828, Jean-Daniel Colladon, un physicien suisse, parvient à déterminer la vitesse de propagation du son dans l’eau. Cette découverte est essentielle dans le développement de plusieurs outils reposant sur l’émission et la réception d’ondes sonores. En 1838, un chercheur de l’université de Virginie aux États-Unis, tente de cartographier les fonds marins grâce à un outil basé sur cette méthode. Sa tentative est un échec, mais son idée inspire les inventeurs du sonar pendant l’entre-deux-guerres, qui disposent alors de moyens technologiques plus avancés1.
Le sonar (acronyme issu de l’anglais « sound navigation and ranging ») est une technique développée pour détecter et localiser les objets sous l’eau. Un sonar émet une impulsion sonore et reçoit l’écho qui est produit lorsque cette impulsion rencontre un objet. Le temps écoulé entre l'émission de l’impulsion sonore et la réception de l'écho est mesurée, et, connaissant la vitesse de propagation du son dans l’eau, il est possible de déterminer la distance entre l’émetteur et l’objet. L’échographie moderne repose sur les mêmes principes physiques que le sonar.
Les recherches sur un tel système sont catalysés, notamment par le naufrage du Titanic, la nécessité de cartographier les fonds marins pour le déploiement des lignes télégraphiques et par la volonté de détecter les sous-marins ennemis lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Les industriels jouent également un rôle important dans l’amélioration de la précision des dispositifs. En effet, les industriels s’intéressent à cette technologie pour détecter les défauts de fabrication dans les carrosseries de voitures et les coques de bateaux. Leurs recherches permettent d’augmenter la fréquence d’émission des impulsions sonores et de mesurer le temps plus précisément entre l’émission de l’onde et la réception de l’écho1.
Les premières expérimentations dans le domaine médical datent de la fin des années 1930, lorsque Karl Dussik, neurologue, et son frère Friedrich Dussik, physicien, essayent d’utiliser les ultrasons pour diagnostiquer des tumeurs cérébrales, mais sans succès. Concernant l’utilisation de l’échographie dans le domaine médical, les avancées majeures ont lieu dans les années 1950. Le britannique John Wild s’intéresse à l’utilisation des ultrasons pour détecter des tumeurs et des calculs, et publie la première image échographique en deux dimensions en 1952. À Denver, Douglas Howry développe un système, le Pan scanner, qui nécessite une immersion de la zone étudiée. Pendant ce temps, à l’université de Glasgow en Écosse, l’obstétricien Ian Donald modifie un échographe industriel conçu pour détecter les défauts dans les coques de bateaux. En 1958, il publie un article fondateur dans le domaine de l’échographie médicale en gynécologie, contenant les premières images échographiques d’un foetus en deux dimensions. Depuis les avancées majeures des années 1950, l’utilisation de l’échographie dans le domaine médical s’est développée considérablement, notamment grâce aux avancées technologiques qui ont permis de réduire la taille et le coût des échographes tout en améliorant leur précision1.
Le matériel
Photographie d'un échographe. Légende : 1. Les sondes, 2. Système de visualisation, 3. Gel pour échographie, 4. Console de commande, 5. Console d'acquisition, 6. Imprimante
L'échographe est constitué des éléments suivants :
- une sonde, permettant l'émission et la réception d'ultrasons ;
- un système informatique, transformant le délai entre l'émission et la réception de l'ultrason en image ;
- une console de commande, permettant la saisie des données du patient et les différents réglages ;
- un système de visualisation : le moniteur ;
- un système d'enregistrement des données, soit de manière analogique (cassette vidéo, impression papier), soit de manière numérique (format DICOM).
Le tout est disposé sur un chariot mobile, permettant d'effectuer l'examen au chevet même du patient.
Les besoins sont différents suivant l'organe étudié. Le plus exigeant est le cœur, mobile par essence, qui exige une bonne définition de l'image spatiale mais aussi temporelle. On retrouve donc une nouvelle génération d’échographes spécialisés sur l’analyse multidimensionnelle et dynamique du cœur et de son fonctionnement (échocardiographe).
La sonde
Les premières études sur les ultrasons n'étaient pas appliquées à la médecine, mais visaient à permettre la détection des sous-marins à l'occasion de la Première Guerre mondiale. En 1951, deux britanniques, J.J. Wild (médecin) et J. Reid (électronicien), présentèrent à la communauté médicale un nouvel appareil : l'échographe. Il était destiné à la recherche des tumeurs cérébrales mais fera carrière dans l'obstétrique. L'usage en obstétrique date du début des années 1970 avec les appareils permettant de mesurer le périmètre cranien et de capter les bruits du cœur fœtal (voir Effet Doppler).
L'élément de base de l'échographie est généralement une céramique piézoélectrique (PZT), située dans la sonde, qui, soumise à des impulsions électriques, vibre générant des ultrasons. Les échos sont captés par cette même céramique, qui joue alors le rôle de récepteur : on parle alors de transducteur ultrasonore. Un échographe est muni d'une sonde échographique, nommée barrette échographique, pourvue à l'origine de 64, 96 voire 128 transducteurs ultrasonores en ligne. Les sondes des échographes modernes possèdent aujourd'hui jusqu'à 960 éléments. En échographie cardiaque le nombre d'éléments est amené à 3 000 éléments. L'émission se fait de manière successive sur chaque transducteur.
Les ultrasons sont envoyés dans un périmètre délimité (souvent trapézoïdal), et les échos enregistrés sont des signatures des obstacles qu'ils ont rencontrés. L'échogénicité est la plus ou moins grande aptitude d'un tissu à rétrodiffuser les ultrasons.
La fréquence des ultrasons peut être modulée : augmenter la fréquence permet d'avoir un signal plus précis (et donc une image plus fine) mais l'ultrason est alors rapidement amorti dans l'organisme examiné et ne permet plus d'examiner les structures profondes. En pratique l'échographiste a, à sa disposition, plusieurs sondes avec des fréquences différentes :
- 1,5 à 4,5 MHz en usage courant pour le secteur profond (abdomen et pelvis), avec une définition de l'ordre de quelques millimètres ;
- 5 MHz pour les structures intermédiaires (cœur d'enfant par exemple), avec une résolution inférieure au millimètre ;
- 7 MHz pour l'exploration des petites structures assez proches de la peau (artères ou veines) avec une résolution proche du dixième de millimètre ;
- de 10 à 18 MHz plus par exemple pour l'étude, en recherche, de petits animaux, mais aussi, dans le domaine médical, pour l'imagerie superficielle (visant les structures proches de la peau) ;
- jusqu'à 50 MHz pour les appareils de biomicroscopie de l’œil[réf. souhaitée].
Cette résolution dépend aussi de la forme de la structure examinée : elle est bien meilleure si elle est perpendiculaire au faisceau d'ultrasons que si elle est parallèle à ce dernier.
La fréquence de réception des signaux joue également sur la qualité de l'image : en mode fondamental le transducteur détecte les signaux de la même fréquence que celle de l'émission. En mode harmonique, il détecte les signaux d'une fréquence double (seconde harmonique) de celle de l'émission. L'avantage de ce dernier système est qu'il ne détecte essentiellement que les échos revenant dans le même sens que l'émission, écartant de fait les échos diffusés et rendant le signal beaucoup moins bruité. La détection non linéaire a une réponse particulière, elle ne réagit pas aux premiers centimètres après la sonde, ce qui permet de faciliter l'imagerie chez un patient en surpoids (dont la couche de graisse sous la peau complique le passage des ultrasons).
Le gel
Pour des raisons mécaniques, on considère que le contact entre la sonde et le ventre ne peut pas être parfait et qu'il existe donc une fine couche d'air entre ceux-ci.
Les impédances acoustiques de l'air et de la peau (tissu biologique), mesurées en Pa⋅s/m, valent respectivement :
- (à 20 °C) Z a = ρ a ⋅ c a = 1 , 204 × 343 , 4 = 413 , 5

- (à 37 °C) Z p = ρ p ⋅ c p = 1047 × 1570 = 164 , 4 ⋅ 10 4

Elles permettent de calculer la valeur du coefficient de transmission T de l'interface air-peau :
- T = 4 ⋅ Z a ⋅ Z p ( Z a + Z p ) 2 ≃ 10 − 3

Cette valeur est très faible et engendre donc une atténuation du signal importante entre l'émission et la réception des ultrasons par la sonde. C'est pour remédier à ce problème que l'échographiste applique un gel, dont l'impédance acoustique est proche de celle de la peau, pour obtenir une atténuation plus faible.
Le traitement du signal
Photographie d'un simulateur d'échographie fœtale.
L'électronique de l'échographe se charge d'amplifier et de traiter ces signaux afin de les convertir en signal vidéo. L'image se fait en niveaux de gris selon l'intensité de l'écho en retour.
Les différents tissus de l'organisme peuvent apparaître de diverses façons :
- les liquides simples, dans lesquels il n'y a pas de particules en suspension laissent les sons les traverser. Sans écho (structures anéchogènes), ils apparaissent noirs sur l'écran ;
- les liquides avec particules tels que le sang, le mucus, renvoient de petits échos. Ils apparaîtront donc dans les tons de gris, plus ou moins homogènes ;
- les structures solides, l'os par exemple, renvoient mieux les échos. On verra donc une forme blanche (hyperéchogène) avec une ombre derrière (cône d'ombre). Une exception cependant : sur la voûte crânienne du nouveau né la fontanelle très fine et perpendiculaire aux échos, en laisse passer et constitue même une véritable "fenêtre" d'observation du cerveau sous-jacent (jusqu’à ce que les os fusionnent vers l'âge de 2 ans). En 2017 une équipe francosuisse a montré qu’une petite sonde ultrasonique de 40 grammes et de la taille d’un domino, positionnée sur les fontanelles de six bébés en bonne santé via une monture en silicone souple et capable d’enregistrement vidéo EEG et d’imagerie ultrasonore en continu a été environ 50 fois plus sensibles à la mesure du débit sanguin que les ultrasons classiques, permettant un suivi non invasif d'une partie du système microvasculaire cérébral du nouveau-né2.
Ce nouvel outil d’échographie fonctionnelle, à la manière d’une machine EEG distingue les deux phases du sommeil du bébé. Combiné à l'EEG, cette sonde a détecté des convulsions chez deux nourrissons dont le cortex s'était anormalement développé, montrant même l’emplacement du cerveau d’où les crises sont parties (en suivant les vagues d'augmentation du flux sanguin qui se produisent alors)2. Cette sonde ne peut actuellement que surveiller que la zone située sous la fontanelle, mais elle bénéficie d’une haute résolution spatiotemporelle (200 µm pour l’échographie et 1 ms pour EEG). Et si les progrès de la technique continuent à progresser de la sorte, elle pourrait être bientôt capable de détecter une activité cérébrale anormale ; par exemple en cas de septicémie précoce, d’infection de la circulation sanguine (cause de lésion cérébrale)2. Cette technique intéresse aussi la surveillance d’essais cliniques chez le bébé ou les neuroscientifiques (par exemple pour l’étude de l'autisme3 du saturnisme infantile... Parce que l’Imagerie par résonance magnétique n’était pas adaptée aux bébés et notamment en cas d'urgence médicale, cette technique pourrait permettre de mieux comprendre le développement du cerveau aux premiers âges de la vie 3.
- les tissus mous sont plus ou moins échogènes : le placenta est plus blanc que l'utérus, qui est plus blanc que les ovaires ;
- le gaz et l'air, sont comme l'os, très blancs.
Les différents réglages
- La puissance d'émission est réglable mais ne joue que peu dans la qualité de l'image. Il faut théoriquement utiliser la puissance minimale acceptable afin d'éviter un échauffement des tissus examinés. En pratique courante ce risque est négligeable.
- La fréquence d'émission peut être modifiée dans les limites des spécifications de la sonde.
- Le gain à la réception peut être augmenté ou diminué globalement ou de manière variable, suivant la profondeur de la zone explorée (TGC pour time gain compensation).
- Différents filtres peuvent être réglés : compression…
- L'imagerie peut être basculée de mode fondamental en mode de seconde harmonique (abrégé en mode harmonique) permettant d'avoir une meilleure définition.
- Le faisceau d'ultrasons peut être focalisé (lentille acoustique par retard d'émission réglé électroniquement) à une plus ou moins grande profondeur (ne joue que peu sur la qualité de l'image).
- La zone d'intérêt de l'organe explorée peut être élargie, ou au contraire, rétrécie. Dans ce dernier cas, l'image a une meilleure définition.
- La cadence d'acquisition (en anglais : frame rate) peut être réglée. Ce paramètre est peu important en cas d'organes fixes mais doit être sensiblement augmentée pour étudier la mobilité d'une structure (cœur).
La console de commande est munie d'un clavier permettant d'entrer les identifiants du patient et les commentaires. Elle permet d'accéder aux différents modes d'échographie et de doppler, ainsi qu'au traitement et au stockage des images. Elle permet également d'effectuer des mesures (distance, surface…) et différents calculs.
Visualisation des images
Négatoscope pour visualiser les clichés dans hôpital au Bénin
Elle se fait par l'intermédiaire d'un écran.
Différents modes sont disponibles :
- le plus courant est le mode BD (pour « bidimensionnel ») : il s'agit d'une représentation en coupe de l'organe étudié, le plan de celui-ci étant déterminé par la position que donne l'examinateur à la sonde ;
- le mode TM (pour time motion en anglais, en français « temps-mouvement ») représente l'évolution d'une ligne de tir (ordonnée) suivant le temps (abscisse). Ce mode permet d'évaluer précisément les structures mobiles (ventricule gauche pour le cœur, par exemple) et d'en évaluer la taille. Cette dernière dépend cependant étroitement du choix de la ligne de tir et reste donc très examinateur-dépendant.
À ces images en niveau de gris, peuvent être associées des données du doppler en couleur. Parfois les échelles de couleurs peuvent être modifiées (apparence bleutée, ou autre) des nuances de gris pour une meilleure visualisation par l’opérateur.
Stockage et distribution des images
Théoriquement, les données à stocker correspondent au film de la durée de l'examen (de quelques minutes à plus d'une demi-heure) ce qui pose encore problèmes quant à l'importance de la mémoire nécessaire. En pratique ne sont conservées que des images fixes ou de courtes boucles d'images. Le format est souvent propriétaire (avec un outil de conversion DICOM) ou fait de manière native en DICOM. Ce format, largement utilisé dans le domaine de l'imagerie médicale, permet de conserver dans un même document l'identifiant du patient, l'image et les caractéristiques de l'acquisition de cette dernière. Sur certains échographes, il est possible de sauvegarder les images au format JPEG une perte de qualité imperceptible.
De manière simple, l'image sélectionnée est imprimée et jointe au compte rendu. Elle n'a dans ce cas qu'un rôle d'illustration, la qualité de la reproduction ne permettant en aucun cas de réévaluer, par exemple, un diagnostic.
L'image peut être également stockée de manière analogique sur une cassette vidéo, entraînant une dégradation sensible de la définition, mais permettant de conserver suffisamment d'informations pour pouvoir en tirer des renseignements a posteriori.
La manière récente, l'existence d'enregistreur de DVD en temps réel (en même temps) que la réalisation de l'examen permet de numériser plusieurs heures d'examens.
Les images (ou boucles d'images) peuvent être transmises de manière numérique, soit par CDrom, soit par réseau informatique.
Le traitement informatisé de l'image
- Par interpolation d'une boucle d'images, prise avec une cadence d'acquisition rapide, on peut simuler une ligne Tm courbe.
- La reconnaissance automatisée des contours reste la pierre d'achoppement de l'échographie en 2005.
- L'imagerie paramétrique consiste à coder chaque pixel suivant des paramètres calculés sur l'image (évolution dans le temps, déphasage…). C'est un sujet encore en phase de recherche.
- L'imagerie tridimensionnelle, jusqu'au début de ce millénaire, était faite par superposition et interpolation de plusieurs images successives, faites suivant différents plans de coupe (soit de manière libre, soit à l'aide d'une sonde rotative). Le procédé est relativement aisé pour les organes fixes mais beaucoup plus complexes pour les organes mobiles (superposition de boucles d'images et non plus d'images simples). Actuellement, certains échographes sont munis de sondes dotées de capteurs-émetteurs, non plus disposées en ligne mais sous forme de matrice rectangulaire, permettant une acquisition tridimensionnelle directe. Les contraintes techniques et informatiques font cependant que l'image standard est alors sensiblement de moins bonne définition, tant spatiale que temporelle, et que le volume de l'organe directement visualisable reste réduit en taille.
Les différents types d'appareils
- Les appareils standards, bien que disposés sur des chariots à roulettes, sont destinés plutôt à être utilisés en poste fixe. Ils peuvent être connectés à un réseau, à une imprimante externe. Leur coût s'échelonne entre 50 000 et plus de 150 000 €.
- Des appareils plus petits sont conçus pour être utilisé au lit du patient. L'écran plat est de moindre qualité et ils ne disposent pas toujours de toutes les fonctionnalités. Ils fonctionnent sur secteur. Leur prix est inférieur à 100 000 €.
- Des échographes de la taille et du poids d'un PC portable ont été développés. Ils ont le grand avantage d'être autonomes pour leur alimentation.
- Depuis 2004, les échographes ultra-portables ont fait leur apparition, de la taille d'un smartphone, permettant d’être très aisément transportés, à la main ou dans la poche, avec une autonomie très modérée (trois ou quatre examens) mais avec un stockage sur carte SD rendant possible une récupération aisée des données. Ils sont dotés de l’imagerie bidimensionnelle et du Doppler couleur.
Avantages et inconvénients de l'échographie
Avantages
- Réalisée par un professionnel4, l'échographie dans un but médical est quasiment sans danger : c'est la seule technique permettant d'avoir une image du fœtus avec une bonne innocuité. Il n' y a pas d'allergie ni de contre-indication à cet examen ;
- elle est indolore pour le patient. Elle ne nécessite, sauf exceptions, ni hospitalisation, ni anesthésie. Elle peut être répétée sans problème ;
- l'échographie est une technique d'imagerie médicale relativement peu coûteuse : elle ne nécessite qu'un appareil et le prix des consommables peut être négligeable. L'examen est réalisé avec une seule personne (médecin, sage-femme, voire manipulateur MERMEA dans certains pays, comme en France ou aux États-Unis) ;
- l'échographe peut être, dans ce genre de configuration, fixe ou mobile, permettant de réaliser l'examen au lit même d'un patient, dans une unité de réanimation par exemple ;
- s'il est effectué par un médecin ou une sage femme, le résultat est immédiat ;
- elle n’utilise pas de procédé d’imagerie basé sur les rayons X, et, par conséquent, est non irradiante.
- c'est une des seules techniques d'imagerie en temps réel, avec laquelle on peut toujours compléter l'interrogatoire et l'examen clinique du patient en cours d'examen. Elle permet une grande précision diagnostique en des mains expertes et permet d'utiliser plusieurs modalités pour préciser une anomalie : 2D, 3D, 4D, reconstructions planaires, échographie de contraste, doppler pulsé ou couleur, élastographie, manœuvres dynamiques, voire sur les toutes nouvelles machines des mesures avancées et une visualisation améliorée du cœur.
- lorsque l'échogénicité et la distance à l'organe le permettent, l'échographie possède dans certains cas une résolution spatiale supérieure au scanner et à l'IRM.
- l'échographie permet de révéler le sexe du fœtus avant sa naissance. Toutefois, certains hôpitaux anglais ne le révèlent pas aux parents, cela n'étant pas considéré comme ayant un intérêt médical5. En Inde ou en Chine, pour éviter les avortements sélectifs basés sur le sexe, il est interdit de révéler le sexe du fœtus aux parents.
Inconvénients
- Selon l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'échographie non médicale, qui expose le fœtus aux ultrasons en continu dans un but esthétique, présente un risque pour celui-ci6 ;
- l'image manque parfois de netteté, jusqu'à être parfois inexploitable : c'est le problème de l'échogénicité, faible en particulier en cas d'obésité ;
- l'examen, et donc ses résultats, sont fonction de l'examinateur : les mesures et la qualité des images dépendent beaucoup de la position de la sonde (plan de coupe), et donc, de l'habileté et de la compétence de l'examinateur. Ce positionnement manuel de la sonde varie d'un examen à l'autre et n'est pas connu a priori, ce qui rend complexe toute réinterprétation de l'examen et tout recalage avec une autre modalité d'imagerie médicale. Autrement dit, en cas de doute ou de discussion, l'examen doit être refait en totalité, idéalement par un autre examinateur ;
- le principal bruit qui vient perturber les images ultrasonores est le speckle (« tavelure » en français) ou « granularité » (car l'image donne l'impression d'être formée de grains). Ce bruit est dû au fait que l'imagerie ultrasonore est une technique d'imagerie cohérente, ce qui autorise les interférences entre les ondes et donc cet aspect granuleux de l'image. Les réflexions sur les nombreuses petites « impuretés » dans le milieu de propagation interfèrent entre elles. À noter que l'importance du speckle est lié à la densité de ces impuretés (rugosité du matériau), il peut donc être vecteur d'informations.
Effets secondaires de l'échographie
Les ultrasons, dans le cadre de leur utilisation en échographie, n'ont jamais révélé de conséquences néfastes chez l'humain7. Dans l'immense majorité des études, seuls des effets biologiques négligeables[évasif] ont été observés, aucun effet pathologique n'en découlant. Une étude américaine a montré que l'échographie, dans certaines conditions, perturberait le développement cérébral du fœtus de souris8. Des études sont en cours pour évaluer ce risque chez l'humain.
Réalisation d'un examen échographique standard
Suivant l'organe examiné, le patient doit être à jeun ou non. Il est allongé sur une table d'examen et la sonde, recouverte d'un gel, est posée directement sur la peau en regard de la structure à visualiser.
Techniques particulières de l'échographie
Échographie gynécologique et obstétricale
L'échographie diagnostique apparaît dans les années 1950 pour le cœur et le sein. En 1957, deux Britanniques, l'ingénieur Tom Brown et le gynécologue Ian Donald (en), inventent la première sonde échographique9.
Dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse, une échographie permet d'obtenir une image monochrome d'un fœtus à l'intérieur du ventre de sa mère. Bien que ce soit l'utilisation la plus connue de l'échographie, on utilise également cette technologie pour la détection des troubles d'organes internes (calculs, kystes, cancers).
Au Québec, depuis 2004, certaines cliniques de procréation et de suivi de grossesse offrent un service d'échographie en 3 dimensions qui permet une vision plus globale du fœtus.
Échographie souvenir non médicale
L'échographie dite « de convenance », de plaisir ou affective est un service fourni par certaines entreprises permettant de visualiser le fœtus, éventuellement en image tridimensionnelle, permettant aux parents de se constituer un enregistrement vidéo souvenir. L'examen est fait alors hors cadre médical.
En , Jacques Lansac, en tant que président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) et de la Commission nationale d'échographie obstétricale et fœtale, a vivement protesté contre les offres commerciales de ce type qui peuvent conduire le fœtus à une exposition aux ultrasons durant une trentaine de minutes parfois, avec un faisceau qui « se focalise sur la face et les organes génitaux », conduisant à une exposition « très différente » de l'échographie médicale qui déplace le faisceau pour une exposition plus brève de chaque zone. Selon lui, « Les effets thermiques et mécaniques des ultrasons ne sont pas forcément anodins », notamment pour le cerveau et l'œil10. La même mise en garde est formulée en Belgique en par l'ONE11.
Échographie en vue de la sélection des garçons
Dans certains pays comme l'Inde, des échographes portables sont utilisés pour déterminer le sexe des enfants à naître, ce qui a comme conséquence un nombre important d'avortements et un déséquilibre du ratio garçons/filles à la naissance12.
Échographie vasculaire
L'examen est toujours couplé au doppler permettant d'analyser les flux sanguins.
Il existe des sondes fines pouvant être introduites directement dans le vaisseau à examiner — artère coronaire par exemple — et permettant l'analyse précise des parois de celui-ci. On parle alors d’échographie endovasculaire.
Échographie cardiaque (ou échocardiographie)
L'examen du cœur comporte des difficultés car il est :
- mobile ;
- inséré dans la cage thoracique, au contact des poumons, ces deux structures (air et os) empêchant la transmission des ultrasons.
Échographie avec produit de contraste
L’échographie de contraste est celle qui utilise un produit de contraste13. Le produit de contraste composé de microbulles est injecté dans la circulation sanguine par voie intraveineuse au moment de l’examen échographique du patient. Tel que découvert par le docteur Raymond Gramiak en 196814, les microbulles du produit de contraste sont très réfléchissantes aux ultrasons pendant l'examen échographique; permettant ainsi d’imager la vascularisation sanguine des organes à des fins diagnostiques. Un usage clinique répandu de l'échographie de contraste est la détection de la tumeur métastatique dont la prise de contraste (évolution temporelle de la concentration du produit de contraste dans le sang) est plus rapide que celle du tissu biologique sain entourant la tumeur15. Il existe aussi des applications en échocardiographie de contraste16 pour obtenir une meilleure délinéation de la paroi ventriculaire dans l’image échographique, constituant une aide supplémentaire dans l’évaluation du déficit contractile du cœur à la suite d'un infarctus du myocarde. Enfin, des applications en perfusion quantitative17 (mesure relative du flux sanguin18) émergent pour le suivi thérapeutique pharmacologique du cancer, méthodologie élaborée par le docteur Nathalie Lassau en 201119 permettant d'identifier au plus tôt la réponse du patient au traitement anti-cancéreux afin d'orienter au mieux la conduite thérapeutique20.
Schéma de principe de l'imagerie par amétrique des signatures vasculaires.
Parmi les techniques de l'échographie de contraste utilisées par les radiologues en pratique clinique, se distingue la méthode d’imagerie paramétrique des signatures vasculaires21 inventée par le docteur Nicolas Rognin en 201022. Cette méthode a été conçue comme un outil d’aide au diagnostic du cancer, facilitant la caractérisation d’une tumeur suspecte (définir si elle est bénigne ou maligne) dans un organe. D’un point de vue fonctionnel, la méthode analyse informatiquement23,24 une série temporelle d’images (enregistrement numérique vidéo en temps réel des images échographiques de contraste pendant l'examen). Deux étapes successives de traitement du signal sont appliquées à chaque pixel dans la tumeur, comme suit :
- calcul de la signature vasculaire (c'est-à-dire de la différence de prise de contraste avec le tissu sain entourant la tumeur) ;
- classification automatique de la signature vasculaire calculée en un paramètre, ce dernier prenant l'une des quatre couleurs suivantes :
- verte pour l'hypervascularisation continue (prise de contraste supérieure à celle du tissu sain),
- bleue pour l'hypovascularisation continue (prise de contraste inférieure à celle du tissu sain),
- rouge pour l'hypervascularisation rapide (prise de contraste avant celle du tissu sain) ou
- jaune pour l'hypovascularisation rapide (prise de contraste après celle du tissu sain).
Une fois le traitement du signal de chaque pixel de la tumeur terminé, la carte spatiale en couleur du paramètre est affichée sur l’écran d’un ordinateur ; synthétisant ainsi l’ensemble de l’information vasculaire en une seule et même image appelée « image paramétrique » (voir la dernière figure de l’article de presse25 comme illustration d’images paramétriques en clinique). Cette image paramétrique est ensuite interprétée par le radiologue sur la base de la couleur prédominante dans la tumeur : le rouge indiquant une suspicion de malignité (risque de cancer), le vert ou le jaune une forte probabilité de bénignité. Dans le premier cas (suspicion de tumeur maligne), le radiologue prescrit une biopsie pour confirmer son diagnostic ou un scanner à rayons X pour une seconde opinion. Dans le deuxième cas (quasi-certitude de tumeur bénigne), seulement une surveillance dans les mois qui suivent est nécessaire avec un nouvel examen d’échographie de contraste. L’avantage clinique de la méthode d'imagerie paramétrique des signatures vasculaires consiste en ce qu'elle permet d'éviter la biopsie — procédure invasive risquée — systématique des tumeurs bénignes ou l'examen de scanner à rayons X exposant le patient à une dose d'irradiation. L’efficacité de la méthode a été évaluée positivement chez l’homme pour la caractérisation des tumeurs dans le foie26. Dans l'avenir la méthode pourrait être appliquée dans le cadre du dépistage du cancer de tout type d’organes, par exemple celui du sein27 ou de la prostate).
Échographie moléculaire
L’avenir de l’échographie de contraste est dans l’imagerie moléculaire. L’application clinique envisagée de l'échographie moléculaire est la détection précoce du cancer à l’aide d’un produit de contraste échographique dit ciblant. Originellement conçu par le docteur Alexander Klibanov en 199728,29, un tel produit est composé de microbulles ciblantes en mesure de s’attacher aux microvaisseaux sanguins des tumeurs malignes. Ce mécanisme d’attachement à la paroi intérieure des microvaisseaux repose sur un ciblage spécifique de l’expression biomoléculaire du cancer (par exemple les biomolécules participant à la néoangiogénèse30,31 ou l’inflammation32 se trouvent surexprimées en cas de cancer). Il en résulte une accumulation conséquente des microbulles ciblantes dans la tumeur maligne, facilitant alors sa localisation précise dans l’image échographique de contraste. En 2013, un tout premier essai clinique exploratoire à Amsterdam aux Pays-Bas a été complété chez l'homme pour le cas du cancer de la prostate par le docteur Hessel Wijkstra33.
En échographie moléculaire, la technique de la pression de radiation acoustique est applicable avec une sonde d’échographe pour littéralement pousser les microbulles ciblantes sur la paroi intérieure des microvaisseaux, première fois démontrée par le docteur Paul Dayton en 199934. Cette technique se traduit par une maximisation de l’accumulation des microbulles dans la tumeur par une plus grande interaction de ces dernières avec les biomolécules cancéreuses à cibler. Au stade de la recherche scientifique pré-clinique, cette technique est implémentée et validée en échographie bidimensionnelle35 et tridimensionnelle36,37.
Échographie de l'appareil locomoteur
L'échographie permet une analyse détaillée des muscles, des tendons, des ligaments et des nerfs périphériques (en complément du bilan radiographique standard).
Échographie per-opératoire
La sonde peut être posée sur la peau ou directement en contact de l'organe. Dans ce dernier cas, la sonde est recouverte d'une gaine de protection adaptée et marquée CE et stérile.
Échographie endoscopique
Appelée aussi ultrason endoscopique ou échoendoscopie, elle emploie une source d’ultrasons au bout d’un endoscope relié à un échographe pour obtenir des images des organes internes de la poitrine et de l'abdomen. Elle peut être utilisée pour visualiser la paroi de ces organes ou pour examiner les structures adjacentes.
Elle s'applique le plus souvent sur le tractus digestif supérieur et sur le système respiratoire. La sonde est introduite dans le vagin, l'anus ou par la bouche la procédure ressemble à celle de l'endoscopie, et peut être complété par une biopsie guidée par l'imagerie échographique.
Élastographie
Il existe aujourd'hui deux modes principaux pour évaluer l'élasticité des tissus avec l'élastographie.
Élastographie par compression manuelle
Technique permettant l'étude de l'élasticité des tissus pour détecter des cancers notamment utilisée en sénologie. Technique commercialisée par Hitachi Medical Systems depuis 200238 et par Siemens depuis 200539.
Elle consiste avec la sonde d'échographie à appliquer de légères pressions afin de soumettre les tissus sous-jacents à une légère contrainte. Ces tissus vont se déformer sous l'effet de la contrainte, plus le tissu est élastique plus il se déforme, plus le tissu est rigide moins il se déforme. Cette mesure réalisée en temps réel permet d'évaluer simplement la rigidité relative des lésions et dans une certaine mesure leur malignité.
Élastographie par impulsion ultrasonore
Dans ce cas la sonde échographique émet une onde focalisée (impulsion ultrasonore) permettant de déplacer très légèrement les tissus. L'image est alors fabriquée de façon identique à l'imagerie d'élasticité par compression manuelle. Cependant comme l'impulsion ultrasonore est parfaitement calibrée, l'image obtenue est plus reproductible. De même il est également possible d'évaluer quantitativement la rigidité tissulaire en mesurant la vitesse de l'onde de cisaillement générée par l'impulsion ultrasonore. Avec cette mesure il est possible d'évaluer le degré de fibrose hépatique, évitant le plus souvent de prescrire au patient une biopsie du foie (procédure invasive avec risque de complications).
Solutions élastographiques
L'industrie active dans l'échographie (General Electric, Philips, Siemens, Toshiba, etc.) offre des solutions utilisant l'imagerie d'élasticité par compression manuelle et impulsion ultrasonore. À noter que la société Supersonic Imagine (française) est historiquement précurseur en termes d’innovation avec son système d'élastographie quantitative.
Échographie d'urgence pour les victimes de traumatismes
L'échographie peut être utilisée en médecine d'urgence. L'échographie de certains organes — cœur et abdomen — permet de détecter la présence de fluides « libres », ce qui, dans le contexte d'un traumatisme, indique en général une hémorragie. Cette méthode, appelée FAST en anglais (Focused assessment with sonography for trauma (en)), est moins invasive que le lavage péritonéal ; elle revient moins cher que la tomographie X et n'expose pas le patient aux radiations40. Cette méthode a été testée en 1999 par l'armée britannique durant la guerre du Kosovo41.
On peut également inclure l'examen des poumons, avec la méthode dite eFAST (extended FAST), pour détecter la présence d'un pneumothorax.
Échographie haute fréquence
L'échographie haute fréquence est une application de l'échographie qui utilise des ultrasons dont la fréquence est supérieure à 20 MHz. Basée sur le même principe de fonctionnement que l'échographie conventionnelle, elle permet néanmoins d'obtenir une meilleure résolution d'image mais avec une faible profondeur de pénétration.
Des applications existent dans le domaine médical mais, à l'heure actuelle, cette technique est surtout utilisée dans l'exploration vétérinaire du petit animal (souris notamment).
Notes et références
- (en) Paul G. Newman et Grace S. Rozycki, « The history of ultrasound », Surgical Clinics of North America, vol. 78, no 2, , p. 179-195 (DOI 10.1016/S0039-6109(05)70308-X, lire en ligne [archive], consulté le ).
- Charlie Demene, Jérome Baranger, Miguel Bernal, Catherine Delanoe, Stéphane Auvin, Valérie Biran, Marianne Alison, Jérome Mairesse, Elisabeth Harribaud, Mathieu Pernot, Mickael Tanter & Olivier Baud (2017), Functional ultrasound imaging of brain activity in human newborns | Science Translational Medicine |11 Oct 2017| Vol. 9, Issue 411 | DOI: 10.1126/scitranslmed.aah6756 | résumé [archive]
- Underwood E (2017), Utrasonic probe could detect stroke, brain damage in young babies [archive], Science news ; publiée le 11 octobre 2017 |doi: 10.1126 / science.aaq1830
- Communiqué du CNGOF du 5 décembre 2011, Les échographies fœtales commerciales : un scandale sanitaire ? [archive] [PDF]
- NHS about ultrasound during pregnancy [archive]
- « Danger de l'échographie à usage non médical » [archive],
- Société Française de Radiologie [archive]
- (en) Eugenius Ang, Jr. et al. « Prenatal exposure to ultrasound waves impacts neuronal migration in mice [archive] » Proceegings of The National Academy of Sciences of the USA (PNAS) 2006 [PDF]
- https://sites.google.com/site/limageriemedicale/echographie/historique [archive]
- Journal Le Parisien, et AFP « Les gynécologues s'opposent aux échographies “souvenir” [archive] », 5 décembre 2011.
- Antoine Clevers, « Interdire les échographies de plaisir ? » [archive], sur Lalibre.be, La Dernière heure (consulté le ).
- (en) « GE machines used to break law » [archive], sur Washington Post,
- Jean-Michel Correas et al., « Produits de contraste injectables en ultrasonologie [archive] » Journal d’échographie et de médecine par ultrasons 1997.
- Raymond Gramiak et al., « Echocardiography of the Aortic Root [archive] » Investigative Radiology 1968
- (en) Michel Claudon et al. « Guidelines and Good Clinical Practice Recommendations for Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS) in the Liver – Update 1012 [archive] » Ultraschall in der Medizin 2013.
- (en) Ariel Cohen et Pascal Guéret, Manuel d'échocardiographie clinique [archive], Librairie Lavoisier, 2012.
- (en) Fabio Piscaglia et al. « The EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Practice of Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS): Update 2011 on non-hepatic applications [archive] » Ultraschall in der Medizin 2012.
- (en) Meng-Xing Tang et al. « Quantitative contrast-enhanced ultrasound imaging: a review of sources of variability [archive] » Interface Focus 2001.
- (en) Nathalie Lassau et al. « Advanced Hepatocellular Carcinoma: Early Evaluation of Response to Bevacizumab Therapy at Dynamic Contrast-enhanced US with Quantification—Preliminary Results [archive] » Radiology 2010.
- (en) Katsutoshi Sugimoto et al. « Hepatocellular carcinoma treated with sorafenib: early detection of treatment response and major adverse events by contrast-enhanced US [archive] » Liver International 2013.
- (en) Nicolas Rognin et al. « Parametric imaging for characterizing focal liver lesions in contrast-enhanced ultrasound [archive] » IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control 2010.
- Nicolas Rognin et al. « Images paramétriques basées sur comportement dynamique au cours du temps [archive] » Brevet d'invention, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) 2010.
- (en) François Tranquart et al. « Perfusion Quantification in Contrast-Enhanced Ultrasound (CEUS) - Ready for Research Projects and Routine Clinical Use [archive] » Ultraschall in der Medizin 2012.
- (en) Paolo Angelelli et al. « Interactive visual analysis of contrast-enhanced ultrasound data based on small neighborhood statistics [archive] » Computers & Graphics 2011.
- (en) Eric Barnes. « Contrast US processing tool shows malignant liver lesions [archive] » AuntMinnie.com, San-Francisco, États-Unis, 2010.
- (en) Anass Annaye et al. « Differentiation of Focal Liver Lesions: Usefulness of Parametric Imaging with Contrast-enhanced US [archive] » Radiology 2011.
- (en) Zhang Yuan et al. « Diagnostic Value of Contrast-Enhanced Ultrasound Parametric Imaging in Breast Tumors [archive] » Journal of Breast Cancer 2013.
- (en) Alexander Klibanov et al. « Targeting of ultrasound contrast material. An in vitro feasibility study [archive] » Acta Radiologica Supplementum 1997.
- (en) Alexander Klibanov « Targeted delivery of gas-filled microspheres, contrast agents for ultrasound imaging [archive] » Advanced Drug Delivery Reviews 1999.
- (en) Sybille Pochon et al. « BR55: a lipopeptide-based VEGFR2-targeted ultrasound contrast agent for molecular imaging of angiogenesis [archive] » Investigative Radiology 2010.
- (en) Joergen Willmann et al. « Targeted Contrast-Enhanced Ultrasound Imaging of Tumor Angiogenesis with Contrast Microbubbles Conjugated to Integrin-Binding Knottin Peptides [archive] » Journal of Nuclear Medicine 2010.
- (en) Jonathan Lindner et al. « Molecular imaging with contrast ultrasound and targeted microbubbles » Journal of Nuclear Radiology 2004. PMID 15052252 [archive]
- (en) BR55 in Prostate Cancer: an Exploratory Clinical Trial [archive] - Base de données d'études cliniques des Instituts américains de la santé, 23 avril 2013.
- (en) Paul Dayton et al. « Acoustic radiation force in vivo: a mechanism to assist targeting of microbubbles [archive] » Ultrasound in Medicine and Biology 1999.
- (en) Peter Frinking et al. « Effects of acoustic radiation force on the binding efficiency of BR55, a VEGFR2-specific ultrasound contrast agent [archive] » Ultrasound in Medicine and Biology 2011.
- (en) Ryan Gessner et al. « An in vivo validation of the application of acoustic radiation force to enhance the diagnostic utility of molecular imaging using 3-d ultrasound [archive] » Ultrasound in Medicine and Biology 2012.
- (en) Nicolas Rognin et al. « Molecular Ultrasound Imaging Enhancement by Volumic Acoustic Radiation Force (VARF): Pre-clinical in vivo Validation in a Murine Tumor Model [archive] erreur modèle {{Lien archive}} : renseignez un paramètre «
|titre= » » World Molecular Imaging Congress, Savannah, États-Unis 2013.
- (en) Hitachi Real-time Tissue Elastography (HI-RTE) [archive] erreur modèle {{Lien archive}} : renseignez un paramètre «
|titre= »
- (en) eSieTouch Elasticity Imaging 2 [archive]
- (en) G. Rozycki et S. Shackford, « Ultrasound, what every trauma surgeon should know », J Trauma, vol. 40, no 1, (DOI 10.1097/00005373-199601000-00001)
Voir aussi
Articles connexes
Alcool – en général l'éthanol ou l'isopropanol. Appliqué sur les plaies et la peau, il s'évapore rapidement. Le pouvoir désinfectant de l'alcool est supérieur quand il est mélangé à de l'eau (en solution alcoolique à environ 70 %). Pur ou trop concentré, il est bien moins efficace car le manque d'eau libre fait sporuler les micro-organismes qu'il est censé détruire. Or l'alcool est inefficace contre les formes sporulées qui ne seront alors pas détruites.
Bétanine
| Bétanine |
 |
 |
| Identification |
|---|
| Nom UICPA |
2,6-Pyridinedicarboxylic acid,
4-(2-(2-carboxy-5-(beta-
D-glucopyranosyloxy)-
2,3-dihydro-6-
hydroxy-1H-indol
-1-yl)ethenyl)-
2,3-dihydro-, (S-(R*,R*))- |
|---|
| No CAS |
7659-95-2 |
|---|
| No ECHA |
100.028.753 |
|---|
| No CE |
231-628-5 |
|---|
| PubChem |
11953901 |
|---|
| No E |
E162 |
|---|
| SMILES |
|
|---|
| InChI |
|
|---|
| Propriétés chimiques |
|---|
| Formule |
C24H26N2O13 |
|---|
| Masse molaire1 |
550,468 8 ± 0,025 3 g/mol
C 52,37 %, H 4,76 %, N 5,09 %, O 37,78 %, |
|---|
|
| Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. |
modifier  |
La bétanine (parfois bétacyanine) est un pigment de couleur rouge du groupe des bétacyanines, une sous-classe des bétalaïnes. C'est un hétéroside de glucose (bétanidine 5-O-glucose), son aglycone est la bétanidine.
Source
La bétanine est le colorant majoritaire du jus de betterave (de 75 à 95 %), on en trouve aussi dans le figuier de barbarie2,3,4.
| + Tableau 1 : Composition en % (massique) de colorants dans le jus de fruit du figuier de barbarie4. |
| Colorants | Jus de fruit orangé | Jus de fruit violacé |
|---|
| Indicaxanthine |
0,245% |
0,022% |
| Bétanine |
0,027% |
0,307% |
Les autres pigments présents dans la betterave sont l'indicaxanthine et la vulgaxanthine.
Utilisation alimentaire
La bétanine est utilisée comme additif alimentaire et est autorisée au niveau européen sous le code E162. On la trouve plus souvent sous l'appellation "rouge de betterave"5,6.
La bétanine se dégrade au contact de l'oxygène, la lumière et la chaleur, ainsi elle est plutôt utilisée dans les produits congelés, en poudre ou à durée de conservation courte7.
La couleur de la bétanine est dépendante du pH, à pH acide (pH 4-5) elle est rouge et tourne progressivement violet-rouge à mesure que le pH monte. À pH alcalin (pH 11-12) la bétanine s'hydrolyse et devient jaune-marron.
Activité
La bétanine est considérée comme un antioxydant4 alimentaire et est très bien assimilée par le corps humain8. Cependant, 10 à 14 % des humains sont incapables de la décomposer, ce qui colore en rouge leur urine après qu’ils ont mangé de la betterave rouge [réf. nécessaire].
Notes et références
- Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 » [archive], sur www.chem.qmul.ac.uk.
- (en) Forni E, Polesello A, Montefiori D, Maestrelli A. High-performance liquid chromatographic analysis of the pigments of blood-red prickly pear (Opuntia ficus indica). J Chromatogr 1992;593:177-83.
- (en) Stintzing FC, Schieber A, Carle R. Identification of betalains from yellow beet (Beta vulgaris L.) and cactus pear [Opuntia ficus-indica (L.) Mill. ] by high-performance liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry. J Agric Food Chem 2002;50:2302-7. PMID 11929288 [archive]
- [PDF] BS Maataoui, A Hmyene et S Hilali (2006) Activités anti-radicalaires d’extraits de jus de fruit du figuier de barbarie (Opunta ficus indica). [archive] Lebanese Science Journal, Vol. 7, No. 1
- [PDF] European Parliament and Council Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires [archive]
- [PDF] Directive 95/45/CE de la Commission établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires [archive]
- (en) Anonymous, « Beetroot » [archive], NATCOL (consulté le )
- (en) L Tesoriere, Mario Allegra, Daniela Butera et Maria A. Livrea, « Absorption, excretion, and distribution of dietary antioxidant betalains in LDLs: potential health effects of betalains in humans », American Journal of Clinical Nutrition, vol. 80, no 4, , p. 941-945 (lire en ligne [archive])
Articles connexes
Acide acétylsalicylique
Pour les articles homonymes, voir AAS.
| Acide acétylsalicylique |
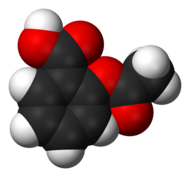 |
 
Molécule d'acide acétylsalicylique. |
| Identification |
|---|
| Nom UICPA |
acide 2-acétyloxybenzoïque |
|---|
| Synonymes |
Aspirine
|
|---|
| No CAS |
50-78-2 |
|---|
| No ECHA |
100.000.059 |
|---|
| No CE |
200-064-1 |
|---|
| No RTECS |
VO0700000 |
|---|
| Code ATC |
A01AD05, B01AC06, N02BA01 |
|---|
| DrugBank |
DB00945 |
|---|
| PubChem |
2244 |
|---|
| ChEBI |
15365 |
|---|
| SMILES |
|
|---|
| InChI |
|
|---|
| Apparence |
cristaux incolores à blancs ou poudre cristalline blanche, d'odeur caractéristique1 |
|---|
| Propriétés chimiques |
|---|
| Formule |
C9H8O4 [Isomères] |
|---|
| Masse molaire2 |
180,157 4 ± 0,009 g/mol
C 60 %, H 4,48 %, O 35,52 %, |
|---|
| pKa |
3,5 |
|---|
| Propriétés physiques |
|---|
| T° fusion |
135 °C1 |
|---|
| T° ébullition |
Se décompose au-dessous du point d'ébullition à 140 °C1 |
|---|
| Solubilité |
2,5 g·l-1 (eau, 15 °C)1,
4,6 g·l-1 (eau, 25 °C),
10 g·l-1 (eau, 37 °C),
1 g/10-15 ml d'éther,
moins sol. dans l'éther anhydre3,
200 g·l-1 (éthanol, 25 °C),
1 g/3,5 ml (acétone, 20 °C),
1 g/17 ml (chloroforme, 25 °C)4
|
|---|
| Masse volumique |
1,4 g·cm-31 |
|---|
| Point d’éclair |
131,2 °C |
|---|
| Pression de vapeur saturante |
0,016 5 Pa à 25 °C |
|---|
| Cristallographie |
|---|
| Classe cristalline ou groupe d’espace |
P21/c5 |
|---|
| Paramètres de maille |
a = 11,430 Å
b = 6,591 Å
c = 11,395 Å
α = 90,00°
β = 95,68°
γ = 90,00°
Z = 45
|
|---|
| Volume |
854,23 Å35 |
|---|
| Propriétés optiques |
|---|
| Indice de réfraction |
1,55 |
|---|
| Précautions |
|---|
| SGH6,7 |
|---|
 Attention |
| SIMDUT8 |
|---|

D2A,
|
| Écotoxicologie |
|---|
| LogP |
1,191 |
|---|
| Données pharmacocinétiques |
|---|
| Biodisponibilité |
60 - 90 % selon la dose9 |
|---|
| Liaison protéique |
99,6 % |
|---|
| Métabolisme |
Hépatique |
|---|
| Demi-vie d’élim. |
3,1 h (dose < 650 mg)
5 h (dose = 1 g)
9 h (dose = 2 g) |
|---|
| Excrétion |
Urinaire
|
|---|
| Considérations thérapeutiques |
|---|
| Classe thérapeutique |
Antalgique • Antipyrétique • Anti-inflammatoire • Antiagrégant plaquettaire |
|---|
| Voie d’administration |
Orale, IV |
|---|
| Grossesse |
Contre-indiqué
au 3e trimestre |
|---|
| Enfants |
Déconseillé aux enfants de 3 à 12 ans (risque de syndrome de Reye) |
|---|
| Précautions |
Toxicité gastrique |
|---|
| Composés apparentés |
|---|
| Isomère(s) |
Acide caféique |
|---|
| Autres composés |
Salicylate de méthyle
|
|---|
|
| Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. |
modifier  |
L’acide acétylsalicylique (AAS), plus connu sous le nom commercial d’aspirine, est la substance active de nombreux médicaments aux propriétés antalgiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Il est surtout utilisé comme antiagrégant plaquettaire. Il s’agit d’un anti-inflammatoire non stéroïdien. C’est un acide faible, dont la base conjuguée est l’anion acétylsalicylate.
C’est un des médicaments les plus consommés au monde.
Étymologie
L’acide acétylsalicylique est obtenu par acétylation de l’acide salicylique. Son nom vient du latin salix, « saule », cet acide ayant été isolé pour la première fois dans l’écorce de cette essence d’arbre.
L’appellation aspirine vient d'Aspirin enregistrée comme nom de marque le par la société Bayer à Berlin10,11. Le nom de marque a été formé à partir des éléments suivants12 :
- Le préfixe A pour Acétyl, l'acétylation rendant ce métabolite secondaire de plantes toxique (son activité allélopathique leur sert de défense chimique contre les herbivores) moins irritant dans le tube digestif ;
- Le radical spir- (issu de l'allemand Spirsäure, « acide spirique », molécule issue de la spirée ulmaire et identique à l'acide salicylique13) ;
- Le suffixe -in(e) (suffixe classique employé en chimie industrielle pour la désignation des alcaloïdes).
Le brevet américain demandé le est accordé le (US Patent no 644 077) pour une durée de validité de 17 ans avec une date d'expiration le 14.
Histoire
L’écorce de saule est connue au moins depuis l’Antiquité pour ses vertus curatives. On a trouvé la mention de décoctions de feuilles de saule dans un papyrus égyptien dès 1550 av. J.-C. (papyrus Ebers)15. Le médecin grec Hippocrate (460-377 av. J.-C.) conseillait déjà une préparation à partir d’écorce de saule blanc pour soulager les douleurs et les fièvres16,17. De même, le médecin et pharmacologue grec Dioscoride (25 - 90 ap. J.-C.) en conseillait l'usage pour les douleurs auriculaires, dans sa Matière médicale (De materia medica) au premier siècle18.
En , le pasteur Edward Stone présente un mémoire devant la Royal Society of Medicine sur l'utilisation thérapeutique de décoctions de l'écorce du saule blanc contre la fièvre malarienne19.
En 1824 Bartolomeo Rigatelli utilise un extrait d’écorce de saule comme agent thérapeutique, le dénommant salino amarissimo antifebbrile (sel antipyrétique très amer). En 1825 le pharmacien-chimiste Francesco Fontana (1794-1867) isole l'acide salicylique des feuilles de saules lui donnant le nom de salicina (salicine)20.
En 1828, le pharmacologue allemand Johann Andreas Buchner l'extrait de l'écorce du saule (Salix alba) . En , Pierre-Joseph Leroux, un pharmacien français, tente, après avoir fait bouillir de la poudre d’écorce de saule blanc dans de l’eau, de concentrer sa préparation ; il en résulte des cristaux solubles qu’il nomme salicyline (de salix)21.
Puis, des scientifiques allemands purifient cette substance active, un des dérivés est identifié comme la substance active. Ce dérivé prend le nom d’acide salicylique. Parmi les dérivés de la salicyline, d'autres médicaments de la famille des salicylacés voient le jour à cette époque.
En , Carl Löwig montre que l’acide spirique, extrait de la reine-des-prés, est chimiquement identique à l’acide salicylique. À partir des extraits naturels, on isole le salicylate de sodium, qui devient alors le médicament couramment employé contre la douleur et l’inflammation. Cette préparation permet de faire tomber la fièvre et de soulager les douleurs et les rhumatismes articulaires, mais provoque de graves brûlures d’estomac. En , à partir de la salicyline, l'Italien Raffaele Piria prépare l'acide salicylique, dont il préconise l'emploi comme désinfectant de la lumière intestinale, notamment dans la fièvre typhoïde.
En , le chimiste strasbourgeois Charles Frédéric Gerhardt effectue la synthèse de l’acide acétylsalicylique (en traitant le salicylate de sodium avec le chlorure d'acétyle), qu’il nomme acide acétosalicylique22, et dépose un brevet. Cependant, son composé est impur et thermolabile. Le savant meurt trois ans plus tard et ses travaux tombent dans l’oubli.
En , Adolph Wilhelm Hermann Kolbe réussit la synthèse totale de l'acide salicylique. Les propriétés antipyrétiques de l'acide salicylique sont mises en évidence par le Suisse Carl Buss en . Utilisé largement mais surtout comme antirhumatismal dans les années 1890, il a très mauvais goût. En , Germain Sée propose le salicylate de soude comme antipyrétique. Marceli Nencki prépare à partir de un dérivé de l’acide salicylique et du phénol appelé Salol, qui, sans présenter de propriétés pharmacologiques supérieures aux médicaments alors existants, a toutefois un goût plus agréable. Ce produit fait l’objet d’un grand engouement populaire23.
C'est Felix Hoffmann, chimiste allemand qui après l'obtention à Munich de son doctorat en pharmacie en 1890, obtient son doctorat en chimie le . Il entre en tant qu'assistant de laboratoire au service des laboratoires Bayer à Elberfeld (Allemagne) en .
Le à Leverkusen, reprenant les travaux antérieurs de Gerhardt, il trouve le moyen de synthétiser l'acide acétylsalicylique sous une forme stable utilisable pour des applications médicales. Il transmet ses résultats à son patron Heinrich Dreser, le responsable du département pharmaceutique et chimique chez Bayer depuis 189624. Ce dernier teste le produit sur le cœur de grenouille, son animal de laboratoire favori, et n'obtient aucun résultat probant. Hoffmann est persuadé de l'intérêt de la molécule (il y a une légende qui indique qu'Hoffmann s'en soit servi pour soigner son père, qui souffrait de rhumatisme chronique et prenait jusque-là du salicylate de sodium, médicament antirhumatismal selon le corps médical de la Belle Époque)25. Hoffmann donne le médicament à des amis médecins et dentistes, qui le testent avec succès sur leurs patients pendant deux ans : les tests révèlent un effet antalgique et moins toxique pour l'estomac que le salicylate de sodium, lorsque Hoffmann a acétylé l'acide salicylique pour produire de l'acide acétylsalicylique.
-
Protocole de laboratoire de Felix Hoffmann du 10 août 1897
En 1898, le Dr Dreser fait tester la substance sur un groupe de 50 patients dans un hôpital de Halle (Saxe-Anhalt).
Commence alors la production industrielle du médicament de l'acide acétylsalicylique par Bayer qui met au point une nouvelle voie de synthèse de la molécule, et observe que l'acétylation de la molécule rend celle-ci moins irritante dans le tube digestif26. Le brevet et la marque de l'aspirine sont déposés le par la société Bayer sous la dénomination d'Aspirin27.
C'est le Dr Kurt Witthauer (de), médecin-chef interniste au Diakoniewerk Halle (de), qui publie les résultats du premier essai clinique de l'aspirine en .
Initialement, l'Aspirin est disponible sous forme de poudre dans les pharmacies : de petits sacs en papier sont remplis de 500 mg de poudre chacun et remis au patient. Dès l'année suivante, le comprimé Aspirin contenant 500 mg d'acide acétylsalicylique est lancé, ce qui en fait l'une des premières préparations sous forme de comprimé au monde11. La préparation arrive en France en 1908 et est commercialisée par la Société chimique des usines du Rhône.
-
-
Couverture du premier rapport clinique du Dr Kurt Witthauer sur l'Aspirine (1899)
-
Présentation pharmacologique de l'Aspirine, par le Dr Heinrich Dreser (1899)
-
En , le supérieur hiérarchique direct d'Hoffmann, Arthur Eichengrün (en), publie un article revendiquant la paternité de la découverte28. Cette revendication est ignorée par les historiens des sciences jusqu'en , date à laquelle les recherches de Walter Sneader de l'université de Strathclyde, à Glasgow, concluent que c'est bien Eichengrün qui a eu l'idée de synthétiser l'acide acétylsalicylique29. Bayer, dans un communiqué de presse, réfute cette théorie, mais la controverse reste ouverte.
Le mécanisme d'action de la molécule n'est élucidé que bien plus tard. En , John Vane et Priscilla Piper découvrent l'action inhibitrice de l'aspirine sur les prostaglandines30. Vane et les biochimistes suédois Bengt Samuelsson et Sune Karl Bergström sont récompensés par le prix Nobel de médecine en pour cette découverte. La cible précise de la molécule, la cyclooxygénase, a été isolée en 31.
Ce n'est qu'en que les propriétés antiagrégantes plaquettaires de l'acide acétylsalicylique ont été mises en évidence32. La première étude clinique démontrant une efficacité dans les maladies cardiovasculaires date de 33.
Le brevet Bayer
Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles stipule que la marque et le procédé de fabrication entrent dans le domaine public dans un certain nombre de pays (France, États-Unis, etc.) mais pas dans d'autres (comme le Canada).
Après l’entrée en guerre des États-Unis contre l’Allemagne en , le Bureau d'administration des biens étrangers (en) a saisi les biens américains de Bayer. Deux ans plus tard, le nom de la société Bayer et les marques commerciales aux États-Unis et au Canada ont été vendus aux enchères et achetés par le laboratoire pharmaceutique Sterling Products Company (en), devenu plus tard Sterling Winthrop, pour un montant de 5,3 millions de dollars.
Aux États-Unis la marque a été partiellement annulée par une décision de justice de 1921 car Bayer n'avait pas utilisé correctement le nom de son propre produit et avait autorisé pendant des années l'utilisation de la mention « aspirine » par d'autres fabricants sans défendre ses droits de propriété intellectuelle34. Une mention en rouge « Authentique » (Genuine), figurait sur les boîtes et apparaissait dans la publicité des comprimés d'aspirine de Bayer peu de temps après la décision de 192135.
La société Bayer n'a récupéré ses droits aux États-Unis qu'en en rachetant l'activité de vente libre de Sterling Winthrop36. Bayer a repris à compter de cette date les droits sur le nom et le logo de Bayer et a permis à l’entreprise de profiter à nouveau des ventes américaines de son produit le plus célèbre10.
Aujourd'hui, l'aspirine est une marque générique dans de nombreux pays. L'aspirine, avec un A majuscule, reste une marque déposée de Bayer en Allemagne, au Canada, au Mexique et dans plus de 80 pays, pour l'acide acétylsalicylique sur tous les marchés, mais en utilisant des emballages et des aspects physiques différents pour chaque37.
Propriétés pharmacologiques
L'aspirine possède les propriétés pharmacologiques suivantes :
Mécanisme d'action
L'aspirine inhibe la production de prostaglandines et de thromboxanes. L'aspirine par une réaction chimique d'acétylation inhibe de façon irréversible les enzymes cyclooxygénase (COX1 et COX2), des enzymes participant à la production de prostaglandines et de thromboxanes. L'aspirine est différente des autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) qui inhibent de façon réversible cette enzyme.
L'aspirine fait baisser la fièvre (antipyrétique), en réduisant la production de prostaglandines dans l'hypothalamus, thermostat de la température corporelle.
Elle réduit la douleur (analgésique) en bloquant la production des hormones responsables des messages transmis aux récepteurs de la douleur dans le cerveau, d'où son efficacité sur les migraines et les douleurs d'origines diverses. Par le même mode d'action, elle réduit les inflammations (AINS) résultant d'une dilatation vasculaire, comme les coups de chaleur, qui ne s'accompagnent pas forcément de coups de soleil.
L'aspirine agit sur les plaquettes sanguines, en inhibant la cyclooxygénase, une enzyme ayant un rôle important dans l'agrégation des plaquettes, et ce, de manière permanente, c'est-à-dire durant toute la durée de vie de la plaquette jusqu'à ce qu'elle soit détruite par la rate (entre sept et dix jours). Elle favorise par ce biais la circulation et peut servir pour prévenir les infarctus (du myocarde ou d'autres organes), en évitant la formation de caillots (thrombose)38.
L'acide acétylsalicylique pourrait avoir une action sur le système immunitaire39 en stimulant légèrement (à faible dose) ou au contraire en inhibant (à forte dose) la production des cytokines40.
Pharmacocinétique
L'aspirine est absorbée au niveau de l'estomac et du duodénum. Le facteur de biodisponibilité dépend de la dose : de 60 % pour moins de 500 mg à 90 % pour 1 g ou plus par saturation de l’hydrolyse hépatique9. La prise de certains aliments épicés semble réduire le taux d'absorption41.
Pour les formes pharmaceutiques immédiates, le pic de concentration est atteint de 25 à 60 minutes après la prise9. Il peut être atteint plusieurs heures après pour une forme gastro-résistante ou à libération modifiée. L’absorption peut être fortement perturbée dans ces dernières formes, en particulier chez le patient diabétique42.
Sa demi-vie dans le sang n'est que de 15 à 20 minutes et de 2 à 4 heures pour l'acide salicylique qui est un métabolite actif obtenu par hydrolyse9.
Indications thérapeutiques et prophylactiques
Douleur, fièvre et inflammation
L'aspirine est utilisée depuis plus de cent ans pour soulager la douleur, faire baisser la fièvre et traiter l'inflammation.
Elle n'est plus indiquée pour traiter ces symptômes, on préfèrera utiliser d'autre AINS comme l'ibuprofène ou des antalgiques/antipyrétique comme le paracétamol.
Maladies cardiovasculaires
Comprimés d'aspirine, 325
mg
À petite dose (entre 75 et 300 mg/jour suivant les études), les propriétés antiagrégantes de l'aspirine préviennent efficacement la formation de caillots de sang dans les vaisseaux sans causer de dommages significatifs à l'organisme. Le bénéfice de cette prise a été prouvé en prévention secondaire43, c'est-à-dire après un premier accident vasculaire (syndrome coronarien aigu, AVC, AOMI...) et elle est indiquée à vie. Le bénéfice excède significativement le risque majoré d'hémorragie dans ce cas.
Les recommandations médicales de la HAS44 préconisent l'emploi de l'aspirine en prévention primaire (c'est-à-dire avant même l'apparition d'une maladie vasculaire) chez les patients à haut risque cardio-vasculaire (SCORE>5). L'efficacité semble être partielle (diminution des infarctus du myocarde mais tendance à l'augmentation des accidents vasculaires cérébraux de type hémorragique) et n'a été testée que sur des populations bien ciblées (médecins)45 ou femmes de plus de 45 ans avec une diminution modérée des accidents vasculaires cérébraux mais un effet sur la mortalité et la morbidité cardiovasculaire non significatif46. Une plus grande efficacité chez la femme que chez l'homme a aussi été constatée47. Les résultats sont plus mitigés pour d'autres études, bien qu'elles soient faites chez des personnes dites « à hauts risques »48,49. En particulier, il n' y a pas de diminution de la mortalité cardiovasculaire, avec une augmentation du risque d'hémorragies50.
Une « résistance à l'aspirine » est décrite chez certains patients, conduisant à une antiagrégation plaquettaire insuffisante51 et concernerait environ 5 % des patients52, avec un risque théorique supérieur d'accidents cardiaques. Cette résistance serait plus liée avec la forme gastro résistante de la présentation de l'aspirine, conduisant à une absorption différée ou réduite qu'avec la molécule elle-même53.
Réduction du risque de cancer
Un grand nombre de données expérimentales, ainsi que plusieurs études épidémiologiques rétrospectives, ont conclu que de petites doses d'aspirine en chimioprévention pouvaient diminuer le risque de contracter certains types de cancers, dont ceux du foie54. Les études expérimentales le montrent pour divers cancers, comme celui du côlon, du sein, de la prostate, de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, de l'estomac et du poumon (non à petites cellules). Les études épidémiologiques montrent que c'est la mortalité par cancers digestifs qui diminuerait le plus55.
Une vingtaine d'études de cancérogenèse chez rats et souris étayent cet effet protecteur56. Plusieurs essais cliniques montrent que de petites doses d'aspirine diminuent, modestement, la récurrence des polypes intestinaux et la survenue des cancers du côlon57, essentiellement si ces derniers expriment l'enzyme cyclooxygénase de type 2 (ce qui représente environ deux tiers desdits cancers)58. Les doses indiquées étant cependant susceptibles de provoquer des saignements gastriques ou intestinaux, l'utilisation de l'aspirine n'est pas actuellement recommandée pour la prévention des cancers59.
Grossesse
A petites doses, chez la femme enceinte, la prise d'aspirine diminue le risque de prématurité, du moins, dans les pays avec accès limités aux soins60.
La prise d'aspirine à 75 mg/jour augmenterait l'efficacité de la fécondation in vitro en améliorant la vascularisation de l'utérus61.
La prise quotidienne d'aspirine à faible dose (entre 100 et 150 mg selon les études) permettrait de réduire significativement le risque de développer une pré-éclampsie au cours de la grossesse pour les femmes à risque62. Cette maladie, également appelée toxémie gravidique, est une des principales causes des décès maternels, jusqu'à 20 %. L'aspirine ayant pour effet de fluidifier le sang permet de diminuer l'hypertension et les dangers qui y sont liés. Toutefois il semble que la prise d'aspirine doive commencer tôt dans la grossesse afin d'empêcher la formation d'anomalies au niveau des artères intra-utérines qui seront la cause de la pré-éclampsie.
Effets secondaires
Ses effets secondaires sont essentiellement des troubles gastriques (exemple : gastrite voire hémorragie digestive en cas de dose élevée) et des allergies (pouvant provoquer l'œdème de Quincke). Certaines présentations de l'aspirine, dites « entériques » diminuent l’absorption de la molécule au niveau de l'estomac, alléguant une protection de ce dernier, mais qui n'est pas du tout démontrée63.
De manière générale, l'aspirine inhibe l'agrégation plaquettaire. Par conséquent, le risque d'hémorragie est à prendre en compte, surtout s'il y a déjà prescription d'anticoagulants.
Contre-indications et précautions
Elle est ainsi totalement contre-indiquée chez les personnes souffrant d'hémophilie. Elle est évidemment déconseillée en cas de plaie en début de cicatrisation.
Elle est déconseillée en tant que prévention primaire de maladies cardiovasculaires, la balance bénéfice-risque n'étant pas favorable.
L'aspirine doit être utilisée avec prudence chez le nourrisson et l'enfant, car en cas de surdosage (au-dessus de 50 mg par kg et par jour), elle est neurotoxique. En outre, elle peut entraîner l'apparition du syndrome de Reye en cas de varicelle ou de grippe. En effet, l'aspirine peut aussi provoquer un syndrome de Lyell (syndrome d'origine médicamenteuse) à l'origine d'une destruction des kératinocytes, décollement dermique et atteinte des muqueuses.
Les cardiaques, sous traitement au long cours à petites doses en raison de son effet antiagrégant, peuvent être exposés à ses effets secondaires. Le bénéfice du traitement reste cependant de loin supérieur au risque, ce qui justifie sa prescription.
Chez les personnes souffrant d'un ulcère gastrique, l'aspirine peut occasionner une hémorragie digestive, par inhibition de la synthèse des prostaglandines, substances protectrices pour la muqueuse de l'estomac.
Lors d'une grossesse, elle peut être prise à titre ponctuel pendant les deux premiers trimestres (notamment associée à l'héparine pour prévenir le risque de fausse-couche lors du syndrome des antiphospholipides). Puis, l'utilisation d'aspirine est contre-indiquée au troisième trimestre : sur le fœtus à partir du sixième mois, ce type de médicament exerce des effets vasoconstricteurs au niveau des reins et peut conduire à une insuffisance rénale ou encore à des troubles de l'appareil cardiopulmonaire.
Ce médicament passe dans le lait, mais compte tenu de la demi-vie d'élimination très courte, l'usage de ce médicament est généralement autorisé pendant l'allaitement en utilisation de courte durée (quelques jours).
En cas de risque de dengue, l'utilisation de médicaments à base d'aspirine est fortement désapprouvée, vu le risque d'apparition de la forme hémorragique de la maladie. Cet avis doit accompagner, au Brésil, toute publicité du produit64.
Chez les personnes présentant un syndrome de Widal (association d'asthme, polypose nasale et allergie à l'aspirine), la prise d'aspirine peut entraîner des difficultés respiratoires allant jusqu'à la crise d'asthme65.
Par ailleurs, la prise d'aspirine (comme celle d'anti-inflammatoires ou d'antibiotiques, médicaments ototoxiques) a été signalée comme pouvant occasionner une perte d'audition ou l'apparition d'acouphènes 66. De manière anecdotique, lors de la pandémie de grippe espagnole (vers 1919), de très fortes doses d'aspirine telles qu'elles ont été préconisées à l'époque (plus de 8 g en 24 h) ont pu contribuer à accroître la mortalité et la sévérité des symptômes 67,64.
Propriétés chimiques
Cristaux d'acide acétylsalicylique sur une page de cahier.
L'acide acétylsalicylique est la dénomination commune internationale de l'acide 2-(acétyloxy) benzoïque (selon les normes IUPAC).
Au cours des années, il fut aussi appelé acide 2-acétyloxybenzoïque, acide 2-acétoxybenzoïque, acétylsalicylate, acide ortho-acétylsalicylique, acide ortho-acétyloxybenzoïque ou encore acétosal.
Les pharmacopées européenne (Ph. Eur.), américaine (USP) et japonaise (en) décrivent des méthodes d'identification et d'analyses de l'acide acétylsalicylique destiné aux médicaments.
Synthèse
La synthèse initiale de Gerhardt décrite en 185322 fut améliorée en 197568. Elle est assez simple et consiste en l'estérification de la fonction hydroxyle de l'acide salicylique avec l'anhydride acétique, en milieu acide. On obtient l'acide acétylsalicylique et de l'acide acétique comme sous-produit (la synthèse de l'acide salicylique se fait par réaction de Kolbe).
La purification peut se faire de deux manières : par recristallisation dans l'acétone (selon un brevet de Monsanto de 1959), par recristallisation dans un solvant mixte éthanol/eau 1:2,5 ou par un procédé mettant en œuvre une distillation (brevet de Norwich Pharma de 1966). Le produit purifié se présente sous la forme de cristaux blancs en forme d'aiguille.
Un test au chlorure de fer(III) FeCl3 peut servir à déterminer l'éventuelle présence d'acide salicylique n'ayant pas réagi. Le chlorure de fer(III) réagit avec le groupe OH phénol et donne lieu à une coloration rouge du produit.
Marché
C'est un des médicaments les plus consommés au monde, avec une consommation annuelle estimée à 40 000 t, soit l'équivalent de 120 milliards de comprimés de 300 mg69. En 2008, 85 % de la production d'acide acétylsalicylique est réalisée à Langreo en Espagne, dans une usine chimique de la multinationale Bayer69. De là, il est envoyé dans le monde entier où il est intégré à de nombreuses autres préparations.
En France, 237 médicaments commercialisés contiennent de l'aspirine. Annuellement, 1 500 t d'aspirine sont consommées70. Sachant qu'un comprimé contient 500 mg, chaque Français consomme en moyenne soixante comprimés d'aspirine par an.
Il est concurrencé par le paracétamol, autre antalgique et antipyrétique mais dépourvu d'effets au plan gastrique (l'aspirine favorise l'ulcère comme les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens). En revanche, le paracétamol a des effets néfastes irréversibles sur le foie à très fortes doses. L'acide acétylsalicylique reste un antiagrégant plaquettaire de référence.
Divers
L'aspirine fait partie de la liste modèle des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé (liste mise à jour en novembre 2015)71.
Dans les années 1980, il était concevable dans certains milieux sportifs d’utiliser un cachet d’aspirine lors de la reprise des entraînements après long arrêt afin de diminuer les effets de courbature des muscles.
Aspirine est une nouvelle d'Amélie Nothomb (2001) comprenant des histoires autour de l'aspirine.
Notes et références
- ACIDE 2 - ACETYLOXYBENZOIQUE [archive], Fiches internationales de sécurité chimique .
- Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 » [archive], sur www.chem.qmul.ac.uk.
- term+@rn+@rel+50-78-2" rel="nofollow" class="external text">« Acetylsalicylic Acid » [archive], sur Hazardous Substances Data Bank (consulté le ).
- (en) R. E. Kirk (dir.), D. F. Othmer (dir.) et al., Encyclopedia of Chemical Technology, vol. 22 : Silicon Compounds to Succinic Acid and Succinic Anhydride, Wiley-Interscience, , 4e éd., 1136 p. (ISBN 9780471526919, présentation en ligne [archive]).
- « Acetyl salicylic acid » [archive], sur www.reciprocalnet.org (consulté le ).
- Entrée « Acetylsalicylic acid » dans la base de données de produits chimiques GESTIS de la IFA (organisme allemand responsable de la sécurité et de la santé au travail) (allemand, anglais), accès le 26 mars 2011 (JavaScript nécessaire).
- Fiche Sigma-Aldrich du composé Acide acétylsalicylique ≥ 99,0 % cristallisé [archive], consultée le 6 avril 2014.
- « Acide acétylsalicylique [archive] » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 23 avril 2009.
- « RCP aspirine comprimé »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • http://afssaps-prd.afssaps.fr/php/ecodex/frames.php?specid=67673559&typedoc=R&ref=R0078547.htm" rel="nofollow" class="external text">Google • Que faire ?) (consulté le ), AFSSAPS.
- (en) History, « Bayer patents aspirin » [archive], sur history.com (consulté le ).
- (de) Bayer Austria, « Geschichte : Histoire » [archive], sur aspirin.at (consulté le ).
- Dominique Frémy, Quid, Éditions Robert Laffont, , p. 183
- Le terme d'aspirine a été forgé pour distinguer de l'acide acétylsalicylique naturel, extrait des fleurs de la reine-des-prés ou spirée ulmaire (à l'époque, le nom latin binomial de cette plante était Spiraea ulmaria), d'où le nom d'acide spirique dont la structure est équivalente à l'acide salicylique extraite de l'écorce du saule (Salix alba).
- (en) Farbenfabriken of Elberfeld Co, « Patent US 644077A : Acetyl salicylic acid. » [archive], sur patents.google.com (consulté le ).
- Olivier Bruzek, Pour l'Aspirine, 10001 Mots, , 40 p. (ISBN 9782371980037, lire en ligne [archive]), Début chapitre II
- (en) Mary Bellis, « History of Aspirin » [archive], sur http://inventors.about.com [archive].
- H. Lévesque et O. Lafont, « L'aspirine à travers les siècles: Rappel historique », La Revue de Médecine Interne, vol. 21, , S8–S17 (ISSN 0248-8663, DOI 10.1016/S0248-8663(00)88720-2, lire en ligne [archive], consulté le )
- Olivier Lafont, « Revue d'Histoire de la Pharmacie : Du saule à l'aspirine » [archive], sur persee.fr, (consulté le ).
- (en) E. Stone, « An account of the success of the bark of the willow in the cure of agues », Philos. Trans., vol. 53, no titre, , p. 195-200 (ISSN 0261-0523, DOI 10.1098/rstl.1763.0033).
- (en) Marson Piero, Giampiero Pasero, « The Italian contributions to the history of salicylates » [archive], sur researchgate.net, (consulté le ).
- L. J. Gay-Lussac et F. Magendie, « Rapport fait à l'Académie royale des sciences le 10 mai 1830, sur le mémoire de M. Leroux, relatif à l'analyse de l'écorce de saule et à la découverte d'un principe immédiat propre à remplacer le sulfate de quinine », J. Chim. Med. Pharm. Toxicol., vol. 6, no titre, , p. 340-342 (lire en ligne [archive]).
- (de) C. Gerhardt, « Untersuchungen über die wasserfreien organischen Säuren », Liebigs Annalen, vol. 87, no 2, , p. 149–179 (ISSN 0075-4617, DOI 10.1002/jlac.18530870206).
- Philippe Albou, « Histoire du traitement de la fièvre avant l'aspirine » [archive] [vidéo], Société française d'histoire de la médecine, .
- (en) Tabea Tietz, « Felix Hoffmann and the Synthesis of Aspirin » [archive], sur scihi.org, (consulté le ).
- Pierre Bachoffner, « Les deux "pharmaciens" à l'aube de l'aspirine : Charles Gerhardt et Felix Hoffmann » [archive], sur persee.fr, (consulté le ).
- (en) Diarmuid Jeffreys, Aspirin: The Remarkable Story of a Wonder Drug, Bloomsbury Publishing, , p. 69-75
- (en) V. Fuster et J. M. Sweeny, « Aspirin - A Historical and Contemporary Therapeutic Overview », Circulation, vol. 123, no titre, , p. 768-778 (ISSN 0009-7322, DOI 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.963843).
- (de) A. Eichengrün, « 50 Jahre Aspirin », Pharmazie, vol. 4, no titre, , p. 582-584.
- (en) W. Sneader, « The discovery of aspirin: a reappraisal », BMJ, vol. 321, no 7276, , p. 1591–1594 (ISSN 0959-8138, PMCID PMC1119266, DOI 10.1136/bmj.321.7276.1591, lire en ligne [archive]).
- (en) J. R. Vane, « Inhibition of prostaglandin synthesis as a mechanism of action for aspirin-like drugs », Nat. New. Biol., vol. 231, no 25, , p. 232-235 (PMID 5284360, DOI 10.1038/newbio231232a0).
- (en) M. Hemler, W. E. Lands et al., « Purification of the cyclooxygenase that forms prostaglandins. Demonstration of two forms of iron in the holoenzyme », J. Biol. Chem., vol. 251, no titre, , p. 5575-5579 (ISSN 0021-9258, lire en ligne [archive]).
- (en) H. J. Weiss et L. M. Aledort, « Impaired platelet-connective-tissue reaction in man after aspirin ingestion », Lancet, vol. 290, no 7514, , p. 495-497 (ISSN 0140-6736, DOI 10.1016/S0140-6736(67)91658-3).
- (en) The Canadian Cooperative Study Group, « A Randomized Trial of Aspirin and Sulfinpyrazone in Threatened Stroke », N. Engl. J. Med., vol. 299, no titre, , p. 53-59 (ISSN 0028-4793, DOI 10.1056/NEJM197807132990201).
- (en) United States District Court for the Southern District of New York (en), « Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921) : Bayer Co contre United Drug Co » [archive], sur cyber.harvard.edu, (consulté le ).
- (en) National Museum of American History, « Bayer-Tablets of Aspirin : Bayer-comprimés d'aspirine » [archive], sur americanhistory.si.edu (consulté le ).
- H. Lévesque et O. Lafont, L'aspirine à travers les siècles : rappel historique, La Revue de médecine interne, 2000 ; 21 Suppl. 1 : 8-17, Éditions scientifiques et médicales Elsevier, 2000, lire en ligne [archive] [PDF], p. 7.
- (en) Société Radio-Canada, « Aspirin: the versatile drug : Aspirine : le médicament polyvalent » [archive], sur cbc.ca, (consulté le ).
- (en) Volker Knappertz, « The dose of aspirin for the prevention of cardiovascular and cerebrovascular events - PubMed », Current medical research and opinion, vol. 22, no 7, , p. 1239–1248 (ISSN 0300-7995, PMID 16892516, DOI 10.1185/030079906x112624, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) M. Jäpel, H. Lötzerich et al., « Role of Acetylsalicylic Acid in Cytokine Stimulation of Macrophages in Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity (ADCC) », Mediators Inflamm., vol. 3, no 6, , p. 419-424 (ISSN 0962-9351, PMCID PMC2365582, DOI 10.1155/S0962935194000591, lire en ligne [archive]).
- (en) C. Härtel, J. Von Puttkamer et al., « Dose-dependent Immunomodulatory Effects of Acetylsalicylic Acid and Indomethacin in Human Whole Blood: Potential Role of Cyclooxygenase-2 Inhibition », Scand. J. Immunol., vol. 60, no 4, , p. 412–420 (ISSN 1365-3083, DOI 10.1111/j.0300-9475.2004.01481.x, lire en ligne [archive]).
- (en) L. Cruz, G. Castañeda-Hernández et al., « Ingestion of chilli pepper (Capsicum annuum) reduces salicylate bioavailability after oral aspirin administration in the rat », Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, vol. 77, no 6, , p. 441-446 (ISSN 0008-4212, DOI 10.1139/y99-032).
- Bhatt DL, Grosser T, Dong JF et al., Enteric coating and aspirin nonresponsiveness in patients with type 2 diabetes mellitus [archive], J. Am. Coll. Cardiol., 2017, 69:603–612.
- (en) Antithrombotic Trialists' Collaboration, « Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients », BMJ, vol. 324, no titre, , p. 71-86 (ISSN 0959-8138, DOI 10.1136/bmj.324.7329.71, lire en ligne [archive]).
- « Bon usage des agents antiplaquettaires » [archive] [PDF], sur has-sante.fr,
- (en) Steering Committee of the Physicians' Health Study Research Group, « Final Report on the Aspirin Component of the Ongoing Physicians' Health Study », N. Engl. J. Med., vol. 321, no 3, , p. 129-135 (ISSN 0028-4793, DOI 10.1056/NEJM198907203210301, lire en ligne [archive]).
- (en) P. M. Ridker, N. R. Cook et al., « A Randomized Trial of Low-Dose Aspirin in the Primary Prevention of Cardiovascular Disease in Women », N. Engl. J. Med., vol. 352, no 13, , p. 1293-1304 (ISSN 0028-4793, DOI 10.1056/NEJMoa050613, lire en ligne [archive]).
- (en) « Malignant melanoma associated with chronic once-daily aspirin exposure in males: A large, single-center, urban, US patient population cohort study from the “Research on Adverse Drug events And Report” (RADAR) project » [archive], sur www.jaad.org, (consulté le )
- (en) « Low-Dose Aspirin for Primary Prevention of Atherosclerotic Events in Patients With Type 2 Diabetes », JAMA, vol. 300, no 18, , p. 2134-2141 (ISSN 0098-7484, PMID 18997198, DOI 10.1001/jama.2008.623, lire en ligne [archive]).
- (en) G. R. Fowkes, J. F. Price et al., « Aspirin for Prevention of Cardiovascular Events in a General Population Screened for a Low Ankle Brachial Index », JAMA, vol. 303, no 9, , p. 841-848 (ISSN 0098-7484, PMID 20197530, DOI 10.1001/jama.2010.221, lire en ligne [archive]).
- Mahmoud AN, Gad MM, Elgendy AY, Elgendy IY, Bavry AA, Efficacy and safety of aspirin for primary prevention of cardiovascular events: a meta-analysis and trial sequential analysis of randomized controlled trials [archive], Eur Heart J, 2019;40:607–617
- Hennekens CH, Schror K, Weisman S, FitzGerald GA, Terms and conditions: semantic complexity and aspirin resistance [archive], Circulation, 2004, 110:1706–1708.
- Gum PA, Kottke-Marchant K, Poggio ED et al., Profile and prevalence of aspirin resistance in patients with cardiovascular disease [archive], Am. J. Cardiol., 2001, 88:230–235.
- Grosser T, Fries S, Lawson JA et al., Drug resistance and pseudoresistance: An unintended consequence of enteric coating aspirin [archive], Circulation, 2013, 127:377-385.
- Simon TG, Duberg AS, Aleman S et al. Association of aspirin with hepatocellular carcinoma and liver-related mortality [archive], N Engl J Med, 2020;382:1018-1028
- (en) D. M. Schreinemachers et R. B. Everson, « Aspirin use and lung, colon, and breast cancer incidence in a prospective study », Epidemiology, vol. 5, no 2, , p. 138-146 (ISSN 1044-3983, lire en ligne [archive]).
- chimioprévention [archive], INRA.
- (en) A. T. Chan, « Aspirin, non-steroidal anti-inflammatory drugs and colorectal neoplasia: future challenges in chemoprevention », Cancer Cause. Control, vol. 14, no 5, , p. 413-418 (ISSN 0957-5243, DOI 10.1023/A:1024986220526, lire en ligne [archive]).
- (en) A. T. Chan, S. Ogino et al., « Aspirin and the risk of colorectal cancer in relation to the expression of COX-2 », N. Engl. J. Med., vol. 356, no 21, , p. 129-135 (ISSN 0028-4793, DOI 10.1056/NEJMoa067208, lire en ligne [archive]).
- (en) U.S. Preventive Services Task Force, « Routine aspirin or nonsteroidal anti-inflammatory drugs for the primary prevention of colorectal cancer: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement », Ann. Intern. Med., vol. 146, no 5, , p. 361-364 (ISSN 0003-4819, PMID 17339621, lire en ligne [archive]).
- Hoffman MK, Goudar SS, Kodkany BS et al. Low-dose aspirin for the prevention of preterm delivery in nulliparous women with a singleton pregnancy (ASPIRIN): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial [archive], Lancet, 2020;395:285-293
- « Low-dose aspirin in a short regimen as standard treatment in in vitro fertilization: a randomized, prospective study » [archive].
- (en) Emmanuel Bujold, « Low-dose aspirin reduces morbidity and mortality in pregnant women at high-risk for preeclampsia », Evid Based Nurs, vol. 18, no 3, , p. 71. (PMID 25743941, DOI 10.1136/ebnurs-2014-101915) modifier.
- Kelly JP, Kaufman DW, Jurgelon JM et al., Risk of aspirin-associated major upper-gastrointestinal bleeding with enteric-coated or buffered product [archive], Lancet, 1996, 348:1413–1416.
- (pt) Sare Drogarias, « Efeitos Colaterais de Somalgin - Ácido Acetilsalicílico: : Effets secondaires de Somalgin - Acide acétylsalicylique : » [archive], sur saredrogarias.com.br (consulté le ).
- G Bochenek, K Bánska, Z Szabó, E Nizankowska et A Szczeklik, « Diagnosis, prevention and treatment of aspirin-induced asthma and rhinitis », Current drug targets. Inflammation and allergy, vol. 1, no 1, , p. 1–11 (PMID 14561202, DOI 10.2174/1568010023345011, lire en ligne [archive]).
- Biorl Acouphènes, « Attention aux médicaments qui provoquent des acouphènes! » [archive], sur biorl.fr, (consulté le ).
- (en) K. M. Starko, « Salicylates and Pandemic Influenza Mortality, 1918–1919 Pharmacology, Pathology, and Historic Evidence », Clin. Infect. Dis., vol. 49, no 9, , p. 1405-1410 (ISSN 1058-4838, DOI 10.1086/606060, lire en ligne [archive]).
- (en) F. A. Lowenheim (dir.) et M. K. Moran (dir.), Faith, Keyes & Clark's industrial chemicals, New York, Wiley-Interscience, , 4e éd.
- (en) T. D. Warner et J. A. Mitchell, « Cyclooxygenase-3 (COX-3): Filling in the gaps toward a COX continuum? », Proc. Natl. Acad. Sci. USA, vol. 99, no 21, , p. 13371-13373 (ISSN 0027-8424, PMID 12374850, DOI 10.1073/pnas.222543099).
- dossier [archive] de ac-nancy-metz.fr, introduction.
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Bibliographie
- Marie Germaine Bousser, L'aspirine, pour ou contre ?, Éd. Le pommier, 2006.
Articles connexes
Liens externes
Sites internet
Bases de données
resurfaçant \ʁə.syʁ.fa.sɑ̃\
- (Cosmétologie) Se dit d'un produit cosmétique qui répare la peau en la lissant.
- Dans ma télé à l'heure de la pub, on me vante les mérites d'une crème resurfaçante tartinée sur les joues d'une vieille (vingt-deux ans à tout casser) qui semble, en effet, impeccablement resurfacée – je ne sais pas quel génie a inventé ce vocabulaire mais j'espère qu'il a été payé correctement. — (Marie-Ange Guillaume, Tout le cimetière en parle, Paris, éditions Le Passage, 2011, page 13)
-
cellule souche
Étymologie
- De cellule (au sens de la biologie) et souche « chose depuis laquelle toute chose peut renaitre ».
Locution nominale
cellule souche \se.lyl suʃ\ féminin
Des cellules souches de souris.
- (Biologie cellulaire, Histologie) Cellule animale ou humaine qui possède les capacités de prolifération, d’autorenouvellement et de différenciation, et qui est à l’origine de lignées cellulaires différenciées.
- Dans une tribune publiée par « Le Monde » (31/3), ces râleurs se plaignent de cette très pieuse fondation, soutenue par le Vatican, qui ne cesse de leur mettre des bâtons dans les roues chaque fois qu’ils veulent lancer des recherches sur les cellules souches embryonnaires. — (H. L., Un embryon de résistance, Le Canard enchaîné, 5 avril 2017, page 8)
Abréviations
Synonymes
Hyperonymes
Hyponymes
Vocabulaire apparenté par le sens
Traductions
Prononciation
Voir aussi
Références
-
Régénération
La régénération, dite aussi parfois régénérescence, est la faculté d'une entité vivante (génome, cellule, organe, organisme, superorganisme, écosystème) à se reconstituer après destruction d'une partie de cette entité.
La régénération peut concerner
- des cellules, des organes ou des parties fonctionnelles de certains êtres vivants, comme (dans une certaine mesure) le foie chez la plupart des vertébrés, dont l'homme.
- des organismes animaux, végétaux, fongiques ou microbiens.
- des organismes simples animaux, qui se régénèrent généralement facilement (exemples : anémone, étoile de mer, hydre, ...).
- des organismes simples (ou plus complexes) végétaux
Certains organismes animaux complexes (dits « supérieurs ») régénèrent certains de leurs organes après amputation. Par exemple une patte amputée de triton se régénère entièrement. Chez les animaux évolués à sang froid, ce sont souvent les membres locomoteurs (triton) ou la queue (lézard) qui peuvent repousser mais non des organes vitaux comme le cerveau, le cœur, le foie, les poumons, etc. Chez les animaux à sang chaud, la peau se régénère particulièrement bien, mais non les organes vitaux (exception accordée au foie capable de se reconstruire partiellement, néanmoins une reconstruction diffère d'une régénération au sens biologique du terme). Les nerfs se régénèrent rarement chez les animaux à sang chaud (sauf le nerf olfactif ?). De nombreuses études portent sur les « cellules totipotentes » et cellules souches, visant à développer des possibilités de régénération chez l'Homme, mais elles se heurtent à de nombreuses difficultés, techniques, biologiques, mais aussi bio-éthiques.
Régénération du génome
Régénération des cellules
Régénération des organismes
Régénération d'un membre
La faculté de régénération nécessite des conditions embryonnaires afin de pouvoir se produire. Ces conditions sont, entre autres, le maintien de caractéristiques larvaires comme l'immaturité du système immunitaire et la présence permanente de cellules souches. D'autres facteurs sont aussi nécessaires à la régénération d'un membre perdu: la ré-expression des glycoprotéines Wnt , la présence d'hydratation et d'acide hyaluronique1. Les seuls vertébrés chez qui ces conditions sont toutes pleinement respectées sont les amphibiens. Ils sont donc caractérisés par une néoténie importante1. Chez les humains, qui sont amniotes, certains gènes en charge de la régénération d'un membre sont présents mais ils ne sont pas exprimés après une blessure 1. En effet, la majeure raison pour cela est que les amniotes ont un système immunitaire très développé. Ainsi, quand un amniote se blesse, il y aura une cicatrisation de la blessure ou amputation au lieu d'une régénération. Ceci est contraire à ce qui se passe chez les amphibiens qui sont anamniotes. De fait, il est possible d'étudier la chronobiologie et la génétique derrière le cycle de régénération chez les amphibiens, plus précisément chez l'Axolotl 2.
Le cycle de régénération d'un membre
Phase 1: Guérison de la lésion (5 jours suivant l'amputation)3
Quelques heures suivant l’amputation du membre, la plaie entame dans la phase « wound healing » ou guérison de la plaie. Afin d’initier le cycle de régénération avec cette phase de guérison, les cellules épithéliales vont envahir le site affecté pour former une mince couche transparente d’épithélium4. Ces cellules épithéliales se multiplieront accompagnées des cellules de Leydig qui servent de protection, le tout pour faire une membrane composée de dix couches3. Un autre facteur démontrant ce processus de guérison est la présence d’un léger blanchiment du tissu épithélial dans la région terminale de la plaie3. Ce changement de couleur est associé à une mort graduelle des tissus présents. Il s’en suit une accumulation de macrophages afin de réduire la distance entre la fine couche d’épithélium aux muscles préexistants3. Cette phagocytose est un élément clé, car elle permet la production de collagène pour faciliter la production de tissu osseux5 .
Phase 2: Dédifférenciation cellulaire (11 jours depuis l'amputation)3
Une fois que la membrane épithéliale se retrouve à proximité de l’os, les cellules épithéliales ne cesseront de se différentier, jusqu'à la maturation du bourgeon. Cette région centrale se voit de plus en plus vascularisée, stimulée par des signaux nerveux amplifiant la multiplication cellulaire3. Une semaine après l’amputation, cette membrane devient significativement plus épaisse ayant maintenant un capuchon d’épithélium apicale (CEA)6. Aussitôt présent, ce capuchon débutera un recrutement de cellule progénitrice poursuivant cette régénération6.
Phase 3: Formation du bourgeon initial (15 jours depuis l'amputation)3
Suite à l’accumulation des cellules progénitrices, ces dernières participeront à la formation d’un blastème, un groupe de cellules qui assurent la régénération d'un membre. Des cellules sénescentes seront aussi formées7. Retrouvée sous le CEA, l’expansion du blastème implique une meilleure acquisition de capacité embryonnaire et de dédifférenciation des cellules qui le compose afin de débuter la croissance du bourgeon6. Il est important de noter que les échanges entre le CEA et le blastème sont primordiaux pour une régénération optimale d’un membre.
Phase 4: Formation du bourgeon moyen (20 jours suivant l'amputation)3
Due à l’innervation du blastème par des facteurs de croissance des fibroblastes (FGF) acheminée par des nerfs, la forme blastème est plus prononcée grâce à sa convexité3,6. Quant au CEA, ce dernier continue de s’épaissir en s’allongeant le long de la couche épithéliale, ressemblant progressivement à un épiderme 3. Du côté basal du blastème, plusieurs masses de cellules à haute densité apparaissent aux alentours de l’os, grâce aux protéines morphogénétiques osseuses (BMP) des vaisseaux sanguins, menant à la création de cartilage6.
Phase 5: Formation du bourgeon final (24 jours suite à l'amputation)3
Puisque la vascularisation se voit riche à ce stade, ceci cause un lobe apical proéminent du blastème marquant la fin du développement du bourgeon3. Cependant, la couche apicale du blastème continue de se différencier en cellules cartilagineuse irriguées par la présence de quelques veines marginales3. Grâce à cette amplification du nombre de cellules cartilagineuse, la formation de cartilage se fait rapidement 3. Pour ce qui est des muscles, leur formation se fait par des cellules musculaires précurseures, mais leur différenciation se fait de façon complexe impliquant plusieurs lignées de cellules dont des cellules mésenchymateuses mononucléaires [archive] ainsi qu’une panoplie de gènes tel que Pax78.
Phase 6: Genèse de la palette (30 jours après l'amputation)3
Une fois le cartilage formé, il y a présence du squelette stylopode puis zeugopode 9. Il est important de savoir que toute différenciation se fait dans le blastème, suivi d’un déplacement cellulaire afin d’atteindre une position génétiquement programmée. Le lobe apical proéminent du blastème régresse et s’aplatit formant ainsi une palette ressemblant au début d’un membre3. À mesure que les cellules cartilagineuses se multiplient, la formation de l’autopode débute9. Concernant le CEA, ses cellules se différentieront en kératinocytes afin de former un épiderme10.
Phase 7: Croissance des doigts
Durant cette dernière phase du cycle de régénération, les cartilages de l’autopode se prolongent formant ainsi les doigts du membre régénéré de l’Axolotl3. À ce stade, les muscles et vaisseaux sanguins sont présents aux extrémités et contribuent à faciliter la croissance normale du membre. Ce cycle de régénération reprend à chaque fois qu’il y a une nouvelle amputation.
Rythmicité biologique de la régénération
Effets de la température et de la lumière
Plusieurs facteurs peuvent affecter l'efficacité de la régénération des membres. Ces facteurs peuvent être internes, comme la présence d'hormones thyroïdiennes et les taux de glucocorticoïdes11. Cependant, parmi ces facteurs, certains sont intrinsèques comme la température et l'exposition à la lumière. Après avoir observé la régénération à différents moments de l'année, Schaubble, chercheur en médecine pathologique, a constaté une croissance plus rapide des membres pendant les saisons avec des périodes de lumière plus longues, comme la fin du printemps et l'été12. En effet, le taux de croissance était plus lent en hiver avec une extension de 0,35cm en 25 jours, alors que les membres des axolotls dans les environnements plus cléments ont crû de 0,61cm; une augmentation de 57% pour le nouveau membre12. Avec l'augmentation du temps d'exposition à la lumière, la température est également entré en jeu. De cette connaissance, nous pouvons déduire qu'une augmentation de la température entraîne une augmentation du taux de régénération13. Puisque ces différences, au niveau du membre, apparaissaient avec le changement de saisons, Schaubble conclut que la régénération d’un membre est en effet cyclique et non due à l’animal lui-même12. La raison pour laquelle les membres ne poussent pas aussi vite pendant les mois ayant moins d’ensoleillement est due à la libération d’une hormone, la mélatonine, qui se montre plus importante lorsque l’animal est exposé à l’obscurité14. Produite par la glande pinéale, la mélatonine est contrôlée par l’horloge interne de l’axolotl. Cette hormone agit comme un inhibiteur de la mitose14. Ayant une activité diurne accrue, la mitose se déroule lorsque les niveaux de mélatonine chutent. Selon les chercheurs, ce phénomène pourrait être une preuve d’un contrôle rythmique entre la présence de mélatonine et l’activité mitotique dans les cellules du blastème de l’axolotl15.
Génétique
Le génome de l’Axolotl est dix fois plus grand que celui de l’humain ce qui cause certaines difficultés pour son étude. Le processus de régénération des membres implique la réactivation du réseau de régulation génique qui permet le développement des membres dans le blastème adulte16. Toutefois, les chercheurs n’ont pas encore tout à fait trouvé comment la régulation génique s’arrête dans un membre mature adulte et comment celle-ci est réactivée suite à une amputation 16.
Une des études qui a été faite pour étudier la génétique de la régénération est celle de Knapp et al. dont le but était d’identifier au moins un gène spécifique relié à l’amputation17. Les Axolotl utilisés dans l'expérience étaient amputés ou blessés et ils étaient placés dans un environnement aquatique propice à leur guérison ou régénération. Les facteurs suivants étaient sous surveillance: la température, le pH et les niveaux d’azote. Les chercheurs ont comparé des échantillons d'un membre amputé et d'un membre simplement blessé17. En comparant l’expression de certains gènes lors de la cicatrisation et de la régénération, seulement 6% de ceux-ci ont montré des modifications d’expression avec une régulation positive plus prononcée lors de la régénération que lors de la cicatrisation des plaies17. Parmi ces gènes se trouvent les gènes reliés au stress-oxydatif. Ils sont généralement plus communs dans la cicatrisation, mais ils ont aussi montré une expression lors de la régénération du membre amputé. En effet, la plupart des gènes importants sont surtout en lien avec les étapes primaires de régénération qui incluent la dédifférenciation et la formation du blastème.
Un aspect important concernant le rythme dans la régénération concerne la mémoire des cellules du blastème. En effet, ces cellules se «souviennent» de leur fonction antérieure avant que le membre ne se fasse amputer. Ces cellules vont se différencier sur une période rythmique d’environ 90 jours pour reformer totalement le membre comme il était au départ 18. Elles vont donc acquérir de nouveau les fonctions de l’os, du muscle, de la peau, du cartilage, etc. Ainsi, avec cette information sur la position, ces cellules du blastème vont interagir et communiquer entre elles en suivant le modèle de coordonnées polaire de régénération 18. Avec ce modèle, les cellules connaissent leur position par rapport aux axes de circonférences du membre amputé et seront guidés encore selon un rythme de division18. Il y a encore peu de recherches qui ont été faites sur l'exactitude des mécanismes chronobiologiques de la régénération chez l’Axolotl.
Toutefois, les chercheurs supposent qu’il y aurait tout de même une horloge qui contrôle le rythme du cycle cellulaire lors de la formation du blastème. Ainsi, la division cellulaire (mitose) serait contrôlée par un rythme où les phases G1, S, G2 et M ont des régulations différentes. 17Ainsi, on voit une rythmicité dans l’expression de chaque phase lors de la régénération. Les chercheurs déduisent donc l'importance de cette horloge interne puisque la régénération du membre ne pourrait pas avoir lieu sans la mitose qui est contrôlée de façon rythmique.18 Ainsi, les phases G1 et S ont montré une expression prononcée à partir de 24h après l’amputation avec un pic à 72 heures. Pour les phases G2 et M, leur pic d’expression était autour de 120h après l’amputation. On peut donc conclure que cette apparition précoce de la prolifération cellulaire est associée à une lésion tissulaire.17 On observe également une expression plus tardive du régulateur du cycle cellulaire. Ceci correspond à l’accumulation des cellules qui forment le blastème. Il y a donc un rythme relié à la régénération qui fait en sorte de modifier les patrons de divisions cellulaires. 17
Des micro-ARN jouent aussi un rôle essentiel dans le rythme et le contrôle de l'expression des gènes reliés à la régénération19. Un des gènes importants parmi ceux-ci fait partie de la famille Wnt (Wnt/b-catenin) dont la rythmicité est présente durant les 3 à 24 premières heures après l’amputation17. Une autre famille de gènes a aussi montré une expression importante lors de la régénération: les facteurs de croissance des fibroblastes (FGF)17. Par exemple, les gènes Fgf8 et Fgf10 sont essentiels pour la croissance et la structure du bourgeon du membre amputé. Ils jouent un rôle crucial dans la formation de l’ectoderme et des composants du mésenchyme17. Plus précisément, en comparant l'expression du gène Fgfs10 dans l'échantillon amputé et dans l'échantillon blessé, ce gène a montré une forte régulation 24 heures après l'événement spécifique (l'amputation ou la simple blessure). Cette hausse de régulation était plus prononcée dans l'échantillon amputé que dans celui avec une simple blessure17.
Une panoplie d'autres gènes ont été identifiés comme étant spécifiques à la régénération d'un membre chez l'Axolotl17. Ces gènes montrent généralement tous une prédominance à un moment précis pour ensuite ne plus être exprimé après la régénération complète du membre amputé. Plusieurs méthodes génétiques, moléculaires et mathématiques sont ainsi utilisées dans le but de comprendre la génétique derrière ce cycle de régénération17. En passant par l'hybridation in situ, la méthode de CRISPR/Cas9 et la méthode d'analyse ANOVA, le mécanisme de régénération chez l'Axolotl reste d'une grande utilité non seulement pour les espèces semblables, mais également pour l'Humain dans des cas d'études sur le cancer, par exemple1,17.
Régénération des superorganismes
Régénération écologique
Les écosystèmes peuvent généralement dans une certaine mesure et avec un certain délai également se régénérer, dans un processus dit de résilience écologique impliquant notamment les espèces pionnières (bactéries, algues, champignons et lichens, puis mousses et végétation pionnière, puis strates herbacée et arborée..) qui jouent en quelque sorte un premier rôle de stabilisation et cicatrisation du système après une perturbation. Une prairie scrappée ou brûlée par un incendie peut se régénérer en quelques années, alors qu'il faut plusieurs milliers d'années à une forêt tropicale humide pour retrouver sa composition antérieure.
Design de la régénération
La sortie du livre Designing Regenerative Cultures de Daniel Christian Wahl20, les travaux du groupe Regenesis21 ou encore de la School of Regerenative Design22 transforme le concept de régénération et tente de comprendre les applications que celui-ci pourrait avoir comme outil de design holistique pouvant être utilisé à une multitude de niveaux dans nos sociétés contemporaines. Cette vision nécessiterait la réintégration de l'humain et de la société comme faisant partie intégrante de la nature et des écosystèmes21.
Notes et références
- (en) Lorenzo Alibardi, « Review: Limb regeneration in humans: Dream or reality? », Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger, vol. 217, , p. 1–6 (ISSN 0940-9602, DOI 10.1016/j.aanat.2017.12.008, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) Warren A. Vieira, Kaylee M. Wells et Catherine D. McCusker, « Advancements to the Axolotl Model for Regeneration and Aging », Gerontology, vol. 66, no 3, , p. 212–222 (ISSN 0304-324X et 1423-0003, PMID 31779024, PMCID PMC7214127, DOI 10.1159/000504294, lire en ligne [archive], consulté le )
- Patrick W. Tank, Bruce M. Carlson et Thomas G. Connelly, « A staging system for forelimb regeneration in the axolotl,Ambystoma mexicanum », Journal of Morphology, vol. 150, no 1, , p. 117–128 (ISSN 0362-2525, DOI 10.1002/jmor.1051500106, lire en ligne [archive], consulté le )
- Mathieu Lévesque, Éric Villiard et Stéphane Roy, « Skin wound healing in axolotls: a scarless process », Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution, vol. 314B, no 8, , p. 684–697 (ISSN 1552-5007, DOI 10.1002/jez.b.21371, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en-US) « Macrophages Essential to Limb Regeneration in the Axolotl Emerge from the Liver » [archive], sur Fight Aging!, (consulté le )
- (en) Aydın Bölük, Mervenur Yavuz et Turan Demircan, « Axolotl: A resourceful vertebrate model for regeneration and beyond », Developmental Dynamics, vol. 251, no 12, , p. 1914–1933 (ISSN 1058-8388 et 1097-0177, DOI 10.1002/dvdy.520, lire en ligne [archive], consulté le )
- Qinghao Yu et Hannah E. Walters, « Cellular senescence modulates progenitor cell expansion during axolotl limb regeneration » [archive], sur dx.doi.org, (consulté le )
- (en) Ji-Feng Fei, Maritta Schuez, Dunja Knapp et Yuka Taniguchi, « Efficient gene knockin in axolotl and its use to test the role of satellite cells in limb regeneration », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 114, no 47, , p. 12501–12506 (ISSN 0027-8424 et 1091-6490, PMID 29087939, PMCID PMC5703281, DOI 10.1073/pnas.1706855114, lire en ligne [archive], consulté le )
- Guimond, Jean-Charles, auteur., Analyse fonctionnelle du gène BMP-2 lors de la régénération du membre chez l'axolotl (OCLC 1101192990, lire en ligne [archive])
- Akira Satoh, Susan V. Bryant et David M. Gardiner, « Nerve signaling regulates basal keratinocyte proliferation in the blastema apical epithelial cap in the axolotl (Ambystoma mexicanum) », Developmental Biology, vol. 366, no 2, , p. 374–381 (ISSN 0012-1606, DOI 10.1016/j.ydbio.2012.03.022, lire en ligne [archive], consulté le )
- Julia Losner, Katharine Courtemanche et Jessica L. Whited, « A cross-species analysis of systemic mediators of repair and complex tissue regeneration », npj Regenerative Medicine, vol. 6, no 1, (ISSN 2057-3995, DOI 10.1038/s41536-021-00130-6, lire en ligne [archive], consulté le )
- Muriel K. Schauble, « Seasonal variation of newt forelimb regeneration under controlled environmental conditions », Journal of Experimental Zoology, vol. 181, no 2, , p. 281–286 (ISSN 0022-104X et 1097-010X, DOI 10.1002/jez.1401810215, lire en ligne [archive], consulté le )
- Henry E. Young, Claudia F. Bailey et Bernell K. Dalley, « Envirnmental conditions prerequisite for complete limb regeneration in the postmetamorphic adult land-phase salamander,Ambystoma », The Anatomical Record, vol. 206, no 3, , p. 289–294 (ISSN 0003-276X et 1097-0185, DOI 10.1002/ar.1092060307, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) C. Eberhardt Maier et Marcus Singer, « The effect of light on forelimb regeneration in the newt », Journal of Experimental Zoology, vol. 202, no 2, , p. 241–244 (ISSN 0022-104X et 1097-010X, DOI 10.1002/jez.1402020213, lire en ligne [archive], consulté le )
- Keith J. Johnson et Steven R. Scadding, « Effects of tunicamycin on retinoic acid induced respecification of positional values in regenerating limbs of the larval axolotl, Ambystoma mexicanum », Developmental Dynamics, vol. 193, no 2, , p. 185–192 (ISSN 1058-8388, DOI 10.1002/aja.1001930210, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) Siegfried Schloissnig, Akane Kawaguchi, Sergej Nowoshilow et Francisco Falcon, « The giant axolotl genome uncovers the evolution, scaling, and transcriptional control of complex gene loci », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 118, no 15, , e2017176118 (ISSN 0027-8424 et 1091-6490, PMID 33827918, PMCID PMC8053990, DOI 10.1073/pnas.2017176118, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) Dunja Knapp, Herbert Schulz, Cynthia Alexander Rascon et Michael Volkmer, « Comparative Transcriptional Profiling of the Axolotl Limb Identifies a Tripartite Regeneration-Specific Gene Program », PLOS ONE, vol. 8, no 5, , e61352 (ISSN 1932-6203, PMID 23658691, PMCID PMC3641036, DOI 10.1371/journal.pone.0061352, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) Catherine McCusker, Susan V. Bryant et David M. Gardiner, « The axolotl limb blastema: cellular and molecular mechanisms driving blastema formation and limb regeneration in tetrapods: The Axolotl Limb Blastema », Regeneration, vol. 2, no 2, , p. 54–71 (PMID 27499868, PMCID PMC4895312, DOI 10.1002/reg2.32, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) Haitham G. Abo‐Al‐Ela et Mario A. Burgos‐Aceves, « Exploring the role of microRNAs in axolotl regeneration », Journal of Cellular Physiology, vol. 236, no 2, , p. 839–850 (ISSN 0021-9541 et 1097-4652, DOI 10.1002/jcp.29920, lire en ligne [archive], consulté le )
- Wahl, Daniel Christian, author., Designing regenerative cultures, , 312 p. (ISBN 978-1-909470-78-1 et 1-909470-78-3, OCLC 990007226, lire en ligne [archive])
- (en) Pamela Mang et Ben Haggard, Regenerative Development, , 272 p. (ISBN 978-1-118-97286-1, DOI 10.1002/9781119149699, lire en ligne [archive])
- (en-US) « Home » [archive], sur School of Regenerative Design (consulté le )
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Liens externes
-
Mercure (chimie)
Cet article concerne l'élément chimique, le corps simple et les composés correspondants. Pour les autres significations, voir Mercure.
| Mercure |

Mercure liquide à température ambiante |
| |
|
|
| Position dans le tableau périodique |
|---|
| Symbole |
Hg |
|---|
| Nom |
Mercure |
|---|
| Numéro atomique |
80 |
|---|
| Groupe |
12 |
|---|
| Période |
6e période |
|---|
| Bloc |
Bloc d |
|---|
| Famille d'éléments |
Métal pauvre ou métal de transition |
|---|
| Configuration électronique |
[Xe] 4f14 5d10 6s2 |
|---|
| Électrons par niveau d’énergie |
2, 8, 18, 32, 18, 2 |
|---|
| Propriétés atomiques de l'élément |
|---|
| Masse atomique |
200,59 ± 0,02 u1 |
|---|
| Rayon atomique (calc) |
150 pm (171 pm) |
|---|
| Rayon de covalence |
132 ± 5 pm2 |
|---|
| Rayon de van der Waals |
155 pm |
|---|
| État d’oxydation |
2, 1 |
|---|
| Électronégativité (Pauling) |
2,00 |
|---|
| Oxyde |
Base faible |
|---|
| Énergies d’ionisation3 |
|---|
| |
| 1re : 10,437 5 eV |
2e : 18,756 8 eV |
| 3e : 34,2 eV |
| Isotopes les plus stables |
|---|
| |
|
|
| Propriétés physiques du corps simple |
|---|
| État ordinaire |
Liquide |
|---|
| Masse volumique |
13,546 g·cm-3 (20 °C)1 |
|---|
| Système cristallin |
Trigonal-rhomboédrique |
|---|
| Dureté (Mohs) |
1,5 |
|---|
| Couleur |
Argenté blanc |
|---|
| Point de fusion |
−38,842 °C4 |
|---|
| Point d’ébullition |
356,62 °C1 |
|---|
| Énergie de fusion |
2,295 kJ·mol-1 |
|---|
| Énergie de vaporisation |
59,11 kJ·mol-1 (1 atm, 356,62 °C)1 |
|---|
| Température critique |
1 477 °C1 |
|---|
| Point triple |
−38,834 4 °C5, 1,65×10−4 Pa |
|---|
| Volume molaire |
14,09×10-6 m3·mol-1 |
|---|
| Pression de vapeur |
0,001 63 mbar (20 °C)
0,003 73 mbar (30 °C)
0,016 96 mbar (50 °C)4
|
|---|
| Vitesse du son |
1 407 m·s-1 à 20 °C |
|---|
| Chaleur massique |
138,8 J·kg-1·K-1 |
|---|
| Conductivité électrique |
1,04×106 S·m-1 |
|---|
| Conductivité thermique |
8,34 W·m-1·K-1 |
|---|
| Solubilité |
sol. dans HNO36 |
|---|
| Divers |
|---|
| No CAS |
7439-97-6 |
|---|
| No ECHA |
100.028.278 |
|---|
| No CE |
231-106-7 |
|---|
| Précautions |
|---|
| SGH4 |
|---|
|
H330, H360D, H372, H410, P201, P273, P304+P340 et P308+P310
|
| SIMDUT7 |
|---|
 
D1A, D2A, E,
|
| Transport4 |
|---|
|
|
|
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. |
modifier  |
Le mercure est l'élément chimique de numéro atomique 80, de symbole Hg.
Le corps simple mercure est un métal, liquide et peu visqueux dans les conditions normales de température et de pression. On l'a appelé vif-argent jusqu'au début du XIXe siècle.
Le mercure (métallique) a longtemps été utilisé dans divers médicaments, dans les thermomètres et les batteries, avant d'être interdit (en France en 1999) car trop toxique. En 2021, il serait encore dans le monde la cause de 250 000 cas de déficience intellectuelle par an8, principalement via l'ingestion de produits de la mer8.
Généralités
Le mercure est un élément du groupe 12 et de la période 6. Stricto sensu, c'est un métal pauvre, qui ne répond pas à la définition des éléments de transition par l'Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC)9 ; en pratique cependant, il est très souvent assimilé aux métaux de transition dans les manuels et de très nombreux ouvrages. Le groupe 12 est également appelé « groupe du zinc », ou groupe IIB, et comprend, par numéro atomique croissant, 30Zn, 48Cd et 80Hg, éléments caractérisés par deux électrons sur la sous-couche s au-delà d'une sous-couche d complète. La configuration électronique du mercure est [Xe] 4f14 5d10 6s2. Dans ce groupe ordonné, la réactivité décroît, le caractère noble et/ou covalent est plus marqué. Le corps simple mercure presque noble peut être mis à part.
Le corps simple mercure est un métal argenté brillant, le seul se présentant sous forme liquide dans les conditions normales de température et de pression sans phénomène de surfusion, conditions dans lesquelles il possède une tension de vapeur non négligeable car au-delà, il se vaporise assez aisément.
Le mercure apparaît comme un puissant neurotoxique et reprotoxique sous ses formes organométalliques (monométhylmercure et diméthylmercure), de sels (calomel, cinabre, etc.) et sous sa forme liquide en elle-même. L'intoxication au mercure est appelée « hydrargisme » (voir également Maladie de Minamata). On le soupçonne également d'être une des causes de la maladie d'Alzheimer, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et d'autres maladies chroniques10. En 2009, le Conseil d’administration du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) a décidé d’élaborer un instrument juridiquement contraignant sur le mercure, sous forme de traité international ; le Comité de négociation intergouvernemental chargé d'élaborer cet instrument juridique s'est réuni en janvier 2011 au Japon puis à Nairobi fin octobre 201111(INC3, pour Intergovernmental Negotiating committee)12,13.
Étymologie
Jusqu'au XIXe siècle, deux termes synonymes, vif-argent et mercure, furent employés concurremment avant que la normalisation de la nomenclature chimique n'impose le dernier à partir de 1787.
Le symbole du mercure, Hg, fait référence à son nom latin, hydrargyrum.
Ancienne dénomination : vif-argent
Le nom en ancien et moyen français de ce corps chimique, liquide dense et remarquablement mobile est le vif-argent.
Le mercure se trouve dans la nature essentiellement sous forme d'un minerai de sulfure de mercure (α-HgS), nommé cinabre. On en tire une poudre de couleur rouge vermillon qui a été utilisée comme pigment pour la confection de céramiques, de fresques murales, de tatouages et lors de cérémonies religieuses. Les plus anciennes attestations archéologiques se trouvent en Turquie (Çatalhöyük, -7000, -8000), en Espagne (mine Casa Montero et tombes de La Pijota et de Montelirio, -5300) puis en Chine (culture Yangshao -4000, -3500)14.
En Grèce, Théophraste (-371, -288) a écrit le premier ouvrage savant sur les minéraux De Lapidus15 dans lequel il décrit l'extraction du cinabre (gr:κινναβαρι, kinnabari) par des lavages successifs et la production de vif-argent (χυτὸν ἄργυρον, chytón árgyron) en broyant avec un pilon d’airain le cinabre avec du vinaigre16. Au premier siècle, Dioscoride décrit la technique de calcination d'une cuillerée de cinabre placée dessous un récipient sur lequel se dépose la vapeur de mercure (De materia medica17, V, 95). Dioscoride qui écrit en grec ancien, nomme le mercure ainsi obtenu ὑδράργυρος, hydrárgyrosa, « argent liquide » en raison de son aspect.
À la même époque, le Romain Pline, décrit la même technique de sublimation du minerai pour obtenir de l'hydrargyrus (terme latin dérivé du grec ancien), expression qui en français deviendra hydrargyre. En 1813-1814, Berzelius choisira le symbole chimique Hg, sigle composé de l'initiale des deux morphèmes Hydrar et Gyrus pour désigner l'élément mercure. Pline distingue l'hydrargyrus de la forme native du métal qu'il nomme vicem argenti qui en français donnera vif-argent (Pline, H.N., XXXIII, 12318,19). En français, le terme « vif-argent » apparaît dans une chanson de geste mise par écrit vers 1160, Le Charroi de Nîmes. Cette appellation va être utilisée jusqu'au début du XIXe siècle.
La nouvelle dénomination : mercure
Dès l'Antiquité, les philosophes néoplatoniciens et astrologues gréco-romains ont associé les sept métaux aux couleurs, aux divinités et aux astres : l'or au Soleil, l'argent à la Lune, le cuivre à Vénus, le fer à Mars, etc. Après la découverte de la technique d'extraction du vif-argent, ils attribuèrent ce métal extravagant, mi-liquide mi-solide, à l'androgyne Mercure20.
Les alchimistes européens du XIIIe siècle utilisent concurremment les deux appellations en latin. Le Pseudo-Geber dans son ouvrage Summa perfectionis parle de argento vivo ou Mercurio21. Ce double usage se perpétuera chez les chimistes des siècles suivants jusqu'à la grande réforme de la nomenclature proposée par Guyton de Morveau, Lavoisier et al. dans Méthode de nomenclature chimique de 1787. Ils choisiront mercure un terme simple (non composé sur le plan morphologique) associé à un corps simple (non décomposable sur le plan chimique).
Isotopes
Le mercure a 40 isotopes connus, dont plusieurs isotopes stables éventuellement utilisables pour des analyses isotopiques ou un traçage isotopique22.
Il a aussi des isotopes radioactifs instables (31 de ses 40 isotopes, dont seulement 4 ont une période supérieure à la journée)22. Seul le 203Hg a, selon l'IRSN22, des applications pratiques comme traceur isotopique.
Le mercure 203 (203Hg) est produit par les centrales nucléaires ou le retraitement des déchets nucléaires22 ; il est recherché et dosé par spectrométrie gamma. Sa période radioactive est de 46,59 jours, pour une activité massique de 5,11 × 1014 Bq.g−1. Son émission principale par désintégration est de 491 keV (avec 100 % de rendement d’émission)(Nuclides 2000, 199922).
Le mercure radioactif a été évalué dans les effluents gazeux de l'usine de La Hague (de 1966 à 1979) à 2 MBq.an−1 à 4 GBq.an−1). On l'a aussi dosé dans l'atmosphère de réacteurs de recherche au CEA23.
Selon l'IRSN, « les rejets de radioisotopes de mercure ne conduisent pas à leur détection dans l’environnement ». Faute de données concernant la cinétique et les effets du 203Hg dans l’environnement, on estime généralement qu'il se comporte comme le mercure élémentaire stable (sachant que du mercure élémentaire stable a été très utilisé par l'industrie nucléaire, en particulier pour la production d’armes nucléaires, notamment des années 1950 à 1963 aux États-Unis, où on le retrouve dans les sols et les eaux qu'il a pollués24.
Occurrence en géochimie, minerai, métallurgie, récupération du mercure métal
Le mercure est un élément assez rare : son clarke est compris entre 0,05 et 0,08 g/t25.
On trouve le mercure sous forme d'un corps simple comme le mercure natif, d'ions et de composés à l'état oxydé, plus fréquemment sous forme de sulfures, tels que le sulfure de mercure (HgS) de couleur rouge vermillon, nommé cinabre en minéralogie, et plus rarement sous forme d'oxydes ou de chlorures. Le cinabre est son principal minerai.
Du mercure est naturellement présent dans l'environnement, mais essentiellement dans les roches du sous-sol. Les principales sources naturelles d'émission dans l'environnement en sont les volcans26 puis les activités industrielles.
Aujourd'hui, une grande partie du mercure utilisé légalement (ou illégalement pour l'orpaillage illégal) provient de la récupération de mercure interdit pour certains usages, ou d'une production secondaire (condensats de grillages de minerais complexes dont ceux du zinc) (blende ou sphalérite)27. En Europe, Avilés (Asturies, en Espagne), est une des grandes zones productrices, avec une production annuelle de plusieurs centaines de flacons par an (l'industrie du mercure nomme flacon un container d'acier contenant 34,5 kg de mercure)27.
Gisements
Propriétés physiques et chimiques, préparation du corps simple, alliages
Goutte de mercure dans un
bécher.
Le corps simple mercure est un métal blanc et très brillant, liquide à température ordinaire. Ce liquide, très mobile (faible viscosité) et très dense (masse volumique : 13,6 g/cm3b), se solidifie à −39 °C.
Propriétés physiques et chimiques du corps simple Hg
Sous les conditions normales de température et de pression, c'est le seul métal à l'état liquide sans phénomène de surfusionc (le seul autre corps simple à l'état liquide dans des conditions atmosphériques de pression et de température est le brome, un halogène). Notons également qu'il s'agit du seul métal dont la température d'ébullition est inférieure à 650 °C. Le point triple du mercure, à −38,834 4 °C, est un point fixe de l'échelle internationale des températures (ITS-90).
Les vapeurs de mercure sont nocives. Le mercure est le seul élément en dehors des gaz rares à exister sous forme de vapeur monoatomique. Une bonne approximation de la pression de vapeur saturante p* du mercure est donnée en kilopascals par les formules suivantes :
- log p ⋆ = 7,149 − 3212 , 5 T
 entre 273 et 423 K ;
entre 273 et 423 K ;
- log p ⋆ = 7,003 − 0,000 197 ( T − 273 ) − 3141 , 33 T
 entre 423 et 673 K.
entre 423 et 673 K.
Le mercure n'est pas soluble dans les acides aqueux, en particulier les acides oxydants.
Amalgames
Le mercure forme facilement des alliages avec presque tous les métaux communs à l'exception du fer, du nickel et du cobalt. L'alliage est également difficile avec le cuivre, le platine et l'antimoine.
Ces alliages sont communément appelés amalgames. Cette propriété du mercure a de nombreux usages.
Stockage
Le mercure dit « vierge » (pur à 99,9 %) réagit avec de nombreux métaux en les dissolvant, voire en produisant une flamme ou en dégageant une forte chaleur (s'il s'agit de métaux alcalins).
Certains métaux résistent mieux à la dissolution et à l'amalgamation, ce sont le vanadium, le fer, le niobium, le molybdène, le tantale et le tungstène. Le mercure peut aussi attaquer les plastiques en formant des composés organomercuriels29. En outre, il est très lourd.
Il doit donc être manipulé avec soin, et stocké avec certaines précautions ; généralement dans de solides contenants spéciaux (dits flasques ou flacons) de fer ou d'acier. Les petites quantités sont parfois stockées dans des flacons spéciaux de verre, protégées par une coque de plastique ou de métal.
Le mercure très pur (dit « mercure électronique » ; pur à 99,99999 %) doit obligatoirement être conditionné en ampoules scellées de verre blanc neutre dit « de chimie ».
Chimie du mercure, propriétés physiques et chimiques des corps composés et complexes
Dans le groupe du zinc, le mercure se distingue par une certaine noblesse ou inertie chimique. L'ionisation est peu notable et plus rare. Les sels de mercure sont souvent anhydres.
Chimie du mercure
Le mercure existe à divers degrés d'oxydation :
- 0 (mercure métallique) ;
- I (ion mercureux Hg22+, Hg2SO4) ;
- II (ion mercurique Hg2+, HgO, HgSO3, HgI+, HgI2, HgI3−, HgI42−).
Le mercure métallique n'est pas oxydé à l'air sec. Cependant, en présence d'humidité, le mercure subit une oxydation. Les oxydes formés sont Hg2O à température ambiante, HgO entre 573 K (300 °C) et 749 K (476 °C). L'acide chlorhydrique (HCl) et l'acide sulfurique (H2SO4) dilué n'attaquent pas le mercure élémentaire. En revanche, l'action de l'acide nitrique (HNO3) sur le mercure Hg produit HgNO3. L'eau régale attaque également le mercure : du mercure corrosif HgCl2 est alors produit.
Combinaison du mercure : sulfures de mercure, mercaptans
avec le soufre : sulfures de mercure, mercaptans
Le mercure tend à former des liaisons covalentes avec les composés soufrés. D'ailleurs, les thiols (composés comportant un groupe -SH lié à un atome de carbone C) étaient autrefois nommés mercaptans, du latin « mercurius captans ». Cette affinité entre le mercure et le soufre peut s'expliquer dans le cadre du principe HSAB car, par exemple, le méthylmercure est un acide très mou, de même que les composés soufrés sont des bases très « molles ».
Utilisations et applications du corps simple, des alliages et des composés
Des composés mercuriques servent comme fongicides et bactéricides, notamment le Thimerosal médiatisé pour sa présence dans les vaccins ou le Panogen qui avait été par hypothèse, incriminé dans l'affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit.
La synthèse du chlore en Europe passe souvent par l'utilisation de cellules à cathode de mercure.
En santé/médecine :
- Les produits organo-mercuriels : mercurochrome, Mercryl Laurylé30. Le mercurochrome ou merbromine, qui est un antiseptique, contient du mercure. Ce produit, depuis 2006, n'est plus commercialisé en France et aux États-Unis.
- Le mercure entre dans la composition des amalgames dentaires (couramment appelés plombages bien que ne contenant pas de plomb), dans une proportion variant entre 45 et 50 % du poids.
- Jusqu'au début du XXe siècle, le mercure était utilisé dans le traitement de la syphilis.
Certaines piles contiennent du mercure. Les piles salines et alcalines ont longtemps contenu du mercure à hauteur de 0,6 % pour les piles salines, 0,025 % pour les autres. Quant aux piles boutons, elles mettent parfois en jeu les couples Zn2+/Zn et Hg2+/Hg.
La réaction en fonctionnement est : Zn + HgO + H2O + 2 KOH → Hg + [Zn(OH)4]K2
Le mercure est utilisé dans les lampes à mercure et à iodure métallique sous haute pression à la forme atome. Les lampes fluorescentes à vapeur de mercure contiennent environ 15 mg de mercure gazeux. La réglementation RoHS impose depuis 2005 une quantité maximale de 5 mg. En 2009, plusieurs fabricants ont réussi à abaisser la quantité à 2 mg.
On notera que le mercure est initialement sous forme d'oxyde. Pour les piles de « type bouton » répondant à ce modèle, 1/3 du poids de la pile est dû au mercure. Dans leur grande majorité cependant, les piles boutons utilisent de l'oxyde d'argent à la place de l'oxyde de mercure ; elles contiennent alors entre 0,5 et 1 % de mercure.
Le mercure a longtemps été utilisé comme fluide dans les thermomètres du fait de sa capacité à se dilater avec la température. Cet usage a été abandonné, et les thermomètres à mercure interdits du fait de la toxicité du mercure.
Le mercure est utilisé dans les contacts des détecteurs de niveau (poire de niveau) dans les fosses qui ont une pompe de relevage ou une alarme de niveau (~4 g de mercure par contact).
Le mercure est utilisé dans les systèmes rotatifs des lentilles de phares permettant l'absence de frottement et la grande régularité du mouvement de rotation de ces systèmes sur leurs socles tout en permettant l'alimentation électrique (deux cuves concentriques)31.
Le mercure est couramment utilisé dans l'orpaillage afin d'amalgamer l'or et de l'extraire plus aisément.
Le mercure est encore présent en septembre 2015 dans certains tensiomètres utilisés dans les cabinets médicaux.
Les qualités du mercure pour la chimie nucléaire et les instruments de mesure en font l'une des huit matières premières stratégiques considérées comme indispensables en temps de guerre comme en temps de paix32.
Le mercure est utilisé dans certaines mines artisanales.
- Des composés à base de mercure ont été et sont encore utilisés pour le traitement des semences.
- Les amalgames dentaires (plombages) sont composés d'environ 50 % de mercure.
- Le mercure est utilisé en homéopathie (mercurius solubilis).
- Le mercure est encore utilisé dans la fabrication de thermostat à basse tension, comme conducteur.
- La vapeur de mercure est utilisée dans la fabrication de lampes fluorescentes, comme conducteur.
Recyclage
Aspects environnementaux : données sur la toxicité et les pollutions de ce métal lourd
Ce métal, parmi les plus toxiques est très mobile dans l'environnement car volatil à température ambiante (y compris à partir de l'eau ou de sols pollués33). Il s'intègre facilement dans la matière organique et les processus métaboliques (sous forme méthylée). Certaines sources (naturelles ou anthropiques) de mercure peuvent être – dans une certaine mesure – tracées par des analyses isotopiques34. On cherche des solutions permettant de mieux et plus durablement le solidifier et/ou l'inerter35.
Toxicologie
Contrairement aux oligo-éléments, le mercure est toxique et écotoxique quelle que soit sa dose, sous toutes ses formes organiques et pour tous ses états chimiques.
Il est bioaccumulable ; Björkman & al. (2007) ont trouvé des taux sanguins médians de mercure inorganique de 1,0 μg/L et de MeHg (Hg total moins mercure inorganique) de 2,2 et ; et dans le cortex du lobe occipital ces taux étaient respectivement de 5 et 4 μg/kg, respectivement. Ils ont observé une corrélation significative entre le MeHg sanguin et du cortex occipital. Le Hg total des ongles d'orteils était également corrélé au MeHg dans le sang et le lobe occipital. Les auteurs observent qu'au moment de la mort, les taux de mercure inorganique(I-Hg) retrouvé dans le sang et dans le cortex occipital, ainsi que ceux de « mercure total » dans l'hypophyse et la thyroïde étaient fortement associés à la surface d'amalgame dentaire dans la bouche au moment du décès36.
Sa toxicité dépend notamment de son degré d'oxydation.
- Au degré 0, il est très toxique sous forme de vapeur ;
- Les ions de mercure II sont bien plus toxiques que les ions de mercure I.
Mercure métallique solide
Une fois ingéré, cette forme du mercure est faiblement absorbé dans le tractus gastro-intestinal (moins de 10 % y sont absorbés, sauf si du mercure pénètre et stagne dans l'appendice où il pourra être source de méthylmercure). Une fois dans le sang, il passe cependant dans le cerveau et le fœtus37. Dans le corps, le mercure métallique est oxydé en mercure mercurique, qui se lie aux groupes sulfhydryle réduits qui cible le rein37.
Mercure métallique vapeur
Inhalées, environ 70 à 80 % de ces vapeurs de mercure métallique sont retenues et absorbées via les voies respiratoires et le système sanguin37 (la vapeur de mercure se solubilise facilement dans le plasma, le sang et l’hémoglobine) ; Ainsi transporté, le mercure cible ensuite les reins, le cerveau et le système nerveux. Chez la femme enceinte, il traverse facilement le placenta et atteint le fœtus. Après la naissance un risque perdure puisque le lait maternel humain est aussi contaminé38. L'exposition intense aux vapeurs de mercure métallique, induit des lésions pulmonaires alors que l'ingestion d'une quantité suffisante de mercure mercurique conduit à une nécrose tubulaire gastro-intestinale et rénale 37.
L'exposition chronique au mercure métallique induit une encéphalopathie et des lésions rénales ; et l'exposition chronique au mercure mercurique provoque des lésions tubulaires rénales37. Une glomérulonéphrite d'origine immunologique peut aussi survenir.
Chlorure mercurique
Chez le rat, il peut provoquer une immunosuppression37, mais il a été montré que son effet de dépression immunitaire varie considérablement selon les souches de rongeurs.
Le mercure inorganique est une cause de dermatite de contact allergique37.
Certains composés du sélénium affectent la cinétique des composés inorganiques et du méthylmercure et ont un effet protecteur contre leur toxicité37.
Méthylmercure
Des bactéries (du sédiment ou de l'intestin) convertissent une partie du mercure dissous, essentiellement en monométhylmercure HgCH3.
- Sous cette forme, le mercure est très neurotoxique et bio-accumulable. Même à faible dose, il a un effet cytotoxique sur les cellules souches du système nerveux central (de même que de faibles doses de plomb ou de paraquat)39. Selon l'IARC (1997) : « les composés de méthylmercure induisent des effets néfastes sur le développement humain - notamment la microcéphalie et les déficits du développement neurologique. Des effets similaires ont été démontrés chez de nombreuses espèces de laboratoire. Le conceptus semble être plus sensible que l'organisme maternel. Les niveaux de dose des composés de méthylmercure qui affectent la reproduction et le développement sont généralement inférieurs à ceux du mercure inorganique et affectent un plus large éventail de paramètres »37.
- Il se concentre surtout dans la chaîne alimentaire aquatique ; la consommation de fruits de mer (filtreurs comme les moules) et de poissons prédateurs (thon, marlin, espadon, requin, etc.) représente une source majeure d'exposition et de risque pour l'homme, en particulier pour les enfants et les femmes enceintes40.
- Le système nerveux est le principal organe cible des composés de méthylmercure, mais il existe des différences interspécifiques; chez certaines espèces, il y a aussi des effets sur les reins37.
Pour toutes ces raisons, l'usage du mercure est réglementé, et beaucoup de ses anciens usages sont peu à peu interdits, dont dans l'Union européenne où depuis les années 2000 des directives limitent de plus en plus la vente d'objets en contenant. Exemple : La France interdit la vente des thermomètres au mercure depuis 1998 et leur utilisation dans les établissements de santé depuis 199941.
Les amalgames dentaires à base de mercure sont devenus (en moyenne pour la population générale) la première source d'exposition au mercure dans les pays développés42. Après 20 ans, un amalgame ne contient plus que 5 % de sa masse initiale de mercure[réf. nécessaire].
Le mercure mercurique est éliminé via les ongles et les cheveux, mais surtout via les urines et les fèces (mais aussi via le lait chez la femme allaitante)37.
Les composés inorganiques du mercure ont deux temps de demi-vie : l'un se compte en jours ou semaines et l'autre en années ou décennies37. « Chez l'homme, les composés de méthylmercure ont une seule demi-vie biologique d'environ deux mois »37. Les taux de mercure dans l'urine, du sang et du plasma sont des indicateurs utiles (mais incomplets) pour la surveillance biologique37 « Les concentrations dans le sang et les cheveux sont utiles pour surveiller l'exposition aux composés de méthylmercure »37.
Imprégnation des populations humaines
Elle est très élevée dans les régions d'orpaillage (Guyane et Surinam notamment) et dans certaines régions industrielles.
En 2018 en France le « Volet périnatal » du programme national de biosurveillance a publié une évaluation de l'imprégnation des femmes enceintes dont pour le mercure (et 12 autres métaux ou métalloïdes ainsi que quelques polluants organiques). Ce travail a été fait par dosage du mercure dans les cheveux maternels de 1 799 femmes enceintes (« Cohorte Elfe »), dosage qui révèle principalement le mercure organique, issu du mercure chroniquement ingéré ou inhalé. Ce panel ne comprenait que des femmes ayant accouché en France en 2011 hors Corse et TOM)43. Le dosage capillaire de ces 1 799 femmes entrantes en maternité a confirmé une légère baisse par rapport aux études françaises précédentes43 ; La moyenne géométrique était de 0,4 μg de mercure par gramme de cheveux43. Moins de 1 % des femmes du panel étudié présentait plus de 2,5 μg de mercure par gramme de cheveux (seuil établi par le JECFA pour les femmes enceintes), cependant ce taux est significativement supérieur à celui relevé au même moment (entre 2011 et 2012) ailleurs, notamment en Europe centrale et de l’Est, et même aux États-Unis où les taux de mercure sont connus pour être souvent problématiques. Un tel écart entre la France et les autres pays avait déjà été observé en 200744 : tout comme pour l'arsenic, ce mercure supplémentaire pourrait provenir d'une consommation plus importante en France de fruits de mer, ce que semble confirmer le fait qu'une consommation plus élevée de produits de la mer (en cohérence avec la littérature scientifique) était associée à un taux de mercure capillaire plus élevé chez la femme enceinte43.
Mercure et orpaillage
En 1997, une étude a été menée par l'Institut de veille sanitaire sur l'exposition alimentaire au mercure de 165 Amérindiens Wayana vivant sur les bords du fleuve Maroni en Guyane dans les quatre villages Wayanas les plus importants (Kayodé, Twenké, Taluhen et Antécume-Pata) ; des dosages de mercure total ont été pratiqués pour 235 habitants de villages environnants ainsi que des relevés anthropométriques de 264 autres individus. On a constaté que certains poissons contenaient jusqu'à 1,62 mg/kg. Plus de 50 % de la population de l'échantillon dépassait la valeur sanguine recommandée par l'OMS de 10 µg/g de mercure total dans les cheveux (11,4 µg/g en moyenne, à comparer à un taux de référence égale à 2 µg/g). De plus, environ 90 % du mercure était sous forme organique, la plus toxique et bio-assimilable. Les teneurs étaient élevées pour toutes les tranches d'âge, un peu moindre mesure chez les enfants de moins d'un an, mais ils y sont beaucoup plus sensibles.
L'exposition était la plus élevée dans la communauté de Kayodé où s'exerçaient au moment des prélèvements des activités d'orpaillage. Pour 242 personnes prélevées dans le Haut-Maroni, 14,5 % dépassaient la valeur limite de 0,5 mg/kg. Depuis, l'exploitation de l'or s'est fortement développée. Les indiens Wayana sont donc exposés au mercure très au-delà de l'apport quotidien habituel (environ 2,4 µg de méthylmercure et 6,7 µg de mercure total), mais aussi bien au-delà de la dose tolérable hebdomadaire recommandée (300 µg de mercure total avec un maximum de 200 µg de méthylmercure, soit environ 30 µg/j par l'OMS à l'époque). Les adultes consomment de 40 à 60 µg de mercure total/jour, les personnes âgées de l'ordre de 30 µg/j.
Les jeunes enfants en ingèrent environ 3 µg/j (dont via l'allaitement), ceux de 1 à 3 ans en ingèrent environ 7 µg/j, ceux de 3 à 6 ans environ 15 µg/j et ceux de 10 à 15 ans de 28 à 40 µg/j.
Ces doses sont sous-estimées car elle ne prennent pas en compte l'apport par les gibiers, l'air et l'eau.
Des taux équivalents à ceux mesurés au Japon à Minamata au moment de la catastrophe sont détectés en Guyane45. L'AFSSET a poursuivi ce travail46.
Le mercure est responsable de maladies professionnelles chez les travailleurs l'utilisant — voir Mercure (maladie professionnelle). Il est responsable chez l'homme de maladies telles que l'érythème mercuriel.
Écotoxicité
Reprotoxicité : Quatre lots de larves de
Jordanella ont été élevés (un mois, dans une eau normale pour le premier lot, et dans une eau contenant des traces de mercure (avec respectivement 0,6 1,26 et 2,5
ppm de
méthylmercure pour les 3 flacons de droite). Plus il y a de mercure, moins les larves ont survécu.
L'un des effets du mercure méthylé (très bioassimilable) sur le développement embryonnaire est une malformation congénitale (ici sur un jeune poisson
Jordanella)
Le mercure est toxique pour toutes les espèces vivantes connues. Quelques-uns des impacts démontrés sur la vie sauvage sont :
- Inhibition de la croissance d'organismes unicellulaires (algues, bactéries et champignons ; l’ancien mercurochrome était un biocide efficace pour cette raison, le mercurochrome actuel ne contient plus de mercure).
Inhibition de croissance chez la truite arc-en-ciel (avec en outre une surmortalité des embryons et larves) .
- Reprotoxicité : Moindre succès reproductif, et pontes inhibées chez le poisson zèbre et bien d’autres espèces.
Délétion de la spermatogenèse (étudiée par exemple chez le Guppie).
Élévation de la mortalité embryo-larvaire (étudiée par exemple chez les amphibiens).
- Moindre succès de reproduction chez les oiseaux (couvées plus petites et moindre survie des canetons chez les oiseaux d'eau vivant en milieux pollués par le mercure).
- Perturbation endocrinienne : le mercure interagit négativement avec une hormone essentielle, la dopamine, mais plus ou moins selon le niveau de contamination, et la durée d'exposition et probablement d'autres facteurs encore mal compris (ainsi, le poisson Pimephales promelas exposé 10 jours (1,69 à 13,57 % g HgCl2/L) capture moins bien et moins vite sa nourriture, mais sans modifications du taux d'hormones telles que norépinephrine, sérotonine et dopamine, alors que chez d'autres espèces des modifications sont observées47.
- Perturbation enzymatique (également observée en cas d'exposition au plomb et cadmium chez diverses espèces dont mollusques…) : protéase, amylase ou lipase inhibées48. Il a été montré que chez une même espèce,il peut exister des prédisposition génétique (génotypes) rendant plus vulnérable encore au mercure (ex. : chez Gambusia holbrooki)49.
- Effets synergiques : ils varient selon les espèces et les composés en cause. Par exemple chez la moule Mytilus edulis un cofacteur exacerbe la bioaccumulation de certains toxiques (comme le sélénium50), mais il semble inversement réduire l'absorption du cadmium chez cette même moule quand elle est expérimentalement exposée au mercure et au cadmium à la fois51.
Quantités émises et géologiquement réabsorbées (« budget global du mercure »)
Dépôts de mercure atmosphérique dans les carottes de glace prélevées dans le haut du
glacier de Fremont (
Wyoming, États-Unis). Chaque « pic de déposition » (depuis 270 ans) correspond à un événement volcanique et/ou
anthropique. Le taux pré-industriel de dépôt peut être extrapolé à 4 ng/L (en vert). On note dans cette région une forte augmentation au
XXe siècle (en rouge) et une relative et récente mais significative diminution (15-20 dernières années)
Schéma simplifié de la
« cinétique environnementale et biomagnification du mercure ». Le mercure naturel, et celui émis par les
centrales électriques au charbon, l'industrie, les
mines et l'
orpaillage, etc aboutit en mer et dans les
sédiments marins où il se transforme en partie en
méthylmercure (plus toxique et entrant facilement dans la
chaîne alimentaire où il se concentre à chaque étape de cette chaîne). Ceci explique que les grands
prédateurs comme les
cachalots,
orques,
requins,
espadons,
thons ou les vieux
brochets, ou des
charognards comme le
flétan contiennent les taux de mercure les plus élevés.
Le mercure est problématique pour le développement ; c'est pourquoi les limites (ici symbolisées par les thermomètres) visent à protéger les femmes qui pourraient devenir
enceinte et les enfants de 12 ans ou moins. Des seuils et recommandations de l'
EPA et d'autres autorités existent à ce sujet.
Les
cétacés bioconcentrent fortement le mercure méthylé, mais hors quelques exceptions (
Japon,
Norvège…) ils ne sont habituellement plus consommés par l'Homme.
Le mercure est un polluant global52. Son budget (sources/puits) commence à être mieux connu53, mais on sait par les enregistrements sédimentaires et les analyses isotopiques que les émissions anthropiques ont fortement augmenté depuis le début de l'« Anthropocène »54. Les évaluations statistiques quantitatives convergent vers les estimations suivantes :
- Au tout début du XXIe siècle, environ 3 500 tonnes de mercure seraient encore émises annuellement dans l'atmosphère par les activités humaines (dont 50 à 75 % issus de la combustion du charbon)55 ; De 1 400 tonnes à 2 400 tonnes/an viendraient du volcanisme, des geysers, de l'évaporation naturelle et de la recirculation56 ;
- d’autres émissions indirectement anthropiques ne sont pas ou mal comptabilisées (évaporation à partir de sols riches en mercure dégradés par les pratiques agricoles ou des aménagements, évaporation ou lessivage à partir de sols dévégétalisés par la déforestation et/ou le pâturage, ou le drainage excessif ou la salinisation, ou à la suite des graves phénomènes d'érosion qui s'ensuivent (ex : Madagascar, ou Chine)57 ;
- les émissions liées à l'orpaillage clandestin sont par définition sous-estimées ;
- selon une étude récente58 (2017) basée sur une évaluation des « facteurs d'émission » de 18 activités humaines depuis 4 000 ans et sur l'Évaluation mondiale du mercure du PNUE59 et de l'Agence internationale de l'énergie60 (dont métallurgie du cuivre, du plomb et du zinc; production d'or et de soude caustique; et la combustion du charbon) l’homme aurait injecté environ 1 540 000 tonnes de mercure dans la biosphère lors de ces 4 millénaires (pour les ¾ après 1850) C’est 78 fois les émissions naturelles durant cette période.
472 gigagrammes (1 Gg = 1 000 tonnes) auraient été directement rejetés dans l'air (336 Gg depuis 1850) alors que 1 070 Gg l’ont été dans les sols et/ou l'eau58.
L’activité la plus polluante a été la production d'argent (31 %), devant la production de mercure elle-même (19 %) et l’industrie chimiques (10 %). Depuis quelques années c’est l’orpaillage et la combustion du charbon qui sont la cause dominante)58.
Depuis 1880 les rejets globaux n’ont que peu diminué (ils sont toujours d’environ 8 Gg par an, depuis une baisse après un pic de 10,4 Gg atteint en 1970) mais les régions émettrices changent : De 1850 à 2010, les rejets venaient surtout d’Amérique du Nord (30 %), d’Europe (27 %) et d’Asie (16 %)58. Avant cela, 81 % des rejets étaient liés à la production d'argent de l’Amérique espagnole. De 1850 à 2010, 79 % des émissions dans l’air ont directement touché l'hémisphère nord (et 21 % le sud) mais la part du sud augmente depuis 1890 (Asie, Afrique et Amérique du Sud)58.
Les émissions dans l'air (plus réglementées) ont diminué, mais pendant que les rejets dans le sol et l’eau augmentaient. Le mercure du charbon et des déchets est retrouvé dans les cendres volantes et les refioms. Une partie des cendres volantes s’envolent ou sont dispersées par les pluies. Elles sont de plus en plus recyclées dans le ciment et des briques58.
Environ 84 % des déchets mercuriels solides ont été introduits dans le sol ou l'eau et c'est la production de ce étal qui est la cause principale de rejets dans l'eau et le sol (30 % des rejets totaux) devant la production d'argent (21 %) et l'industrie de la chimie (12 %)58.
La cinétique environnementale et le cycle biogéochimique du mercure sont encore mal compris, surtout pour le long terme61. Pour un métal, parce que volatil, le mercure est très présent dans l'air (4,57 Gg de mercure en 2010, soit le triple du niveau de 185058. Au début des années 2000, on commence à mieux modéliser sa cinétique terre-air-mer62. Une étude de 201561 a conclu qu'en 2017 23 % des dépôts atmosphériques actuels sont d'origine humaine et que 40 % des rejets faits dans l'eau et les sols depuis 4000 ans ont depuis été séquestrés dans un état stable et plutôt dans l'écosystème terrestre qu'océanique61. En 2020, une modélisation a porté sur le rôle des activités humaines dans le cycle du mercure63.
Les modèles mondiaux de cycle du mercure et de risque se sont d'abord centré sur le mercure océanique, que l'on pensait essentiellement venu des dépôts atmosphériques8, mais l'origine fluviale s'est ensuite avérée être une source importante de mercure océanique8 : selon les données disponibles en 2021, les fleuves en reçoivent environ64, et ils en apportent environ autant (1000 Mg/an ; entre 893 et 1224) aux océans côtiers, soit trois fois plus que les dépôts atmosphériques.
De plus, les pointes de haut-débit fluvial, de plus en plus fréquents dans le contexte du réchauffement climatique, sont aussi des sources nouvelles et disproportionné d'apports en mercure.
Les océans côtiers comptent pour seulement 0,2 % du volume total de l'océan, mais ils abritent les nourrisseries de poissons et reçoivent 27 % de l'apport externe de mercure à l'océan. Selon une évaluation encore à confirmer, les fleuves, via leurs estuaires, pourraient apporter en mer 350 Mg de mercure (plage interquartile : 52-640) ; ils sont la plus grande source de mercure contaminant les océans côtiers8. L'écosystème estuarien (bouchon vaseux notamment) est également très propice à la méthylation du mercure et à sa bioconcentration dans le réseau trophique65,66,67.
Le mercure pose néanmoins un problème environnemental global : sa concentration moyenne augmente ou reste présent à des niveaux très préoccupants chez les poissons et mammifères dans tous les océans, alors que la plupart des autres métaux lourds sont en diminution. Sa répartition dans les océans, sur les continents et dans les pays varie : ainsi selon Lehnherr et ses collaborateurs en 2011, le taux de mercure augmente d'Est en Ouest en Amérique du Nord. Un phénomène dit de « pluies de mercure » touche l'Arctique depuis quelques décennies, et bien que ces régions semblent peu anthropisées, leurs cours d'eau sont aussi une source de mercure pour l'océan arctique68. Une partie de ce mercure est méthylé et ainsi rendu plus biodisponible dans l'océan arctique69,70,71.
Principales sources d'émissions
85 % de la pollution mercurielle actuelle des lacs et cours d'eau72 proviendraient des activités humaines (centrales thermiques au charbon, et exploitation ou combustion de gaz73 ou pétrole74,75,76). Ce mercure provient essentiellement du lessivage de l'air et de sols pollués, et des apports terrigènes en mer ou dans les zones humides.
Les sources seraient, par ordre décroissant d'importance :
- Le raffinage et la combustion des combustibles fossiles77,78, et notamment la combustion du charbon dans les centrales électriques.
Tous les hydrocarbures fossiles proviennent de cadavres d'organismes qui ont dans le passé bioaccumulé un peu de mercure. On en trouve dans tous les hydrocarbures fossiles, dont le gaz naturel79. Ils sont plus ou moins « riches » en mercure, avec des teneurs variant fortement selon leur provenance et selon les filons. Selon la compilation scientifique faite par l'EPA (2001) : certains condensats et pétroles bruts étaient proches de la saturation en Hg0 (1 à 4 ppm). Du mercure en suspension, sous forme ionique et/ou organique a été trouvé dans des pétroles brut (jusqu'à plus de 5 ppm). Des condensats de gaz extraits en Asie du Sud contenaient de 10 à 800 ppb (en poids) de mercure. La plupart des pétroles bruts raffinés aux États-Unis en contiennent moins de 10 ppb, mais on en a trouvé de 1 à 1000 ppb (en poids), pour une moyenne approchant 5 ppb (en poids)77. Les naphtes issues du raffinage en contiennent encore de 5 à 200 ppb80.
L'EPA a évalué en 2001 que la seule production pétrolière annuelle des États-Unis pouvait en émettre jusqu'à 10 000 t environ/an de mercure dans l'environnement81). Dans le gaz naturel, le mercure est presque exclusivement sous sa forme élémentaire, et présent à des taux inférieurs à la saturation ce qui laisse penser qu'il n'existe habituellement pas de mercure en phase liquide dans la plupart des réservoirs81. On connait cependant au moins un réservoir de gaz (au Texas) où le gaz sort saturé en mercure élémentaire, produisant du mercure liquide élémentaire par condensation, ce qui suggère que - dans ce seul exemple - le gaz est en équilibre avec une phase de mercure liquide présente dans le réservoir même81. La teneur en dialkylmercure du gaz naturel est mal connue, mais supposée faible (moins de 1 pour cent du mercure total) sur la base des quelques données de spéciation rapportées par la littérature sur les teneurs en substances indésirables des condensats de gaz80.
Le pétrole brut, ses vapeurs et leurs condensats peuvent contenir plusieurs formes chimiques du mercure, plus ou moins stables82 et variant dans leurs propriétés chimiques, physiques et toxicologiques.
Le pétrole brut et les condensats de gaz naturel contiennent notamment - selon l'EPA - « des quantités importantes de composés du mercure en suspension et/ou de mercure adsorbé sur les matières en suspension. Les composés en suspension sont généralement plus souvent HgS mais incluent d'autres espèces de mercure adsorbé sur des silicates et d'autres matières en suspension colloïdales ». Ce mercure en suspension peut constituer une part importante du mercure total des échantillons liquides d'hydrocarbures81. Il doit être séparé (filtré) préalablement à toute analyse de spéciation des formes dissoutes81. Pour mesurer le mercure total d'un échantillon de pétrole ou gaz brut, il faut le faire avant filtration, centrifugation ou exposition à l'air qui peuvent être source de perte (évaporation, adsorption de mercure). Exposé à la chaleur ou au soleil, une partie au moins de ce mercure peut contaminer l'air puis d'autres compartiments de l'environnement.
- Les activités minières ; celle des anciennes mines d'or83,84,85,86 (dont l'extraction du mercure, activité relativement discrète, mais aussi l'extraction et le traitement d'autres minerais ou de pétrole, gaz et charbon naturellement contaminés par du mercure). Dans les pays où il est très pratiqué, le mercure perdu par l’orpaillage est de loin la première source dans l’environnement.
- Les incinérateurs, dont les crématoriums qui incinèrent des plombages dentaires et autrefois certains incinérateurs hospitaliers dans lesquels on pouvait trouver d'importants résidus de mercurochrome ou de thermomètres cassés).
- L'usage d'autres combustibles fossiles que le charbon, pétrole ou gaz naturel, dont la tourbe ou le bois ayant poussé sur des sols contaminés ou dans une atmosphère contaminée peut en contenir des taux excessifs, libérés lors de la combustion ou de sa transformation (en papier, en aggloméré, en contreplaqué).
- Certains processus industriels notamment liés à l'industrie du chlore et de la soude caustique87.
- Le recyclage des thermomètres, des voitures, des lampes au mercure, etc. qui sont plutôt source de pollutions locales, mais parfois très graves.
- Séquelles industrielles et séquelles de guerre ; Bien des années après, le mercure industriel88 et notamment celui issu de la fabrication des munitions (fulminate de mercure utilisés depuis 180589 dans des milliards d'amorces de balles, obus, cartouches, mines, etc.) par les militaires, chasseurs ou adeptes du tir, comme celui des sols pollués par les industries, parfois anciennes (chapellerie, miroiteries, cristalleries, ateliers de doreurs..) peuvent encore poser de graves problèmes. Des pollutions chroniques comme celle de Minamata peuvent laisser des séquelles durables socio-économiques, écologiques et humaines.
Mobilité
Le mercure émis sous forme de vapeur est très mobile dans l’air, et reste pour partie mobile dans le sol et les sédiments. Il l’est plus ou moins selon la température et le type de sol (il l’est moins en présence de complexes argilo-humiques et plus dans les sols acides et lessivables). Ainsi dit-on parfois qu’une simple pile bouton au mercure peut polluer 1 m3 d'un sol européen moyen pour 500 ans, ou 500 m3 pour un an. Les animaux le transportent aussi (bioturbation). Le mercure n’est cependant ni biodégradable ni dégradable. Il restera un polluant tant qu’il sera accessible pour les êtres vivants.
Il est ce qu'on appelle un contaminant transfrontalier, par exemple de nombreux lacs du Québec sont pollués dû au transport de particules de la région Nord Ouest de l’Amérique du Nord tel le sud de l’Ontario ainsi que le nord des États-Unis. La teneur en Hg aurait doublé depuis les 100 dernières années, de ce fait les pêcheurs sportifs de cette province doivent mesurer leur consommation de poisson venant de cette région.
Pollution de l’air
Air extérieur
Nombreux étaient ceux qui pensaient que les pluies diluaient les pollutions et amenaient de l’eau propre régénérant les écosystèmes. On sait maintenant qu’elles lessivent les polluants émis dans l'atmosphère, en particulier les pesticides et les métaux lourds, dont le mercure, qui peuvent agir en synergie. Le mercure, très volatil, pollue le compartiment atmosphérique, lequel est lavé par la pluie et le brouillard qui polluent les eaux superficielles et les sédiments. Il peut ensuite dégazer ou être émis par les incendies et polluer de nouveau l’air.
Des analyses de pluies et de neige par l'Environmental Protection Agency (EPA) et des universités américaines ont montré que de nombreuses régions étaient polluées par le mercure : la teneur en mercure est jusqu’à 65 fois supérieure au seuil défini comme sûr par l'EPA autour de Détroit, 41 fois au-dessus de ce seuil à Chicago, 73 fois à Kenosha (Wisconsin, proche de la frontière avec l'Illinois), et près de 6 fois le seuil pour la teneur moyenne sur six ans à Duluth. Même les pluies les moins polluées dépassent souvent le seuil de sûreté. Les régions moins urbaines sont également parfois touchées : 35 fois le seuil EPA dans le Michigan et 23 fois pour le secteur du Devil’s Lake, dans le Wisconsin.
Dans 12 États de l'est américain (Alabama, Floride, Géorgie, Indiana, Louisiane, Maryland, Mississippi, New York, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Pennsylvanie et Texas) à la fin des années 1990 et au début des années 2000, la pluie présentait encore des teneurs en mercure dépassant les seuils acceptables pour l'EPA pour les eaux de surface.
Les États-Unis et la Chine sont particulièrement touchés en raison de l’usage massif du charbon. La Chine est devenue le premier émetteur mondial90.
Air intérieur
Le mercure des lampes fluocompactes a diminué, passant en quelques années de 12 mg à 4 mg (et souvent à moins de 2 mg en 2011) mais dans le même temps, le nombre de lampe a beaucoup augmenté. En France, bien qu'« aucun accident impliquant le mercure contenu dans les lampes n’a été enregistré par l’Institut de veille sanitaire (InVS) », la diffusion de ces lampes a reposé la question des risques liés aux vapeurs de mercure, en cas de bris, pour l'air intérieur, et via les filières d'élimination ou incinération pour l'air extérieur. Si les lampes étaient évacuées dans les ordures ménagères et incinérées, en considérant qu'une ampoule contient 5 mg de mercure, et qu'il y a en environ 30 millions, 150 kg de mercure seraient rejetés en plus des 6,7 tonnes déjà rejetés dans l'air (en 2007) selon le CITEPA91. Or, la réglementation limite le taux de mercure dans les lampes (à 5 mg92), mais n'a toujours pas produit de norme pour la teneur en mercure de l'air intérieur ou extérieur, tant pour une exposition de courte durée que pour une exposition à long terme.
On se réfère donc aux valeurs guide de l'OMS (1 µg/m3 de mercure inorganique sous forme de vapeur à ne pas dépasser sur une année). En France, la Commission de la sécurité des consommateurs a demandé en 2011 que le gouvernement produise des « valeurs maximales d'exposition aux vapeurs de mercure acceptables dans l'air ambiant » et préconise la révision de la directive européenne relative à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques actuellement en vigueur (2002/95/CE du ) ce, afin de « prendre en compte les progrès technologiques réalisés ces dernières années et abaisser le niveau maximal de teneur en mercure de 5 à moins de 2 mg par lampe »93.
Seul le code du travail fixe en France, pour les travailleurs, une teneur maximale tolérée en mercure dans l'air (20 µg/m3 d’air).
L'Europe, tout en considérant le mercure comme très toxique, a omis dans sa directive de 200494,95 sur l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les HAP dans l'air de préciser une valeur cible pour le mercure dans l’air (alors qu'elle existe pour les autres éléments et que la directive reconnait explicitement le mercure comme substance très dangereuse pour la santé et l'environnement. Pour le mercure, il n'y a pas non plus de valeurs maximales d’exposition à court terme (qui existent pour d'autres neurotoxiques).
Certaines précautions sont préconisées en cas de casse d'une ampoule au mercure : aération prolongée de la pièce, utilisation de gants pour le ramassage des débris et non-utilisation de l'aspirateur (risque de dispersion)
Pollution de l’eau et des sédiments
Il suffit de très peu de mercure pour polluer de vastes étendues d’eau (et les poissons à des niveaux dangereux pour la consommation humaine).
- Selon un article de 199197, une centrale thermique classique de 100 mégawatts émet environ 25 livres (environ 11,4 kg) de mercure par an, ce qui semble peu.
- Or, 0,02 livre (environ 9 grammes) de mercure (1/70e de cuillère à café) suffit à polluer 25 acres d’étang dans lequel la chaîne alimentaire va reconcentrer le mercure au point que les taux de mercure dans les poissons dépasseront les seuils considérés comme « sûrs »[réf. souhaitée] pour la consommation.
Un cas de pollution importante par le mercure se rencontre près de Bergen, en Norvège. Le , le U-864, un sous-marin allemand de type U-Boot, a été coulé près de l'île de Fedje. Outre son armement conventionnel (torpilles, grenades et autres munitions), le sous-marin contenait 65 tonnes de mercure réparties dans 1 875 flasques d'acier, destinées à soutenir l'effort de guerre du Japon. Depuis 1945, les bouteilles d'acier résistent très mal aux effets conjugués du temps et de l'eau de mer, et ont commencé à suinter puis à relâcher leur contenu dans les sédiments98, et contaminer aussi les poissons. L'épave n'a été découverte que le , et depuis lors, la pêche est interdite dans une zone de 30 000 m2. Diverses études et projets ont été menés par l'administration côtière norvégienne (Kystverket), mais la dépollution de l'épave et du site, n'a toujours pas commencé, à la fin 201599.
Contamination des organismes et des écosystèmes
Le mercure étant très volatil, il passe dans l'air et contamine les pluies et peut se retrouver dans la neige et les eaux nivéales (de fonte de neige) puis des lacs de montagne100.
Les sédiments : ils finissent par recueillir la part du mercure qui n'a pas été ré-évaporée ou absorbée par les plantes ou stockée (plus ou moins durablement) dans le sol. Là, des bactéries peuvent méthyler le mercure et le rendre très bio-assimilable, notamment pour les poissons et crustacés ou les oiseaux aquatiques. Les plantes et animaux contaminés contaminent à leur tour la chaine alimentaire).
En mer les poissons piscivores et vivant vieux sont les plus touchés (thons, espadons... en particulier) ; Ils sont presque systématiquement au-dessus des normes quand ils sont adultes. De nombreux poissons des grands fonds sont aussi contaminés (Sabre, Grenadier, Empereur…), à des taux très variés selon leur âge (certains vivent jusqu'à 130 ans) et leur provenance.
Oiseaux marins prédateurs et cétacés sont également victimes d'une bioaccumulation du mercure dans le réseau trophique. À titre d'exemple, en mer du Nord, au début des années 1990, les taux moyens de mercure dans le foie et les muscles de quelques oiseaux marins de mer du Nord étaient de 8,5 µg/g dans le foie chez le Guillemot de Troïl (pour 3,4 µg/g dans le muscle), 5,6 µg/g chez la Mouette tridactyle pour 1,9 µg/g dans le muscle, 2,6 µg/g chez la mouette rieuse pour 0,9 µg/g dans le muscle et 9,5 µg/g chez la Macreuse noire pour 2,1 µg/g dans le muscle), en µg/g de poids sec. Chez le marsouin (Phocoena phocoena de cette même région, le taux moyen de mercure était de 65,2 µg/g dans les foies, de 4,1 µg/g dans les muscles et de 7,7 µg/g dans les reins (en poids sec). Ce sont des taux très élevés, et on a mesuré dans ce lot des « records » de 17,5 µg/g de poids sec chez la mouette tridactyle et de 456 µg/g de poids sec chez le marsouin. Les deux principaux facteurs de risques semblaient être l'habitat et le régime alimentaire.
On a constaté que le taux de mercure augmente avec l'âge chez les marsouins, mais que la proportion de méthylmercure diminue avec l'âge au profit du mercure lié à du sélénium, ce qui laisse supposer l'existence d'un processus de détoxification chez ce mammifère (peut être dans le lysosome des cellules du foie)101.
Pour ces raisons, 44 états américains ont établi des limites de consommation des produits de la pêche dans plusieurs milliers de lacs et de rivières. Les populations autochtones sont particulièrement visées par ces mesures.
Dans les sols : dans les sols pollués, ou quand ils poussent sur du bois contaminé en décomposition, le mercure est notamment bioaccumulé par les champignons. Par exemple, la vesse de loup géante (Calvatia gigantea), comestible quand elle est encore à chair blanche, bio-accumule fortement le mercure et un peu le méthylmercure102), avec des teneurs atteignant déjà 19,7 ppm (en poids sec) sur un sol a priori non pollué102. Sur terre, certaines plantes, les lichens et champignons peuvent en accumuler des quantités importantes
- Chez les agarics croissant sur un sol non pollué, on peut trouver 20 à 50 fois plus de méthylmercure et mercure que dans le sol environnant tant ils ont accumulé ces deux contaminants102 ;
- Une étude faite par Didier Michelot (CNRS) en France à partir de 3 000 mesures de 15 métaux chez 120 spécimens de champignons de diverses espèces a détecté quatre espèces particulièrement accumulatrices :
Dans quelques pays et à plusieurs reprises, des publications officielles ont averti les individus de la possibilité d'empoisonnement provoqué par les métaux lourds dans les champignons, notamment prélevés dans la nature.
Santé reproductive
Les espèces qui sont en haut de la chaîne alimentaire sont les plus concernées, outre les poissons, requins, cachalots, phoques, épaulards, etc., dans les milieux continentaux, la loutre, le vison, le huard, la sterne, les limicoles, les canards, etc., peuvent aussi être très touchés. L’Homme, de par sa position dans la chaîne alimentaire, fait partie des espèces touchées.
Ampleur du phénomène chez l’Homme
Selon les CDC américains (Centers for Disease Control and Prevention) :
- Une femme en âge de procréer sur douze a un taux de mercure dans le sang assez élevé pour mettre en danger le développement neurologique du fœtus.
- Plus de 320 000 bébés nés annuellement courent ainsi le risque de développer des malformations.
Santé : le mercure est présent dans les vaccins sous le principe actif Thiomersal depuis 1930.
Contrôle, statut, évolution de la législation
À l'échelle mondiale, le Programme des Nations unies pour l'environnement a mis en place un « Plan mercure »103.
Le , après une semaine de négociation, 140 États ont adopté à Genève la convention de Minamata qui vise la réduction des émissions de mercure au niveau mondial. Cette convention a été signée le , par les représentants des 140 États à Minamata au Japon, en hommage aux habitants de cette ville, touchés durant des décennies par une très grave contamination au mercure, on y parle même de la Maladie de Minamata. Cette convention doit désormais être ratifiée par 50 États, pour entrer en vigueur104. La convention prévoit l'interdiction du mercure d'ici 2020 dans les thermomètres, instruments de mesure de la tension, batteries, interrupteurs, crèmes et lotions cosmétiques et certains types de lampes fluorescentes. Elle règle également la question du stockage et du traitement des déchets. Des ONG de défense de l'environnement regrettent néanmoins que cette convention ne touche pas les petites mines d'or et les centrales électriques au charbon. Certains vaccins et les amalgames dentaires, ne sont également pas touchés par cette convention. Achim Steiner, secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé du Programme des Nations unies pour l'environnement a souligné, qu'il est assez « incroyable comme le mercure est répandu […] Nous laissons là un terrible héritage » qui affecte « les Inuits du Canada comme les travailleurs des petites mines d'or en Afrique du Sud105 ».
Aux États-Unis
Le Michigan, l'Ohio et l'Indiana ont institué des réglementations (par état) sur la consommation de poisson.
Le Wisconsin et le Minnesota ont pris des arrêtés interdisant ou limitant la consommation sur des centaines de lacs.
L'Environmental Protection Agency met à jour régulièrement des conseils aux femmes enceintes, enfants et personnes fragiles, recommandant notamment de limiter la consommation de certains poissons (thon, espadon en particulier) et fruits de mer.
Au Canada
Le Canada recommande également de limiter la consommation de certains poissons marins et poissons des grands lacs.
En Europe
Le mercure est limité ou interdit pour certains usages.
Il fait partie des métaux devant être contrôlé dans l'eau potable et l'alimentation.
L'Union européenne s'est dotée en 2005 d'une « stratégie communautaire sur le mercure »106,107 en 6 objectifs déclinés en actions spécifiques, à la suite d'un rapport de 2003 sur « les risques pour la santé et l'environnement en relation avec l’utilisation du mercure dans les produits », et à un rapport de la Commission au Conseil, du 6 septembre 2002, concernant le mercure issu de l'industrie du chlore et de la soude108 après une directive (22 mars 1982)109 sur le mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins. La Commission européenne a confié à la France la rédaction d’un argumentaire en vue d'éventuellement réviser la classification du Mercure dans le cadre de la directive 67/548/CEE (sur la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses). L’AFSSET a restreint l’étude à la seule classification CMR (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique), pouvant se traduire par une interdiction de vente du mercure en Europe pour un usage grand public et une surveillance accrue en milieu professionnel. L'avis de l'AFSSET a été soumis aux responsables de la classification et d’étiquetage pour l'Europe en novembre 2005 qui ont demandé plus de détails sur la toxicologie du mercure et son caractère cancérogenèse et mutagène (travail fait par l’INRS et l’INERIS). La procédure devrait aboutir à une modification du statut du mercure110.
Le 1er juillet 2006, la directive RoHS limite son usage dans certains produits commercialisés en Europe ; usage limité à 0,1 % du poids de matériau homogène (cette directive pourra être élargie à d'autres produits et à d'autres toxiques).
En juin 2007, le Parlement à Strasbourg a voté un règlement interdisant l'exportation et l'importation de mercure et réglementant les conditions de stockage.
Mi-2007 les députés ont voté pour l'interdiction des thermomètres au mercure non-électriques (les matériels électriques et contenant du mercure étaient déjà couverts par une directive) et d'autres instruments de mesure d'usage courant contenant du mercure, sans amendement à la position commune du Conseil, c’est-à-dire sans accepter la demande du PE d'une « dérogation permanente pour les fabricants de baromètres », mais acceptant « une exemption de deux ans ». (La pile au mercure reste autorisée dans le thermomètre) ;
Le parlement estime que 80 à 90 % du mercure des outils de mesure et contrôle est présent dans les thermomètres médicaux et domestique (importés pour les 2/3 d'Extrême-Orient souvent), et que les produits de substitution existent et sont même moins chers pour le particulier. Les instruments plus techniques ou scientifiques (manomètres, baromètres, le sphygmomanomètres, ou thermomètres non médicaux) sont eux fabriqués en Europe et leurs substituts peuvent être plus chers. Quelques dérogations sont prévues à la demande du parlement alors que le conseil envisageait une interdiction totale. Elles concernent les antiquités (thermomètres anciens au mercure) et le domaine médical (ex sphygmomanomètres à mercure, qui mesurent le mieux la tension artérielle). L’interdiction, non rétroactive ne touchera que les instruments neufs, la revente autorisée de matériels existant rendra les fraudes plus difficiles à contrôler, d’autant que les instruments vieux de plus de 50 ans, considérés comme des antiquités pourront encore être importés contenant du mercure.
Chaque État membre doit traduire la directive dans son droit national dans un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur, et son application effective ne doit pas prendre plus de 18 mois à partir de la transposition (sauf pour les baromètres, pour lesquels le délai est porté à 24 mois)111 ;
Fin 2007, la Commission européenne envisage de bannir le mercure de toute préparation à usage thérapeutique. Elle doit aussi statuer sur l'avenir du mercure en dentisterie (incorporé à 50 % dans les plombages ou amalgames dentaires).
Depuis le 1er janvier 2008, la Norvège, qui ne fait pas partie de l'Union Européenne, a interdit l'utilisation du mercure pour toutes applications112.
Mi-janvier 2008, un comité scientifique européen, mandaté par la Communauté et composé pour moitié de dentistes, publie un rapport déclarant que l'amalgame dentaire est un matériau sain, dépourvu de tout risque sur la santé humaine. Le document n'est édité qu'en anglais113.
Le 22 février 2008 ; Selon la Commission, l'UE, le « plus grand exportateur de mercure au monde, doit montrer la voie à suivre dans la réduction de l'utilisation de ce métal». Pour cela, la commission a proposé114 d'interdire toute exportations européenne de mercure115, ceci après une vaste consultation [archive]. L'UE étudie des solutions pour gérer les « énormes surplus » (12 000 tonnes) attendus d'ici 2020 par l'abandon progressif du mercure par l’industrie du chlore et de la soude. Le stockage dans d'anciennes mines de sel spécialement adaptées est notamment à l'étude.
Le 26 février 2008 le JOUE publie une Position commune du conseil (CE) no 1/2008 du 20 décembre 2007 en vue de l'adoption d'un règlement [archive] (sur l'interdiction des exportations de mercure métallique et le stockage en toute sécurité du mercure).
En France
La Direction générale de l'alimentation a publié une Évolution des recommandations de consommation en 2008116 mais ne dispose pas d'un plan de surveillance des contaminants comme le mercure117.
Un cas particulier est celui des impacts de l'orpaillage en Guyane pour lequel la quantité de mercure illégalement utilisée et dispersée dans l'environnement est mal connue.
En 2017, le règlement européen relatif au mercure118 intégrant l'union européenne dans la Convention de Minamata (du 10 octobre 2013) est traduit dans le droit français119. Il doit combler les lacunes réglementaires de l'UE en fixant « les mesures et conditions applicables à l'utilisation, au stockage et au commerce du mercure, des composés du mercure et des mélanges à base de mercure, et à la fabrication, à l'utilisation et au commerce des produits contenant du mercure ajouté ainsi qu'à la gestion des déchets de mercure afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement contre les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure ». Les lacunes identifiées sont au nombre de six118 :
- les importations de mercure métallique,
- les exportations de produits contenant du mercure ajouté,
- les utilisations existantes du mercure dans les procédés industriels,
- les nouvelles utilisations du mercure dans les produits et procédés,
- l'extraction minière artisanale et à petite échelle d'or,
- l'utilisation d'amalgames dentaires (principale utilisation du mercure subsistant dans l'Union en 2017 ; il devient interdit d'utiliser des amalgames dentaires pour les populations vulnérables (femmes enceintes ou allaitantes, enfants de moins de 15 ans). Il devient obligatoire d'utiliser des amalgames prédosés encapsulés afin de réduire les émissions et l'exposition dans les établissements de soins dentaires, et d'équiper les cliniques dentaires de séparateurs d'amalgames afin d'éviter le rejet des déchets d'amalgames dans les égouts et dans les masses d'eau. Avant juin 2020 la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur la faisabilité d'un abandon des amalgames dentaires d'ici à 2030.
Gestion du risque
Les caractères physiques et chimiques du mercure ont influencé leur présence dans plusieurs produits de consommation, par exemple les thermomètres, les manomètres, l’amalgame dentaire, les lampes fluorescentes et autres. Ce sont des sources émettrices qui ajoutent à l’environnement.
Les solutions évoquées impliquent des interventions à différents niveaux. On peut limiter la diffusion du mercure dans l'environnement par les mesures suivantes :
- La réduction à la source du mercure, voire son interdiction pour les usages non essentiels et là où une alternative moins toxique existe ;
- Un meilleur recyclage des objets, piles et accumulateurs en contenant ;
- Le contrôle de la teneur en mercure du charbon destiné à la combustion, et l'utilisation de procédés visant à traiter les gaz avant leur relâchement dans l'atmosphère ;
- L'utilisation de procédés industriels sans mercure, en particulier dans le secteur minier.
Les piles bâton au mercure sont pour partie remplacées par d’autres. Les piles bouton sont obligatoirement récupérées et recyclées. On peut aussi réduire l'exposition humaine au méthylmercure par les mesures suivantes :
- Des conseils alimentaires, notamment pour les personnes à risque et surtout pour les femmes enceintes (éviter le thon, merlin, espadon…) ;
- Une surveillance de la teneur en mercure des poissons dans les lacs où se pratique la pêche sportive, et l'émission d'avis aux pêcheurs.
Décontamination
Il faut entre autres relever le défi du traitement de la pluie, tel que conclut un rapport et une campagne120 de sensibilisation aux États-Unis dont les auteurs et la NWF invitent les industriels et les gestionnaires d'incinérateurs à fortement réduire leurs émissions de mercure. Ils incitent aussi les citoyens à économiser l’énergie pour limiter les émissions de mercure à partir des combustibles, et à ne plus acheter de piles ou produits contenant du mercure, ou s'ils les achètent, à s’en débarrasser correctement. La campagne invite également le gouvernement fédéral et les États à surveiller plus étroitement les niveaux de mercure dans les précipitations… Avec des scientifiques des Universités du Michigan du Minnesota, la NWF annonce qu’elle fera elle-même ses prélèvements et analyses de la pluie si les autorités responsables ne le font pas. Les premières villes visées pour une surveillance particulière étaient Chicago, Cleveland, Détroit, Duluth, et Gary (Indiana). Encore sur la question de l'eau de pluie, plus précisément pour les systèmes de récupération des eaux pluviales pour la consommation, l'arrosage des légumes ou la consommation des animaux, il a été suggéré de tamponner l’acidité de la pluie et de la filtrer sur charbon actif. Ce charbon devrait ensuite être brûlé dans des incinérateurs équipés de filtres appropriés.
Une étude récente basée sur le suivi de l'alimentation de femmes d'un village amazonien (sur les berges de la rivière Tapajós, durant un an) laisse penser que la consommation de fruits diminue l'absorption du mercure par l'organisme. Reste à savoir si ce phénomène est lié à un fruit particulier disponible localement, ou aux fruits en général121.
On a dressé avec succès des chiens pour repérer des gouttes de mercure par exemple piégées dans la moquette ou dans les fentes d'un plancher, des instruments contaminés, des puits, des égouts.. de manière à les récupérer avant qu'elles ne s'évaporent et après les avoir amalgamé avec un autre métal (poudre à base de zinc par exemple). En Suède, 1,3 t de mercure ont ainsi été collectées après avoir été détectées par deux labradors "renifleurs" de mercure, dans les 1 000 écoles ayant participé au projet "Mercurius 98"122. Aux États-Unis, un chien dressé à détecter l'odeur de la vapeur de mercure a ainsi permis de récupérer 2 t de mercure dans les écoles du Minnesota123. Des chercheurs envisagent aussi de génétiquement modifier des plantes pour augmenter les rendements de phytoremédiation124.
Méthode analytique
La méthode d’analyse du mercure le plus courant est la spectroscopie d'absorption atomique. C’est une bonne technique pour le dosage des eaux telle l’eau potable, l’eau de surface, les eaux souterraines et les eaux usées. La concentration du mercure dans l’eau est mesurée pour différentes raisons, entre autres : les réglementations sur l’eau potable, le contrôle des réseaux d’égouts municipaux, la réglementation sur les matières dangereuses et loi sur la protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. La préparation de l’échantillon pour le dosage est séparable en deux étapes : en premier lieu, on oxyde toutes les formes de l’Hg au travers d’une digestion acide En second lieu, les ions sont réduits en Hg élémentaire qui est volatil. L’échantillon gazeux est dirigé vers la cellule du spectromètre atomique.
La présence de mercure dans l’eau se retrouve dans les poissons et dans les sédiments sous sa forme organique, à cause de son affinité pour les lipides des tissus gras des organismes vivants et par précipitation pour les sédiments marins contenant aussi ce contaminant. L’analyse de sédiments marins est tout aussi utile pour connaître l'âge d'une pollution au mercure et ainsi retracer les pollutions industrielles ou naturelles passées.
En cas d'échantillons solides, une méthode analytique semblable peut être utilisée pour déterminer le métal trace. Les échantillons solides sont d'abord traités thermiquement (combustion) dans un four fermé où la température est contrôlée et en présence d’oxygène. Les gaz ainsi créés sont ensuite dirigés dans un tube catalytique à haute température afin de réduire les organo-mercures en mercure. Le mercure ainsi généré par la combustion ou traité par le tube catalytique est amalgamé grâce à un support ayant de l'or. Cet amalgame est ensuite chauffé brutalement (autour de 950 °C) afin de relarguer le mercure en « paquet ». Le mercure est ensuite mesuré en spectroscopie d'absorption atomique en vapeur froide à 253,95 nm et quantifié par comparaison à un standard international (appelé MRC (Matériaux de Référence Certifié) ou CRM (Certified Reference Material)). Elle est appelée ainsi car la température de mesure est « relativement froide » (autour de 115 °C) au regard de l'absorption atomique classique qui utilise soit une flamme soit un four graphite. Les avantages de cette technique permettent d'éviter les préparations des échantillons qui utilisent souvent des acides ou d'autres produits chimiques. L'échantillon est simplement pesé et analysé ce qui procure aussi un gain de temps. Elles permettent aussi d'avoir un taux de récupération autour de 100 % et enfin de réduire les limites de quantification par réitération de l'amalgamation avant mesure. Ainsi, dans certaines conditions (salle blanche, amalgamation), ces limites de quantifications peuvent descendre à 0,005 ng de mercure pour 1 g d'échantillon soit 0,005 ppb ou 5 ppt. La limite de quantification dans des conditions normales (1 analyse simple), par cette technique, reste cependant autour de 0,5 ppb (0,5 µg/kg) ou 500 ppt. Les limites de détection se mesurent en absolu et peuvent atteindre 0,003 ng absolu de mercure.
Dans le cadre de la spectroscopie d'absorption atomique, la lampe à cathode creuse est réglée à 253,7 nm étant la longueur d'onde d'absorbance pour Hg, l’absorbance mesurée est comparée avec les absorbances de solutions étalons préparées. Le domaine d’étalonnage est entre 0,1 µg/L et 1,5 µg/L. Il existe une limite de quantification de 0,12 µg/L découlant d’une limite de détection d’environ 0,04 µg/L. Le taux de récupération de cette méthode est de 101 % depuis la matrice de l’eau, 97,2 % pour les milieux biologiques et 90,1 % pour les sédiments selon les analyses du Centre d’Expertise en Analyse Environnementale du Québec125.
Histoire
Connu depuis l'Antiquité, les alchimistes puis le corps médical du XVIe au XIXe siècle le désignaient par le nom « vif-argent » et le représentaient grâce au symbole de la planète Mercure, d'où son nom actuel.
Ce métal, en dépit de sa haute toxicité autrefois négligée, a eu de tout temps de nombreuses utilisations :
- Il a été utilisé pour produire de nombreux remèdes, simples ou composés, plus ou moins communément employés (« mercure courant, coulant ou crud ; le mercure uni plus ou moins intimement au soufre ; savoir, le cinabre & l'éthiops minéral, plusieurs sels neutres ou liqueurs salines, dont le mercure est la base ; savoir, le sublimé corrosif, le sublimé doux & mercure doux, ou aquila alba ; le calomelas des Anglois, la panacée mercurielle, le précipité blanc & l'eau phagédénique, la dissolution de mercure & le précipité rouge, le turbith minéral ou précipité jaune, & le précipité verd. Toutes ces substances doivent être regardées comme simples en Pharmacie, voyez Simple, Pharmacie. Les compositions pharmaceutiques mercurielles les plus usitées, dont les remèdes mercuriels sont l'ingrédient principal ou la base, sont les pilules mercurielles de [p. 375] la pharmacopée de Paris ; les pilules de Belloste, les dragées de Keyser, le sucre vermifuge & l'oprate mésentérique de la pharmacopée de Paris, la pommade mercurielle, onguent néapolitain ou onguent à frictions, l'onguent gris, l'onguent mercuriel pour la gale, les trochisques escharotiques, les trochisques de minium, l'emplâtre de vigo, &c »)126.
- Le mercure fut utilisé probablement dès 2700 avant notre ère pour amalgamer l'or, l'argent ou d'autres métaux. La plupart des chercheurs d'or utilisent encore du mercure pour amalgamer les paillettes ou poussières d'or. L'amalgame obtenu est ensuite chauffé vers 400 à 500 °C, ce qui conduit à l'évaporation du mercure. Cette vapeur de mercure peut être distillée, c’est-à-dire condensée et récupérée après son évaporation lors de son passage dans un simple serpentin refroidi, mais c'est rarement le cas lors de l'orpaillage artisanal. Il concernerait au moins 10 % de la production mondiale d'or, mais sur l'essentiel du territoire prospecté en termes de surface. Il pose de très graves problèmes de pollution, notamment des rivières et des écosystèmes qu'elles irriguent en Amazonie ainsi qu'en Birmanie entre autres. Les populations qui consomment beaucoup de poissons, et en particulier les personnes les plus âgées sont particulièrement concernées (ex : Amérindiens Wayana en Amazonie).
- En miroiterie, on a employé le mercure dans l'étamage des glaces. La feuille de verre était étamée (ou mise au tain) sur son dessous, c'est-à-dire couverte d'une feuille d'étain préparée et dissoute en partie par le mercure. Celui-ci servait à dissoudre en partie la feuille d'étain, et l'aidait à son parfait contact avec le poli de la glace. Le tain était un amalgame de plomb, d’étain et de bismuth réduit en feuilles127. On a aussi utilisé le mercure et d'étain sous forme d'amalgame[réf. nécessaire].
- Du fait de la densité élevée de ce métal, Torricelli utilisa du mercure pour la création de son baromètre en 1643.
- Grâce à son coefficient de dilatation thermique élevé, le mercure fut, dès le XVIIe siècle, utilisé pour la fabrication des thermomètres. Cela pose d'ailleurs des problèmes de santé publique : cf. Thermomètre et tensiomètre à mercure
- L'amalgame de mercure et d'or est utilisé dans l'artisanat d'art pour réaliser la dorure de différents objets, notamment les bronzes.
- L'Anglais Howard fut le premier à utiliser, en 1799, le fulminate de mercure (Hg(ONC)2) comme détonateur. Cet usage a perduré jusqu'à récemment.
- L'alchimiste du XVIe siècle Paracelse élabora un remède contre la syphilis à base de mercure.
- Dans le calendrier républicain, Mercure était le nom donné au 29e jour du mois de nivôse128.
Notes et références
Notes
- hydrárgyros est composé de ὕδωρ, húdôr (« eau »), et ἄργυρος, árgyros (« argent ») soit « argent liquide ».
- La masse volumique du mercure est ainsi égale à 13,6 fois celle de l'eau, et supérieure de 20 % à celle du plomb.
Références
- (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press Inc, , 90e éd., 2804 p., Relié (ISBN 978-1-420-09084-0)
- (en) Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana E. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge Echeverría, Eduard Cremades, Flavia Barragán et Santiago Alvarez, « Covalent radii revisited », Dalton Transactions, , p. 2832 - 2838 (DOI 10.1039/b801115j)
- (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC, , 89e éd., p. 10-203
- Entrée « Mercury » dans la base de données de produits chimiques GESTIS de la IFA (organisme allemand responsable de la sécurité et de la santé au travail) (allemand, anglais), accès le 28 août 2018 (JavaScript nécessaire)
- Procès-verbaux du Comité international des poids et mesures, 78e session, 1989, pp. T1-T21 [archive] (et pp. T23-T42, version anglaise).
- (en) Metals handbook, vol. 10 : Materials characterization, ASM International, , 1310 p. (ISBN 0-87170-007-7), p. 344
- « Mercure [archive] » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009
- (en) Maodian Liu, Qianru Zhang, Taylor Maavara et Shaoda Liu, « Rivers as the largest source of mercury to coastal oceans worldwide », Nature Geoscience, vol. 14, no 9, , p. 672–677 (ISSN 1752-0894 et 1752-0908, DOI 10.1038/s41561-021-00793-2, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) « transition element [archive] », IUPAC, Compendium of Chemical Terminology [« Gold Book »], Oxford, Blackwell Scientific Publications, 1997, version corrigée en ligne : (2019-), 2e éd. (ISBN 0-9678550-9-8) « Transition element: an element whose atom has an incomplete d sub-shell, or which can give rise to cations with an incomplete d sub-shell. ».
- [Cambayrac F., 2010, Maladies émergentes, comment s'en sortir ?, Éditions Mosaïque-Santé].
- http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/INC2/INC2_20_report_f.pdf [archive].
- Actu Environnement, Vers un traité international contre la pollution au Mercure [archive], 26 février 2009.
- Journal de l'environnement Vers un traité international sur le mercure? [archive] 31 octobre 2011.
- K. Krist Hirst, « Cinnabar - The Ancient Pigment of Mercury » [archive] (consulté le )
- Théophraste (traduit du grec par Hill, puis de l'anglais en français), Traité des pierres, Chez J.-T. Herissant, (lire en ligne [archive])
- Philippe Remacle Marc Szwajcer, « Théophraste Le livre des pierres » [archive] (consulté le )
- John Scarborough, « Introduction », dans Pedanius Dioscorides of Anazarbus, translated by Lily Y. Beck, De materia medica, Olms - Weidmann, (ISBN 978-3-487-14719-2)
- Pline l'Ancien, Histoire naturelle (traduit, présenté et annoté par Stéphane Schmitt), Bibliothèque de la Pléiade, nrf, Gallimard, , 2131 p.
- Pline l'Ancien (trad. Émile Littré), Histoire naturelle de Pline : avec la traduction en français. Tome 2, Firmin-Didot et Cie (Paris), (lire en ligne [archive])
- Auguste Bouché-Leclercq, L'astrologie grecque, E. Lerous, Paris, (lire en ligne [archive])
- (la) Gabir, Bacon et al., In hoc vo lumine De alchemia continentur haec, Norimberge : apud Ioh. Petreium, (lire en ligne [archive])
- K. Beaugelin-Seiller et O. Simon, Fiche pédagogique Radionucléide 203Hg [archive] IRSN, PDF, 21 pp, 2004-05-12.
- GRNC (1999). Inventaire des rejets radioactifs des installations nucléaires. Volume 1 du rapport de mission du Groupe Radioécologique Nord Cotentin, IRSN, Paris, 196 p.
- ATSDR (1999). Toxicological Profile for Mercury [archive]. Agency for Toxic Substances and Disease Registry, États-Unis, consulté le 6 janvier 2003).
- Alain Foucault, opus cité.
- Article de la revue du BRGM sur le mercure et la santé [archive].
- Francisco Blanco Alvares et José Pedro Sancho Martinez métallurgie du mercure [archive] 10 janv. 1993, consulté 2010/06/25].
- « Gallium » [archive], sur societechimiquedefrance.fr.
- Fiche INRS, 1997 [archive] (page 1/6).
- http://sante-guerir.notrefamille.com/v2/services-sante/article-sante.asp?id_guerir=373 [archive].
- Phares - Les dangers du mercure [archive].
- Avec le germanium (électronique avancée) ; titane (sous-marins de chasse, alliage extrêmement résistant) ; magnésium (explosifs) ; platine (contacts aussi conducteurs que l'or pour l'aviation, circuits avec contacts rapides) ; molybdène (acier) ; cobalt (chimie nucléaire) ; colombium (alliages spéciaux extrêmement rares). (Christine Ockrent, comte de Marenches, Dans le secret des princes, éd. Stock, 1986, p; 193.).
- Jörg Rinklebe, Anja During, Mark Overesch, Rainer Wennrich, Hans-Joachim Stärk, Sibylle Mothes, Heinz-Ulrich Neue (2009) Optimization of a simple field method to determine mercury volatilization from soils—Examples of 13 sites in floodplain ecosystems at the Elbe River (Germany) ; Vol.35, Issue 2, 9 fév 2009, Pages 319–328 (résumé [archive]).
- Estrade N (2010) Discrimination et traçage isotopique des sources anthropiques du mercure dans l'environnement [archive] (Doctoral dissertation, Université de Pau et des Pays de l'Adour).
- McWhinney, H.G., Cocke, D.L., Balke, K., Ortego, J.D., (1990) An investigation of mercury solidification and stabilization in Portland cement using xray photoelectron spectroscopy and energy dispersive spectroscopy. Cement and concrete research, 20, 79-91 (en).
- (en) Lars Björkman, Birgitte F Lundekvam, Torgils Lægreid et Bjørn I Bertelsen, « Mercury in human brain, blood, muscle and toenails in relation to exposure: an autopsy study », Environmental Health, vol. 6, no 1, , p. 30 (ISSN 1476-069X, PMID 17931423, PMCID PMC2098763, DOI 10.1186/1476-069X-6-30, lire en ligne [archive], consulté le )
- « Mercury and Mercury Compounds (IARC Summary & Evaluation, Volume 58, 1993) » [archive], sur inchem.org (consulté le )
- Counter S.A et Buchanan L.H (2004) Mercury exposure in chidren : a review. Toxicology and Applied Pharmacology 198: 209-230.
- Li Z, Dong T, Proschel C, Noble M. 2007. Chemically diverse toxicants converge on Fyn and c-Cbl to disrupt precursor cell function. PLoS Biol 5(2):e35.
- (en) Raphael A. Lavoie, Ariane Bouffard, Roxane Maranger et Marc Amyot, « Mercury transport and human exposure from global marine fisheries », Scientific Reports, vol. 8, no 1, (ISSN 2045-2322, DOI 10.1038/s41598-018-24938-3, lire en ligne [archive], consulté le )
- Voir le site du Sénat [archive].
- « La principale source d'exposition au mercure dans les pays développés est dentaire » [archive], (consulté le ).
- : métaux et métalloïde [archive] des recherches de la cohorte Elfe ; décembre 2016 ; SANTÉ PUBLIQUE France / Imprégnation des femmes enceintes par les polluants de l’environnement en France en 2011]. Volet périnatal du programme national de biosurveillance|PDF, 224p|aussi disponible à partir de l’URL : www.santepubliquefrance.fr
- étude ENNS 2007
- (fr) Exposition au mercure de la population amérindienne Wayana de Guyane [archive].
- Page AFSSET sur le mercure en Guyane. [archive].
- AMIARD Jean-Claude et AMIARD-TRIQUET Claude (2008) Les biomarqueurs dans l'évaluation de l'état écologique des milieux aquatiques [archive] ; Lavoisier, 14 janv. voir p 165/400 pages
- AMIARD Jean-Claude et AMIARD-TRIQUET Claude (2008) Les biomarqueurs dans l'évaluation de l'état écologique des milieux aquatiques [archive] ; Lavoisier, 14 janv. voir p 256/400 pages
- AMIARD Jean-Claude et AMIARD-TRIQUET Claude (2008) Les biomarqueurs dans l'évaluation de l'état écologique des milieux aquatiques [archive] ; Lavoisier, 14 janv. voir p 12/400 pages
- Emilien Pelletier ; Modification de la bioaccumulation du sélénium chez Mytilus edulis en présence du mercure organique et inorganique ; Can. J. Fish. Aquat. Sci. 43(1): 203–210 (1986); doi:10.1139/f86-023 ; 1986 CNRC Canada (Résumés anglais et français [archive]).
- J.P. Breittmayer, R. Guido et S. Tuncer ; Effet du cadmium sur la toxicite du mercure vis-a-vis de la moule ; Chemosphere Volume 9, Issue 11, 1980, Pages 725-728 doi:10.1016/0045-6535(80)90125-3 (Résumé [archive]).
- (en) Charles T. Driscoll, Robert P. Mason, Hing Man Chan et Daniel J. Jacob, « Mercury as a Global Pollutant: Sources, Pathways, and Effects », Environmental Science & Technology, vol. 47, no 10, , p. 4967–4983 (ISSN 0013-936X et 1520-5851, DOI 10.1021/es305071v, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) Anne L. Soerensen, Daniel J. Jacob, Amina T. Schartup et Jenny A. Fisher, « A mass budget for mercury and methylmercury in the Arctic Ocean: ARCTIC OCEAN HG AND MEHG MASS BUDGET », Global Biogeochemical Cycles, vol. 30, no 4, , p. 560–575 (DOI 10.1002/2015GB005280, lire en ligne [archive], consulté le )
- Courcelles M (1998), Enregistrement sédimentaire des flux récents de métaux lourds (Pb, Hg) et d'isotopes à courte période e1opb, I37 Cs et 228Th) dans un lac sub arctique à faible vitesse de sédimentation (Lac Jobert, Québec), Thèse, Université du Québec à Montréal : 185 p.
- Rapport "Évaluation mondiale du mercure [archive] « Copie archivée » (version du 14 mai 2014 sur l'Internet Archive)" du Programme des Nations unies pour l'Environnement (décembre 2002), p. 114.
- Rapport "Évaluation mondiale du mercure [archive] « Copie archivée » (version du 14 mai 2014 sur l'Internet Archive)" du Programme des Nations unies pour l'Environnement (décembre 2002), p. 103.
- (en) Maodian Liu, Qianru Zhang, Yao Luo et Robert P. Mason, « Impact of Water-Induced Soil Erosion on the Terrestrial Transport and Atmospheric Emission of Mercury in China », Environmental Science & Technology, vol. 52, no 12, , p. 6945–6956 (ISSN 0013-936X et 1520-5851, DOI 10.1021/acs.est.8b01319, lire en ligne [archive], consulté le )
- Streets D.G, Horowitz H.M, Jacob D.J, Lu Z, Levin L, Ter Schure A.F et Sunderland E.M (2017) Total Mercury Released to the Environment by Human Activities [archive]. Environmental Science & Technology, 51(11): 5969–5977
- UNEP (2013) Global Mercury Assessment 2013 : Sources, Emissions, Releases and Environmental Transport; United Nations Environment Programme (UNEP), Genève, Suisse. http://wedocs.unep.org//handle/20.500.11822/7984 [archive])
- International Energy Agency (2016). Key World Energy Statistics, 2016 edn | URL:https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2016.pdf [archive]
- Song S et al. (2015) Top-down constraints on atmospheric mercury emissions and implications for global biogeochemical cycling. Atmos. Chem. Phys. 15, 7103–7125
- (en) Noelle E. Selin, Daniel J. Jacob, Robert M. Yantosca et Sarah Strode, « Global 3-D land-ocean-atmosphere model for mercury: Present-day versus preindustrial cycles and anthropogenic enrichment factors for deposition », Global Biogeochemical Cycles, vol. 22, no 2, , n/a–n/a (ISSN 0886-6236, DOI 10.1029/2007gb003040, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) Toru Kawai, Takeo Sakurai et Noriyuki Suzuki, « Application of a new dynamic 3-D model to investigate human impacts on the fate of mercury in the global ocean », Environmental Modelling & Software, vol. 124, , p. 104599 (ISSN 1364-8152, DOI 10.1016/j.envsoft.2019.104599, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) David Kocman, Simon Wilson, Helen Amos et Kevin Telmer, « Toward an Assessment of the Global Inventory of Present-Day Mercury Releases to Freshwater Environments », International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 14, no 2, , p. 138 (ISSN 1660-4601, PMID 28157152, PMCID PMC5334692, DOI 10.3390/ijerph14020138, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) Celia Y. Chen, Mark E. Borsuk, Deenie M. Bugge et Terill Hollweg, « Benthic and Pelagic Pathways of Methylmercury Bioaccumulation in Estuarine Food Webs of the Northeast United States », PLoS ONE, vol. 9, no 2, , e89305 (ISSN 1932-6203, DOI 10.1371/journal.pone.0089305, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) Kate L. Buckman, Robert P. Mason, Emily Seelen et Vivien F. Taylor, « Patterns in forage fish mercury concentrations across Northeast US estuaries », Environmental Research, vol. 194, , p. 110629 (ISSN 0013-9351, DOI 10.1016/j.envres.2020.110629, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) Sofi Jonsson, Agneta Andersson, Mats B. Nilsson et Ulf Skyllberg, « Terrestrial discharges mediate trophic shifts and enhance methylmercury accumulation in estuarine biota », Science Advances, vol. 3, no 1, , e1601239 (ISSN 2375-2548, DOI 10.1126/sciadv.1601239, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) Amina T. Schartup, Prentiss H. Balcom, Anne L. Soerensen et Kathleen J. Gosnell, « Freshwater discharges drive high levels of methylmercury in Arctic marine biota », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 112, no 38, , p. 11789–11794 (ISSN 0027-8424 et 1091-6490, DOI 10.1073/pnas.1505541112, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) Igor Lehnherr, Vincent L. St. Louis, Holger Hintelmann et Jane L. Kirk, « Methylation of inorganic mercury in polar marine waters », Nature Geoscience, vol. 4, no 5, , p. 298–302 (ISSN 1752-0894 et 1752-0908, DOI 10.1038/ngeo1134, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) Joel D. Blum, Brian N. Popp, Jeffrey C. Drazen et C. Anela Choy, « Methylmercury production below the mixed layer in the North Pacific Ocean », Nature Geoscience, vol. 6, no 10, , p. 879–884 (ISSN 1752-0894 et 1752-0908, DOI 10.1038/ngeo1918, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) Jeroen E. Sonke, Roman Teisserenc, Lars-Eric Heimbürger-Boavida et Mariia V. Petrova, « Eurasian river spring flood observations support net Arctic Ocean mercury export to the atmosphere and Atlantic Ocean », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 115, no 50, , E11586–E11594 (ISSN 0027-8424 et 1091-6490, DOI 10.1073/pnas.1811957115, lire en ligne [archive], consulté le )
- Fitzgerald, W. F., and C. J. Watras, 1989, Mercury in surficial waters of rural Wisconsin lakes, Sci. Tot. Environ. 87/88:223
- Schickling, C., and J. Broekaert, 1995, Determination of Mercury Species in Gas Condensates by On-line Coupled HPLC and CVAA Spectrometry, App. Organomet. Chem., 9:29.
- Liang, L., Lazoff, S., Horvat, M., Swain, E., and J. Gilkeson, 2000, Determination of mercury in crude oil by in-situ thermal decomposition using a simple lab built system, Fresenius’ J. Anal. Chem., 367:8.
- Olsen, S., Westerlund, S., and R. Visser, 1997, Analysis of Metals in Condensates and Naphthas by ICP-MS, Analyst, 122:1229.
- Shafawi, A., Ebdon, L., Foulkes, M., Stockwell, P., and W. Corns, 1999, Determination of total mercury in hydrocarbons and natural gas condensate by atomic fluorescence spectrometry, Analyst, 124:185.
- Wilhelm, S., and N. Bloom, 2000, Mercury in Petroleum, Fuel Proc. Technol., 63:1.
- Wilhelm, S., 2001, An Estimate of Mercury Emissions from Petroleum, in press, Environ. Sci. Tech., cité par le rapport US EPA de 2001 (déjà cité dans les notes de cet article).
- Frech, W., Baxter, D., Bakke, B., Snell, J., and Y. Thomasson, 1996. Determination and Speciation of Mercury in Natural Gases and Gas Condensates, Anal. Comm., 33:7H (May).
- Tao, H., Murakami, T., Tominaga, M., and A. Miyazaki, 1998, Mercury speciation in natural gas condensate by gas chromatography-inductively coupled plasma mass spectrometry, J. Anal. At. Spectrom., 13:1085.
- [PDF]David Kirchgessner ; Mercury in Petroleum and Natural Gas: Estimation of Emissions From Production [archive], Processing, and Combustion (PDF)], Sept 2001 (ou résumé [archive] US EPA, Office of Research & Development | National Risk Management Research Laboratory. Voir notamment le chap. 5 ("Mercury in Petroleum and Natural Gas").
- Bloom, N. S., 2000, Analysis and Stability of Mercury Speciation in Petroleum Hydrocarbons, Fresenius J. Anal. Chem., 366:5.
- Azcue, lM., Mudroch, A., Rosa, F., Hall, G.E.M., Jackson, 1.A. et Reynoldson, T. (1995), Trace-Elements in Water, Sediments, Porewater, and Biota Polluted by Tailings from an Abandoned Gold Mine in British-Columbia, Canada. Journal of Geochemical Exploration 52(1-2): 25-34.
- Crawford, G. A. (1995), Environmental Improvements by the Mining-Industry in the Sudbury Basin of Canada. Journal of Geochemical Exploration 52(1-2): 267 284.
- Wong, H. K. T., Gauthier, A et Nriagu, 1. O.(1999), Dispersion and toxicity of metals from abandoned gold mine tailings at Goldenville, Nova Scotia, Canada. Science of the Total Environment 228(1): 35-47.
- Weech, S.A., Scheuhammer, AM., Elliott, J.E. et Cheng, K.M. (2004) mercury in fish from the Pinchi Lake region, British Colombia, Canada. Environmental Pollution 131:275-286.
- Grigal, D. F. (2002), Inputs and outputs of mercury from terrestrial watersheds: A review. Environmental Review 10: 1-39.
- (en) Helen M. Amos, Daniel J. Jacob, David G. Streets et Elsie M. Sunderland, « Legacy impacts of all-time anthropogenic emissions on the global mercury cycle », Global Biogeochemical Cycles, vol. 27, no 2, , p. 410–421 (ISSN 0886-6236, DOI 10.1002/gbc.20040, lire en ligne [archive], consulté le )
- Date du brevet déposé par Gévelot pour les munitions de chasse.
- Fu, X. W., Zhang, H., Yu, B., Wang, X., Lin, C. J., et Feng, X. B. (2015). Observations of atmospheric mercury in China: a critical review [archive]. Atmospheric Chemistry and Physics, 15(16), 9455.
- Chiffres publiées sur le site du CITEPA.
- la directive 2002/95/CE du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, limite (dans son annexe) la quantité de mercure contenue dans les lampes fluorescentes à 5 mg. Ceci est transposés dans le droit français par un décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements (décret DEEE). L’arrêté du 25 novembre 2005 modifié par les arrêtés du 6 juillet 2006 et du 25 février 2009, complètent le décret précité.
- [Avis relatif aux risques liés à l’utilisation des lampes fluocompactes en milieu domestique 11/10 et 01/11 Voir l'avis [archive], sur 22 janvier 2008, saisine de la Commission sur les risques associés à la présence de mercure dans des ampoules à basse consommation, appelées aussi lampes fluocompactes (requête n° 08-012).
- directive européenne n°2004/107/CE du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant.
- décret n°2008-1152 du 7 novembre 2008 relatif à la qualité de l’air.
- Rem : ces données proviennent de la base de donées WISE-SoW où figurent les pays de l'UE 28 excepté la Croatie, le Danemark, la Grèce, l'Irlande et la Lituanie ; source : https://www.eea.europa.eu/media/infographics/impact-of-mercury-on-european-1/view [archive]
- Raloff, Jo., 1991. Mercurial Risks From Acids Reign, Science News, 130:152-166.
- (en) NIVA, « Investigations of mercury during a survey near submarine U-864 outside Fedje in 2013 » [archive] [PDF], sur rapp.niva.no, (consulté le ).
- (no) Kystverket, « Hva har skjedd med U-864 siden 2003? » [archive] [« Qu'est-il arrivé à l'U-864 depuis 2003? »], sur kystverket.no, (consulté le ).
- Marusczak N (2010). Étude du transfert du mercure et du méthylmercure dans les écosystèmes lacustres alpins [archive], Thèse de Doctorat de l'Université de Grenoble en Sciences de la Terre et de l’Univers et de l’Environnement, soutenue le 26 novembre 2010 (résumé [archive]), PDF, 206 pages.
- Antoine N., Jansegeers I., Holsbeek L., Joiris C., Bouquegneau J.-M. (1992), Contamination par les métaux lourds des oiseaux marins et des marsouins de la Mer du Nord [archive], Bull. Soc. Roy. Sc. Liège, 61, 162, 1992, 163-176 (PDF).
- T.; Roschnik, R Stijve (1976), Mercury and methyl mercury content of different species of fungi. (étude qui a analysé des échantillons de 32 espèces de champignons prélevés sur des sols scandinaves), 1976-04-01 ; 974 AD ; Control Lab. of Nestle Products Tech. Assistance Co. Ltd., La Tour-de-Peilz, Switzerland SO Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene 65 (2) 209-220 ; 16 ref.
- Plan mercure de l'ONU [archive] (Programme des Nations unies pour l'environnement, (en)).
- « Japon: 140 pays signent la «Convention Minamata» sur le mercure »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • http://www.liberation.fr/monde/2013/10/10/japon-140-pays-signent-la-convention-minamata-sur-le-mercure_938411" rel="nofollow" class="external text">Google • Que faire ?), Libération, 10 octobre 2013.
- Convention sur le mercure adoptée à Genève par 140 États [archive], 20 minutes, du 19 février 2013.
- Communication de la Commission, du 28 janvier 2005 [archive], « Stratégie communautaire sur le mercure » [COM(2005) 20 - Journal officiel C 52 du 2 mars 2005].
- Voir aussi [archive] (UE).
- COM(2002) 489 - Non publié au Journal officiel.
- directive 82/176/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins (Journal officiel L 81 du 27.03.1982).
- Page sur le statut du mercure en Europe [archive].
- Communiqué du parlement européen, juillet 2007 [archive]).
- La Norvège interdit l'utilisation de mercure [archive], lemonde.fr, dépêche AFP 21 décembre 2007 à 11h32.
- http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_011.pdf [archive].
- Projet de règlement [archive].
- L’Environnement pour les Européens - La Commission propose d’interdire les exportations européennes de mercure [archive].
- Velge Pierre, Pinte Jérémy, Noël Laurent et Guérin Thierry, « Bilan de la surveillance 2008 des niveaux de contamination en mercure dans les produits de la pêche - Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Direction générale de l'alimentation, Bureau des produits de la mer et d'eau douce ; Bulletin épidémiologique, 2010-03, n° 36 » [archive] (consulté le ).
- « De « graves anomalies » dans la politique de contrôle sanitaire » [archive], (consulté le ).
- JOUE L.137 : règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure, abrogeant le règlement (CE) 1102/2008 ; voir aussi le communiqué de la DG Environnement [archive] et le mémo(Questions/réponses) [archive] joint
- Mercure - nouveau règlement alignant le droit de l'UE sur la Convention de Minamata, 24 mai 2017 : Mis à jour : 30 mai 2017
- (en) Alarming New Data Reveals Dangerous Mercury Levels In Rain Falling On Midwestern Cities [archive].
- IDRC [archive] page sur étude réalisée en Amazonie sur le lien entre alimentation et contamination mercurielle (Voir [archive]).
- SWEDEN: mercury sniffer dogs clean up Swedish schools [archive] (Article du 16 avril 1999, consulté 2010 03 27).
- OCDE ; Politiques de l'environnement : quelles combinaisons d'instruments ? ; 2007 ;.
- Ruiz ON, Daniell H. ; Genetic engineering to enhance mercury phytoremediation ; Curr Opin Biotechnol. 2009 Apr;20(2):213-9. Epub 2009 Mar 26. Review.PMID 19328673 [archive].
- Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, Détermination du mercure dans l’eau; Méthode par spectrophotométrie d’absorption atomique et génération de vapeur ; MA. 203 – Hg 1.0, Ministère de l’Environnement du Québec, 2003, 16 p.
- Article « mercure » de l'Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers [archive].
- J.M. Morisot, Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages du bâtiment. Vocabulaire des arts et métiers en ce qui concerne les constructions (miroiterie), Carilian, 1814.
- Aubin-Louis Millin, Annuaire du républicain, ou légende physico-économique, Paris, Marie-François Drouhin, (lire en ligne [archive])
Bibliographie
- Hans Breuer (dir.), "Mercure", Atlas de la chimie, Le livre de poche, 476 pages
- Alain Foucault, Jean-François Raoult, Fabrizio Cecca, Bernard Platevoet, Dictionnaire de Géologie - 8e édition, Français/Anglais, édition Dunod, 2014, 416 pages. Avec la simple entrée "mercure" p. 212.
- Paul Pascal, Nouveau traité de chimie minérale, Paris, Masson, (réimpr. 1966), 32 vol. (BNF 37229023) :
« 5. Zinc, cadmium, mercure ; 20.1. Alliages métalliques ; 20.2. Alliages métalliques (suite) ; 20.3 Alliages métalliques (suite) »
- (en) Daniel Obrist, Jane L. Kirk, Lei Zhang et Elsie M. Sunderland, « A review of global environmental mercury processes in response to human and natural perturbations: Changes of emissions, climate, and land use », Ambio, vol. 47, no 2, , p. 116–140 (ISSN 0044-7447 et 1654-7209, DOI 10.1007/s13280-017-1004-9, lire en ligne [archive], consulté le )
- Guy Pérez, Jean-Louis Vignes, article « Mercure, élément chimique », in Encyclopædia Universalis, début [archive]
- Précis de médecine du travail - chapitre « Mercure » - 4e édition
- Techniques de l'Ingénieur, traité Matériaux métalliques, M 2 395 - « Métallurgie du mercure »
Vidéographie
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Liens externes
- MERCURE AU CHROME
Pansement
Un pansement est un dispositif de protection permettant de recouvrir une plaie située sur la peau.
Le pansement adhésif est parfois désigné en France par le terme éponyme sparadrap ou, au Canada francophone, diachylon ou plaster, nom commun emprunté à l'anglais.
Origines
Le pansement est une mesure de soin des plaies mise au point dès la préhistoire, et documentée dès l'Antiquité.
Au Moyen-Age, Fra Tederico (Lucca, 1206 – Bologne, 1298), disciple (et peut-être fils) d'Ugo de Borgognoni da Lucca, auteur d'un traité de chirurgie en 1260 préconise l'usage de pansements imbibés de vin pour aseptiser rapidement les plaies. Le Livre du trésor de chirurgie en français, daté du XIVe ou XVe siècle, qui serait bien l'œuvre de l'école de chirurgie de Paris contient une « toile de maistre Jehan Pitart contre toutes bleceures de jambes et d'autres lieus et en ot la recepte du roy de France », c'est-à-dire une recette de pansement formé d'une toile enduite de suif de cerf et de gommes cuits au vin pour désinfecter la plaie1,2. Au XVe siècle, François Rabelais fait réaliser par son héros, Pantagruel un pansement à l'alcool qui vaut à ses serviteurs « d'estre tantost gueris ».
La définition du pansement figure dès la premiere édition de l'encyclopédie de Denis Diderot en 17653.
Les guerres napoléoniennes contribuent à leur popularité.
Pendant le siège de Paris en 1870, le médecin Alphonse Guérin, developpe le pansement ouaté4. Sa methode permet d'éviter efficacement que les germes présents dans l'air n'atteignent une plaie. Elle lui vaudra le surnom de « père de la méthode aseptique».
Utilité
Le pansement a plusieurs buts5 :
- protéger la plaie (contre une infection, une irritation) et l'isoler du milieu extérieur ;
- permettre une meilleure cicatrisation en maintenant un milieu humide favorable sur le lit de la plaie ;
- faire cesser un saignement minime en comprimant les petits vaisseaux ;
- rapprocher les berges d'une plaie ;
- absorber les exsudats afin de préserver les berges de la plaie et la peau péri-lésionnelle. Le pansement doit également retenir les exsudats afin d'éviter la macération des berges.
Les différents types de pansements
Les pansements sont nombreux et varient selon le type de plaies6.
- Une de ses formes les plus communes dans la vie quotidienne se présente sous la forme d'une fine compresse maintenue sur la plaie par un adhésif. Cependant, il s'agit là de pansements dits « secs » qui ne permettent pas le maintien d'un milieu humide.
- Il existe également des pansements dits « modernes » : hydrocellulaires, hydrofibres, alginates, hydrogels et hydrocolloïdes. Le choix du type de pansement doit être fonction du stade de la plaie (état de la plaie qui peut être nécrotique, fibrineuse, bourgeonnante, en voie d'épidermisation) et du niveau d'exsudat (liquide sécrété par la plaie et pouvant être d'un volume plus ou moins élevé). Certains pansements sont également dits à hématose et se présentent sous forme de mèches coagulantes ou de poudre7.
Remarques relatives au choix d'un pansement :
- le patient peut être allergique à l'un des composants du pansement (film plastique, gel, adhésif) : vérifier au préalable ;
- un pansement trop adhésif ou desséché peut être douloureux à l'ablation ;
- un pansement non transparent peut gêner la surveillance de la plaie.
De couleur claire, le pansement contraste avec les pigmentations foncées de peau. Toutefois en 2020 apparaissent au Royaume-Uni des pansements disponibles pour trois tons de peau (claire, moyenne et foncée)8.
Bibliographie
- Christian Régnier, L'art de panser: penser la plaie : petite histoire du traitement des plaies et de l'art de panser, Paris, LEN médical, impr. 2002, 112 p., (ISBN 9782914232142)
- Z. Cope, The treatment of wounds through the ages. Medical history 1958, 2, 163-74.
- E. Churchill, Healing by first intention and with suppuration : studies in the history of wound healing; Journal of the history of medicine, 1964, 193-214.
Notes et références
- K. Sudhoff, « Ein chirurgisches Manual des Jean Pitard, Wundarztes König Philipps des Schönen von Frankreich », Archiv für Geschichte der Medizin, 2, 1908
- C. de Tovar, « Contamination, interférences et tentatives de systématisation dans la tradition manuscrite des réceptaires médicaux français : le réceptaire de Jean Sauvage », Revue d’Histoire des Textes, 3, 1973, p. 115-191, p. 160 ss.
- reproduit sous https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Encyclop%C3%A9die/1re_%C3%A9dition/PANSEMENT [archive]
- « Alphonse Guérin » [archive], sur www.assorennes.org (consulté le )
- « Le pansement stérile » [archive], sur www.soins-infirmiers.com (consulté le )
- « Les différents types de pansements » [archive], sur www.therapeutique-dermatologique.org (consulté le ).
- « Les nouveaux pansements: poudre et coagulants » [archive], sur www.universpara.com
Articles connexes
Sur les autres projets Wikimedia :
Pansement compressif
Application d'un tampon compressif sur une plaie hémorragique afin d'en limiter le saignement. Le membre est surélevé afin de limiter mécaniquement l'afflux sanguin
Un pansement compressif est un pansement qui possède la caractéristique d'exercer une pression sur une plaie afin de juguler ou de prévenir une hémorragie.
Principe de fonctionnement
L'objectif de ce type de pansements est d'arrêter ou de limiter un saignement abondant en appliquant une forte pression sur la lésion à l'aide d'un tampon (une compresse ou un linge propre) et d'un système de maintien (une bande ou une pression manuelle) sur une lésion cutanée hémorragique en comprimant le réseau sanguin sous-jacent à la plaie au niveau de la peau.
Il ne peut se réaliser que sur une plaie franche sans corps étrangers ni morceaux d'os (fracture ouverte). Contrairement au garrot qui interrompt totalement la circulation sanguine, le pansement compressif peut rester en place plusieurs heures durant, jusqu'à 24 heures lors de cathéterisme artériel par exemple.
Cette technique est maintenant préférée (en formation PSC1) à la mise en place d'un garrot ou l'utilisation d'un point de compression qui bloquent l'afflux de sang d'une artère.
La mise en place d'un garrot tourniquet est de nouveau enseignée dans les formations de secourisme, dans des circonstances exceptionnelles.
Procédés
En milieu hospitalier
Le pansement compressif est réalisé dans la plupart des cas dans les suites immédiates d'une intervention chirurgicale, ou chez une personne à fort risque hémorragique en cas de brèche cutanée. Il est généralement constitué d'un paquet de compresses maintenu par une bande élastique adhésive. Les compresses peuvent être complétées par un pansement hémostatique.
En situation d'urgence ou lors d'un secours à une victime
Il est possible de se servir d'un linge propre (un vêtement, un mouchoir, une serviette, un torchon). Il est préférable d'éviter d'utiliser du papier ménage qui sera difficile à décoller.
Ce tampon de fortune peut être maintenu à l'aide de la main ou d'un lien large (comme un foulard, une écharpe). Il est important d'éviter d'utiliser des liens trop fins (comme une corde) qui agiraient comme garrot. Certaines trousses d'urgence du commerce contiennent des dispositifs prêts à l'emploi similaires aux pansements hospitaliers.
Dans la mesure du possible, il est important de se protéger du contact avec le sang de la personne en mettant des gants ou en se servant d'un sac plastique placé par-dessus le tampon. En cas de contact avec le sang, il est fortement recommandé de contacter un médecin afin d'évaluer un éventuel risque de contamination par des maladies transmissibles par le sang.
Surveillances
L'efficacité du pansement est à évaluer rapidement : le critère principal étant l'arrêt de l'hémorragie au niveau de la lésion. Si malgré tout du sang continue à s'extérioriser, il convient de renforcer le premier pansement, et non de l'enlever.
Il faut également surveiller l'état de la personne dans le cadre des premiers secours.
Annexes
Articles connexes
Aiguille
Quelques types d'aiguilles.
Une aiguille est un objet fin, de forme allongée. De manière plus spécifique, le mot « aiguille » peut faire référence aux termes suivants :
Couture et textile
Aiguille courbe de restauration textile au Mobilier national, Paris.
Médecine et acupuncture
- L'aiguille hypodermique, une aiguille creuse pouvant traverser la peau, qui est utilisée en médecine pour injecter des substances dans le corps, ou pour en prélever des échantillons liquides.
- L'aiguille d'acupuncture, utilisée sur le corps en acupuncture.
- L'aiguille de reverdin est une aiguille à suturer.
- L'aiguille canule, permettant le passage d'air ou de liquide à travers un orifice, naturel ou chirurgical1.
- L'aiguille à tatouer, en acier chirurgical, destinée à réaliser un tatouage sur la peau. Il en existe deux types :
- l'un pour le tracé ;
- l'autre pour l'ombrage ou le remplissage2.
Risques infectieux
Cela peut être une blessure qui vient d'une perforation accidentelle de la peau.
[afficher]
Détails des risques d'une infection par une aiguille contaminée
|
Horlogerie
- L'aiguille est un élément d'un compteur :
Ingénierie
Agriculture
- l'aiguille à meule (aussi appelée troyes) est une longue tige de bois ou de fer servant à lier les meules ou les bottes de foin. Elle est à l'origine de l'expression « Chercher une aiguille dans une botte de foin ».
Biologie
- En zoologie :
- En botanique :
- les aiguilles remplacent les feuilles chez les conifères ;
- l’omphale aiguille (Rickenella fibula), aussi nommée « omphale épingle » ou « omphale bibelot », est une espèce de champignon (Fungi) basidiomycète de la famille des Tricholomataceae.
Géographie
Mesures
Orientation
- Aiguille d'une boussole, est aimantée, les extrémités se dirigent vers les pôles magnétiques de la Terre, ce qui permet de reconnaître la direction du nord5.
Autres
- Aiguille à pompe, sert à gonfler un ballon notamment.
- En construction et génie civil, une aiguille est un câble semi-rigide conçu pour être inséré facilement dans toute la longueur d'une gaine ou d'un fourreau, afin de tirer un câble électrique, une fibre optique, un tuyau...
Arts
Expressions
- « Chercher une aiguille dans une botte de foin » signifie chercher une chose presque impossible à trouver.
- « De fil en aiguille » signifie en passant d'une chose à une autre qui lui fait suite.
- « On le ferait passer par le trou d'une aiguille » se dit de quelqu'un de timide, lâche.
- « Je vous le dis, il est plus aisé pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille, que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu » (Évangile selon saint Mathieu, XIX, 24)6.
Notes et références
Article connexe
Retrait d'un plâtre chirurgical au membre inférieur.
Enfant du
Niger portant un plâtre (2020).
Un plâtre est un système de tissu durcissable servant à assurer la contention d'un membre afin de répondre à un traumatisme, en cas de lésions tendineuses ou de fracture ou, en orthopédie, à corriger une déformation1.
Description technique
La peau est tout d'abord protégée à l'aide d'un tissu jersey et de bandes d'ouate ou de 3 couches de jersey.
Les bandes de plâtre classiques sont imprégnées de plâtre de Paris. Le plâtre dit moderne fait appel à la fibre de verre en bandes de largeurs variables à tremper également pour réaction exothermique (polymérisation comme le plâtre).
Le plâtre classique est facile à modeler, permettant des contentions externes plus confortables et surtout plus précises.
Les plâtres peuvent être en résine (polypropylène thermo malléable à faible température). Ces derniers sont radio-transparents, plus légers et plus résistants à l'eau que les plâtres classiques.
En France, les médecins, étudiants en médecine et infirmiers formés aux immobilisations plâtrées (et résines) peuvent en réaliser.
Complications
L'information, tant écrite qu'orale, du patient amené à porter un plâtre est primordiale à la pose de celui-ci2. Un plâtre mal mis en place risque de ne pas être efficace sur la lésion. S'il est trop serré, il favorise le risque d'escarre ou de syndrome des loges2.
De plus, on utilise de moins en moins le plâtre pour guérir une entorse. On lui préfère une attelle, ce qui permet d'éviter une « fonte » des muscles et une meilleure rééducation. Cependant, un plâtre est indiqué pour les entorses de degré 3 (ou entorse grave).
Quelques patients développent une phobie du plâtre qui leur rend le plâtre impossible à supporter3,4,5.
Notes et références
- Plâtre chirurgical sur HON [archive]
- (en) Anne S Boyd, Holly J Benjamin, Chad Asplund, « Principles of casting and splinting », American family physician, vol. 79, no 1, , p. 16-22 (ISSN 0002-838X, PMID 19145960, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) Moylan B. Kehoe, « Cast Claustrophobia, A Clinical Entity », Clinical Orthopaedics and Related Research, vol. 110, (DOI 10.1097/00003086-197507000-00076)
- (en) Delores Christina Schoen, Adult Orthopaedic Nursing, Lippincott Williams & Wilkins, , 484 p. (ISBN 978-0-7817-1880-6, lire en ligne [archive]), p. 122
- (en) Edward D Lanigan, Charles E Thomas, Marc D Basson, « Intolerance of short arm cast wear by patients with claustrophobia: case report », The Journal of hand surgery, vol. 35, no 5, , p. 743-745 (ISSN 1531-6564, PMID 20438992, DOI 10.1016/j.jhsa.2010.02.030, lire en ligne [archive], consulté le )
Articles connexes
Béquille (médecine)
Béquilles avec appui aux aisselles.
Une béquille est un ustensile sur lequel une personne, gênée dans sa mobilité, prend appui au niveau des bras et épaules pour soulager la charge des jambes dans la marche ou la station debout. Généralement les béquilles vont par deux, contrairement aux cannes. La forme la plus élémentaire est celle d'un bâton taillé et façonné pour relier les épaules - aux aisselles - et le sol, tandis que des modèles plus évolués appelés cannes anglaises, plus courts, plus légers et ajustables, sont conçus pour être maintenus et dirigés uniquement par les avant-bras. En médecine, les béquilles aident les patients à marcher le temps de la rééducation ou en cas de handicap.
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Fauteuil roulant
Fauteuil roulant pliable en 2006.
Un fauteuil roulant, aussi parfois appelé chaise roulante dans le langage familier, est une aide technique à la mobilité qui permet de transporter une personne assise sans peine sur une surface plane.
En France, son appellation officielle est « véhicule pour handicapé physique » (VHP).
Histoire
Chaise roulante du
XVIIIe siècle.
Les premiers meubles à roulettes ont été inventés en Chine au Ve siècle av. J.-C. : des lits pour enfants ont ainsi été découverts sur des frises. Ce n'est qu'à partir du VIe siècle que l'on trouve des fauteuils permettant de transporter des personnes2.
Un fauteuil roulant a été fabriqué spécialement pour Philippe II d'Espagne (1527-1598)3. Il figure sur un croquis datant de 1595 dans une chaise avec des roues.
Nicolas Grollier de Servières (1596-1689), ingénieur lyonnais et inventeur de machines fantastiques, construisit et exposa dans son cabinet de curiosités un fauteuil roulant dont le dessin fut publié par son petit-fils en 17194.
Un horloger allemand paralysé invente en 1665 un fauteuil à trois roues, avec une manivelle sur la roue avant.
En 1783, John Dawson de Bath en Angleterre, invente une chaise roulante nommée d'après sa ville d'origine5.
Époque moderne
À l'origine littéralement « chaises avec des roues », les fauteuils roulants, bien que souffrant d'une image plutôt négative, sont devenus de véritables objets techniques faisant appel à une technicité importante.
Il est difficile de parler de fauteuils roulants au singulier tant l'offre actuelle est importante, diversifiée et adaptée à des besoins très différents. En France uniquement, il est distribué plus de 450 modèles par une cinquantaine de fabricants. Il n'existe pas à l'heure actuelle de consensus sur leur classification, même si de grandes catégories se dessinent.
La première occurrence de compétition sportive pour handicapés se tient en 1948 à Londres, avec en particulier une épreuve de basket-ball en fauteuil6. Une institution chargée de gérer le sport en fauteuil roulant est créée en 1951, l'nternational Stoke Mandeville Federation.
Flemming Moller dépose un brevet en 2005 concernant la chaise roulante moderne7.
Description
Jeune garçon en fauteuil roulant.
Aspects pour la personne handicapée
Les paraplégiques (handicapés moteurs des membres inférieurs) et certains tétraplégiques (handicapés moteurs des membres inférieurs et supérieurs) ayant suffisamment de force dans les bras utilisent en général des fauteuils dont les roues arrière sont de grand diamètre. Ils peuvent ainsi propulser le fauteuil en mettant les roues arrière en mouvement, par l'intermédiaire d'un volant solidaire de la roue.
Il est important de distinguer la personne active (enfant ou adulte dans la force de l'âge) ayant été victime d'un accident médullaire ou autre (avec comme conséquence une paraplégie ou une tétraplégie partielle), de la personne âgée, dont les pathologies diverses associées au vieillissement font que ses capacités physiques globales sont amoindries ou très amoindries. Dans cette deuxième catégorie on peut aussi ranger les personnes souffrant de pathologies neuro-musculaires. En effet les besoins de l'un ou de l'autre sont alors très différents. C'est pourquoi l'offre de fauteuil roulant est une offre très diversifiée. Les nuances sont subtiles mais bien réelles. Certains patients auront besoin d'un fauteuil roulant manuel pour se déplacer, d'autres devront s'équiper de fauteuil roulant électrique pour garder leur autonomie.8
Le poids d'un fauteuil varie de 150 kg pour un modèle électrique complexe à 15 kg pour un modèle standard manuel, et descend désormais jusqu'à moins de 5 kg par l'emploi de matériaux spécifiques (alliages complexes d'aluminium, carbone) mais surtout aussi grâce à un travail du tube bien particulier. Les tubes peuvent être à épaisseur variable afin de "garder de la matière" là où elle est nécessaire. L'emploi du titane existe, mais son aspect cassant impose de fortes épaisseurs de tubes qui annulent l'avantage de sa faible masse volumétrique. Les prix des modèles légers sont élevés, en raison des techniques utilisées et de la qualité des matériaux, mais surtout en raison du temps passé pour la construction sur mesure et l'adaptation parfaite du modèle pour un confort maximal de l'utilisateur. Cela permet d'exploiter au mieux ses ressources musculaires et d'avoir un maximum de mobilité et de liberté au quotidien.
Dans cette optique, le fauteuil roulant devient un vrai véhicule et ses caractéristiques essentielles sont celles d'un véhicule; on parle alors de voie, d'empattement, de chasse, de carrossage, de centre de gravité, d'assiette, de diamètre de roue, de pneumatique. Tous ces paramètres vont jouer pour avoir un fauteuil maniable ou au contraire très stable mais difficile à propulser, adapté à l'extérieur, ou fait pour des salles de sport, etc. Pour les patients les plus jeunes (et les moins jeunes parfois), un facteur irrationnel mais néanmoins fondamental concerne le « look » du fauteuil ; il faut dire que certains fauteuils sont d'une grande esthétique, tout à fait comparable à un vélo très haut de gamme. Par ailleurs, le fauteuil roulant est une des premières choses que les gens voient lorsqu'une personne handicapée arrive, il est donc important de bien présenter.
Des équipements relativement récents (une dizaine d'années) mais encore peu répandus en France comme les assistances électriques à la propulsion 9: le but est de garder le concept du fauteuil roulant manuel et son aspect visuel, mais les roues d'origine sont remplacées par des roues incorporant moteur et batteries (à ne pas confondre avec les motorisations). Le but est de permettre à quelqu'un possédant un capital musculaire des membres supérieurs faible (tétraplégique, malade neuro-musculaire) de quand même rouler en fauteuil roulant manuel (ce qui est moins dur psychologiquement à accepter) plutôt que de passer à un fauteuil électrique. Ou bien ils conviennent à une personne « simplement » paraplégique qui veut aller au travail sans transpirer pendant son trajet. Chaque cas est particulier et chacun apprivoise son fauteuil en fonction de son usage. Les fabricants de fauteuils roulants sont majoritairement saxons (allemand, suisse allemand, autrichien, etc.), la culture du handicap est beaucoup plus forte dans ces pays et globalement dans toute l'Europe du Nord, pour qui les notions d'ergonomie et de design au sens des fonctionnalités apportées est un réel souci.
Pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, les problèmes sont tout aussi nombreux et là aussi des solutions peuvent être envisagées pour augmenter leurs autonomie, comme des scooters électriques et des fauteuils permettant de monter et descendre les marches d'escalier10.
Les personnes porteuses de handicap ne pouvant pas se propulser utilisent en général un fauteuil motorisé, dirigé par une poignée de type joystick. Ce type de fauteuil coûte de 2 702,81 euros (=prix de remboursement de base par la sécurité sociale) à plus de 20 000 euros (fauteuil à propulsion électrique et verticalisation électrique + système sans fil de contrôle d'environnement par exemple). La sécurité sociale rembourse suivant les équipements de 2 702,81 euros à 3 938,01 euros, la différence resta à charge de l'utilisateur.
Aspects dans les contextes sociaux
En milieu hospitalier, pour le transport de patients, on utilise des chaises sans motorisation, avec quatre roulettes, une à chaque pied de la chaise. En préhospitalier, de telles chaises sont utilisées pour l'évacuation de victimes supportant la station assise, ce qui facilite le brancardage ; ce sont en général des modèles pliants qui se rangent aisément dans l'ambulance ou le véhicule d'intervention. On parle en général de chaise de transport ou de chaise d'évacuation.
Avoir le meilleur fauteuil possible est essentiel pour vaincre son environnement. Il faut dire que souvent, des aménagements anodins lorsque l'on peut marcher, deviennent tout à fait problématiques lorsqu'on y est confronté en fauteuil roulant. Par exemple, un commerce avec une marche à l'entrée, ou par exemple, une personne handicapée en fauteuil roulant monte sur un trottoir avec un bateau (aménagement d'une portion de trottoir avec une pente et une marche de hauteur très réduite), se déplace sur toute la longueur de la rue, et se retrouve coincé parce qu'il n'y a pas de bateau. Songez de même aux trottoirs qui ne sont que rarement parfaitement horizontaux ; le moindre devers demande à corriger sans arrêt les trajectoires ce qui est très éprouvant. Tout est obstacle potentiel.
Élévateur pour fauteuil roulant.
Des efforts grandissants sont faits pour que l'environnement urbain soit accessible du mieux possible, principalement dans les grandes villes ; mais beaucoup de chemin est encore à faire et très nombreuses sont les villes qui n'y prêtent pas assez d'attention. (Par exemple; des villes qui proposent de transporter par un service spécialisé les personnes en fauteuil roulant de la commune, lorsque le réseau de transport en commun n'a pas de matériel roulant accessible, refusent de prendre en charge des personnes handicapée de passage, tandis que tout un chacun peut utiliser les bus sans discrimination sur le lieu de domicile). Une loi passée en 2005, Accessibilité de la voirie et des espaces publics en France, indique que le domaine public devra être entièrement accessible à compter de 2015. Toutefois, cette loi ne prévoit pas de supprimer les trottoirs surélevés pour mettre l'ensemble de l'espace public sur le même plan, tel que dans beaucoup de pays du Nord de l'Europe, ce qui éviterait pourtant les soucis d'accès ou de détours nécessaires pour accéder aux bateaux. Certaines villes, comme Évry ou Nantes, l'ont bien compris et sont aujourd'hui les exemples à suivre.
Fauteuil tout terrain
Pour les articles homonymes, voir FTT.
Fauteuil roulant à roues larges, utilisable sur le sable.
Les fauteuils tout terrain (FTT) sont des fauteuils roulants pour personnes handicapées qui permettent leur utilisation sur des terrains escarpés. Ils comportent en général quatre roues qui sont indépendamment suspendues et freinées par des freins à disques hydrauliques.
Il existe aussi des modèles à trois roues dont la roue à l'avant peut être fixe ou amovible et permet de rendre son fauteuil ordinaire tout chemin ou tout-terrain. Certains fauteuils peuvent être poussés ou tractés par un vélo tout terrain11.
Circuit accessibles
Cette adaptation tout chemin ou tout terrain permet de développer des circuits adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR). Ces circuits PMR de randonnées sont particulièrement adaptés aux fauteuils roulants manuels de randonnée12.
Logement adapté
Pour permettre aux personnes dépendantes d'un fauteuil roulant de vivre de manière indépendante, des logements adaptés ont été conçus ou aménagés. Pour cela, ils doivent pouvoir y accéder, y circuler et en utiliser toutes les fonctions de manière autonome. Certaines communes ou associations dressent l'inventaire de ces habitations.
Les critères sont notamment :
- cheminement et accès à la porte d'entrée ;
- dimension des portes et de l'ascenseur ;
- franchissement des seuils ;
- espace de manœuvre, y compris les sanitaires pour permettre un transfert de la chaise aux toilettes ou à la douche ;
- revêtement de sol carrossable ;
- hauteur des éléments : poignée (porte, fenêtre, armoire, réfrigérateur, four), interrupteur, prise, robinet, fusible.
Il y a différents types de fauteuil roulant. Il faut bien vérifier les caractéristiques du fauteuil lors de l'aménagement du domicile.
Handisport
Fauteuils roulants handisport lors de la finale
FIPFA 2007.
Pour la pratique de certains handisports, les sportifs en situation de handicap peuvent utiliser des fauteuils de compétition, plus légers et plus maniables que les fauteuils qu'ils utilisent dans la vie quotidienne. Ces fauteuils de sport ont autant de différence avec un fauteuil de « tous les jours » qu'une voiture de série avec une voiture de compétition. On peut aussi comparer un fauteuil de sport à une chaussure de sport : de même qu'il existe des chaussures « de ville » et d'autres modèles spécifiques pour différents sports (basket-ball, tennis, faire de la course à pied…), il existe des fauteuils pour les déplacements quotidiens et d'autres qui sont spécialement dessinés/équipés pour le handisport (modèles différents pour le handibasket, le tennis handisport, l'athlétisme en fauteuil… et ainsi de suite). Certains sportifs, tel que Aaron Fotheringham participeront ainsi à rendre les fauteuils roulants quasiment indestructibles.
Références
- Fauteuil roulant de Nicolas Grollier de Servières exposé dans son cabinet de curiosités, publié page 96 : Chaise très commode pour les boiteux, ou pour ceux qui ont la goûte aux jambes ; et par le moyen duquel on peut se promener dans un appartement de plein pied [sic], ou dans un jardin, sans le recours de personne, dans Gaspard Grollier de Servières, Recueil d'ouvrages curieux de mathématique et de mécanique, ou Description du cabinet de M. Grollier de Servière : avec des figures en taille-douce, par M. Grollier de Servière, Lyon, D. Forey, (lire en ligne [archive])
- (en) Putting the 'Whee!' Back in 'Wheelchair' | WIRED [archive]
- Le petit livre des grandes découvertes médicales, Naomi Craft, Ed. Dunod p. 114
- fauteuil roulant de Nicolas Grollier de Servières en page 96 de : Gaspard Grollier de Servières, Recueil d'ouvrages curieux de mathématique et de mécanique, ou Description du cabinet de M. Grollier de Servière : avec des figures en taille-douce, par M. Grollier de Servière, Lyon, D. Forey, (lire en ligne [archive]).
- (en) « The First Wheelchair Was Built for Phillip II of Spain » [archive], sur ThoughtCo (consulté le ).
- World Wheelchair and Amputee Games - http://www.universalis.fr/encyclopedie/handisport/1-histoire-d-une-idee-force/ [archive]
- http://patents.justia.com/inventor/flemming-moller [archive]
- « Fauteuil roulant par pathologie » [archive]
- www.handicap.org fauteuils particuliers [archive]
- fauteuils monte-escaliers autonome [archive]
- « Les fauteuils de randonnée - Rand'Ôroues » [archive], sur randoroues.sportsregions.fr (consulté le )
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Liens externes
Aspivenin
Une pompe à venin et ses différents embouts.
L'aspivenin est un appareil d'aspiration (dispositif médical de classe I) revendiqué comme geste de premier secours dont la fonction est d'aspirer le venin injecté par un animal ou une plante. C'est un appareil qui a été breveté ainsi qu'une marque protégée et déposée en France et à l’international.
Aspivenin a une efficacité avérée pour certaines indications, et controversée pour d'autres.
Pour une morsure de serpent, l'aspiration est fortement déconseillée par la direction générale de la Sécurité civile en France1.
Histoire
Le concept de l'Aspivenin est une invention du vingtième siècle imaginée par le français André Emerit et son fils. Ils présentent leur premier modèle au concours Lépine des inventions où l'Aspivenin est récompensé en 1983.
Description
L'Aspivenin est un appareil composé d'une pompe à vide et de ventouses de dimensions et formes différente. Le brevet décrit le mécanisme permettant de créer le vide en poussant le piston, rendant l’utilisation à une main possible.
La présentation habituelle est dans une boite en la pompe en forme de seringue, deux ventouses rondes de 10 et 22 mm de diamètre et une ventouse ovale.
Utilisation
L'Aspivenin est utilisé en cas de piqures de guêpes, frelons, abeilles ou autres insectes.
Pour les piqûres de scorpions ainsi que pour aspirer les venins de poissons, de méduses ou de plantes urticantes, tout comme l'utilisation contre les morsures de serpent, l'Aspivenin n'a pas démontré d'efficacité et est même déconseillé. Il augmenterait la vascularisation localement et de fait la circulation du venin dans le sang. Or, c'est le pic plasmatique du venin qui est le danger, il ne dispense donc pas de la conduite à tenir habituellement en cas de morsure de serpent[pas clair].
Mode d'emploi
Choisir une ventouse qui recouvre totalement la piqure, morsure ou autre blessure envenimée et la placer sur la pompe dont on tire le piston.
Poser sur la peau et repousser le piston, laisser aspirer durant 1 à 3 minutes.
Efficacité
Selon le type d’animal, elle est variable.
Aspivenin serait efficace2[source insuffisante],3,4,5,6,7,8 pour :
- les morsures d’araignée ;
- les morsures ou piqûres d’insectes ;
- l’extraction des larves sous-cutanées des Œstres.
L'efficacité est controversée pour les morsures de serpent, cette indication reposant sur des observations faites lors d'une étude de 19859,10, mais des études plus récentes arrivent à des conclusions contradictoires sur des morsures simulées de crotale6,11,12. Les techniques d'aspiration sont fortement déconseillées par la direction générale de la sécurité civile en France1,13.
Notes et références
- Le référentiel technique Premiers secours en équipe niveau 1 et niveau 2, édition de septembre 2014 p 181 indique : « Ne jamais pratiquer de techniques d’aspiration, qu’elles soient buccales ou à l’aide d’un appareil ».
- Étude menée par Dr J-P Dandeu en 1985 dans l'unité d'imuno-allergologie de l'institut pasteur, Paris, dirigée par Dr Bernard David
- Mode d'emploi de l'Aspivenin
- (en) Bronstein AC, Russell FE, Sullivan JB, Egen NB, Rumach. « Negative pressure suction in field treatment of rattlesnake bite » Vet Hum Toxicol. 1985;28:297.
- (en) Bronstein AC, Russell FE, Sullivan JB. « Negative pressure suction in the field treatment of rattlesnake bite victims » Vet Hum Toxicol. 1986;28:485.
- (en) Bush SP, Hegewald KG, Green SM, Cardwell MD, Hayes WK, « Effects of a negative pressure venom extraction device (Extractor) on local tissue injury after artificial rattlesnake envenomation in a porcine model », Wilderness Environ Med, vol. 11, no 3, , p. 180-8. (PMID 11055564) modifier
- (en) JK West, « Simple and effective field extraction of human botfly, Dermatobia hominis, using a venom extractor », Wilderness Environ Med, vol. 24, no 1, , p. 17-22. (PMID 23246347, DOI 10.1016/j.wem.2012.09.007) modifier
- rapport de mission de Pharmaciens sans frontière en Amazonie "témoignage sur l'utilisation de la pompe Aspivenin" menée entre novembre 1992 et février 1995.
- (en) 1985 AACT/AAPCC/ABMT/CAPCC Annual Scientific meeting Kansas city Hyatt Regency Hotel (August 4-9 1985): « Negative pressure suction in field of treatment of rattlesnake bite »
- (en) Grayson RR. « A technic for using suction in cases of snake bite » Mo Med. 1953;50:763–764.
- protocole « morsure de serpent » [archive] sur www.protocoles-urgences.fr, 9 septembre 2008, consulté le 15 avril 2015.
- (en) Alberts MB, Shalit M, LoGalbo F, « Suction for venomous snakebite: a study of "mock venom" extraction in a human model », Ann Emerg Med, vol. 43, no 2, , p. 181-6. (PMID 14747805) modifier
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
Prothèse (médecine)
Pour les articles homonymes, voir Prothèse.
L'une des plus anciennes prothèses connues, datant de l'Égypte antique, aujourd'hui dans le musée du Caire. Le gros orteil est sculpté dans le bois. Il était lié au pied par une gaine de cuir cousue.
Une prothèse est un dispositif artificiel destiné à remplacer un membre, un organe ou une articulation. Le mot prothèse vient du latin prosthesis venant du grec signifiant « action d'ajouter ».
Histoire
Les premières traces
Les premières traces écrites des prothèses remontent des Histoires de l’historien grec Hérodote, datant d’environ 484-425 av. J.-C.. Il y est mentionné un substitut en bois d’un pied préalablement amputé, histoire reprise également par Plutarque plusieurs siècles plus tard, vers 416-417 ap. J.-C.. D’autres récits évoquent également la présence de prothèse de mains, comme par exemple Pline l’ancien dans L’Histoire naturelle, où est mentionné la prothèse de main en fer du général romain Marcus Sergius lors de la deuxième guerre punique (218-210 av. J.-C.)1.
Cependant les plus anciennes prothèses découvertes remontent à l’Egypte antique. Des fouilles archéologiques du XIXème siècle ont permis de retrouver des prothèses d’orteil, datant d’avant 600 av. J.-C., comme par exemple l’orteil de Greville Chester, trouvée dans la nécropole de Thèbes, sur la rive ouest du Nil près de Luxor. Un deuxième orteil de ce type a été retrouvée dans les années 2000, attaché à la momie d’une femme enterrée près de Luxor datant de la même époque. Cet orteil, fait de cuir et de bois, présente une charnière,dont les recherches ont montré que le but était d’imiter le fonctionnement de l’articulation métatarso-phalangienne, permettant la marche à pied-nu à son porteur2.
La première trace de prothèse de jambe fut retrouvée en 1885 à Capoue, en Italie. Cette relique était considérée par certains comme la première prothèse datée aux alentours de 300 av. J.-C.
D’autres découvertes en Europe supposées être des répliques de jambes en bois ont été tracées au VIème-VIIe siècles après J.-C.. Une des découvertes notables fut la prothèse de main d’un homme italien datant du VIIe siècle enterré dans la nécropole de Longobardie en Italie. Des recherches et études ont permis de déterminer que la prothèse fut attachée par une sangle en cuir à la suite d'une amputation au couteau, montrant une adaptation notable par le porteur durant l’ère pré-antibiotique2.
XXe siècle
Première Guerre mondiale
De par sa violence, la Grande Guerre reste marquée dans la mémoire collective. Les combats infligent des dégâts aux corps des combattants d’une ampleur inédite dans l’Histoire3. La France releva 2,8 millions de blessés sur les 8 millions de soldats mobilisés. Les conditions du combat ont provoqué nombre de blessures d’un nouveau type dues au développement de l’artillerie, dont les obus et les grenades, responsables de 75 % des blessures notamment de la face. 11 à 14 % des blessés français l’ont été au visage. On recense 10 000 à 15 000 grands blessés de la face4. Ces vastes blessures laissent pour morts de nombreux soldats sur le champ de bataille.
Une nouvelle discipline chirurgicale apparaît : la chirurgie maxillo-faciale réparatrice et plastique. La reconstruction faciale de ces gueules cassées nécessite la création de nouvelles techniques chirurgicales et la conception de prothèses innovantes. Au sens littéral du terme, le blessé maxillo-facial est un blessé qui présente à la fois des lésions des mâchoires et de la face. Cependant dans la pratique, au cours de la Grande Guerre, l’appellation a été déviée pour désigner tout blessé qui exige le double traitement chirurgical et prothétique. Dans la plupart des cas, la fracture maxillaire s'accompagne d'une perte importante de matériel osseux et cutané. Les manifestations cliniques de ces atteintes maxillo-faciales sont diverses et leur gravité dépend de la nature de l’obus, de la résistance du tissu lésé, de la trajectoire du projectile et de la vitesse et de la forme du projectile. Chaque type de lésion maxillo-faciale est unique et le traitement doit être adapté à chaque patient, en particulier au niveau prothétique, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de concevoir et d'inventer différents types de prothèses pour chaque personne blessée5. Une fois traitées les urgences d’ordre maxillo-facial, telles que l’asphyxie ou les hémorragies, les blessés sont transférés le plus rapidement possible afin d’éviter infections, cicatrisations vicieuses et l'impossibilité de déglutir pouvant se révéler fatales. Des centres de chirurgie réparatrice maxillo-faciale sont créés dans les zones non combattantes devant le grand nombre de blessés. Ces centres reçoivent les blessés en voie de cicatrisation. Il s’agit ensuite de reconstruire leur visage. L’évolution de la chirurgie maxillo-faciale et la réparation des gueules cassées sont directement liées aux progrès de l’anesthésie. Les interventions ont été facilitées par l’utilisation de nouveaux anesthésiques locaux et, dans le cas de l’anesthésie générale, par de nouvelles techniques d’intubation buccale ou nasale et par l’utilisation de la voie intraveineuse, qui évitent le port du masque d’anesthésie pendant l’intervention4.
Après la phase de reconstruction chirurgicale qui a permis de combler la perte de substance vient la phase prothétique6. Les prothèses provisoires et définitives sont réalisées par des mécaniciens dentistes. Après avoir été photographié, un moulage facial est effectué sur le blessé. À partir du moulage du visage mutilé, les mécaniciens réalisent les appareils prothétiques. En premier lieu, une prothèse temporaire est utilisée pendant la période de cicatrisation. Elles sont différentes, en fonction de la blessure et sont divisées en quatre catégories principales : les prothèses de réduction, les prothèses de compression, les prothèses de modélisation et les dispositifs pour étendre les cicatrices5. Une fois les plaies cicatrisées, les prothèses temporaires sont remplacées par des prothèses dites définitives qui ont pour but de pallier les limites de la chirurgie si nécessaire. La chirurgie de reconstruction faciale est lourde, douloureuse et les résultats sont aléatoires. Selon le cas cette ultime étape s’appuie sur plusieurs types de prothèses :
- la prothèse amovible complète (perte de toutes les dents) ou partielle a bénéficié de l’évolution des matériaux utilisés au cours du conflit : caoutchouc ou métal léger, porcelaine et matière plastique. La Grande Guerre marque le début des matières plastiques. S’il demeure quelques dents sur les arcades, ces prothèses seront maintenues par des crochets.
- la prothèse fixe : couronnes et bridges métalliques pour les édentations de moindre étendue sont réalisés sur les dents piliers reliées entre elles afin de former des ponts sur les zones édentées5.
Après la Première Guerre mondiale, de nombreux soldats étaient encore défigurés, malgré les nombreuses interventions. Ils devront apprendre à accepter de nouveaux visages et à surmonter les difficultés de retour à la vie civile. Faire face à la vue des autres dans leur famille ou dans la société est un test terrible. Par conséquent, certaines gueules cassées préfèrent se réfugier parmi des camarades démembrés.
Évolution post Seconde Guerre mondiale
Différentes prothèses métalliques utilisés en chirurgie
Durant la Seconde Guerre mondiale, les prothèses n’évoluent que très peu.
En 1945, de nombreuses controverses éclatent aux États-Unis concernant le manque de considération apporté aux vétérans amputés de la Seconde Guerre mondiale (27 000 soldats américains amputés à la jambe ou au bras sont recensés). Pour répondre à cela, la National Academy of Science initie un plan de recherche et développement visant à améliorer les prothèses en utilisant d’autres technologies existantes. La fabrication de prothèses, jusque-là considérée comme artisanale entre alors dans une démarche scientifique. En 1948, le Congrès des États-Unis alloue pour la première fois un budget annuel d’un million de dollars pour le développement de prothèses et aides sensorielles. À partir de cette date, la conception et la fabrication de prothèses n’a cessé d’évoluer7.
Histoire contemporaine
Le service des plus pauvres
Dans les années 1970, les Frères Jaccard ont mis au point une technique de prothèse rudimentaire qu'ils transmettent à travers le monde. Ils l'ont développée dans une léproserie dont ils avaient la charge au Cameroun. À force d'acharnement, les deux frères sont parvenus à une technique simple suivant deux principes fondamentaux : la prothèse est toujours réalisée avec des matériaux locaux, et doit s'aligner avec le membre amputé pour éviter des boitements qui entraînent toujours des déformations dorsales. Ils réalisent l'emboiture en cuir, à partir du moule du moignon, pour une jonction parfaite de souplesse et de précision, qui évite tout frottement douloureux8. La prothèse dite Jaccard, ou prothèse africaine, garde les grands principes de la prothèse mais dépouillée de tous les aspects superficiels et esthétiques. Conçue pour les pauvres, elle est fabriquée avec le matériel trouvé sur place, les rivets, les manchons, les sacs en cuir. Une prothèse robuste, efficace, fonctionnelle et auto corrective car le moignon se rétrécit9.
Cet appareillage de masse vient révolutionner le soin des amputés de la lèpre, de la guerre et ceux de catastrophes naturelles. Jean Baptiste Richardier, fondateur de Handicap International, Mère Teresa à la léproserie de Shanti-Nagar et au Yémen, et Mgr Jean Zoa partout au Cameroun, entre autres, feront appel aux Frères Jaccard, ses concepteurs, pour venir en aide aux plus démunis à travers le monde10.
Le sport
Depuis 1988, il y a eu un avancement dans la technologie des prothèses dans les pays occidentaux notamment dans le domaine sportif concernant les prothèses de jambe. Une évolution des matériaux utilisés est également observée passant du bois à la fibre de verre puis à la fibre de carbone ainsi que des alliages métalliques légers. De plus en plus d’athlètes arrivent à pratiquer le sport comme par exemple aux jeux paralympiques, certains même passant de la chaise roulante à la course sur deux jambes grâce à la technologie flex-foot (“pied flexible”) permettant une mobilité accrue de la cheville. C’est notamment le cas de Markus Rehm et Oscar Pistorius, deux athlètes médaillés d’or aux jeux paralympiques (en saut en longueur et course à pied respectivement). Cependant une certaine controverse a émergé quant à la participation de ces athlètes dans les Jeux olympiques en compétition avec des valides. Markus Rehm s’est vu refusé la participation par la fédération allemande d’athlétisme aux championnats, stipulant que sa prothèse de jambe apporte un avantage par rapport aux athlètes valides. Oscar Pistorius quant à lui a été autorisé à participer aux championnats du monde en 2011, décrochant la 2ème place au relais de 4 x 400 m, faisant de lui le premier athlète amputé à décrocher une médaille parmi les valides. Il participe également aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Cependant sa participation ne fait pas l’unanimité, puisque des études montrant l’avantage fourni par ses prothèses en comparaison avec les coureurs valides font leur émergence, même si elles n’ont pas révoqué la décision prise par le tribunal arbitral du sport de laisser Pistorius participer parmi les valides11.
Il existe également des prothèses destinées à des personnes valides, ayant pour but d'améliorer leurs performances. Parmi elles on compte :
- La combinaison speedo LZR Racer mimant la peau des requins. Cette combinaison a permis 18 records du monde en deux ans, avant son interdiction par la fédération12.
- Les Nike Vaporfly qui contiennent une plaque de fibre de carbone afin d'optimiser le rebond du coureur ont permis de relever plusieurs records du monde notamment de marathon et de course sur route. Ce modèle a évité de justesse son interdiction car considéré comme des chaussures à ressorts13.
L’évolution des matériaux composites tels que la fibre de carbone permet de créer des prothèses plus efficaces car plus légères.
Types
- Prothèse articulaire : ajout ou, mieux, substitution synthétique (acier, titane, céramique) destinée à remplacer en partie ou en totalité les surfaces articulaires d'une articulation humaine ou animale. La restauration associée des moyens d'union passifs est limitée, partielle ou totale.
- Les prothèses « externes » ou exo-prothèses ont pour objet la substitution d'un membre amputé ou d'un organe manquant (par exemple prothèse oculaire).
Une orthèse corrige une fonction déficiente : une attelle est un système de contention soutenant un membre déficient. Ces derniers sont appelés « appareillages orthopédiques ».
Il existe également d'autres formes de dispositifs prothétiques : dans le cas de l'audition, ce sont les prothèses auditives (amplification externe des sons) et implants cochléaires (conversion directe des vibrations en stimulations électriques). À noter dans ce cas que l'opposition prothèse/orthèse n'est pas retrouvée, dans la mesure où la prothèse a un rôle de soutien et l'implant de remplacement.
En chirurgie de la paroi abdominale, on utilise souvent des prothèses, comme en chirurgie de la hernie inguinale.
En chirurgie réparatrice et esthétique, diverses prothèses, les plus fréquentes sont les prothèses ou implants mammaires et les implants fessiers.
Par extension, on parle aussi de prothèse pour désigner un outil remplaçant l'action de l'homme (objet prothétique) .
Prothèses réparatrices
Les prothèses immédiates
Décrites par Claude Martin dès la fin du XIXe siècle, les prothèses immédiates s’interposent directement dans la plaie entre les fragments fracturés. Cette technique a été abandonnée car elle provoquait de nombreuses complications infectieuses.
Les prothèses temporaires
Les prothèses temporaires sont utilisées provisoirement durant tout le temps de cicatrisation.
Les prothèses définitives
En remplacement des précédentes. Les prothèses définitives servent en fin de traitement à pallier les limites de la chirurgie5.
Élaboration de la prothèse
L'élaboration d'une prothèse pose le problème :
- de la manière dont elle va simuler l'action de la partie remplacée (biomécanique, ergonomie) ;
- de la tolérance de l'organisme vis-à-vis de ce corps étranger ;
- de la dégradation :
- dégradation chimique du matériau dans le corps humain (par corrosion) ;
- usure mécanique, et notamment du fretting (usure sous un faible débattement, avec accumulation des produits d'usure au niveau de la surface de contact) ;
- lorsque les produits d'usure s'échappent, ils peuvent provoquer des granulomes : étant des corps étrangers, ils sont absorbés par les macrophages, formant les granulomes ; ces granulomes entraînent une résorption de l'os autour de la prothèse (ostéolyse périprothétique) ce qui fragilise l'ancrage et rend problématique le remplacement ;
- de l'esthétique. L'esthétique d'une exo-prothèse est un problème qui préoccupe les amputés, spécialement pour les membres supérieurs. Il existe des gants en silicone pour recouvrir la prothèse de l'avant-bras.
Industrie et marché de la prothèse
Les prothèses actuelles vont de l'équivalent d'une simple jambe de bois aux prothèses avec articulation et moteur électrique, leur prix varie ainsi d’une centaine d’euros jusqu’à plusieurs milliers d’euros14. Les matériaux constituants les prothèses sont principalement les métaux, les polymères et la céramique. L’utilisation de matériaux inertes et biocompatibles tels que le titane ou le polyéthylène permet de diminuer le risque de rejet de ce corps étranger par l’organisme. Ceci est une des raisons qui explique le coût élevé de certaines prothèses15.
Contrairement à ce que les campagnes publicitaires autour des Jeux Paralympiques et des prothèses de sport laissent penser, la grande majorité des personnes appareillées sont des personnes âgées. L’âge moyen des porteurs de prothèse de cheville est de 63,8 ans16. De plus, 76,2% des porteurs de prothèses de genou ont plus de 65 ans17. L’appareillage est principalement d’origine post-traumatique (47,8%) et d’arthrose (35,3%). Selon un rapport portant sur l’Union Européenne, 50% des personnes indiquant porter une prothèse dentaire ont plus de 55 ans.18 Dans la population française, la répartition par tranches d’âge des surdités, quelle que soit la sévérité, a été estimée comme suit : 11% ont moins de 18 ans, 25% ont entre 18 et 65 ans et 63% ont plus de 65 ans19.
Le marché mondial de l’audioprothèse peut être estimé à 5,5 millions d’appareils vendus. La croissance est approximativement de 6 % par an en volume. Le principal facteur de croissance est d’ordre démographique mais les changements d’habitude de vie et de consommation, la qualité de la vie, la place occupée par les loisirs sont aussi des facteurs de croissance. En France, en 30 ans (entre 1975 et 2005), les ventes annuelles d’audioprothèses sont passées de 55 000 à 365 000, avec actuellement une prépondérance d’appareils numériques19. Les prothèses auditives et les prothèses dentaires sont parmi les plus consommés chez les personnes âgées.
À l’horizon 2040, la France comptera 10,6 millions de personnes âgées de plus de 75 ans, contre 6 millions aujourd’hui, d’après les projections établies par l’Insee. En France, ces consommateurs sont plus aisés que d’autres, avec un niveau de vie médian de 9 % de plus que l’ensemble des Français, selon les statistiques de l’Insee datées de 2017. Cela leur donne un plus grand pouvoir d’achat notamment pour les prothèses de confort20.
De nombreuses sociétés se partagent le marché de la prothèse de hanche, parmi lesquelles on compte notamment B Braun, Link, ImplanTec, DePuy Synthes et Smith and Nephew. Quant aux prothèses de cheville, les principales marques en France sont Salto (78%) et Hintegra (14,8%)21.
La durée de vie des prothèses a été amélioré ces dernières années. Effectivement, la proportion de prothèses toujours fonctionnelles après dix ans d’utilisation avoisine les 99 % chez certains patients de moins de 50 ans. Chez les patients plus âgés, et donc plus sédentaires, on peut aussi observer des chiffres similaires. La durée de vie d’une prothèse dépend de différents paramètres tels que :
- Âge, IMC et degré d’activité du patient
- Diamètre de la tête prothétique
- Type de couple de frottement (“dur-mou” ou “dur-dur”)15
Notes et références
- Judith Nicogossian, « La prothèse de guerre : réparation du corps du soldat », Corps, , p. 225-232 (ISSN 1954-1228, lire en ligne [archive])
- (en) Jacqueline Finch, « The ancient origins of prosthetic medicine », The art of Medicine, , p. 548-549 (lire en ligne [archive])
- Benoît Franck, « Les innovations techniques, scientifiques et médicales de la Prempière Guerre mondiale » [archive], sur provincedeliege.be
- Marie-Andrée Roze-Pellat, « La réparation des gueules cassées », Corps, , p. 41-48 (ISSN 1954-1228, lire en ligne [archive])
- Virginie ROCHETTE et Jacques MARGERIT, « Les gueules cassées de la Première Guerre mondiale : thérapeutiques prothétiques et chirurgicales », Actualités Odonto-Stomatologiques, , p. 261-269 (ISSN 0001-7817, lire en ligne [archive])
- Gary Sheffield, La première Guerre mondiale en 100 objets : Ces objets qui ont écrit l'histoire de la grande guerre, Paris, Elcy éditions, , 256 p. (ISBN 978 2 753 20832 2), p. 138-139
- (en) James McAleer, « Mobility redux: Post-World War II prosthetics and functional aids for veterans, 1945 to 2010 », Journal of Rehabilitation Research and Development, , Volume 48: vii — xvi (ISSN 0748-7711, lire en ligne [archive])
- Humanitaire, une vie d'actions [archive], Philippe Chabasse, Camille Sayart
- Raymond Jaccard et Pierre Jaccard, La prothèse fémorale auto-corrective, Paris, Raoul Follereau, , 77 p. (lire en ligne), p. 13-15
- Pierre Alain Gourion, « Entretien avec Jean Baptiste Richardier, fondateur d'Handicap International », Médiapart, non renseigné (lire en ligne [archive])
- (en) P. David Howe et Carla Filomena Silva, « The cyborgification of paralympic sport », Movement & Sport Sciences, , p. 17-25 (ISSN 2118-5735, lire en ligne [archive])
- Par Gérard Nicaud, « Les secrets de la combinaison Speedo » [archive], sur Le Figaro.fr, (consulté le )
- « Nike Vaporfly. Découvrez la nouvelle Vaporfly NEXT% » [archive], sur Nike.com (consulté le )
- « Bulletin Officiel n°2001-30 » [archive], sur solidarites-sante.gouv.fr, (consulté le )
- « Bien choisir une prothèse de hanche » [archive], sur Guides d'achat MedicalExpo, (consulté le )
- Jean Luc Besse, « Rapport 2018 sur le registre national des Prothèse totales de cheville de l’AFCP » [archive], sur afcp.com.fr,
- ANSM, « Surveillance des dispositifs médicaux à risque : Prothèses totales de genou (PTG) » [archive], sur ansm.sante.fr,
- TNS Opinion & Social, « Rapport-La santé dentaire » [archive], Rapport d'une étude concernant la santé dentaire, sur ec.europa.eu,
- Corinne COLLIGNON, « APPAREILS ÉLECTRONIQUES CORRECTEURS DE SURDITÉ » [archive], Étude sur les Audioprothèses, sur has-sante.fr,
- Jean‑Luc Tavernier, « Tableaux de l’économie française » [archive], sur insee.fr, (consulté le )
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Catalogue de prothèses L'Elvea, 1914.
Prothèse totale de hanche
Une prothèse totale de hanche (PTH) est un dispositif articulaire interne qui vise à remplacer l'articulation de la hanche et lui permettre un fonctionnement quasi normal, en tout cas permettant la marche.
- Une PTH dite de « première intention » est une prothèse posée sur une hanche en principe « vierge », par opposition à
- la « reprise de PTH » ou même
- la « PTH de reprise » d'une hanche déjà opérée, voire déjà infectée.
Histoire des prothèses 1920-1980
Prothèses de hanches 1920-1980
« Tantale servit aux Dieux les membres de son fils Pélops. Les Dieux indignés ressuscitèrent Pélops. Une épaule déjà mangée par Déméter fut remplacée par une articulation d’ivoire. »
— Ovide, Métamorphoses, livre VI, vers 410-415
Du fond de la mythologie, la première endoprothèse était née.
Au début du XXe siècle, les chirurgiens orthopédistes sont confrontés à deux types d’atteinte de la hanche: l’arthrose et la fracture du col du fémur. Les conséquences de l’arthrose sont connues. Avec l’usure, du cartilage disparaît, ce précieux revêtement qui permet le glissement harmonieux de la tête du fémur à l’intérieur de la cavité cotyloïdienne. Pour remplacer le cartilage perdu, de nombreux matériaux sont interposés entre la tête du fémur et le cotyle : plâtre, buis, caoutchouc, plomb, zinc, cuivre, or, argent ou fragment de vessie de porc ….
Aucune de ces interfaces ne convient : trop fragile, trop mou, trop toxique.
Les premiers résultats convaincants sont obtenus, en 1923, par Smith-Petersen. Ce jeune chirurgien de Boston a déjà fait parler de lui en inventant au début de son internat une nouvelle voie d’abord antérieure de la hanche. Lors de son exercice il extirpe du dos d’un patient un éclat de verre resté en place une année et parfaitement supporté par l’organisme. L’observation de cette réaction lui donne l’idée d’une application orthopédique. Il fait construire de fins moules de verre qu’il interpose entre les deux surfaces de la hanche. Cette lentille de quelques millimètres d’épaisseur « guide le travail de réparation de la nature». Hormis sa fragilité l’inconvénient majeur de cette méthode reste la nécrose de la tête fémorale liée à la section des vaisseaux pendant l’opération.
À la même époque Hey-Groves (1922) propose une autre approche particulièrement intéressante dans les fractures du col. En effet lors de ce traumatisme la vitalité de la tête fémorale est compromise par le cisaillement des minces vaisseaux qui l’irriguent. Il remplace donc la tête dans sa totalité par une sphère d’ivoire de même calibre. Sa fixation est assurée par un manche qui traverse la diaphyse fémorale. La prothèse prend à la fois la place de la tête fémorale et de la surface articulaire qu’elle porte. Cette intervention reste un cas isolé bien que le résultat soit satisfaisant quatre ans après l’intervention.
Les prothèses fémorales
Malgré de nombreuses recherches le matériau idéal solide et bien toléré par l’organisme se fait attendre. Une solution est proposée en 1936 par le Dr. Venable. Après avoir expérimenté de longues années les effets de différents métaux sur l’os celui-ci conclut à la supériorité de l’alliage Chrome-Cobalt-Molybdène pour les applications orthopédiques. Il l’appelle Vitalium.
En 1939 Harold Bohlman reprend les travaux de Venable et met au point la première prothèse fémorale en métal (Vitalium). Celle-ci remplace la tête du fémur et le cartilage qui la recouvre. Cette solution fait disparaître le risque de nécrose rencontrée dans les suites des cupules d’interposition. Cependant une nouvelle question se pose : comment faire tenir cette tête prothétique ? Bohlman choisit de fixer la tête métallique à la corticale externe du col fémoral par un clou. Les deux premières opérations se soldent par un échec ce qui amène Bohlman à verticaliser le clou.
Durant les années qui suivent quelques tentatives voient le jour. Les résultats sont peu concluants et les interventions très peu nombreuses.
Ce sont les frères Judet qui conçurent, en France, en 1946, la première prothèse posée en nombre (on dénombrait moins de dix tentatives précédentes). Jean Judet n'avait jamais aimé le blocage de l’articulation (arthrodèse) proposé à l’époque pour soulager les arthroses sévères. Il préférait réséquer la tête fémorale pathologique et articulait le col fémoral dans le cotyle car « en arthrodèsant une hanche douloureuse vous substituez une infirmité à une autre ». À partir de 1946 les deux chirurgiens remplacent la tête retirée par une sphère de même calibre en méthacrylate de méthyle plus connu sous le nom de plexiglas. Celle-ci est fixée sur un pivot traversant de part en part le col du fémur. Dans tous les cas les résultats immédiats sont bons puis décevants dès le moyen terme. Ces échecs sont dus à une intolérance aux débris d’usure de l’acrylique qui sera définitivement abandonné en 1949.
Austin Moore a déjà conçu avec Bohlman en 1940 une unique méga prothèse métallique. Le procédé de fixation révolutionnaire qu’il propose pour maintenir la tête fémorale date lui de 1950 : la tête métallique sera portée par une tige fichée dans le canal médullaire du fémur. Depuis cette date la quasi-totalité des implants fémoraux reprendront ce concept de tige intra médullaire.
À cette époque, Moore est le chirurgien de l'Hôpital Psychiatrique de l’État de Columbia, qui dispose de 7000 lits. Les fractures du col du fémur sont fréquentes chez des patients en général âgés, souvent en mauvais état général. Le pronostic de cette lésion est transformé. Quelques jours après l'opération les opérés évoluent dans les couloirs de l'hôpital ce qui est très nouveau. À l'époque la fracture du col du fémur était une cause de mort fréquente chez le vieillard. La prothèse de Moore est en Vitallium. Une fenêtre est pratiquée dans la queue prothétique pour permettre la repousse de l’os. Un trou est placé à la partie supérieure du col. Il sera utilisé, si nécessaire, pour extraire la prothèse.
Au début les poses s’effectuent par voie d’abord antérieure. L’opération est difficile et les résultats médiocres : les luxations sont fréquentes. Moore modifie donc la technique opératoire. Il utilise un abord de plus en plus postérieur que l’on surnommera en clin d’œil « l’abord du Sud » ou voie de Moore. La prothèse fémorale simple prend en charge les pathologies liées à la tête fémorale. Cette solution est très utile pour le traitement des fractures du col du fémur.
Toutefois dans l’arthrose, face à la tête métallique, le cartilage usé du cotyle reste inchangé. Ce traitement nécessite une prothèse totale ou la tête fémorale et le cotyle sont remplacés.
Les prothèses totales de hanche
De l'autre côté de l’Atlantique, Mac Kee cherche à résoudre le double problème posé par l’arthrose de hanche. L’usure du cartilage est bilatérale. Il propose de changer les deux surfaces. Son choix se porte sur le métal. La nouvelle tête fémorale roulera dans le cotyle osseux recouvert d’une coque métallique. Suivant son exemple le couple de glissement métal contre métal entre tête et cotyle deviendra la solution proposée pendant de nombreuses années par les concepteurs de prothèses de hanche.
Mac Kee conçoit un premier prototype en 1941 suivi d’une première pose … 10 ans plus tard. Ses recherches se poursuivront 40 ans. Dès ses débuts la fixation à l’os reste le problème principal. La pièce cotyloïdienne est fixée par une grosse vis postérieure inspiré des vis d’arthrodèses de l’époque. La pièce fémorale se fixe à la corticale diaphysaire par une plaque.
En 1951 Mac Kee implanta pour la première fois trois de ces prothèses totales de hanche. Dans deux cas la prothèse est en acier inoxydable et se descelle en moins d’un an. La troisième est en Vitalium, recommandé par Venable depuis 1936. Cet alliage ne présente pas cette tendance si commune au « grippage ». La prothèse resta en place plus de trois ans, avant que le col prothétique ne casse, ce qui redonne l’espoir au chirurgien après toutes ces années de travail.
En 1953, Mac Kee rencontre son confrère Américain, le médiatique Thompson. Celui-ci propose, depuis 1952, un modèle ressemblant à la prothèse de Moore mais sans fenêtre. Il le convainc de la fiabilité de la fixation de la prothèse fémorale par une tige intra médullaire. Le modèle suivant comporte donc une pièce fémorale type Thompson avec une tête un peu plus petite pour pouvoir s’articuler à l’intérieur du cotyle prothétique métallique.
Ce modèle est utilisé de 1956 à 1960. 26 personnes seront opérées. Les résultats sont assez satisfaisants à plus de 10 ans. Mais dans 10 cas sur 26 c’est un échec par descellement. À l’époque Mac Kee attribue cette mauvaise tenue des implants aux frottements répétés d’une pièce métallique sur l’autre. Pour résister à cette sollicitation, il cherche à améliorer le système de fixation des implants. La véritable cause de ces descellements ne sera comprise que bien plus tard.
Jusqu’en 1960 Mac Kee propose comme solution au problème posé : soit une tige Vitalium portant une grosse tête femorale s'articulant dans un cotyle métallique en Vitalium, et une tenue des deux composants par fixation mécanique ; soit une tige fémorale et une grosse vis cotyloïdienne.
Les résultats de ce type de prothèse sont inégaux. Malgré les améliorations apportées par Mac Kee, il persiste dans un grand nombre de cas des descellements précoces. À l’époque la cause en est attribuée au frottement ou « grippage » entre les deux pièces métalliques trop contraignant pour la méthode de fixation mécanique des implants.
Ce n’est que bien plus tard, en 1974, que l’on comprendra la raison véritable de ces descellements : l’organisme humain réagit face aux débris d’usure relargués dans la nouvelle articulation. Les macrophages éliminent les particules étrangères et s’attaquent, dans le même temps, à l’os environnant : c’est l’ostéolyse qui ronge l’os et fragilise la fixation prothétique.
Les prothèses totales cimentées
C'est le professeur John Charnley (1911-1982) qui est à l'origine d'une véritable révolution dans le domaine de la prothèse de la hanche.
Son concept s'appuie sur plusieurs principes complémentaires et totalement innovants : nouveaux matériaux, fixation au ciment, nouvelle taille de tête prothétique, nouvelle opération. C'est à partir de 1970 que plus d'un million de ses prothèses seront posées. Il s'en pose encore aujourd'hui.
Charnley proposa une diminution du frottement entre les deux surfaces articulaires, qui était responsable du « grippage » dans les prothèses métal-métal. C'est donc en 1959 qu'il mesura le coefficient de frottement d'une articulation normale et la compara à celui d'un patin glissant sur de la glace. Bien sûr, les technologies de l'époque ne permettaient pas encore de fabriquer des pièces articulées avec des coefficients de friction aussi faibles, surtout dans le cas des mouvements pendulaires lents et en pleine charge. Dans ses expériences, Charnley confirma néanmoins que les propriétés mécaniques de l’articulation venaient du cartilage articulaire et non du liquide synovial.
Charnley chercha un matériau pour remplacer le cartilage détruit dans le coxarthrose. Mais celui-ci devait offrir un faible coefficient de friction et pouvoir être toléré par l'organisme, c'est-à-dire biocompatible. À cette époque, c'était le polytétrafluoroéthylène ou Téflon qui semblait remplir ces critères. C'est donc Charnley qui développa le concept d'articulation synthétique en recouvrant les surfaces articulaires d'une fine pellicule de ce plastique. Ces minces cupules donnèrent des résultats immédiats. Mais comme les cupules de Smith-Petersen, il y avait le problème de la nécrose ischémique. Les résultats ne furent pas au rendez-vous mais Charnley venait de faire l'expérience d'un nouveau matériau : le plastique.
En 1960 Charnley décida alors de diminuer encore le risque de descellement en diminuant le frottement entre la pièce fémorale et la pièce cotyloïdienne. Il s’éloigna du diamètre naturel d’une tête de fémur passant de 41 millimètres à 22 millimètres. La démonstration était mathématique : plus la tête fémorale est petite et moins la surface de frottement est importante. Ce fut la fameuse « prothèse à faible friction » (low-friction arthroplasty). Ce petit diamètre de tête fémorale avait un autre avantage : il laissait plus de place pour le cotyle en Téflon à l’intérieur de l’os cotyloïdien. L’épaisseur du cotyle a donc pu être augmentée.
Charnley s'intéressa aux prothèses de Moore qui résolvait le problème de la nécrose ischémique en remplaçant la tête fémorale. Mais comme les frères Judet, elles ont le problème de descellement. Grâce aux travaux du docteur Wiltse publiés en 1957, Charnley retient la possibilité d’utiliser l’acrylique autodurci comme méthode de fixation prothétique. L’acrylique est déjà utilisé par les dentistes. À partir de 1959, les prothèses seront fixées avec du polyméthacrylate de méthyle qu’il appellera ciment à os. Une dizaine de patients ont été opérés et comme prévu, les résultats furent bien meilleurs que ceux obtenus avec la même prothèse sans ciment. Après avoir vu ces résultats, Charnley proposa donc de cimenter ses prothèses.
Afin d'améliorer les performances de ses prothèses au niveau du cotyle tout en diminuant encore le coefficient de frottement, il fera frotter sur le Téflon plutôt que sur du cartilage abimé. Sa prothèse devint alors totale. Pour le cotyle, il reprit ses premiers cotyles en Téflon et posa des prothèses que l’on peut qualifier d’hybrides, composées d’un cotyle de type « cartilage artificiel » de son invention en face d’un élément fémoral en métal, de type Moore, fixé au « ciment à os ». Les résultats furent assez bons ; mais le cotyle très fin s’usait rapidement et continuait à se desceller dans un grand nombre de cas.
Mais du fait que la tête fût plus petite, la pression que la cupule subissait était grande et s'usait de ce fait beaucoup trop vite. Charnley ne revint pas en arrière, persuadé que le principe de la petite tête était le bon, il préféra trouver un matériau plus solide que le Téflon. Il choisit en 1962 le polyéthylène. Ce matériau possède un coefficient de friction contre l’acier 5 fois supérieur au Téflon mais sa résistance à l’usure est 500 à 1000 fois supérieure. La prothèse de Charnley sera donc cimentée avec une petite tête métallique de 22 mm roulant dans un cotyle en polyéthylène.
Un nouveau problème se présenta chez les patients opérés : les petites têtes fémorales se luxaient plus fréquemment. Charnley essaya de changer sa voie d'abord et proposa une solution : la trochantérotomie. Cet abord, ancien, nécessite une incision latérale, ainsi qu'une section du grand trochanter pour dégager l’articulation. Celui-ci devra être cerclé avec des fils métalliques en fin d’intervention ce qui devait retendre les muscles fessiers, éléments stabilisateurs de la hanche. Cette technique p, définie précisément par Charnley, permettait de réduire grandement les risques de luxation avec une reprise de l'appui du côté opéré cinq semaines après l'opération.
Charnley proposa donc au monde orthopédique une triple solution au problème posé : la première était une baisse de friction et donc un faible taux d'usure par roulement d'une tête métallique de petit diamètre dans un cotyle épais en plastique polyéthylène, la seconde solution est une fixation des composants par un ciment acrylique, et la dernière est la voie d'abord : la section de l'os trochantérien pour retendre les muscles fessiers et diminuer les risques de luxation dues au petit diamètre de la tête fémorale prothétique
Ce trépied établissait un juste équilibre entre les trois risques : usure, descellement et luxation
Devant les résultats impressionnants de son concitoyen Charnley, Mac Kee commence à cimenter lui aussi ses prothèses en 1960. Il utilise le même ciment. Il fixe l’élément fémoral et l’élément cotyloïdien, ce que ne fait pas Charnley au début. La prothèse utilisée est métal-métal associant un composant fémoral de type Thomson à un cotyle qui perd sa grande vis postérieure du fait de la fixation au ciment.
C’est à cette époque que Farrar rejoint Mac Kee. Le problème principal auquel ils sont confrontés est le conflit entre le large col de la prothèse de Thomson et le bord du cotyle métallique dans les mouvements de grande amplitude. En 1961 le col est affiné. En 1965 l’élément fémoral est redessiné avec un col étroit à section biconcave comme sur la tige fémorale de Charnley.
En 1974, la persistance des descellements est enfin comprise : ce n’est pas la forme de la prothèse qui est en cause, ni le ciment, mais les débris métalliques dus aux frottements métal sur métal. Cette métallose induit une réaction de l’organisme source du descellement. Comme Charnley, Mac Kee et Farrar décident donc d’abandonner le couple métal-métal pour utiliser une cotyle polyéthylène à haute densité. Après 35 ans de loyaux services le couple métal-métal disparaît du paysage orthopédique dans l’attente du progrès des biomatériaux.
Toutefois ce changement de couple de friction ne suffira pas. Face aux têtes prothétiques de gros diamètre les cotyles en polyéthylène restent fins. L’usure est bien plus importante. Ceux-ci sont pulvérisés en quelques années. Les petites têtes fémorales de type Charnley permettent une plus grande épaisseur de plastique.
McKee commentait avec esprit en 1982: « we always learn more from our failures than our successes. »
Le Suisse Maurice Müller ne souhaite pas utiliser la voie d’abord proposée par Charnley. Il préfère à la section de l’os trochantérien une voie postérieure de Moore. Cette voie permet à ses patients une reprise de l’appui immédiat alors que la trochanterotomie préconisée par Charnley induit une période de non appui de plus d’un mois.
En contrepartie, le risque de luxation s’accroît avec la voie postérieure. Pour y remédier, Müller augmente dans un premier temps le diamètre de la tête fémorale de 22 mm à 32 mm. Le taux de luxation diminue mais l’usure du cotyle polyéthylène est alors plus importante. Le trépied proposé par Charnley doit trouver un nouvel équilibre. À partir de la voie postérieure considérée comme moins agressive un nouveau consensus s’établit entre luxation et usure. Le diamètre de la tête fémorale sera de 28 mm.
La forme de la tige cimentée proposée par Müller est également différente. Cette tige sera surnommée la prothèse « banane » à cause de sa forme. Le cotyle est également en polyéthylène.
Müller propose une variante à la triple solution proposée par Charnley :
- Friction faible par roulement d’une tête métallique de diamètre 28 mm dans un cotyle épais en plastique polyéthylène. Toutefois le taux d’usure sera plus important qu’avec une tête de 22 mm.
- Fixation des deux composants par un ciment acrylique comme pour Charnley.
- Voie d’abord postérieure ce qui permet une reprise immédiate de l’appui.
Les années 1970
Au début des années 1970 le monde de l’orthopédie connaît et analyse avec un certain recul, tant temporel que numérique, les résultats de la technique de Charnley. Ils sont bons et même très bons.
La fixation par le ciment résout le problème de la tenue des prothèses de hanche à tel point qu’elle devient obligatoire aux États-Unis à partir de 1972. En association le faible taux de friction entre petite tête métallique et cotyle permet de diminuer l’usure du couple de frottement.
Avant Charnley une prothèse devait durer 5 voire 10 ans, ce qui la réservait aux personnes les plus âgées. Avec Charnley, les prothèses durent souvent plus de 15 ans. Le temps passe. Au début des années 1980 les premiers descellements surviennent.
En occident, des centaines de milliers de prothèses totales de hanche sont posées chaque année. Merle d’Aubigné participe à la diffusion de ce type de prothèse en France à l’Hôpital Cochin où elles seront toujours posées jusqu'en 2010 par la même voie d’abord : la trochanterotomie.
Cependant certains éléments vont progressivement modifier l’utilisation systématique du ciment. Les patients ont changé. Il devient de moins en moins admissible de souffrir d’une maladie de la hanche et les opérés sont de plus en plus jeunes. Le travail demandé à l’articulation artificielle est de plus en plus proche d’une articulation normale avec reprise d’activité en force voire sportive.
« Le ciment acrylique se trouve donc peu adapté à ces nouvelles conditions. L’os humain, surtout chez le jeune sujet, est une structure évolutive en perpétuelle activité de remodelage en fonction des contraintes biomécaniques à la marche et à l’effort. » — Jean-Alain Epinette.
La poursuite des prothèses sans ciment entre 1970 et 1980
Durant cette période la prévalence des techniques proposées par Charnley est telle que les initiatives pour s’en éloigner sont peu nombreuses et le fait de personnalités marquantes.
Deux axes de recherches s’offrent à ces chirurgiens : l’exploration de nouveaux types de fixation plus performants que le ciment et celui d’un nouveau couple de friction : le couple céramique-céramique. Durant cette décennie ce couple prometteur est imaginé et adapté par un seul chirurgien, véritable précurseur, le français Boutin.
La fixation
En 1956, Siwash, un chirurgien soviétique, met au point en URSS la première prothèse totale de hanche à ancrage direct tant pour la tige que pour le cotyle. Très innovante, la surface extérieure de la pièce cotyloïdienne comporte trois couronnes d'aspérités tranchantes et fenêtrées en « pétales » ou en « rosace » destinées à l'ancrage osseux direct. Posée pour la première fois en 1956, ce concept, élaboré en URSS, passera inaperçu. Il sera découvert en Europe quinze ans plus tard.
Entre 1970 et 1980 différentes propositions de fixation de la tige fémorale sans ciment voient le jour : par Judet en France (1971) ; Lord En Angleterre (1974) ; Engh aux États-Unis (1977); Zweimüller en Autriche (1979)
Judet propose en 1971 une prothèse à ancrage direct. Il nomme cet alliage à base de cobalt le porométal parce que les billes qui le recouvrent sont séparées par des pores. Il pose 1611 de ces prothèses jusqu’en 1975, mais de nombreux échecs surviennent dues aux mauvaises caractéristiques mécaniques et métallurgiques des implants. Pourtant le coup d’envoi est donné et de nombreux modèles vont se développer en France.
En France, le Professeur Lord propose, en 1974, sa prothèse madréporique qui ressemble au corail vivant : le madrépore. Sa surface est composée de billes de 1 mm. Malheureusement cette tige présente plusieurs inconvénients : difficultés d’extraction majeures et mauvaise adaptation à long terme os-prothèse ce qui entraîne parfois une résorption osseuse autour de la tige. Ces problèmes ont alors suscité un certain discrédit sur ce type d’implant.
Aux États-Unis, l’utilisation du ciment acrylique en chirurgie est interdit jusqu’en 1967, puis devient obligatoire à partir de 1972. C’est en 1969 que Welsch et coll. commencent un travail de recherche considérable sur la fixation sans ciment. En 1971 naît un revêtement métallique poreux. C'est en 1977 qu'Engh commence à utiliser ce « porous-coat » sur la tige fémorale de ses prothèses.
En 1979 Zweimüller présente à Vienne une prothèse fémorale dont la particularité est sa forme pyramidale à section rectangulaire. Le principe de fixation est l’autoblocage cortical. La tige en titane présente une rugosité de 3 à 5 microns ce qui améliore la fixation primaire sur l’os. Après 25 ans de recul cette tige sans ciment donne d’excellents résultats à très long terme et est toujours abondamment posée.
Le couple de friction
Les céramiques seront exploitées pour la qualité de la friction céramique sur céramique et pour leur biocompatibilité qui permet un macro-ancrage. C’est P. Boutin, de Pau, qui ouvre la voie en 1970 avec une prothèse totale de hanche dont le cotyle est en céramique et la pièce fémorale en deux parties : une tête en céramique fixée sur un corps en acier.
Comme pour les couples précédents, métal-métal ou métal-plastique, la fixation des deux composants est un souci constant car le cotyle céramique accepte mal le ciment et la fixation de la tête sur la tige métallique, par collage ou vissage, est incertaine. En 1971 le cotyle devient non cimenté. L’ancrage est direct par des reliefs macro-géométriques de 1 mm. En 1975 des plis de surface sont pratiqués sur la tige ce qui permet une implantation sans ciment. En 1977 la tête céramique est fixée sur la tige par un emmanchement conique.
À l’issue de cette décennie s'ouvre le concept de la fixation sans ciment par traitement de surface ainsi que celui d'un nouveau couple de frottement dit dur-dur.
Début 2000
Les techniques de fixation sans ciment se développent. La tige fémorale a une surface traitée qui permet son intégration à l’os. La solution choisie pour le cotyle est celle d’une coquille métallique impactée dans l’os spongieux : le « metal back ». Comme pour le fémur, sa surface extérieure est traitée par des minis reliefs qui permettent son intégration à l’os du bassin. Les surfaces de la tige et du cotyle prothétique sont volontiers recouvertes d’un composant primaire de l’os : l’hydroxyapatite. Ce fin revêtement accélère l’intégration des pièces métalliques.
De nouveaux couples de friction apparaissent. Le couple céramique-céramique prend son essor. La tête fémorale est fixée sur un cône morse, le cotyle est enchâssé dans une coque « metal back ». Un autre couple réapparaît depuis quelques années : le métal-métal. En effet grâce aux progrès d’usinage l’usure de ce couple est maintenant très faible.
Avec la bonne résolution des problèmes liés à l’implant, certains chirurgiens s’intéressent à l’évolution de la voie d’abord. Ces voies mini invasives par mini incision ont été décrites par voie antérieure et postérieure.
Une nouvelle dimension est donnée au respect de l’architecture de la hanche naturelle (notion d'offset). Le choix de la prothèse se fait sur des calques à la fois en longueur mais aussi en largeur. Ces implants s'adaptent à l’anatomie du patient afin de conserver les tensions musculaires inchangées.
Aujourd'hui
Planification d'une prothèse de hanche sur ordinateur
La prothèse totale de hanche (PTH) est une intervention chirurgicale dont l’efficacité et la régularité des résultats sont remarquables en assurant
- le soulagement des douleurs ;
- l’amélioration de la fonction ;
- l'amélioration de la qualité de vie.
La longévité de la prothèse dépend de plusieurs facteurs dont les principaux sont le type d’implant, la méthode de fixation, la technique de pose (et donc le chirurgien et son équipe).
L’excellence des résultats de la prothèse de hanche pousse à étendre les indications de cette opération à des sujets
- aux exigences fonctionnelles lourdes ;
- aux problèmes d’anatomie compliqués.
L'introduction des techniques de récupération rapide après chirurgie permet à présent la pose de prothèse totale de hanche en chirurgie ambulatoire pour certains patients
Statistiques
Il y a environ 285 000 interventions de ce type, chaque année, aux États-Unis1, 2. En France, chaque année, environ 140 000 patients subissent une arthroplastie totale de la hanche (chiffres 2013)3.
Indications
- Coxarthrose (arthrose de hanche)
- Coxarthrose faisant suite à une fracture de l'acetabulum (communément appelé "cotyle")
- Ostéonécrose de la tête fémorale.
- Coxopathies rapidement destructrices (rhumatismale, infectieuse, tabétique, tumorale).
- Dysplasies coxo-fémorales au stade arthrosique
- Dé-arthrodèse
Technique chirurgicale
Choix de l'implant
Il y a différents types d'implant :
- implant inox, son avantage est d'être de faible coût mais il est de moins en moins utilisé à cause de son usure précoce.
- implant titane, il est d'une solidité extrême mais, hélas, le coût du matériel est très élevé. Il est sensible à la corrosion lorsqu'il est dans l'organisme humain. Il est cependant tout à fait biocompatible.
- implant polyéthylène, matière plastique spécialisée. Son avantage est d'être de la même densité que le tissu osseux, ce qui va favoriser l'ostéosynthèse. Capacité de glissement supérieure au niveau de l'articulation.
- implant céramique, quasi inusable, il a repoussé la limite statistique des 15 ans de durée de vie moyenne des prothèses. Son principal désavantage est sa fragilité en cas de choc et sa difficulté industrielle d'élaboration.
Voies d'abord
Modifications architecturales avant et après la mise en place d'une prothèse totale de hanche
Un patient qui a besoin d'une prothèse de hanche en raison d'une destruction de son articulation (traumatique, dégénérative, tumorale, métabolique...) est opéré selon une voie d'abord antérieure ou postérieure.
Dans le cas général, l'intervention, réalisée sous anesthésie générale ou sous rachianesthésie, dure moins de deux heures et le saignement est inférieur à 500 cm3.
Évolution post-opératoire
Surveillance et soins
Le patient est en général levé le lendemain en appui total et peut se déplacer avec des cannes béquilles vers le 3e ou 4e jour post opératoire. Il sort de l'hôpital vers cette date pour retourner à son domicile si les conditions le permettent ou pour être admis dans un centre de rééducation. Il restera sous anticoagulants, le plus souvent sous cutanés, pour 5 semaines habituellement. La durée de réhabilitation pour obtenir les pleins bénéfices de la prothèse et retrouver une marche correcte est habituellement d'un mois et demi.
Résultats
Les résultats fonctionnels des prothèses de hanche font qu'à 6 mois, 1 personne sur 3 n'a plus du tout de douleur, et 1 sur 3 n'a plus qu'une légère douleur. En revanche, 1 personne sur 25 a une douleur sévère et 1 sur 200 une douleur extrême4.
Il est possible d'améliorer ces résultats en utilisant les techniques de récupération rapide après chirurgie[réf. nécessaire].
Complications
Infection
L'infection après PTH est heureusement peu commune ; de nous jours, le chiffre de 0,5 % pour la PTH est admis en cas de PTH de première intention (Garvin KL et Hanssen AD., 1995), même chez l'obèse.
Le facteur pris isolément le plus important de prévention d'infection précoce serait le recours aux antibiotiques en péri-opératoire (Espehaug B, Engesaeter LB, Vollset SE, et al., 1997).
Une technique opératoire soigneuse, une réduction des allées et venues dans la salle d'opération (personnel néophyte, anesthésiste en nombre insuffisant...), des combinaisons spéciales pour les opérateurs et une circulation d'air à flux laminaire seraient de nature à réduire ce risque d'infection initiale (Garvin KL et Hanssen AD., 1995).
L'infection dite tardive ou à distance de la prothèse serait le résultat de bactériémie.
Les directives de certaines institutions, telles que l'American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) sont en faveur de la prescription - au moins au cours des deux années qui suivent la pose de la prothèse - d'antibiotiques de manière préventive à tous les candidats à un geste chirurgical dentaire ou autre susceptible de s'accompagner de bactériémie.
Luxation
Luxation d'une prothèse de hanche.
La luxation de la prothèse peut être due à un problème de positionnement de celle-ci, de faiblesse musculaire, de balance des tissus mous lors de la chirurgie, d'anatomie, ou à l'imprudence du patient. Cette complication n'implique pas toujours la reprise. L'abord postérieur est statistiquement plus à risque pour ce genre de complication, sauf en cas d'utilisation de prothèses double mobilité qui abaissent le risque de luxation à celui des voies antérieures tout en s'épargnant des complications des voies antérieures.
Afin d'éviter les luxations de PTH il faut respecter les restrictions suivantes soit :
Pour les 6 premières semaines:
- Ne pas plier la hanche à plus de 90°
- Demander de l'aide pour se laver, se chausser ou habiller la jambe opérée ou utiliser les aides techniques.
Pour les 3 premiers mois:
- Mettre un oreiller entre les jambes pour dormir, pas sous les genoux. Cela permettra d'éviter que la jambe soit en position d'adduction.
- Positions permises : sur le côté opéré, sur le ventre et sur le dos.
- Éviter de dormir sur le côté sain car la jambe saine est portée à aller en adduction.
- Utiliser un siège de toilette surélevé (selon la grandeur de la personne)
Pour les 6 premiers mois :
- Utiliser un banc de transfert pour prendre sa douche ou son bain.
- Interdiction d'aller s'asseoir dans le fond du bain
Mouvements à éviter à vie :
- Ne pas se croiser les jambes
- Ne pas coller les genoux ensemble si les pieds sont éloignés.
- Éviter de s'asseoir dans un fauteuil trop bas et profond.
- Éviter les sports de contact et de raquette5.
Complications peropératoires
- Lésion nerveuse (en particulier le nerf sciatique)
- Lésion vasculaire
- Fracture du fémur
- Lésion d'organe du petit bassin (vessie)
- "choc au ciment" équivalent d'une embolie pulmonaire
Complications tardives
Descellement de l'implant
Usure du polyéthylène et ostéolyse
Elles sont en rapport avec les matériaux posés et l'activité du patient, qui est le problème principal mais n'est pas prévisible pour un patient et une prothèse donnée car elle dépend de multiples facteurs. Aussi, il est difficile de donner à un patient une estimation de la durée de vie de sa prothèse. Certes, chez les patients de moins de 55 ans, les patients très actifs physiquement, les patients obèses avec un Indice de masse corporelle élevé sont plus à risque pour un descellement précoce de l'arthroplastie. Les meilleures séries font état de plusieurs dizaines d'années pour le moment, mais surtout chez des patients peu actifs.
Pour pallier ce dernier problème, on a développé des prothèses utilisant des surfaces de frottement différentes du couple original de John Charnley (métal et polyéthylène), incluant métal-métal ou des céramiques industrielles dont les résultats sont très encourageants. Les propriétés tribologiques des polyéthylènes ont été perfectionnées, permettant de conserver les avantages du polyéthylène tout en s'affranchissant des complications de la céramique ou du métal.
Résorption de l'os au contact de la prothèse (stress shielding au niveau de la tige fémorale)
Le "stress shielding" est une résorption osseuse causée par les sollicitations mécaniques de l'implant sur l'os au niveau de la tige fémorale. Cela entraîne sur le long terme une mobilité de l'implant avec le fémur. L'implant doit être alors remplacé par un autre avec une tige fémorale plus importante (plus longue et de plus gros diamètre) pour pallier ce problème.
Fracture péri-prothétique
Notes et références
- Issa K, Mont MA
- Total hip replacement: mortality and risks [archive], Lancet, 2013;382:1074-1076
- Académie de médecine [www.academie-medecine.fr › uploads › 2018/06 › P.1063-1070.pdf]
- Kazunari Ninomiya, Naonobu Takahira, Shunsuke Ochiai et Takashi Ikeda, « Incidence of postoperative complications and non- periprosthetic fractures after total hip arthroplasty: A more than 10-year follow-up retrospective cohort study », Physical Therapy Research, vol. 24, no 1, , p. 77–83 (DOI 10.1298/ptr.E10043, lire en ligne [archive], consulté le )
- Informations tirées du protocole de réadaptation, arthroplastie et hémi-arthroplastie de la hanche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Liens externes
Prothèse dentaire
La prothèse dentaire est un dispositif dentaire remplaçant une ou plusieurs dents absentes et, si nécessaire, les structures anatomiques associées1.
La première prothèse dentaire connue date de 2 600 ans ; c'est une invention étrusque. Elle remplaçait trois incisives supérieures par une dent de vache retaillée et marquée de traits verticaux pour simuler les dents naturelles, fixée aux dents avoisinantes (incisive restante, et canines et prémolaires) par un fil d'or2.
L'acte prothétique permettra de reconstituer les dents trop délabrées (à la suite d'une carie ou d'une fracture) grâce à des couronnes, en métal ou en céramique. Il permet également de remplacer des dents manquantes, soit par un moyen fixe (bridge), soit par des appareils amovibles dits châssis métalliques ou stellites.
Le dentiste travaille en association avec un prothésiste dentaire. Ce dernier travaille dans un laboratoire, avec un matériel très spécifique.
Une prothèse ne dispense en aucune manière d'une hygiène buccodentaire rigoureuse. Les dents, même artificiellement couronnées, peuvent se carier à la jonction entre la prothèse et la dent naturelle. Et les dents porteuses de crochets (pour la prothèse amovible) sont également fragilisées (caries) par le manque d'hygiène dentaire quotidien.
Prothèse fixe
Une fois que le dentiste a fait les empreintes du patient, le prothésiste les utilise et fait des moules. Pour effectuer ce travail, il utilise de nombreuses machines, comme le four à céramique qui sert à cuire les dents en céramique.
Bridge 4 éléments pour remplacer la dent
no 46 (dents
nos 45, 46, 47, 48)
Il existe deux types de prothèses fixes :
Couronnes artificielles
Une couronne artificielle couvre ou à remplace la majeure partie ou la totalité de la couronne de la dent délabrée1. Elle peut être simple, ou associée à un inlay-core (faux-moignon ancré dans la racine de la dent par un tenon, qui va servir d'ancrage à la couronne).
Couronne (dent
no 24)
Bridge 3 éléments (dents
nos 25, 26, 27)
- Avantages : elle protège la dent et ne se remarque pas.
- Inconvénients : elle oblige à tailler la dent.
Bridges
Un bridge (pont au Québec3) ou prothèse partielle fixe1 permet de remplacer une dent absente, voire deux, en s'appuyant sur les dents adjacentes (une de chaque côté) ; au-delà le risque de fracture est trop élevé. Mais on peut également réaliser un bridge de plus grande portée, en prenant appui sur plusieurs dents piliers. Le principe est le même que pour la couronne.
- Avantages : à très long terme (30 ans et plus), cela permet d'éviter les migrations dentaires dans l'os (récidives orthodontiques ; traitement des parodontolyses et des malocclusions) ou de remplacer une dent manquante, en utilisant un système fixe s'appuyant sur les dents voisines (qu'on ne doit pas enlever chaque jour pour le nettoyage).
- Inconvénients : mutilation des dents piliers saines (la carie mutile aussi les dents), prix.
Une prothèse partielle fixe reconstitue la dent au plus proche de l'état naturel.
Matériaux
Les prothèses fixes peuvent être métalliques, céramo-métalliques, ou tout céramique.
Le métal est généralement utilisé pour les dents postérieures. C'est souvent du Nickel-Chrome, du Chrome-Cobalt, parfois de l'or ou du titane.
- Avantage : le prix
- Inconvénients : inesthétique (à éviter sur les dents antérieures). Allergies possibles (mais rares).
La céramique est de plus en plus utilisée. Les propriétés mécaniques continuent de s'améliorer.
Couronnes prothétiques en céramique feldspathique sur les dents antérieures
- Avantages : esthétique, bonne biocompatibilité.
- Inconvénient : prix plus élevé que les couronnes métal.
La céramique peut être utilisée seule (couronne céramo-céramique), ou associée à du métal : couronne céramo-métallique (CCM) pour des bridges de longue étendue (8 à 14 dents) garantis à très long terme (30 ans et plus, si l'hygiène dentaire quotidienne est suffisante).
La couronne céramo-céramique a des meilleures qualités esthétiques, et ses qualités mécaniques sont aujourd’hui suffisantes pour permettre son utilisation sans risque sur quelques dents.
Les céramiques utilisées en dentisterie : céramique feldspathique (plus esthétique mais plus fragile), céramique au disilicate de lithium (alliant solidité et esthétique), céramique alumineuse (plus résistante mais plus opaque) ; tenons à base de zircone (oxyde de zirconium, ZrO2).
La résine est surtout utilisée pour la restauration provisoire, dans l'attente d'une des restaurations définitives citées ci-dessus.
Il existe aussi des résines chargées en céramique à but de restauration définitive qui appartiennent a la famille des composites .
Prothèse amovible
Prothèse partielle en résine, amovible
Une prothèse amovible, communément appelée « dentier », est une prothèse qui peut s'enlever. Elle remplace généralement plusieurs dents. Elle s'appuie en partie sur les dents restantes, en partie sur la gencive et l'os sous-jacent.
Une prothèse amovible demande généralement quelques jours d'adaptation. Bien étudiée, elle doit être bien supportée.
Châssis métallique
C'est une prothèse à base métallique généralement en chrome cobalt molybdène rigide, qui s'appuie à la fois sur les dents restantes et sur les muqueuses. La base métal sert de support pour soutenir des dents résines à l'emplacement des édentations.
- Avantages : légèreté, encombrement réduit, stable, en général bien supportée, pas de perte de sensations chaud/froid.
- Inconvénients : entraîne une charge importante sur les dents restantes ; aliments qui se coincent dans les espaces libres, par exemple sous la barre linguale pour un appareil mandibulaire, dans l'intrados.
Prothèse partielle en résine
C'est une prothèse composée principalement de résine, avec des crochets en métal souple. On peut la renforcer avec de la fibre de verre ou des éléments métalliques.
Elle est plutôt réservée à un usage temporaire, voire être un appareil de transition, par exemple un appareil provisoire, à la suite d'extractions récentes, dans l'attente d'un travail implantaire.
Prothèse complète
Lorsqu'il ne reste plus du tout de dents, on les remplace par une prothèse en résine, qui doit s'appuyer le plus largement possible sur les muqueuses. Le problème de ces prothèses totales est leur adhérence en bouche, car elles n’adhèrent à la muqueuse buccale que par un phénomène physique dit « de succion » qui se réalise si les deux surfaces ont un relief identique, d'où l'importance de l'extrême précision des empreintes effectuées par le chirurgien dentiste, faute de quoi il faudra procéder à un rebasage ou le porteur de la prothèse sera obligé d'utiliser des crèmes fixatives4
Matériaux
Les dents des prothèses amovibles peuvent être en résine ou en céramique en fonction de la morphologie et de l'âge du patient. Les prothèses amovibles nécessitent peu de retouches voire aucune si tous les protocoles de réalisation sont respectés — prise d'empreinte primaire, empreinte secondaire soignée, enregistrement de l'articulation correct. Une fois la prothèse placée, il ne faut plus effectuer de retouches. Si un problème apparaît, il faut reprendre le protocole de l'empreinte secondaire ou procéder à un nouvel enregistrement de l'articulé pour faire les corrections nécessaires. Il n'est pas possible de retoucher pour ajuster à la muqueuse. Le patient doit penser à retourner régulièrement chez son dentiste, tous les six mois environ, dans le cas d'une prothèse complète, pour effectuer un rebasage de celle-ci. Il est aussi possible d'effectuer de la polychromie de la résine pour adapter à la teinte de la gencive de chaque patient.
Prothèse sur implants
Implant dentaire Nobel Active WP de 13 mm de longueur, de la marque Nobel Biocare
Un implant est une vis qu'on va fixer dans l'os selon des modalités opératoires bien précises afin de remplacer le support naturel de la dent qui a disparu: la racine dentaire. Du respect de ces modalités opératoires dépendra le résultat final. Le métal utilisé est du titane très pur, la pureté du métal se traduit par le prix des implants mais aussi par leur longévité. Les implants en zircone, très à la mode il y a une vingtaine d'années sont aujourd'hui en retrait, les implants disques sont utilisés de façon très variable selon les pays. Le titane est bio compatible c'est-à-dire qu'il n'est pas corrodé par l'os vivant à son contact. Une fois mis en place l'os se régénère même autour des spires pour entrer en contact intime avec le métal ce qui soude littéralement l'implant et le rend indémontable. C'est ce processus tout à fait particulier qui explique leur longévité, supérieure à 40 ans pour certains. Les implants récents ont un état de surface rendu micro poreux par un traitement spécial pour une meilleure « accroche » et une phase de cicatrisation plus courte. De nouvelles techniques permettent aujourd'hui de connecter des pièces en zircone (teinte de la dent) sur les implants titanes (en métal gris) pour un meilleur rendu esthétique sans augmentation notable du prix des prothèses.
Les techniques implantaires permettent de remplacer la ou les dent(s) manquante(s) de manière très esthétique, autant sur le plan esthétique que fonctionnel. L'ancien dogme une dent remplacée = un implant est dépassé. Pour des raisons de coûts mais aussi à la suite de progrès techniques (métallurgie, radiographie, techniques de fabrication en laboratoires de prothèses, techniques opératoires), il est possible de réaliser par exemple une prothèse fixe de douze dents sur six implants.
Prothèses fixes sur implants
Il en existe de nombreux types adaptés à chaque cas particulier: couronnes unitaires scellées ou vissées, bridges scellés ou vissés, prothèses totales résines ou céramiques vissées, bridge complet étendu à la totalité de l'arcade dentaire .
Dent unitaire
Il faut adapter la forme, la couleur/teinte aux dents voisines et régler parfaitement l'occlusion. En effet l'implant est totalement fixe (soudé donc sans aucun degré de liberté), alors que la dent est légèrement mobile (grâce au desmodonte). La dent sur implant doit donc être en très légère sous-occlusion (légèrement moins haute que les dents voisines), pour éviter le phénomène de friction lorsqu'on serre fort les dents.
-
L'implant est la « racine » artificielle de la dent manquante.
-
Prothèse céramique en occlusion.
Bridge ou pont dentaire
Le bridge (ou pont dentaire au Québec3) répond aux mêmes critères esthétiques et d'occlusion. La prudence est de mettre en place autant d'implants que de dents à remplacer. C'est moins vrai à la mandibule faite d'un os plus compact qu'au maxillaire supérieur fait d'un os spongieux.
-
Bridge en place, la gencive n'est pas visible lors du sourire.
-
Bridge sur modèle en plâtre.
-
Implants en place. Notez qu'il y a moins d'implants que de dents sur la prothèse.
Prothèse totales fixes sur implants
Elles ont en règle réalisables sur six implants (selon des modalités bien précises pour l'observation desquelles le poseur d'implant doit avoir les qualifications requises). Selon la récession osseuse du patient à la suite de la perte de ses dents, on réalisera une prothèse sans ou avec fausse gencive. Moins coûteuses que les bridges, ces prothèses sont moins longues à réaliser. Rien n'empêche cependant le patient de faire remplacer sa prothèse résine par une prothèse céramique après une période d'observation de deux ans.
-
Radiographie des six implants
-
Contrôle de la cicatrisation à une semaine de l'intervention
Prothèses amovibles totales sur implants
Prothèse totale inférieure en résine
Pour assurer une mastication correcte donc une tenue de prothèse satisfaisante on met en place deux implants à 1,5 cm de part et d'autre de la ligne médiane. La prothèse est reliée à ces implants par des attachements, boutons-pression (le système préconisé par la plupart des marques d’implants est le système Locator (marque déposée). Les aimants sont abandonnés. Les barres de fixation ont peu d'intérêt dans cette indication.
-
Les implants à 3 cm de distance
-
Prothèse totale supérieure en résine
Un système de fixation pour les prothèses totales du haut est beaucoup moins demandé par les patients qui sont en général satisfaits de leur prothèse totale conventionnelle. Un tel système nécessite la mise en place de quatre implants (l'os est spongieux donc moins « résistant ») et la réalisation d'une barre transvisée en titane sur laquelle on retrouve les mêmes systèmes de contention Locator. Ce type de fixation est indiqué si le scanner pré opératoire montre une quantité très faible d'os. La prothèse réalisée est très mince et n'a pas de faux palais ce qui permet à cette patiente victime d'un réflexe nauséeux intense avec une prothèse conventionnelle total maxillaire de supporter cette prothèse.
-
3 Locators supportés par une barre titane usinée fixée sur 4 implants
-
Notez les systèmes de fixation femelles à l'intrados de la prothèse
Prothèse amovible partielle stabilisée par des implants
Les implants peuvent aussi permettre de stabiliser une prothèse amovible partielle : soit pour améliorer l'esthétique en permettant de se passer de crochet trop antérieur , soit pour empêcher l'enfoncement de la prothèse dans le cas d'édentement postérieur.
Prothésiste dentaire
Un aspect du travail du prothésiste
Lors de l'élaboration d’une prothèse, le dentiste travaille en étroite collaboration avec le prothésiste. Le dentiste prend des empreintes des mâchoires supérieure et inférieure, qui vont ensuite chez le prothésiste ; celui-ci accomplit le travail demandé à partir des empreintes et des préparations effectuées en bouche du patient par le praticien (taille de vestige de la dent à couronner) le travail repart enfin chez le dentiste pour l'essayage en bouche et le scellement. Il faut souvent plusieurs étapes, en fonction du travail à réaliser. Pour les prothèses en Chrome-Cobalt, l'une des difficultés tient au polissage; il est fait traditionnellement de manière manuelle, ce qui est assez coûteux et délicat; de plus en plus fréquemment, ce lissage-polissage est effectué en machine de type centrifugeuse satellitaire en utilisant plusieurs abrasifs; le processus dure entre 1.5 et 3 heures pour une vingtaine de châssis, mais il s'agit de temps masqué durant lequel le technicien peut se concentrer sur d'autres tâches.
Santé au travail, toxicologie...
La pose de prothèse, la manipulation de certains produits (amalgames), le fraisage, sablage, le chauffage, le décapage, sciage, polissage, etc. et l'utilisation de résines et de métaux rares ou toxiques sont des sources de risques pour le patient, le dentiste, le prothésiste.
Le mercure est le métal le plus souvent évoqué en dentisterie, mais d'autres sources d'exposition à des risques sanitaires et environnementaux existent (avec notamment des métaux ou alliages impliquant des éléments chimiques tels que le chrome, cobalt, nickel, molybdène, manganèse, aluminium, tungstène, béryllium, Zirconium, mercure, des résines et leurs catalyseurs...). Ils ont notamment justifié en France une étude INRS sur la pollution de l'air intérieur et plus généralement la « pollution dans les ateliers de prothèse dentaire »5. Dans ce pays, durant la période de l'étude (fin des années 1980), environ 14 000 salariés travaillaient dans 4 500 ateliers, dont une trentaine ont été étudiés dans ce cadre5.
La littérature médicale a décrit de nombreux cas de silicose, pneumoconiose par métal dur, et même de bérylliose, et les toxicologues craignent de nouvelles pathologies induites par les matériaux issus de la chimie organique5. Les guides de bonne pratique recommandent la pose de système préventifs et performant de filtration/aspiration et de renouvellement de l'air intérieur, adaptés aux postes de travail5.
Notes et références
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
- Odontologie
- Denturologie
- MOF, le domaine de la prothèse dentaire fait partie des 162 disciplines du concours des Meilleurs Ouvriers de France.
Prothèse du genou
Cet article a une forme trop académique ().
La forme ressemble trop à un extrait de cours et nécessite une réécriture afin de correspondre aux standards de Wikipédia. N'hésitez pas à l'améliorer.
Modèle de prothèse du genou
Une prothèse du genou est un implant articulaire interne qui remplace les surfaces articulaires défaillantes du genou, dans le but de permettre de nouveau un appui stable, la flexion et l'extension, et de récupérer un bon périmètre de marche.
Épdémiologie
La prothèse de genou (PG ou PTG) est l'une des opérations les plus communément pratiquées : environ 40 000 prothèses de genou sont posées chaque année en France, Outremer compris.
En 2008, aux États-Unis, 650 000 prothèses de genou ont été implantées1, chiffre traduisant un taux d'accroissement annuel de 10 % au cours de la décennie 1990.
À titre de comparaison, « seulement » 139 000 prothèses de hanche (PTH) sont implantées, chiffre traduisant un taux d'accroissement annuel, également moins élevé (AAOS Bull 1999)[réf. souhaitée].
À titre d'exemple insulaire, en Guadeloupe, depuis plus de deux décennies, si l'on admet que le pays est 1 000 fois moins peuplé et plus jeune que les États-Unis, les statistiques d'activité de reconstruction articulaire de genoux et hanches sont, depuis le début de la décennie 1980, régulièrement comparées aux chiffres américains, connus et divisés par 1 000. Les résultats de prothèse de genou (PTG et « uni ») à 10 et 15 ans, voire 20 ans seraient comparables, voire surpasseraient les meilleurs résultats de la PTH.
Indications
-
Radiographie d'une prothèse de genou(face)
-
Radiographie d'une prothèse de genou (profil)
La prothèse du genou n'est en principe, proposée et mise en place qu'en cas de lésions graves : arthrose évoluée, polyarthrite rhumatoïde, destructions d'origine traumatique.
Il n'y a pas de place pour la chirurgie préventive au vu de radios en matière de prothèse articulaire, mais trop tarder aboutit aussi, à l'inverse, à une sédentarisation excessive (avec ses conséquences : hypertension, diabète, obésité, etc.) en majorant le risque opératoire et la complexité des suites.
Les objectifs assignés à la prothèse de genou (PTG) sont de trois ordres : soulagement des douleurs, restauration des axes du membre et restauration de l'amplitude des mouvements du genou.
Les contraintes techniques sont importantes : la PTG se doit tout particulièrement d'autoriser flexion et extension tout en résistant aux mouvements anormaux tels que varus, valgus ou translation excessive.
La précision des coupes osseuses et de la préparation des parties molles sont les principaux gages de bons résultats de la PTG[réf. souhaitée].
Technologie
L'implant est constitué de métal (alliage acier chrome cobalt, titane) et de polyéthylène (versant tibial).
La fixation à l'os utilise soit du ciment chirurgical (polyméthyl métacrylate) soit un système de fixation sans ciment.
Considérations d'ordre technique
Les prothèses de genou peuvent être regroupée en deux principales catégories2:
- les prothèses à glissement: l'implant fémoral glissant sur l'implant tibial, se déclinant elle-même en plateau fixe ou mobile, ultracongruant et/ postero-stabilisée.
- les prothèses contraintes: il existe une charnière entre l'implant fémoral et l'implant tibial.
Une troisième catégorie intermédiaire existe:
- les prothèses semi-contraintes: coques entre l'implant fémoral et tibial.
Geste chirurgical volontiers qualifié de « majeur »
Examens et bilan pré-opératoire
Radiographies
Déviations angulaires irréductibles et rétractions, raideur
Instabilité grossière ligamentaire
Maladies vasculaires : artères, etc.
État de la peau
Désaxations des gros os de jambe et de cuisse et déformation de hanches (controlatérale aussi)
Calques préopératoires numérisés
Antécédents d'opération(s) à ce genou
Grosses pertes de substance osseuse
Préparation à l'opération
L'intervention chirurgicale, peut être précédée d'une stimulation par érythropoïétine.
Instruments chirurgicaux : ancillaire
Antibiothérapie dite « préventive »
Installation de l'opéré(e)
Technique opératoire
La prothèse est en principe posée dans un environnement aseptique strict.
L'intervention chirurgicale dure environ une heure et 30 minutes, durée variable en fonction de l'expérience de l'équipe et de l'habileté du chirurgien et de l'importance des déformations du genou.
Équilibrage par résection mesurée ou par création de perte de substance en flexion ?
Préparation de l'extrémité inférieure du fémur aux coupes osseuses
Résection du tibia
Respect ou non du ligament croisé postérieur
Équilibrage du genou
Équilibrage des ligaments
Écarts en flexion et en extension
Rotules
Fermeture
Ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure
Soins péri-opératoires
L'hospitalisation dure volontiers moins de huit jours (gonarthrose évoluée unilatérale), mais plus si le chirurgien le juge prudent. L'opéré appuie complètement au plus tard à 48 heures sauf exception. Le traitement anticoagulant en post opératoire est la règle, plus ou moins intensif ou « curatif » en fonction des antécédents et de la mobilité globale du patient, et ce, en prévention de la maladie thrombo-embolique. Les techniques modernes de prise en charge, telles que la récupération rapide après chirurgie permettent de réduire la durée de séjour à 4 jours et parfois même moins. Certains patients peuvent même bénéficier de prise en charge en chirurgie ambulatoire pour les prothèses uni-compartimentales du genou, voire pour des prothèses totales du genou. Cela passe par une mobilisation très précoce de l'articulation, elle-même conditionnée par un traitement parfait de la douleur. L'utilisation de l'infiltration peropératoire d'un mélange d'antalgique, d'anti-inflammatoire et d'adrénaline est un facteur facilitant l'obtention de cette antalgie quasi parfaite et tend donc à se diffuser.
Un œdème du genou apparaît dans les heures ou jours qui suivent. Il est maximal 3 à 8 jours après l'opération. En moyenne, le volume est augmenté de 35 % par rapport à avant l'opération. Trois mois après l'intervention, il est encore augmenté de 11 %3.
Rééducation
La rééducation précoce par des kinésithérapeutes/physiothérapeutes est recommandée. Elle débute dès le lendemain de l'intervention en l'absence de complications, au plus tard dans les deux semaines pour être qualifiée de précoce et être plus efficace en termes de qualité et rapidité de récupération.
Les kinésithérapeutes, en collaboration avec les patients, réalisent un bilan pour déterminer les objectifs de la prise en charge qui sont généralement :
- la récupération des amplitudes articulaires du genou en flexion et extension ;
- la récupération de la force musculaire des muscles du membre inférieur ;
- la surveillance de la non apparition de complications et de la diminution des douleurs ;
- la reprise des activités de la vie quotidienne puis sportive.4
Le séjour en centre de rééducation (ou soin de suite et de réadaptation) n'est pas nécessaire si les suites sont simples5. À la sortie de l'hôpital, les soins de rééducation se déroulent à domicile ou en cabinet.
Après l'opération, 88 % des personnes retrouvent leur niveau d'activité physique et sportive antérieur à l'opération. Dix an après, encore 70 % continuent à pratiquer un sport6.
Complications
Complications dites « non mécaniques »
Ce sont :
Complications mécaniques
Les problèmes qui peuvent se présenter sont essentiellement :
- l'usure de la prothèse (plus précisément du polyéthylène)
- le déscellement de la prothèse d'autant moins à redouter que l'indication de l'opération et sa mise en œuvre sont de qualité (expérience du chirurgien).
Orthopédie
Voir aussi
Bibliographie
Articles connexes
Notes et références
- Carr AJ, Robertsson O, Graves S et al. Knee replacement [archive], Lancet, 2012;379:1331-1340
- Sulimovic S, Sedel L., « Revue de prothèses totales de genou multidirectionnelles » [archive], sur pepite.univ-lille2.fr (consulté le )
- Brian J. Loyd, Andrew J. Kittelson, Jeri Forster et Scott Stackhouse, « Development of a reference chart to monitor postoperative swelling following total knee arthroplasty », Disability and Rehabilitation, vol. 42, no 12, , p. 1767–1774 (ISSN 1464-5165, PMID 30668214, DOI 10.1080/09638288.2018.1534005, lire en ligne [archive], consulté le )
- Kate G. Henderson, Jason A. Wallis et David A. Snowdon, « Active physiotherapy interventions following total knee arthroplasty in the hospital and inpatient rehabilitation settings: a systematic review and meta-analysis », Physiotherapy, vol. 104, no 1, , p. 25–35 (ISSN 1873-1465, PMID 28802773, DOI 10.1016/j.physio.2017.01.002, lire en ligne [archive], consulté le )
- Haute autorité de santé (HAS). Orientation en rééducation après prothèse totale de genou. 2008. Lire en ligne [archive]
- Ana Oljaca, Ivan Vidakovic, Andreas Leithner et Marko Bergovec, « Current knowledge in orthopaedic surgery on recommending sport activities after total hip and knee replacement », Acta Orthopaedica Belgica, vol. 84, no 4, , p. 415–422 (ISSN 0001-6462, PMID 30879445, lire en ligne [archive], consulté le )
Prothèse phonatoire
Pour les articles homonymes, voir Prothèse.
La prothèse phonatoire est une substitution synthétique du larynx pour sa seule fonction phonatoire.
Principe
La prothèse phonatoireA 1 permet aux patients de parler après une laryngectomie totale. Dans les suites de cette opération, le pharynx ne peut plus jouer son rôle de carrefour aérodigestif, la trachée ayant été abouchée directement à la face antérieure du cou (lors de la trachéotomie) et l'œsophage connecté directement au pharynx (nommé la néo-glotte). L'air ne passe donc plus par les cordes vocales, aussi enlevées.
Le patient ainsi est sans voix. Sa communication orale et donc son interaction sociale sont gravement compliquées1.
Pour permettre au patient de parler quand même, la technique employée actuellement est celle de la mise en place d'une prothèse, placée dans une fistule tracheo-ösophageale créée par l'opérationA 2, permettant le passage de l'air des trachées dans le pharynx et d'y former la voix par vibrations de tissu muqueux.
Histoire
Développement des larynx artificiels
En 1869, le chirurgien Czermak construit le premier larynx artificiel2. En 1873, le chirurgien Billroth, après une laryngectomie implante un larynx artificiel2. Une version moderne du larynx artificiel (avec des matériaux comme le titane) est conçue et implantée pour la première fois en 2012 par le chirurgien Christian Debry 3.
Développement des prothèses phonatoires
En 1972, Mozolewski donne la description de la prothèse phonatoire actuelle4.
Depuis lors, de nombreux progrès ont été accomplis concernant ces mesures de réhabilitation.
Les principaux producteurs et distributeurs de ces prothèses sontA 3 :
- Adeva (production et distribution)5,6
- Atos Medical (production et distribution)
- Heimomed (production et distribution)7,8
- InHealth (production et distribution)
Etapes de développement (exemples)
Atos Medical (ProvoxA 4)
En 1990, Atos Medical9 commercialise sa première prothèse, la Provox10, puis la Provox2 en 199711, et la Provox ActiValve en 200312.
En 2005, Atos Medical présente la prothèse de longue durée 13,A 5.
En 2009, Provox Vega représente une nouvelle génération (la troisième) 14 qui offre une aide d’insertion (SmartInserter)15,16.
InHealth (Blom-SingerA 6)
En 1994, InHealth17 commercialise une prothèse de longue durée, la Blom-Singer Classic™A 5,18.
La plupart des prothèses phonatoires fonctionnent de la même façon, mais quelques détails structurels restent cependant différents, et se résument généralement au petit tube de quelques millimètres de diamètre (à peu près 5 mm / 15 French) qui constitue la prothèse, et dont la longueur varie (cela dépend notamment de l'anatomique du patient). Des collerettes à chacune de ses extrémités le maintiennent dans la fistule artificielleA 7,19. La collerette du côté de l'œsophage est normalement plus massive et parfois marquée par la couleur et radio-opaqueA 8. Une valve est placée au côté œsophagien pour empêcher le passage de la salive, des aliments et des liquides de l'œsophage à la trachéeA 9.
Un ruban de sécurité se trouve sur toutes les prothèses, et est coupé après placement pour les prothèses de courte durée, ou fixé au cou pour les prothèses de longue durée.
Propriétés des prothèses phonatoires
Matériel
Les prothèses phonatoires sont habituellement constituées de gomme de silicone. La valve et son siège sont habituellement constitués de PTFE ou de silicone dure. Quelques valves sont recouvertes d'argent.
Dimensions
La longueur des prothèses phonatoires dépendent de l'anatomie du patient et varie de 4 à 22 mm. Le diamètre extérieur varie de 5,3 à 7,5 mm. Les collerettes ont un diamètre d'environ 12 mm.
Une étude a montré que le diamètre extérieur influence la qualité de la voix20.
Problèmes utilisant des prothèses phonatoires
- Infestation par des champignons
L'infestation par des champignons est un problème grave, réduisant la durée de vie des prothèses et entravant la fonction de la valve. Quelques prothèses contiennent un aimant comme assistance, d'autres sont couvertes d'argent pour prévenir la formation d'un biofilm21. L'application d'argent est en discussion22.
- Fuites
Des fuites, intra- ou extra-prothétiques, sont le problème le plus fréquent.
Nettoyage
Les prothèses phonatoires ont besoin d'être régulièrement nettoyées des restes d’aliments, mucus et des champignons et bactéries qui se trouvent naturellement dans l'œsophage. Des attaques fongiques autour de la valve diminuent sa fonction de protection23.
- Brosses
L'intérieur des prothèses est normalement nettoyé avec une brosse24 pour éliminer les restes d’aliments et le mucus.
- Rincer
Une autre méthode est le nettoyage par de l'eau ou par de l'air25. La combinaision de ces méthodes est le choix optimal.
Durée de vie des prothèses phonatoires
La durée de vie des prothèses phonatoires (de quelques semaines à deux années) dépend du modèle de prothèse mais aussi des circonstances de l'usage26, principalement le nettoyage et la nourriture du patient27, mais d'autres facteurs tels que la radiothérapie et le pyrosis entrent également en ligne de compte28.
Voir aussi
Liens externes
Annotations
- La dénomination comme prothèsis n'est pas juste (parce que la prothèse ne parle) mais usuelle.
- Ce qui est une malformation normalement
- La plupart des distributeurs s'engagent aussi aux soins des patients (ce qui est bien lucratif).
- Provox est le nom des produits de Atos Medical.
- L'insertion et le renouvellement de cette sorte de prothèses demandent une qualification médicale (orthophoniste ou médecin).
- Blom-Singer est le nom des produits de InHealth.
- La collerette à côté de l'œsophage doit être pliée pour la mise en place.
- Parfois toute la prothèse est radio-opaque.
- La forme de la valve est un détail variant.
Références
- (en) « UltraVoice - Traditional Options Comparison With UltraVoice Plus » [archive] (consulté le )
- (de) « Prothetische Stimmrehabilitation nach totaler Kehlkopfentfernung - eine historische Abhandlung seit Billroth (1873) » [archive] (consulté le )
- Fréour, Pauline, « Le premier larynx artificiel du monde est français », Le Figaro, (lire en ligne [archive], consulté le )
- (pl) E Mozolewski, « Surgical rehabilitation of voice and speech following laryngectomy », . Otolaryngol Pol, 26(6), Otolaryngol Pol, , p. 653–661
- (de) « Adeva® BigFlow » [archive du ] (consulté le )
- (en) « Dispositif de prothèse pour usage dans le rétablissement de la voix EP 0222509 A2 » [archive] (consulté le )
- (de) « Heimomed Phonax® Prothese » [archive du ] (consulté le )
- (en) « SYSTEME ECH HEIMOMED » [archive] (consulté le )
- https://www.atosmedical.fr/ [archive]
- (en) FJ Hilgers, « A new low-resistance, self-retaining prosthesis (Provox) for voice rehabilitation after total laryngectomy », Laryngoscope, vol. 100, no 11, , p. 1202–1207 (PMID 2233085, DOI 10.1288/00005537-199011000-00014)
- (en) FJ Hilgers, « Development and clinical evaluation of a second-generation voice prosthesis (Provox 2), designed for anterograde and retrograde insertion », Acta Otolaryngol, vol. 117, no 6, , p. 889–896 (PMID 9442833, DOI 10.3109/00016489709114220)
- (en) FJ., Hilgers, « A new problem-solving indwelling voice prosthesis, eliminating the need for frequent Candida- and "underpressure"-related replacements: Provox ActiValve », Acta Otolaryngol, vol. 123, no 8, , p. 972–979 (PMID 14606602, DOI 10.1080/00016480310015371)
- (en) K Hancock, « First clinical experience with a new non-indwelling voice prosthesis (Provox NID) for voice rehabilitation after total laryngectomy », Acta Otolaryngol, vol. 125, no 9, , p. 981–990 (PMID 16109676, DOI 10.1080/00016480510043486)
- (en) FJ Hilgers, « Clinical phase I/feasibility study of the next generation indwelling Provox voice prosthesis (Provox Vega) », Acta Otolaryngol, vol. 130, no 4, , p. 511–519
- (en) FJ. Hilgers, « Prospective clinical phase II study of two new indwelling voice prostheses (Provox Vega 22.5 and 20 Fr) and a novel anterograde insertion device (Provox Smart Inserter) », Laryngoscope, vol. 120, no 6, , p. 1135–1143 (PMID 20513030, DOI 10.1002/lary.20925)
- (en) EC Ward, « Perceptual characteristics of tracheoesophageal speech production using the new indwelling Provox Vega voice prosthesis: a randomized controlled crossover trial », Head Neck, vol. 33, no 1, , p. 13– 19 (PMID 20848411, DOI 10.1002/hed.21389)
- https://www.inhealthgroup.com/about [archive]
- (en) P Kress, « Measurement and comparison of in vitro air-flow characteristics of the most frequently used European indwelling voice prostheses types », 6th European Congress of oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, June 30 - July 4, 2007, Vienna, Austria,
- (de) « Provox® NID Einsatzverfahren » [archive du ] (consulté le )
- (en) FJ Hilgers, Ackerstaff AH et van RM, « Clinical phase I/feasibility study of the next generation indwelling Provox voice prosthesis (Provox Vega) », Acta Otolaryngol,
- (de) « Einfluss von Silber auf die Vitalität von Biofilmen klinisch relevanter Bakterien » [archive] (consulté le )
- (de) « Silber ist doch kein gut verträglicher Bakterienkiller. » [archive] (consulté le )
- (en) R Van Weissenbruch, Albers FW, Bouckaert S, HJ Nelis, G Criel, JP Remon et AM Sulter, « Deterioration of the Provox silicone tracheoesophageal voice prosthesis: microbial aspects and structural changes », Acta Otolaryngol, vol. 117, no 3, , p. 452–458 (PMID 9199534, DOI 10.3109/00016489709113420)
- (en) « Provox® Brush » [archive] (consulté le )
- (en) RH Free, « Influence of the Provox Flush, blowing and imitated coughing on voice prosthetic biofilms in vitro », Acta Otolaryngol, vol. 123, no 4, , p. 547–551 (PMID 12797592, DOI 10.1080/0036554021000028118)
- (en) FJ Hilgers et Balm AJ, « Long-term results of vocal rehabilitation after total laryngectomy with the low-resistance, indwelling Provox voice prosthesis system », Clin Otolaryngol, vol. 18, no 6, , p. 517–523 (PMID 8877233, DOI 10.1111/j.1365-2273.1993.tb00627.x)
- (en) LQ Schwandt, van WR, Van der Mei HC, Busscher HJ et Albers FW, « Effect of dairy products on the lifetime of Provox2 voice prostheses in vitro and in vivo », Head Neck, vol. 27, no 6, , p. 471–477 (PMID 15825199, DOI 10.1002/hed.20180)
- (en) P Boscolo-Rizzo, Marchiori C, Gava A et Da Mosto MC, « The impact of radiotherapy and GERD on in situ lifetime of indwelling voice prostheses », Eur Arch Otorhinolaryngol, vol. 265, no 7, , p. 791–796 (PMID 18008081, DOI 10.1007/s00405-007-0536-1)
Sur les autres projets Wikimedia :
 Portail du handicap
Portail du handicap  Portail de la médecine
Portail de la médecine -
Hydroxychloroquine
Wikipédia ne donne pas de conseils médicaux ou sanitaires. Cet article est susceptible de contenir des informations obsolètes ou inexactes. Seul un professionnel de la santé est apte à vous fournir un avis médical, et seules les autorités sanitaires de votre pays sont compétentes pour donner des consignes de santé publique relatives à la pandémie de Covid-19.
Pour les articles homonymes, voir HCQ.
| Hydroxychloroquine |
 |
 |
| structure canonique de l'hydroxychloroquine (en haut) et animation de la structure de la (R)-hydroxychloroquine (en bas) |
| Identification |
|---|
| Nom UICPA |
(RS)-2-[{4-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]pentyl}(éthyl)amino]éthanol |
|---|
| No CAS |
118-42-3 (R/S) |
|---|
| No ECHA |
100.003.864 |
|---|
| Code ATC |
P01BA02 |
|---|
| DrugBank |
DB01611 |
|---|
| PubChem |
3652 |
|---|
| ChEBI |
5801 |
|---|
| SMILES |
|
|---|
| InChI |
|
|---|
| Propriétés chimiques |
|---|
| Formule |
C18H26ClN3O [Isomères] |
|---|
| Masse molaire1 |
335,872 ± 0,019 g/mol
C 64,37 %, H 7,8 %, Cl 10,56 %, N 12,51 %, O 4,76 %, 335,18 unité de masse atomique unifiée |
|---|
| Données pharmacocinétiques |
|---|
| Métabolisme |
rénal |
|---|
| Demi-vie d’élim. |
1 à 2 mois |
|---|
| Excrétion |
urinaire
|
|---|
| Considérations thérapeutiques |
|---|
| Voie d’administration |
Orale |
|---|
| Grossesse |
D (Au), C (États-Unis) |
|---|
|
| Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. |
modifier  |
L’hydroxychloroquine (HCQ) est un médicament (commercialisé sous forme de sulfate d'hydroxychloroquine, par Sanofi sous les noms de marque Plaquenil/Quensyl/Plaquinol, et d'autres producteurs sous le nom d'Axemal et Dolquine) indiqué en rhumatologie dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et du lupus érythémateux disséminé pour ses propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices2. Elle est inscrite sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS. En 2020, cette molécule est également le sujet de recherches dans le contexte de la lutte contre le coronavirus SARS-CoV-2.
Histoire
Les propriétés fébrifuges et antipaludéennes de l'écorce amère de l'arbuste quinquina originaire d'Amérique du Sud sont connues en Europe au XVIIe siècle. En 1820 les pharmaciens français Caventou et Pelletier isolent l'amer ou alcaloïde qui en est le principe actif, auquel ils donnent le nom de quinine. En 1934, un chimiste allemand, Hans Andersag, synthétise la chloroquine, un dérivé de la quinoléine, le noyau aromatique de la quinine.
Dans les années 1960, en raison de leurs propriétés anti-inflammatoires, la chloroquine et l'hydroxychloroquine sont prescrites, notamment en rhumatologie.
Très utilisées à titre préventif par les voyageurs, les fonctionnaires et les soldats qui se rendent dans des pays où sévit le paludisme et certaines infections tropicales, la quinine était consommée couramment dans des sodas « à base d'écorce amère de quinquina » comme la version primitive de l'Indian Tonic de Schweppes.
En 2020, en raison de propriétés anti-virales in vitro, l'intérêt de l'hydroxychloroquine est étudié, notamment chez les patients en début d'infection par le coronavirus SARS-CoV-2.
La chloroquine et l'hydroxychloroquine sont commercialisées en France sous forme de sulfates, respectivement sous les marques Nivaquine et Plaquenil.
L'hydroxychloroquine était délivrée sans ordonnance jusqu'en janvier 20203.
Caractéristiques physico-chimiques
L'hydroxychloroquine est chimiquement apparentée à deux autres antipaludéens : la quinacrine et la chloroquine. Elle partage avec cette dernière une structure de type 4-amino-quinoléine et ne diffère que par un groupe hydroxyle (OH) en bout de chaîne. Elle se présente également sous la forme de deux énantiomères car elle est chirale. En effet, l'atome de carbone en α de l'amine et qui porte un substituant méthyle est asymétrique, comme dans la chloroquine. Les différences dans les propriétés pharmacologiques de chaque énantiomère de l'hydroxychloroquine sont vraisemblablement du même ordre que celles observées avec la chloroquine.
Le sulfate d'hydroxychloroquine est une poudre cristalline blanche blanchâtre, soluble dans l'eau, presque insoluble dans l'alcool, le chloroforme et l'éther4.
Pharmacocinétique et métabolisation
L'hydroxychloroquine a une pharmacocinétique proche de celle de la chloroquine : absorption gastro-intestinale rapide, élimination par les reins. Une fois dans le tractus digestif, la molécule passe facilement dans le sang pour atteindre son taux plasmatique maximal en 1 à 2 heures (taux qui persistera en raison d'une forte liaison aux protéines plasmatiques)5. La molécule a ensuite un tropisme marqué pour le foie et le rein, et moindrement l'œil. Elle passe la barrière placentaire (« les concentrations sanguines chez le fœtus sont similaires aux concentrations sanguines maternelles »5 (on la retrouve aussi en faible quantité dans le lait maternel)5.
Métabolisation : la molécule est directement (mais très lentement) éliminée par le rein ou préalablement métabolisée par alkylation et glycuroconjugaison en N-déséthyl-hydroxychloroquine grâce à des enzymes du cytochrome P450 (CYP2D6, 2C8, 3A4 et 3A5)6,7.
Indications en clinique
Paludisme
Initialement utilisé dès 19558 dans le traitement du paludisme, il ne l'est plus aujourd'hui en raison du développement de résistances chez le Plasmodium, parasite responsable du paludisme.
L'hydroxychloroquine était initialement utilisée9 comme une alternative moins toxique à la chloroquine, sans être efficace contre les formes latentes de Plasmodium vivax et Plasmodium ovale (dites « hypnozoïtes » : causes de rechutes tardives). En 2020, elle n'est plus recommandée pour la prévention ou prise en charge du paludisme dans le Sahel par l'OMS10,11, ni pour le « paludisme d’importation » en France par la Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF) (2017)12, et ne figure plus pour cet usage dans la Base de données française des médicaments5. Son usage comme antipaludéen est parfois remplacé au profit notamment de composés contenant entre autres de l'artémisinine (avec certaines restrictions13,14,15) ou de la méfloquine (malgré certains effets indésirables}, mais elle est encore le traitement de choix dans d'autres pays d'Europe, par exemple pour le paludisme non compliqué importé en Norvège16 et elle reste en 2020 (de même que la chloroquine) approuvés par la FDA « pour prévenir et traiter certains types de paludisme » (paludisme non compliqué dû à P. falciparum, P. malariae, P. ovale et P. vivax) dans les zones géographiques où la résistance à la chloroquine n'est pas signalée. Le NIH recommande aux médecins de consulter le site Web du CDC sur la malaria17 avant de prescrire ce médicament pour le traitement ou la prophylaxie du paludisme.
Rhumatologie
Dans le lupus érythémateux disséminé (ou systémique) elle permet de maintenir la rémission et améliore les manifestations cutanées, articulaires et autres18. L'hydroxychloroquine réduit la morbidité néonatale chez les femmes atteintes de lupus érythémateux disséminé (moins de bébés prématurés et anormalement petits)19, comme immunomodulateur, à des doses plus élevées (200–400 mg/j) que contre le paludisme20. Les autres indications en rhumatologie incluent :
Mais aussi les troubles articulaires infectieux :
L'hydroxychloroquine a un effet immunomodulateur étudié depuis les années 196021 ; elle augmente22 le pH lysosomial dans les cellules présentatrices d'antigène. En conditions inflammatoires, elle bloque les récepteurs de type Toll des cellules dendritiques plasmacytoïdes. Les récepteurs de type Toll 9 conduisent à la production d'interféron et poussent les cellules dendritiques à mûrir et à présenter des antigènes aux lymphocytes T. L'hydroxychloroquine, en diminuant les signaux des récepteurs de type Toll, réduit l'activation des cellules dendritiques et le processus inflammatoire. Dans un modèle murin (rat) d'arthrite, cette molécule testée comme immunomodulateur a aussi eu un effet antioxydant. Et pour les neutrophiles humains, elle semble réduire la concentration d'oxydants externes tout en diminuant la phosphorylation de la protéine kinase C, ce qui pourrait être l'une des explications de son effet anti-inflammatoire encore mal compris23.
Dermatologie
L'hydroxychloroquine est indiquée en prévention des lucites (une forme d'allergie solaire)24.
Législation
L'hydroxychloroquine est inscrite sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS pour son utilisation en rhumatologie25.
En France, l'hydroxychloroquine est classée substance vénéneuse sous toutes ses formes depuis l'arrêté du signé par le Directeur Général de la Santé Jérôme Salomon. Le 8 octobre 2019 l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) demande un avis à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) qui rend son avis en date le 26. Il rejoint l'avis de l'ANSM et porte l'hydroxychloroquine sur la liste II des substances vénéneuses (médicaments comprenant des substances toxiques)27.
La molécule est aussi utilisée en médecine vétérinaire, notamment pour les chiens28,29,30. En France, « Cette substance active n’entre pas dans la composition de médicaments vétérinaires autorisés, son classement est donc sans impact en médecine vétérinaire31. »
Contre-indications, interactions, effets secondaires
L'étiquetage du médicament mentionne notamment que l'hydroxychloroquine ne doit pas être prescrite aux personnes présentant une hypersensibilité connue aux composés de la 4-amino-quinoléine18. D'autres contre-indications existent32 :
Des médicaments interagissant négativement avec l'hydroxychloroquine sont déconseillés, à éviter ou à doser différemment, dont :
Effets indésirables et toxicité
L'hydroxychloroquine est un médicament à marge thérapeutique étroite (hautement toxique en cas de surdose)33. À dose égale et à propriétés pharmacologiques comparables, elle est cependant réputée 2 à 3 fois moins toxique que la chloroquine (selon le modèle animal)36,37,38, mais avec des conséquences semblables en termes d’organes ou fonctions physiologiques affectés. Certaines sont expliquées depuis les années 194039 et d'autres encore mal comprises. « Non toxique, le Plaquenil a des effets secondaires tout à fait supportables, même pour les patients fragiles et âgés » explique Guillaume Robert de l'INSERM [1] [archive]. Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur la base des effets secondaires de la chloroquine rapportés, comparés aux données de ventes (3 987 854 boîtes de trente comprimés dosés à 200 mg vendues en France entre le et le , les données de pharmacovigilance rapportent sur la période (72 mois) 312 cas signalés pour « au moins un effet indésirable », soit moins de 0,01 %. Sur ces 312 cas d'effets indésirables signalés, 21 (6,7 %) sont des effets cardiovasculaires dont quatre cas d’insuffisance cardiaque, huit cas de cardiomyopathie, huit cas de troubles du rythme au sens large et un cas d'hypertension pulmonaire. Deux cas sont des décès (dont un par intoxication médicamenteuse chez un sujet prenant en outre six psychotropes40).
Le surdosage est la première cause de problèmes graves ; et comme la molécule est très vite absorbée, les symptômes peuvent survenir dès trente minutes après ingestion : effets visuels et auditifs, gastro-intestinaux, cutanés, cérébraux (somnolence, céphalée) et neuromusculaires (convulsions), sanguins et cardiovasculaires (arythmie, insuffisance cardiaque, etc.), difficultés respiratoires, etc.
Les posologies non-antipaludéennes conduisent souvent à un cumul de doses susceptibles de déclencher une toxicose médicamenteuse41. Outre cette dose cumulée, les facteurs de risques sont :
- l’obésité,
- être enfant42,
- avoir plus de 60 ans,
- avoir une maladie rétinienne,
- prendre des médicaments interagissant négativement avec l’hydroxychloroquine (tamoxifène notamment43),
- souffrir d'insuffisance rénale ou hépatique (insuffisance causant une accumulation d'hydroxychloroquine dans les tissus, ce qui équivaut à un surdosage)44.
Les mécanismes en sont pour partie mal compris, mais pourraient notamment être liés à des métabolites sources d’espèces réactives de l'oxygène45. Des protocoles de soins sont décrits par la littérature médicale46,47.
| Effets toxicologiques | Descriptions des effets de l’hydroxychloroquine
(ou de ses dérivés, sulphate, phosphate) |
|---|
| Mort par empoisonnement |
L’hydroxychloroquine est moins toxique que la chloroquine, ou que la quinine, mais elle est une des premières causes d'empoisonnement par les antipaludéens ;
- une seule surdose importante peut être mortelle48 ; elle est parfois utilisée pour des suicides49, en particulier en Afrique et en France ;
|
| Cardiotoxicité |
Le traitement (aigu ou chronique) a fréquemment des effets cardiovasculaires potentiellement graves (faisant alors généralement à la suite d'un surdosage) ; comme pour la chloroquine, ils incluent :
- des cardiomyopathies (parfois mortelles)50 avec souvent une hypertrophie, physiologie restrictive et insuffisance cardiaque congestive, parfois irréversibles ; les signes et symptômes de cardiomyopathie devraient être suivis lors du traitement, dont via outils tels que l'ECG18 ;
- l'allongement de l'intervalle QT51, Torsades de pointe, arythmies ventriculaires, un syndrome tachycardie-bradycardie ou complications cardiaques ; des troubles de la conduction (bloc de branche) du faisceau auriculo-ventriculaire, droit ou gauche et/ou le bloc auriculo-ventriculaire induisant des syncopes ; la toxicité chronique de la molécule doit être prise en compte lors du diagnostic de troubles de la conduction (bloc ramifié / bloc cardiaque auriculo-ventriculaire) ou d'hypertrophie biventriculaire18. Selon le fabricant, si une cardiotoxicité est suspectée, l'arrêt rapide du médicament peut prévenir des complications potentiellement mortelles18. Le médicament ne doit donc pas être administré avec d'autres médicaments susceptibles de modifier l'intervalle QT.
|
| Neurotoxicité |
L'hydroxychloroquine affecte le système nerveux, avec :
- de possibles neuropathies proximales ou des muscles squelettiques impliquant « une faiblesse progressive et une atrophie des groupes musculaires proximaux »18 ;
- une « dégradation des réflexes tendineux » ; les patients suivant un traitement chronique doivent faire périodiquement évaluer leurs réflexes tendineux profonds18 ;
- une « conduction nerveuse anormale » ; « Les biopsies nerveuses ont été associées à des corps curvilignes et à une atrophie des fibres musculaires avec des changements vacuolaires »18 ;
- des effets psychiatriques mineurs (labilité, nervosité) ; et moins fréquemment des épisodes psychotiques et neuropsychiatriques sont éventuellement possibles52, avec des éventuels comportements suicidaires (rarement, comme pour la chloroquine53). Typiquement, la psychose peut survenir « chez un malade sans antécédents psychiatriques » avec « manifestations à type de délire, hallucinations, épisode maniaque, ou dépression, après un délai de quelques heures à quarante jours, cédant en moyenne une semaine après l’arrêt des antipaludéens de synthèse. Il n’y a pas de relation entre la dose d’antipaludéens de synthèse administrée et la survenue de troubles psychiatriques. Les mécanismes de survenue sont inconnus ; il semble s’agir d’une réaction idiosyncrasique »54. Une revue d'étude récente (mi-2018) a identifié comme facteurs de risques la « co-exposition à des médicaments en interaction, la consommation d'alcool, les antécédents familiaux de maladies psychiatriques, le sexe féminin et l'utilisation concomitante de glucocorticoïdes à faible dose »55 ; ces facteurs peuvent « précipiter une psychose induite par l'hydroxychloroquine »55. Ce risque peut être atténué par une détection précoce « Dans certains cas, il a été possible d'inverser le comportement psychotique avec le traitement antipsychotique ou avec la suspension de l'hydroxychloroquine »55. Le , l'ANSM publie un avertissement concernant des troubles neuropsychiatriques causés par l'hydroxychloroquine utilisée comme traitement contre la Covid-19 (psychoses et tentatives de suicide), symptômes peut-être aggravés par le confinement et le contexte anxiogène de la pandémie56.
- un syndrome de mouvements involontaires (jusqu’aux convulsions) qui n’est a priori induit qu'en cas de surdosage ;
- la neuromyopathie (rare mais grave), résultant a priori d'années de bioacccumulation de la molécule. Elle peut être proximales ou concerner les muscles squelettiques, avec « faiblesse progressive et une atrophie des groupes musculaires proximaux, des réflexes tendineux déprimés et une conduction nerveuse anormale ». La biopsie montre une atrophie des fibres musculaires et des changements vacuolaires18 ;
|
| Néphrotoxicité |
L'administration chronique d'hydroxychloroquine au rat affecte la morphologie et la fonction des cellules rénales, pouvant induire (même à court terme) des nécroses cellulaires (mais moins que dans le cas de la chloroquine : 70 % des rats traités à la chloroquine développent une fibrose tissulaire intersticielle, contre seulement 20 % du groupe traité à l’hydroxychloroquine)38. |
| Hépatotoxicité |
Le foie accumule l'hydroxychloroquine ;
Ces derniers deviennent anormalement nombreux et gros ; et sont surchargés par du matériel non-digestible57.
- Selon Zhao et al. en 2005, la membrane des lysosomes semble aussi se fragiliser en présence de chloroquine58 ;
- un risque (rare) d'hépatite fulminante existe5.
|
Toxicité oculaire
Rétinopathie… |
La toxicité oculaire de l'hydroxychloroquine concerne deux zones distinctes du globe oculaire :
1) la cornée : des dépôts peuvent s’y former en générant des kératopathies vortex ou verticillates cornéennes. Ces « dépôts cornéens », selon Stokkermans (2019) résultent d'une liaison entre chloroquine et des lipides des cellules de l'épithélium basal de la cornée59. Ils causent des halos et reflets qui parasitent la vision.
En outre le cristallin peut partiellement s'opacifier et le corps ciliaire fonctionne mal ; Ces troubles sont sans rapport avec la posologie et généralement réversibles à l'arrêt de l’hydroxychloroquine ;
2) la macula : en cas de rétinopathie avancée, elle peut être irréversiblement dégradée (« Des lésions rétiniennes irréversibles ont été observées chez certains patients ayant reçu du sulfate d’hydroxychloroquine » précise la notice du Plaquenil18) :
- les cônes maculaires sont endommagés à l'extérieur de la fovéa ; des anomalies de pigmentation maculaire apparaissent ; une lésion maculaire en « œil de bœuf » (absente au début de l’atteinte) réduit progressivement de l'acuité visuelle (remarque : les personnes d'origine asiatique peuvent avoir la rétine qui se dégrade d'abord à l'extérieur de la macula ; il leur est recommandé de tester leur champ visuel dans les 24 degrés centraux au lieu des dix degrés centraux)18 ; en phase finale le disque optique devient anormalement pâle.
- des spicules osseux périphériques peuvent se former, avec une mauvaise vascularisation ;
- la vision nocturne se dégrade, de même que le champ visuel ; en cas d'utilisation chronique (5–7 ans ou plus) ou après des doses élevées si le traitement n'est pas stoppé ou adapté, le sujet peut perdre la vue60,61,62,63. La cause serait que l'activité des lysosomes de l'épithélium pigmentaire rétinien (RPE) est dégradée, ce qui inhibe la phagocytose des segments externes des photorécepteurs éliminés. S'ensuit une perte irréversible de photorécepteurs et une atrophie de cet épithélium64 ;
Facteurs de risque : ils varient selon les auteurs, mais le seuil posologique est généralement estimé de 5 à 6,5 mg/kg de poids corpore/jour de sulfate d'hydroxychloroquine, utilisé sur plus de cinq ans. Le risque augmente en cas de filtration glomérulaire subnormale, et de prise conjointe de citrate de tamoxifène (qui présente aussi une toxicité oculaire) ou si une maladie maculaire est concomitante au traitement18.
(voir détail plus bas dans l'article) ;
Dépistage : il doit être initial en cas de traitement long, puis annuel après cinq ans d'utilisation.
(voir détail plus bas dans l'article).
Chez des patients âgés, pour des traitements non antipaludéens, la posologie recommandée suffit parfois à induire une toxicité oculaire65 ;
|
| Troubles digestifs |
Les troubles digestifs sont le symptôme le plus courant (même à court terme), avec pour un traitement antipaludéens : de légères nausées, des crampes d'estomac occasionnelles accompagnées d'une légère diarrhée42, des crampes une diminution de l’appétit, allant éventuellement jusqu'aux vomissements et à l’anorexie42.
- hypoglycémie, parfois grave et pouvant alors entrainer une perte de conscience et la mise en danger la vie chez les patients « traités avec ou sans médicaments antidiabétiques » ; les patients « doivent être avertis du risque d'hypoglycémie et des signes et symptômes cliniques associés. Les patients présentant des symptômes cliniques suggérant une hypoglycémie pendant le traitement doivent faire vérifier leur glycémie et revoir le traitement si nécessaire »18,5.
|
| Allergies (et autres effets cutanés) |
C'est le trouble le plus fréquent après les troubles digestifs. Comme la quinine ou la chloroquine, même à faible dose, l’hydroxychloroquine peut induire (dans les 2 à 33 jours après la première prise)66 :
- démangeaisons, éruptions cutanées (de type exanthèmes maculopapulaires) et (chez certains patients traités pour un lupus) prurit aquagénique, parfois associé à une urticaire aquagénique, généralisé, apparaissant quelques minutes après un contact avec l'eau (chaude ou froide) ; d'abord très intense durant dix minutes environ puis disparaissant en quelques heures ; le prurit aquagénique apparaissant de une à trois semaines après le début du traitement67 ; en début de traitement, un érythème généralisé fébrile associé à des pustules suggère une pustulose exanthématique aiguë généralisée qui en France « impose l’arrêt du traitement et contre-indique toute nouvelle administration »5 ;
- photosensibilisation ;
- acné ;
- changements de couleur de la peau (pâleur due à l’anémie et/ou hyperpigmentation localement ardoisée, en cas de traitement chronique (par exemple d'un lupus ou d'une polyarthrite rhumatoïde) après une durée médiane de traitement de 6,1 ans et une dose cumulée de 720 g68) et/ou changement de couleur des cheveux) avec parfois desquamation, cloques dans la bouche et autour des yeux42 (comme pour le traitement à la chloroquine69) ;
- perte de cheveux (plus courantes chez les noirs africains (70 % des cas) moins fréquentes avec les autres type de peau70 ;
- éosinophilie rarement, ou autres symptômes systémiques66 ;
- le risque d'allergies et leur intensité augmentent avec la charge parasitaire paludisme et/ou avec l’âge ; et il croît en période de fièvre paludéenne ;
- angio-œdème et bronchospasme5 ;
- une base génétique pourrait être liée au fait que la chloroquine se lie aux récepteurs opiacés de manière centrale ou périphérique ;
- le psoriasis et la porphyrie sont parfois fortement exacerbés par cette molécule42 qui ne devrait pas être utilisé chez ces patients « sauf si, de l'avis du médecin, le bénéfice pour le patient l'emporte sur le danger éventuel » d’après la notice du médicament18.
Nota : divers protocoles de désensibilisation prolongée aux allergies à l'hydroxychloroquine ont été proposés66 ; ils durent 4 à 36 jours et visent plutôt des allergies légères à modérées, un cas de désensibilisation accélérée en cinq heures, sous surveillance médicale, a été décrit66. Un autre, deux étapes et via des prises orales, s'est montré efficace chez douze de treize patients l'ayant testé71. Ils peuvent améliorer la qualité de vie des patients modérément allergiques et réduire les non-observances du traitement pour cause d'allergie72,71.
|
| Toxicité cellulaire |
La chloroquine se réparti dans tout le corps mais cible particulièrement certaines cellules (de l’œil, dans la rétine et la cornée) ou elle se concentre dans le foie ou le rein chargés de détoxiquer l'organisme42. |
| Ototoxicité |
Le risque de troubles de l'audition augmente (comme sous chloroquine), avec principalement des acouphènes42 et des vertiges voire une surdité5. |
| Génotoxicité, cancérogénicité |
« La chloroquine est (en France) inscrite sur la liste II des substances vénéneuses […] par arrêté du . »
Selon la Base française de données publique du médicament73 (version ), « Les données disponibles sur la génotoxicité de l’hydroxychloroquine sont limitées, par conséquent les données de la chloroquine ont été prises en compte en raison de la similitude de structure et des propriétés pharmacologiques des deux molécules. Les données issues de la littérature ont montré un potentiel génotoxique de la chloroquine in vitro et in vivo. Aucune étude pertinente de cancérogénicité n’a été fournie pour l’hydroxychloroquine ou la chloroquine. Chez l’Homme, les données sont insuffisantes pour écarter un risque augmenté de cancer chez les patients recevant un traitement au long cours »5 ;
|
| Reprotoxicité |
Elle est encore discutée. En France, selon la fiche Plaquenil de la base de données publique du médicament (version ) « en raison du potentiel génotoxique de la chloroquine, les hommes et les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et jusqu’à huit mois après l’arrêt du traitement ». De même, la chloroquine ne doit pas être utilisée pendant la grossesse »5. |
Toxicité oculaire
Doses toxiques pour l'homme
La dose toxique pour l'homme est de 400 mg/j (ou 6,5 mg/kg de poids corporel idéal) en traitement long44, c'est-à-dire après cinq ans, ou à la suite d'une dose cumulée d'un kilogramme74 était considéré comme la dose sûre en termes de toxicité oculaire pour un adulte moyen, mais il est apparu que la toxicité de l'hydroxychloroquine n’est pas dose-dépendante mais plutôt liée à la dose cumulée totale, et à la durée du traitement74. Selon le modèle animal, toutes les couches de la rétine sont endommagées, mais les cônes et bâtonnets le sont le plus75.
Des preuves récentes plaident pour une toxicité rétinienne plus élevée qu’on le pensait. La prévalence d'effets toxiques rétiniens serait en moyenne en Corée du Sud de 2,9 % pour les traitements rhumatologiques76, mais de 7,5 % au Royaume-Uni pour les traitements non paludéens de long terme, et selon la dose cumulée, elle y augmente de 20 à 50 % après vingt ans de traitement (étude basée sur 2 361 patients). Au Royaume-Uni, le Royal College of Opthalmologists a produit un formulaire de référence récent et des lignes directrices (depuis 2018) aidant les médecins à identifier les patients à haut risque et nécessitant un dépistage rétinien approfondi77. La dose est à ajuster au poids du patient78, à partir d'algorithmes ad hoc et de calculateurs [archive]44,78, mais selon l'algorithme, les résultats diffèrent ; les femmes, moins lourdes que les hommes, sont exposées au surdosage (vers 2010, 16 % à 98 % d'entre elles étaient dans la plage toxique et 12 %–56 % des patients des États-Unis étaient surdosés)79,80,81,44.
Remarque : certaines cellules de l’œil concentrent la molécule ; y compris in utero (si la mère est traitée par de la chloroquine)82,83.
Prévention, dépistage des effets secondaires
Le dépistage porte sur la qualité de la vision (vision floue, difficulté à concentrer le regard) et du champ visuel84,85. Dès qu'une anomalie rétinienne est détectée, un examen ophtalmologique approfondi est recommandé18. L'examen annuel doit inclure BCVA, VF et SD- OCT (et l'électrorétinogramme multifocal (mfERG), la tomographie à cohérence optique dans le domaine spectral (SD-OCT) ainsi que l'autofluorescence du fond d'œil (FAF), peuvent être plus précis que la simple évaluation des champs visuels78). « Les tests de grille Amsler ne sont plus recommandés. Les examens du fond d'œil sont conseillés pour la documentation, mais la « maculopathie à œil de bœuf » visible est un changement tardif, et l'objectif du dépistage est de reconnaître la toxicité à un stade plus précoce »78. Pour les autres patients, ce rythme d’examen peut commencer après cinq ans de traitement18. L'hydroxychloroquine ayant une « demi-vie particulièrement longue »86, notamment dans l’œil, même après un arrêt du traitement justifié par une toxicité oculaire « le patient doit être étroitement surveillé étant donné que les modifications de la rétine (et les troubles visuels) peuvent progresser même après l'arrêt du traitement ». Les recommandations de l'American Academy of Ophthalmology pour le dépistage de la rétinopathie à la chloroquine (CQ) et à l'hydroxychloroquine (HCQ) ont été publiées en 2002 les outils et connaissances ont évolué depuis, mais en 2020 selon cette académie : « Aucun traitement n'existe encore pour ce trouble […] Les patients doivent être conscients du risque de toxicité et de la justification du dépistage (pour détecter les changements précoces et minimiser la perte visuelle, pas nécessairement pour l'éviter). Les médicaments doivent être arrêtés si possible lorsque la toxicité est reconnue ou fortement suspectée, mais il s'agit d'une décision à prendre en collaboration avec les patients et leurs médecins »78.
Traitement du surdosage ou de l'intoxication par hydroxychloroquine
Tout surdosage en amino-4-quinoléine est grave, notamment chez les nourrissons (chez qui 1 à 2 g suffisent parfois à provoquer la mort)5.
Une intoxication avérée par hydroxychloroquine impose une prise en charge pré-hospitalière urgente (SAMU ou autre service mobile d’urgence). Avant l'arrivée d'une ambulance, une perfusion IV avec une solution de remplissage peut être posée. À partir de 4 g supposés ingérés ou en cas d'hypotension (et/ou de signes ECG), les mesures préconisées sont l'injection d'adrénaline (0,25 µg kg−1 min−1) ; l'intubation et ventilation assistée ; le diazépam (2 mg/kg en 30 min, puis 2 à 4 mg/kg par 24 heures). Une suspicion d'intoxication exige aussi une hospitalisation (quelle que soit la quantité estimée ingérée)5.
En cas d’intoxication, ni l’acidification des urines, ni l’hémodialyse, ni la dialyse péritonéale ni même l'exsanguinotransfusion n’apportent de bénéfice (l'hémodialyse n'élimine que très lentement l’hydroxychloroquine ; la clairance de dialyse représente 15 % de la clairance totale)5.
Production
Fin 2020 (20 décembre), l'usine de Taoyuan de la SCI Pharmtech, l'un des premiers producteurs de précurseurs de médicaments, et en particulier de sulphate d'hydroxychloroquine à Taiwan a connu une explosion et un grave incendie (un mort et un blessé) ; il a fallu 45 h pour maitriser le feu qui s'était étendu à 5 autres usines de la zone industrielle. Il n'y a pas de risque de pénurie d'hydroxychloroquine grâce à d'autres usines fabricant aussi ce produit87.
Utilisation contre la Covid-19
L'utilisation de l'hydroxychloroquine contre la Covid-19 est suggérée début 2020 par le compte-rendu d'une réunion d'officiels chinois, puis par l'infectiologue français Didier Raoult (en association à l'azithromycine), ce qui a conduit à son autorisation temporaire à titre dérogatoire dans plusieurs pays et à son utilisation courante dans plusieurs autres pays, notamment en Afrique, en Inde et en Grèce, pays producteurs de la molécule88.
En avril 2020, l'ancien ministre de la santé Philippe Douste-Blazy et l'urgentiste Patrick Pelloux demandent au gouvernement d'ouvrir la délivrance du médicament à plus de patients atteints du coronavirus, en modifiant « en urgence » le décret qui le réserve aux cas les plus graves89.
Elle est ensuite écartée dans le cadre des soins d'urgence par certains pays, notamment le 15 juin par la FDA aux États-Unis90, le 26 juin par la Corée du Sud91, ainsi que par l'OMS92 à la suite d'une série de résultats négatifs ou non probants de différentes études93 et essais cliniques94,95. L'OMS précise cependant, à l'époque, que les études visant les patients non hospitalisés, ou la prise d'hydroxychloroquine en prévention, ne sont pas interrompues96 mais en mars 2021 elle déconseille vivement l’hydroxychloroquine comme traitement préventif : « Des recherches ont permis de démontrer avec certitude que l’hydroxychloroquine n’a pas d’effet significatif sur le risque de décès ou d’admission à l’hôpital, tandis que d’autres recherches ont montré que l’hydroxychloroquine n’a pas d’effet sur le nombre de cas de Covid-19 rapportés positifs confirmés par les laboratoires et qu’elle augmente probablement le risque d’effets indésirables » 97 .
L'hydroxychloroquine n'ayant pas une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour la Covid-19, la prescription hors AMM (off-label) par ordonnance est possible au cas par cas sous la responsabilité du médecin avec obligation d'information du patient98.
Essais et études
- 5 octobre 2020 : l'essai britannique Recovery montre l'absence d'effet bénéfique de l'hydroxychloroquine chez les patients déjà hospitalisés99,100.
- 16 octobre 2020 : l'essai international Solidarity confirme l'inefficacité de l'hydroxychloroquine également chez les patients hospitalisés101,102.
- l'essai français Covidoc, censé tester la combinaison hydroxychloroquine / azithromycine, est interrompu en 2020 sans avoir démontré le bénéfice du traitement103.
- 5 avril 2021 : une étude montre par méta-analyse sur 10 ans d'observations, que les traitements avec la chloroquine et l'hydroxychloroquine sont sûrs et qu'il n'y a pas de risques cardiaques avérés, quelques rares arythmies ventriculaires et infarctus du myocarde remarqués sur des patients hospitalisés pour Covid-19 étant dus à l'application de doses plus élevées que les doses habituelles, l'étude concluant qu'il faut éviter de recourir à de telles prescriptions104. Cette méta-étude ne porte pas sur l'efficacité des traitements contre le covid en elle-même.
Théories conspirationnistes
Les débats sur l'hydroxychloroquine inspirent plusieurs théories du complot105. Paradoxalement, alors que cette molécule est produite et distribuée par les industries pharmaceutiques (ce qui pourrait nourrir la théorie du complot de Big Pharma) et qu'elle est préconisée par Didier Raoult, elle n'est pas associée aux théories conspirationnistes mais aux discours antisystème ciblant notamment ces industries106.
Notes et références
- Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 » [archive], sur www.chem.qmul.ac.uk.
- Académie de pharmacie, « Hydroxychloroquine (sulfate de) — acadpharm » [archive], sur dictionnaire.acadpharm.org, (consulté le ).
- VIDAL, « VIDAL - PLAQUENIL (hydroxychloroquine) : la prescription médicale devient obligatoire - Actualités » [archive], sur https://www.vidal.fr [archive], 2020-15-01 (consulté le ).
- (en) « DailyMed - PLAQUENIL- hydroxychloroquine sulfate tablet » [archive], sur dailymed.nlm.nih.gov (consulté le ).
- « Résumé des caractéristiques du produit - Plaquenil 200 mg, comprimé pelliculé - Base de données publique des médicaments » [archive], sur base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr (consulté le ).
- (en) S. Kalia et J. P. Dutz, « New concepts in antimalarial use and mode of action in dermatology », Dermatologic Therapy, vol. 20 (4), , p. 160–174 (PMID 17970883, DOI 10.1111/j.1529-8019.2007.00131.x)
- (en) Sunil Kalia et Jan P. Dutz, « New concepts in antimalarial use and mode of action in dermatology », Dermatologic Therapy, vol. 20, no 4, , p. 160–174 (ISSN 1396-0296, PMID 17970883, DOI 10.1111/j.1529-8019.2007.00131.x, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) D. J. Wallace, « The history of antimalarials », Lupus, vol. 5 Suppl 1, , S2–3 (ISSN 0961-2033, PMID 8803902, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) Miguel Nieto-Caicedo, « Hydroxychloroquine in the Treatment of Malaria », The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, vol. 5, no 4, , p. 681–685 (ISSN 0002-9637 et 1476-1645, DOI 10.4269/ajtmh.1956.5.681, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) Organisation mondiale de la santé, « WHO | Guidelines for the treatment of malaria. Third edition » [archive], sur who.int, (consulté le ), p. 317.
- Organisation mondiale de la santé, « Recommandation de politique générale de l’OMS : Chimioprévention du paludisme saisonnier pour lutter contre le paludisme à Plasmodium falciparum en zone de forte transmission saisonnière dans la sous région du Sahel en Afrique » [archive] [PDF], sur who.int, (consulté le ).
- SPILF, « Prise en charge et prévention du paludisme d’importation » [archive] [PDF], sur infectiologie.com, (consulté le ), p. 71.
- La promotion de l'Artémisia contre le paludisme inquiète l'OMS [archive]
- Etude de l’efficacité et de la tolérance d’une tisane à base de Artemisia annua L. (Asteraceae) cultivée au Bénin pour la prise en charge du paludisme simple [archive]
- Paludisme : des résistances à l’artémisine en Asie du Sud-Est [archive]
- (en) Solbakken M.J (2019) « Malaria in Myanmar-Causes, treatment, prevention and prognosis of malaria, and the occurrence in the endemic Myanmar and non-endemic Norway[PDF] [archive] » (Master's thesis ; Department of Community Medicine and Global Health, University of Oslo). Voir chap. 6.4 Diagnosis and treatment, p. 23.
- (en-US) « CDC - Parasites - Malaria » [archive], sur www.cdc.gov, (consulté le ).
- (en) Steere AC et Angelis SM, « Therapy for Lyme arthritis: strategies for the treatment of antibiotic-refractory arthritis », Arthritis Rheum., vol. 54, no 10, , p. 3079–3086 (PMID 17009226, DOI 10.1002/art.22131).
- (en) M Leroux, C Desveaux, M Parcevaux et B Julliac, « Impact of hydroxychloroquine on preterm delivery and intrauterine growth restriction in pregnant women with systemic lupus erythematosus: a descriptive cohort study », Lupus, vol. 24, no 13, , p. 1384–1391 (ISSN 0961-2033 et 1477-0962, DOI 10.1177/0961203315591027, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) Claire de Moreuil, Zarrin Alavi et Elisabeth Pasquier, « Hydroxychloroquine may be beneficial in preeclampsia and recurrent miscarriage », British Journal of Clinical Pharmacology, vol. 86, no 1, , p. 39–49 (ISSN 1365-2125, PMID 31633823, PMCID PMC6983516, DOI 10.1111/bcp.14131, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) Kalmanson, G. M., & Guze, L. B. (1965). Studies of the Effects of Hydroxychloroquine on Immune Responses. Journal of Laboratory and Clinical Medicine, 65(3), 484-9.
- (en) Waller et al., Medical pharmacology and therapeutics, 2e éd., p. 370.
- (en) Viera Jančinová, Silvia Pažoureková, Marianna Lucová et Tomáš Perečko, « Selective inhibition of extracellular oxidants liberated from human neutrophils—A new mechanism potentially involved in the anti-inflammatory activity of hydroxychloroquine », International Immunopharmacology, vol. 28, no 1, , p. 175–181 (DOI 10.1016/j.intimp.2015.05.048, lire en ligne [archive], consulté le ).
- « VIDAL - PLAQUENIL 200 mg cp pellic - Indications » [archive], sur www.vidal.fr (consulté le )
- (en) Organisation mondiale de la santé, « World Health Organization Model List of Essential Medicines » [archive] [PDF], sur apps.who.int, (consulté le ), p. 65.
- Roger Genet, « AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,de l’environnement et du travail » [archive], sur www.anses.fr
- « Arrêté du portant classement sur les listes des substances vénéneuses » [archive], sur Légifrance, .
- (en) Ursula Oberkirchner, Keith E. Linder et Thierry Olivry, « Successful treatment of a novel generalized variant of canine discoid lupus erythematosus with oral hydroxychloroquine », Veterinary Dermatology, vol. 23, no 1, , p. 65–e16 (ISSN 1365-3164, DOI 10.1111/j.1365-3164.2011.00994.x, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) Elizabeth A. Mauldin, Daniel O. Morris, Dorothy C. Brown et Margret L. Casal, « Exfoliative cutaneous lupus erythematosus in German shorthaired pointer dogs: disease development, progression and evaluation of three immunomodulatory drugs (ciclosporin, hydroxychloroquine, and adalimumab) in a controlled environment », Veterinary Dermatology, (PMID 20374572, PMCID PMC3294011, DOI 10.1111/j.1365-3164.2010.00867.x, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) Bryden, S. L., White, S. D., Dunston, S. M., Burrows, A. K., & Olivry, T. (2005). Clinical, histopathological and immunological characteristics of exfoliative cutaneous lupus erythematosus in 25 German short‐haired pointers. Veterinary dermatology, 16(4), 239-252.
- ANSES (2019), Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail portant sur une « demande d'avis relatif à une proposition d'arrêté portant inscription sur les listes des substances vénéneuses »[PDF] [archive], .
- (en) « Plaquenil (hydroxychloroquine sulfate) dose, indications, adverse effects, interactions… from PDR.net » [archive], sur pdr.net (consulté le ).
- boss, « Chloroquine et hydroxychloroquine » [archive], sur Réseau français des centres régionaux de pharmacovigilance, (consulté le ).
- (en) Samya Mohammad, Megan E. B. Clowse, Amanda M. Eudy et Lisa G. Criscione-Schreiber, « DailyMed - PLAQUENIL- hydroxychloroquine sulfate tablet », Arthritis Care & Research, vol. 70, no 3, , p. 481–485 (ISSN 2151-4658, PMID 28556555, DOI 10.1002/acr.23296, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (ru) K. Marquardt et T. E. Albertson, « Плаквенил (Plaquenil) - инструкция по применению, состав, аналоги препарата, дозировки, побочные действия » [archive], sur rlsnet.ru, The American Journal of Emergency Medicine, (ISSN 0735-6757, PMID 11555803, DOI 10.1053/ajem.2001.25774, consulté le ), p. 420–424.
- (en) Jordan, P. ; Brookes, J.G. ; Nikolic, G. et al. (1999), Hydroxychloroquine overdose: toxicokinetics and management, Clin. Toxicol., 37(7): 861-864.
- Smith et Klein-Schwartz.
- (en) El Shishtawy, M. A., Hassan, K. H., Ramzy, R., Berri, F., Mortada, M., Nasreddine, S. et Ezzedine, M. (2014), Comparative toxicity study of chloroquine and hydroxychloroquine on adult albino rats[PDF] [archive]. In 2nd Mediterranean interdisciplinary forum on social sciences and humanities, MIFS 2014 (voir p. 399).
- (en) Alf S. Alving, Lillian Eichelberger, Branch Craige et Ralph Jones, « Studies on the chronicité toxicity of chloroquine (SN-7618) », The Journal of Clinical Investigation, vol. 27, no 3, , p. 60–65 (ISSN 0021-9738, PMID 16695637, DOI 10.1172/JCI101974, lire en ligne [archive], consulté le ).
- « Un collectif de médecins cite une étude de l'Agence du médicament pour prôner l'usage de la chloroquine » [archive], sur lci.fr, (consulté le ).
- (en) Ruther K ; Forester J ; berndt S et al., Chloroquine / hydroxychloroquine: variability of retinotoxic cumulative doses, Ophthalmologe, 104: 875-879, 2007.
- (en) « Hydroxychloroquine Use During Pregnancy » [archive], sur Drugs.com (consulté le ).
- (en) Tomas Miranda-Aquino, Silvia Esmeralda Perez-Topete, Williams Ortega-Pantoja et Carlos Alejandro Gomez-Vazquez, « Long QT syndrome secondary to drug interaction between hydroxychloroquine and amiodarone », Revista Mexicana de Cardiologia, vol. 29, no 2, , p. 98–101 (ISSN 0188-2198, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) David J Browning, Chong Lee et David Rotberg, « The impact of different algorithms for ideal body weight on screening for hydroxychloroquine retinopathy in women », Clinical Ophthalmology (Auckland, N.Z.), vol. 8, , p. 1401–1407 (ISSN 1177-5467, PMID 25092963, PMCID 4116363, DOI 10.2147/OPTH.S66531, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) Al- Jassabi, L.; Azirun, S.M. et Saad.A. (2011) Biochemical Studies on the Role of Curcumin in the Protection of Liver and Kidney Damage by Anti-Malaria Drug. AETJS, 3(1):17-22.
- (en) K. Marquardt et T. E. Albertson, « Treatment of hydroxychloroquine overdose », The American Journal of Emergency Medicine, vol. 19, no 5, , p. 420–424 (ISSN 0735-6757, PMID 11555803, DOI 10.1053/ajem.2001.25774, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) N. Gunja, D. Roberts, D. McCoubrie et P. Lamberth, « Survival after Massive Hydroxychloroquine Overdose », Anaesthesia and Intensive Care, vol. 37, no 1, , p. 130–133 (ISSN 0310-057X, DOI 10.1177/0310057X0903700112).
- Vincent Danel et Patrick Barriot, Intoxications aiguës en réanimation, 2e éd..
- (en) Mongenot, F., Gonthier, Y. T., Derderian, F., Durand, M. et Blin, D. (2006). Treatment of hydroxychloroquine poisoning with extracorporeal circulation. Dans : Annales françaises d'anesthesie et de reanimation (vol. 26, novembre, no 2, p. 164-167).
- (en) « DailyMed - PLAQUENIL- hydroxychloroquine sulfate tablet » [archive], sur dailymed.nlm.nih.gov (consulté le ).
- (en) Chun-Yu Chen, Feng-Lin Wang et Chih-Chuan Lin, « Chronic Hydroxychloroquine Use Associated with QT Prolongation and Refractory Ventricular Arrhythmia », Clinical Toxicology, vol. 44, no 2, , p. 173–175 (ISSN 1556-3650, DOI 10.1080/15563650500514558).
- (en) J A Gonzalez-Nieto et E Costa-Juan, « Psychiatric symptoms induced by hydroxychloroquine » [archive], sur Lupus, (ISSN 0961-2033, DOI 10.1177/0961203314558863, consulté le ), p. 339–340.
- H. Artaguine, O. Hocar, K. Laissaoui et N. Akhadari, « P 37 : Accès psychotique aigu induit par la Chloroquine », Annales de Dermatologie et de Vénéréologie, 30 Congrès de l’Association des Dermatologistes Francophones, 20-23 avril 2016 - Abidjan, Côte d’Ivoire, vol. 143, no 4, Supplement 1, , S48–S49 (ISSN 0151-9638, PMID 21220626, DOI 10.1016/S0151-9638(16)30212-5, lire en ligne [archive], consulté le ).
- V. Ferraro, F. Mantoux, K. Denis et M. -A. Lay-Macagno, « Hallucinations au cours d’un traitement par hydroxychloroquine », Annales de Dermatologie et de Vénéréologie, vol. 131, no 5, , p. 471–473 (ISSN 0151-9638, DOI 10.1016/S0151-9638(04)93642-3, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) Annamaria Mascolo, Pasquale Maria Berrino, Pietro Gareri et Alberto Castagna, « Neuropsychiatric clinical manifestations in elderly patients treated with hydroxychloroquine: a review article », Inflammopharmacology, vol. 26, no 5, , p. 1141–1149 (ISSN 1568-5608, DOI 10.1007/s10787-018-0498-5).
- « Médicaments utilisés chez les patients atteints du COVID-19 : une surveillance renforcée des effets indésirables - Point d'information (actualisé le 14/05/2020) », ANSM, (lire en ligne [archive]).
- (en) Schneider P, Korolenko T.A et Busch U (1997), A review of druginduced lysosomal disorders of the liver in man and laboratory animals. Microsc. Res. Tech., 36(4): 253-275.
- (en) Zhao H, Cai Y, Santi S et al. (2005), Chloroquine mediated radiosensitization is due to the destabilization of the lysosomal membrane and subsequent induction of cell death by necrosis. Radiat. Res., 164(3): 250-7.
- (en) Raizman MB, Hamrah P, Holland EJ, Kim T, Mah FS, Rapuano CJ, Ulrich RG. Drug-induced corneal epithelial changes. Surv Ophthalmol. 2017 May - Jun;62(3):286-301.
- (en) Francis P, Michaelides M, Niamh S et Weleber R, Retinal toxicity associated with hydroxychloroquine and chloroquine [archive], Arch. Ophthalmol., 2011, 129:30-9.
- (en) Yam JC, Kwok AK. Ocular toxicity of hydroxychloroquine. Hong Kong Med J. 2006 Aug;12(4):294-304 (résumé [archive]).
- (en) Cabral RTS, Klumb EM, Couto MINN, Carneiro S. Evaluation of toxic retinopathy caused by antimalarial medications with spectral domain optical coherence tomography. Arq Bras Oftalmol. 2019 Jan-Feb;82(1):12-17.
- (en) Yusuf IH, Sharma S, Luqmani R, Downes SM. Hydroxychloroquine retinopathy. Eye (Lond) 2017 Jun;31(6):828-845.
- (en) Stokkermans T.J et Trichonas G (2019), Chloroquine And Hydroxychloroquine Toxicity [archive], Review from StatPearls Publishing, Treasure Island (FL), , CC-BY-SA 4.0.
- (en) « Hydroxychloroquine toxicity despite normal dose therapy. Europe PMC », Annals of Ophthalmology, (lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) Marija Rowane, Jason Schend, Jaimin Patel et Robert Hostoffer, « Rapid desensitization of hydroxychloroquine », Annals of Allergy, Asthma & Immunology, vol. 124, no 1, , p. 97–98 (ISSN 1081-1206 et 1534-4436, PMID 31606403, DOI 10.1016/j.anai.2019.10.001, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) J. Jiménez‐Alonso, J. Tercedor, L. Jáimez et E. García‐Lora, « Antimalarial drug-induced aquagenic-type pruritus in patients with lupus », Arthritis & Rheumatism, vol. 41, no 4, , p. 744–745 ; voir aussi https://pdfs.semanticscholar.org/1049/1fddf1c560407cbf9f2a355a1bb8f94befe0.pdf [archive] (ISSN 1529-0131, DOI 10.1002/1529-0131(199804)41:43.0.CO;2-F, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) Moez Jallouli, « Hydroxychloroquine-Induced Pigmentation in Patients With Systemic Lupus Erythematosus: A Case-Control Study », JAMA Dermatology, vol. 149, no 8, , p. 935 (ISSN 2168-6068, DOI 10.1001/jamadermatol.2013.709, lire en ligne [archive], consulté le ).
- Amin N'Cho C (2019), Dosage des spécialités et génériques pharmaceutiques de la chloroquine par chromatographie liquide haute performance.
- (en) Melles RB, Marmor MF. Pericentral retinopathy and racial differences in hydroxychloroquine toxicity. Ophthalmology. 2015 Jan;122(1):110-6.
- (en-US) Y Tal, R Maoz Segal, P Langevitz et S Kivity, « Hydroxychloroquine desensitization, an effective method to overcome hypersensitivity—a multicenter experience », Lupus, vol. 27, no 5, , p. 703–707 (ISSN 0961-2033 et 1477-0962, DOI 10.1177/0961203317735185).
- (en) M Jolly, L Galicier, O Aumaître et C Francès, « Quality of life in systemic lupus erythematosus: description in a cohort of French patients and association with blood hydroxychloroquine levels », Lupus, vol. 25, no 7, , p. 735–740 (ISSN 0961-2033 et 1477-0962, DOI 10.1177/0961203315627200, lire en ligne [archive], consulté le ).
- Base de données publique du médicament [archive],
- (en) Allan J. Flach, « Improving the risk-benefit relationship and informed consent for patients treated with hydroxychloroquine » [archive], sur Transactions of the American Ophthalmological Society, (ISSN 1545-6110, PMID 18427609, PMCID 2258132, consulté le ), p. 191–194; discussion 195–197.
- (en) Nathalie Costedoat-Chalumeau, Bertrand Dunogué, Gaëlle Leroux et Nathalie Morel, « A Critical Review of the Effects of Hydroxychloroquine and Chloroquine on the Eye », Clinical Reviews in Allergy & Immunology, vol. 49, no 3, , p. 317–326 (ISSN 1080-0549 et 1559-0267, DOI 10.1007/s12016-015-8469-8, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) Doo-ri Eo, Min Gyu Lee, Don-Il Ham et Se Woong Kang, « Frequency and Clinical Characteristics of Hydroxychloroquine Retinopathy in Korean Patients with Rheumatologic Diseases », Journal of Korean Medical Science, vol. 32, no 3, , p. 522–527 (ISSN 1011-8934, PMID 28145658, PMCID PMC5290114, DOI 10.3346/jkms.2017.32.3.522).
- (en) Ursula Laverty, Gerard Reid, Julie Silvestri et Adrian Pendleton, « Fri0200 Review of Hydroxychloroquine Use and Development of a Regional Strategy to Minimise Retinal Toxicity », Annals of the Rheumatic Diseases, vol. 78, no Suppl 2, , p. 779–779 (ISSN 0003-4967 et 1468-2060, DOI 10.1136/annrheumdis-2019-eular.5898, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) Michael F. Marmor, Ulrich Kellner, Timothy Y. Y. Lai et Jonathan S. Lyons, « Revised recommendations on screening for chloroquine and hydroxychloroquine retinopathy », Ophthalmology, vol. 118, no 2, , p. 415–422 (ISSN 1549-4713, PMID 21292109, DOI 10.1016/j.ophtha.2010.11.017, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) G. D. Levy, S. J. Munz, J. Paschal et H. B. Cohen, « Incidence of hydroxychloroquine retinopathy in 1,207 patients in a large multicenter outpatient practice », Arthritis and Rheumatism, vol. 40, no 8, , p. 1482–1486 (ISSN 0004-3591, PMID 9259429, DOI 10.1002/art.1780400817, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) David J. Browning, S. J. Munz, J. Paschal et H. B. Cohen, « Impact of the revised american academy of ophthalmology guidelines regarding hydroxychloroquine screening on actual practice », American Journal of Ophthalmology, vol. 155, no 3, , p. 418–428.e1 (ISSN 1879-1891, PMID 23218706, DOI 10.1016/j.ajo.2012.09.025, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) Matthew D. Walvick, Michael P. Walvick, Edison Tongson et Chau H. Ngo, « Hydroxychloroquine: lean body weight dosing », Ophthalmology, vol. 118, no 10, , p. 2100; author reply 2101 (ISSN 1549-4713, PMID 21968180, DOI 10.1016/j.ophtha.2011.07.020, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) Ullberg S, Lindquist NG, Sjòstrand SE. Accumulation of chorio-retinotoxic drugs in the foetal eye. Nature. 1970 Sep 19;227(5264):1257-8.
- (en + ru) Kolotova A et Ermakov N.V, « Toxic lesions of the organ of vision caused by chloroquine derivatives », Vestnik oftalmologii, vol. 119, no 1, , p. 39-42 (lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) Kellner U, Lai T, Lyons J, Marmor M et Mieler W, Revised recommendations on screening for chloroquine and hydroxychloroquine retinopathy [archive], Ophthalmology, 2011, 118:415-22.
- (en) Michel Michaelides, Niamh B. Stover, Peter J. Francis et Richard G. Weleber, « Retinal toxicity associated with hydroxychloroquine and chloroquine: risk factors, screening, and progression despite cessation of therapy », Archives of Ophthalmology (Chicago, Ill.: 1960), vol. 129, no 1, , p. 30–39 (ISSN 1538-3601, PMID 21220626, DOI 10.1001/archophthalmol.2010.321, lire en ligne [archive], consulté le ).
- Nathalie Costedoat-Chalumeau, « Etude du rapport bénéfice/ risque du traitement par hydroxychloroquine dans le lupus systématique : étude de la toxicité fœtale, de la toxicité cardiaque et optimisation posologique basée sur la détermination de sa concentration sanguine » [archive], Paris 6, (consulté le ).
- (zh) « Emissions - Explosion de SCI Pharmtech, l’usine de production d’hydroxychloroquine taiwanaise » [archive], sur Radio Taiwan International (consulté le )
- « France, Italie, Brésil... Le monde divisé sur l’utilisation de l’hydroxychloroquine », L'Obs, (lire en ligne [archive], consulté le ).
- Astrid de Villaines, « Douste-Blazy et Pelloux prennent parti pour la chloroquine et en appellent à Philippe », HuffPost, (lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) « Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Revokes Emergency Use Authorization for Chloroquine and Hydroxychloroquine » [archive], FDA, (consulté le ).
- (en) « South Korea backs remdesivir for COVID-19, urges caution with dexamethasone » [archive], Reuters, (consulté le ).
- (en) « Hydroxychloroquine Halted in WHO-Sponsored Covid-19 Trials » [archive], Bloomberg News, (consulté le ).
- (en) David R. Boulware, Matthew F. Pullen, Ananta S. Bangdiwala, Katelyn A. Pastick, Sarah M. Lofgren, Elizabeth C. Okafor, Caleb P. Skipper, Alanna A. Nascene, Melanie R. Nicol, Mahsa Abassi, Nicole W. Engen, Matthew P. Cheng, Derek LaBar, Sylvain A. Lother, Lauren J. MacKenzie, Glen Drobot, Nicole Marten, Ryan Zarychanski, Lauren E. Kelly, Ilan S. Schwartz, Emily G. McDonald, Radha Rajasingham, Todd C. Lee et Kathy H. Hullsiek, « A Randomized Trial of Hydroxychloroquine as Postexposure Prophylaxis for Covid-19 », The New England Journal of Medicine, (PMID 32492293, PMCID 7289276, DOI 10.1056/NEJMoa2016638, lire en ligne [archive])
- (en) « No clinical benefit from use of hydroxychloroquine in hospitalised patients with COVID-19 » [archive], Essai clinique Recovery, (consulté le )
- (en) Reed AC Siemieniuk, Jessica J. Bartoszko, Long Ge et Dena Zeraatkar, « Drug treatments for covid-19: living systematic review and network meta-analysis », BMJ, vol. 370, (ISSN 1756-1833, PMID 32732190, DOI 10.1136/bmj.m2980, lire en ligne [archive], consulté le )
- Coronavirus - L'OMS met fin aux essais cliniques sur l'hydroxychloroquine "qui ne réduit pas ou très peu la mortalité" [archive]
- Covid-19 : l’OMS déconseille vivement l’hydroxychloroquine comme traitement préventif [archive]
- Marianne Schaffner, Prescription d’hydroxychloroquine : un cadre réglementaire exigeant mais protecteur Le club des juristes, 10 juin 2020 [archive]
- « « Pas d'effet bénéfique » de l'hydroxychloroquine, selon les résultats préliminaires de l'essai britannique Recovery » [archive], sur Le Quotidien du médecin (consulté le ).
- « Covid-19 : l’hydroxychloroquine n’a « aucun effet bénéfique » sur les patients hospitalisés, selon l’essai Recovery » [archive], sur Le Monde.fr, Le Monde, (ISSN 1950-6244, consulté le ).
- « Traitements du Covid-19 : résultats négatifs pour l’essai Solidarity, confirmant l’inefficacité du Remdesivir et de l’hydroxychloroquine » [archive], sur Le Monde.fr, Le Monde, (ISSN 1950-6244, consulté le ).
- « Solidarity confirme l’inefficacité de plusieurs traitements anti-covid » [archive], sur Le Temps, (consulté le ).
- Hervé Seitz, Hydroxychloroquine et Covid-19 : résumé d'un an de controverse, (lire en ligne [archive])
- (en) Fernando Luiz Barros Edington, Sandra Rocha Gadellha et Mittermayer Barreto Santiago, « Safety of treatment with chloroquine and hydroxychloroquine: A ten-year systematic review and meta-analysis », European Journal of Internal Medicine, vol. 88, , p. 63–72 (ISSN 0953-6205, DOI 10.1016/j.ejim.2021.03.028, lire en ligne [archive], consulté le ).
- Damien Leloup et Lucie Soullier, « Coronavirus : comment le professeur Didier Raoult est devenu une figure centrale des théories complotistes. Les débats sur l’hydroxychloroquine ont inspiré des théories conspirationnistes, avec une question récurrente : pourquoi le traitement n’est-il pas généralisé ? » [archive], sur lemonde.fr,
- (en) Paul Bertin, Kenzo Nera & Sylvain Delouvée, « Conspiracy Beliefs, Rejection of Vaccination, and Support for hydroxychloroquine: A Conceptual Replication-Extension in the COVID-19 Pandemic Contex », Front. Psychol., vol. 11, no 1, (DOI 10.3389/fpsyg.2020.565128)
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressources relatives à la santé
- :
-
-
Cannabis (usage récréatif)
Cet article concerne le cannabis à usage récréatif. Pour l'usage médical, voir Cannabis médical. Pour le genre botanique et les généralités sur les chanvres, voir Cannabis. Pour l'espèce botanique, voir Cannabis sativa.
Le cannabis qui se présente sous forme de fleurs, de feuilles, de résine ou d'huile est connu dans le langage populaire sous des dizaines de surnoms plus ou moins imagés comme :
- le cannabis récréatif en général : cannabis, chanvre récréatif, chanvre indien ;
- les fleurs (et feuilles) : marijuana, weed, ganja, beuh, pot (en français québécois), zamal (en créole réunionnais) ;
- la résine (et autres parties pressées) : haschich, hasch, double H, shit, kif, jaune, mousseux ;
- la cigarette roulée : joint, bedo, pétard , spliff (anglicisme employé lors de mélange de cannabis avec du tabac) ;
- l’huile de cannabis.
Le nom commun « cannabis », calqué sur le latin, se réfère principalement en français contemporain à l'utilisation des plantes du genre végétal éponyme (le genre Cannabis) pour leurs effets psychoactifs et médicinaux1. Le principal constituant psychoactif présent dans ces plantes est le tétrahydrocannabinol (THC), parmi les 483 composés connus, dont au moins 84 autres cannabinoïdes, tels que le cannabidiol (CBD), le cannabinol (CBN), et la tétrahydrocannabivarine (THCV). L'usage du cannabis comme substance récréative a progressivement mis au point diverses recettes, préparations et modes de consommation.
Les recherches sur la dangerosité de la marijuana pour les populations, bien que toujours controversées au XXIe siècle, ont conduit à son inscription comme étant une drogue dans la convention unique sur les stupéfiants de 1961. Ainsi, la détention, le commerce, la promotion et la consommation de marijuana ont été interdits au cours du XXe siècle dans la majorité des pays du monde. Le cannabis reste malgré cela très consommé comme psychotrope, notamment en Amérique du Nord et en Europe.
Biologie et culture
D'après les recherches récentes, et bien que les auteurs soient encore hésitants sur la séparation en plusieurs espèces distinctes, il s'agirait plus probablement d'une seule et même plante : l'espèce végétale Cannabis sativa, avec de nombreuses variantes. Dans les milieux industriels ou agricoles, c'est de préférence le mot français chanvre qui est utilisé au XXIe siècle pour désigner les plants ou la matière qu'ils produisent1. C'est le taux de tétrahydrocannabinol présent dans chaque variété botanique ou cultivars de Cannabis sativa qui détermine si elle est utilisée comme chanvre à usage agricole ou bien pour ses substances chimiques. De par le monde, on a ainsi sélectionné progressivement un grand nombre de lignées de cannabis en fonction de l'usage que l'on souhaite en faire ou des réglementations locales.
Histoire
Carte actuelle du cimetière de Jirzankal (
Pamir, Chine), site des premières preuves de la consommation de cannabis
Localisation du
Rif, premier lieu de production et de transformation au monde.
Le Maroc est le premier producteur mondial de cannabis2. Le cannabis consommé en Europe provient principalement de la région du Rif, une région montagneuse située dans le Nord du Maroc. Le chanvre serait cultivé dans le Rif depuis le VIIe siècle, soit depuis plus d'un millénaire3. Le cannabis marocain est appelé le kîf (venant du mot katf, garrot, qui sert à lier), peut être issu des rameaux d'herbes liés et conditionnés pour le séchage. En arabe ou dialecte marocain (darija), il peut être aussi appelé zatla, hashish, zakataka, al hasha, al hanchla, flitoxa, ghalghoula, aachour, tbisla, frimija, etc. après transformation en drogue2.
Cannabinoïdes dans la plante
Plus de soixante cannabinoïdes sont recensées dans les différents cultivars de Cannabis. Le tétrahydrocannabinol (THC), le cannabidiol (CBD) et le cannabinol (CBN) sont les plus répandues des cannabinoïdes. La biosynthèse du (CBD) et du (THC) se fait directement dans des glandes spécialisées présentes sur toutes les parties aériennes (trichome) de la plante, alors que le (CBN) résulte de l'oxydation du (THC) à la suite de l'exposition prolongée à l'air et/ou au soleil. Le développement de ces glandes débute avec la formation des bractées. Sur un autre plan, nous pouvons notifier que les facteurs régulant la production de cannabinoïdes ne sont que partiellement connus de nos jours.
Dès lors, on recense plusieurs recherches scientifiques sur les caractéristiques de ces cannabinoïdes :
- Il est prouvé par Haney et Kutscheid que le stress environnemental augmente de manière importante la quantité de Δ 9-tetrahydrocannabinol. (Haney and Kutscheid, 1973 ; Coffman and Gentner, 1975)4 ;
- Latta et Eaton démontrent que les cannabinoïdes jouent le rôle d'agents défensifs, contre la dessiccation, les parasites, les UV-B, le froid et les micro-organismes (Latta and Eaton, 1975)5.
Usage psychotropique
Le chanvre est largement utilisé pour les propriétés dysleptiques induites notamment par la présence de tétrahydrocannabinol (THC). C'est le cas essentiellement de trois des quatre sous-espèces qui peuvent être consommées directement après la récolte incluant cannabis sativa, cannabis indica et cannabis afghanica.
La sous-espèce Cannabis ruderalis, essentiellement cultivée pour la production de chanvre textile, ne contient pas suffisamment de THC pour provoquer des effets psychotropes. Elle n'est utilisée par les cultivateurs de cannabis que pour effectuer des croisements en vue d'obtenir une meilleure résistance et une floraison plus précoce. Actuellement, presque tous les cultivars utilisés pour l'auto-consommation sont des hybrides de ces quatre espèces. Pour la production d'hybrides, les sous-espèces cannabis indica et cannabis sativa sont essentiellement utilisées.
Modes de consommation
Exemple de « tête » de cannabis.
Vaporisateur avec tube flexible.
Le cannabis peut se présenter sous différentes formes :
- fleurs séchées femelles (5-25 % THC) (qui forment les « têtes » ou « cocottes »), appelées « marijuana », ou des feuilles séchées (habituellement, les feuilles de la couronne fleurie des plantes femelles, appelées « feuilles de manucure ») ;
- huile de haschich (60-90 % THC), concentré issu d'une extraction à l'aide de solvants (généralement solvant apolaire car le THC est soluble dans ceux-ci). Les feuilles sont mélangées au solvant pendant quelques minutes puis retirées par filtration. Le solvant est ensuite évaporé pour laisser apparaître l'huile ;
- pollen (~30 % THC), aussi appelé skuff, appelé ainsi par analogie avec le pollen des botanistes mais qui n'a en réalité rien à voir : le vrai pollen de la plante, poussière jaune produite par les pieds mâles au moment de leur reproduction, ne contient pas de substance active. Il s'agit ici de la poudre résineuse obtenue en battant des ballots de tissus remplis de fleurs de cannabis (têtes). La poudre ainsi récupérée, est ensuite compactée en bloc, ce qui donne le haschich, souvent « coupé » avec différents produits (paraffine, etc.) afin d'en augmenter le volume et le poids, avec pour effet une diminution de la concentration en THC.
Le cannabis est généralement consommé dans des cigarettes artisanales appelées « joints », « pétards »6, « spliff »7, « boze »8, « tar-pé »9, ou « cigarettes magiques ». D'autres modes de consommation existent :
- pipe, chillum, etc., avec ou sans tabac ;
- « bang » (ou « bong »), une pipe à eau à travers laquelle la fumée est refroidie et filtrée avant d'arriver aux poumons : la quantité aspirée est plus importante et les effets plus rapides et plus intenses qu'avec un joint ;
- gâteaux (« space cakes ») : les effets mettent plus longtemps à venir et ce mode de consommation demande des quantités plus importantes car une partie du THC est détruite par les enzymes de l'estomac[réf. souhaitée] ;
- vaporisation : ce mode de consommation, comme les gâteaux, ne présenterait pas les dangers liés aux produits de combustion cancérigènes : goudrons, oxyde de carbone, etc. Par ailleurs la quantité de cannabis nécessaire est moins importante car le THC n'est pas détruit par la chaleur de la combustion. C'est le mode de consommation privilégié par les utilisateurs de cannabis à des fins thérapeutiques.
Comparaison avec d'autres substances
Il est très difficile de définir et de comparer des psychotropes et notamment leur dangerosité en raison de la multiplicité des usages, doses, fréquences, modes de consommation, raisons de la consommation (récréative ou médicale par exemple), contexte social, des combinaisons de produits, de l'état de santé du consommateur etc10. Les classifications dépendent des caractéristiques comparés. Par exemple l’addiction, la nocivité ou l’impact sur le comportement11.
Le cannabis est régulièrement présenté comme moins dangereux que l'alcool mais ce point ne fait pas l'unanimité12,13. L'alcool ne contient qu'une seule substance active, l'éthanol, contre plus de 400 pour le cannabis. L'élimination de l'alcool du corps est très rapide alors que le cannabis dont des éléments cancérogènes est accumulé dans les tissus adipeux peut être libéré dans la circulation sanguine même des années après l'arrêt de la consommation, provoquant des accidents ou des rechutes14. Ces particularités biochimiques expliquent pourquoi une consommation occasionnelle d'alcool est généralement tolérée, alors qu'il est impensable de faire de même avec le cannabis ou d'autres drogues14.
Le taux de THC du cannabis récréatif peut beaucoup varier, ce qui rend les comparaisons difficiles. Le taux de THC mesuré dans le cannabis saisis par les douanes a beaucoup augmenté entre les années 1970 et 2020. Le taux moyen de THC est passé de 1 % en 1970 et 2 % en 1980 à entre 16 et 26 % en 201915.
En 1998, Bernard Roques, un professeur français membre de l'Académie des sciences, présente une approche globale considérant à la fois les propriétés pharmacologiques des produits psychotropes et les problèmes et risques sanitaires et sociaux liés à la consommation de ces produits.
Le rapport Roques propose de regrouper les différents psychotropes selon leur effet neuropharmacologique, les catégories étant16 :
Ainsi, la dangerosité est-elle évaluée selon trois paramètres17 :
- la dangerosité pour le système nerveux central ;
- la dangerosité individuelle/toxicité générale ;
- la dangerosité interindividuelle/sociale.
Ce tableau est un extrait du tableau publié à la page 182 du Rapport sur la dangerosité des produits par le professeur Bernard Roques et adressé au Secrétaire d'État à la Santé de l'époque, M. Kouchner, à l'issue des Rencontres Nationales sur l'Abus de drogues et la toxicomanie (France, )18.
Le professeur Nordmann, membre de l'Académie nationale de médecine, a en 2003 déclaré dans un rapport fait au Sénat que l'indication « neurotoxicité : 0 » concernant le cannabis dans le tableau récapitulatif du rapport Roques était une erreur, qui contredit d'ailleurs des constats faits dans le reste du document19.
Habitudes de consommation
Généralement, le cannabis est fumé. Il peut se présenter sous les formes suivantes :
- la marijuana : on l'appelle aussi pot, beuh ou herbe. Roulée en joint, on l'appelle joint, pétard, ou d'autres surnoms. Elle est composée à partir des fleurs séchées du cannabis ou des feuilles. Mais si les feuilles ne sont pas de bonne qualité, elles sont appelées feuillasse ou paille. Celles-ci sont séchées, finement hachées, puis fumées telles quelles ou mélangées à du tabac. Elle est aussi, parfois, mêlée à des pâtisseries ou à des boissons. La teneur en THC varie de 0,1 à 25 % selon la provenance et son mode de préparation ;
- le haschisch ou hasch : il est fabriqué avec la résine du chanvre qui couvre les fleurs et les feuilles du sommet de la plante. La résine est raclée, pressée en blocs et généralement fumée. Le haschisch est mélangé à du tabac sous forme de cigarette ou dans une pipe. Parfois encore, certains adeptes le mélangent à des aliments ou boissons. Les effets du haschisch sont plus forts que ceux de la marijuana : sa teneur en THC varie entre 10 et 30 % lorsque le produit n'est pas coupé ;
- l'huile de cannabis : Pour extraire l'huile, le cannabis est trempé dans un solvant, ensuite évaporé pour obtenir un concentré de THC (entre 60 et 80 %) ainsi que d'autres cannabinoïdes. Cette huile, qui se fume mélangée à du tabac, est dangereuse en raison de son très fort taux de concentration. Elle est peu répandue20. L'huile essentielle de cannabis est extraite de la plante par distillation, elle contient un très fort taux de cannabinoïde ainsi que d'arôme, elle est très peu répandue.
Lorsqu'il est fumé, entre 15 et 50 % du THC passe dans le sang et l'effet dure entre 45 minutes et 2 h 30. Une des techniques pour avoir un maximum d'effet est d'aspirer la fumée par plusieurs inhalations courtes, de l'envoyer dans les poumons et de l'y laisser un certain temps. On dit qu'on cogne ou compresse (ou konye en créole) lorsqu'on utilise cette technique. La méthode dite à « l'indienne » se pratique en groupe. Elle consiste à faire tourner le joint et à expirer la fumée le plus tard possible, tout en continuant à faire tourner le joint. Le fumeur garde ainsi la fumée dans ses poumons, mais cette technique, quoique récréative, n'augmente pas les effets du cannabis puisque les poumons absorbent 95 % du THC du cannabis fumé dès les premières secondes. Retenir la fumée va juste déposer plus de goudron dans les poumons. D'autres techniques incluent l'utilisation de narguilé ou pipe à eau pour fumer le cannabis tout en refroidissant la fumée. Il s'agit de techniques censées filtrer la fumée, qui multiplient en réalité les quantités d'air et de toxiques inhalés, du fait qu'il faut aspirer plus profondément. Ce mode de consommation fait pénétrer les fumées plus profondément dans les poumons, avec les risques qui en résultent21.
Le cannabis peut aussi être ingéré car le THC est soluble dans les graisses et l'alcool. Néanmoins, lorsqu'il est ingéré, les effets du cannabis se déclarent au bout de trente minutes et peuvent se prolonger plusieurs heures, ce qui peut générer un état d'anxiété et de paranoïa appelé bad trip :
- le beurre de Marrakech, obtenu par extraction des composés liposolubles du haschisch ou des inflorescences de cannabis se substitue au beurre classique dans les recettes. Il est utilisé pour préparer des plats tels que le space cake, la pot pie ou les hash brownies ;
- le cannabis peut également être mis en solution dans du lait (de préférence entier), ce que l'on nomme un bhang ou « lait vert » ;
- le haschich peut être mis à fondre dans du chocolat noir et servir ensuite en pâtisserie ou solidifié pour l'utiliser à la demande ;
- le Green Dragon désigne une boisson alcoolisée à base de macération de cannabis dans de l'alcool (ou une boisson au datura). Le nom provient de la couleur verte de la solution ;
- le cannabis tea (en) (ou thé/tisane au chanvre) est une infusion de chanvre. Les cannabinoïdes se diluant moins bien dans l'eau, le chanvre est en général bien séché pour une infusion. Il existe plusieurs variantes pour rendre une tisane au chanvre agréable à boire tout en ayant des effets puissants selon la concentration de THC. La plus connue est le thé-chai au cannabis. Les effets de cette tisane se font ressentir environ 2 heures après ingestion et peuvent durer jusqu'à 18-24h selon les individus[réf. nécessaire]. C'est pourquoi elle est plus rarement consommée.
La vaporisation ou sublimation est une autre méthode d'absorption. On peut extraire le THC et les autres cannabinoïdes sous forme de vapeur en chauffant légèrement la plante sans la brûler. Cette méthode a l'avantage de ne pas produire les substances toxiques contenues dans la fumée du cannabis et du tabac lors d'une combustion normale (monoxyde de carbone, goudrons, nitrosamines…). En chauffant le cannabis à une température précise, les substances psychotropes s'évaporent, mais la plante ne brûle pas encore. La vapeur produite peut alors être inhalée, avec un effet aussi immédiat et plus puissant que si le cannabis était fumé. En 2008, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies signale qu'en général, les prix de vente au détail du cannabis végétal et de la résine de cannabis oscillent en Europe entre 2 et 14 euros le gramme. La plupart des pays européens font état de prix compris entre 4 et 10 euros pour les deux produits22.
Évaluation de la consommation
Pourcentage de la population ayant déjà consommé du cannabis dans l'Union européenne.
En 2008, l'ONU dans son rapport mondial sur les drogues 2008, estimait qu'il y avait 166 millions d'usagers de cannabis, le pays comportant le plus d'utilisateurs restant les États-Unis23. Plus de soixante-deux millions d'Européens (plus de 20 % de l'ensemble de la population adulte) ont déjà consommé du cannabis et vingt millions en ont consommé au cours de la dernière année, selon une étude publiée le par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT).
En France, parmi les adultes âgés de 18 à 64 ans, 33 % déclare avoir déjà consommé du cannabis au cours de leur vie, ce qui représente 13,4 millions de personnes24. Le nombre de personnes ayant consommé du cannabis dans l’année est de 3,8 millions (8 % de la population), situant la France parmi les pays d’Europe les plus consommateurs, aux côtés de la République tchèque, du Royaume-Uni, de l’Italie et du Danemark25.
Dans son rapport annuel du , l'OICS indique que l'Afrique compterait trente-quatre millions d'usagers. Cependant cette évaluation est certainement très loin de la réalité. Il n'existe aucune méthode fiable pour évaluer un marché illégal, ce qui se fait par des extrapolations des drogues saisies ainsi que des évaluations des surfaces cultivées. Il s'agit en revanche de la drogue illégale la plus consommée dans le monde26.
Effets recherchés
D'une manière générale, les effets varient en intensité et en durée, en fonction du mode de consommation, des teneurs respectives en THC et CBD ainsi que du sujet, de son état physique et psychique.
Les effets peuvent durer entre quelques minutes (inhalation) et quelques heures (ingestion). Le Delta 9-tétrahydo-cannabinol (THC) (à la dose de 10mg oralement), principe actif du chanvre indien, le cannabis, a été administré par Pierre Etevenon et collaborateurs chez des sujets volontaires sains au Centre Hospitalier Sainte-Anne. Sur les enregistrements électroencéphalographiques (EEG), des stades successifs de sommeil léger de stade 1 d'endormissement (avec des images hypnagogiques brèves) sont suivis et alternent avec des épisodes de sommeil paradoxal (subjectivement relié à un rêve). Ceci peut entrer en compte dans les effets onirogène, hypnogène, et même hallucinatoire, observés et quantifiés en laboratoire par électroencéphalographie quantitative27. Leur durée est tout autant variable.
Généralement :
- euphorie, hilarité, excitation ;
- relaxation, détente, sensation de flottement ;
- facilité d'introspection (disparition de l'inhibition) ;
- association d'idées créatives ;
- sensation d'intelligence, de créativité qui est souvent due à une augmentation de l'ego.
- stimulation de l'appétit (voir Usage médical) ;
- sommeil ;
- perception visuelle ralentie (sensation de voir les évènements se passer plus lentement) ;
- sensation d'extrême plaisir même face à des choses parfois futiles, contemplation constante de l'environnement.
Des doses plus fortes peuvent induire une augmentation de la perception auditive et visuelle (diminution de l'inhibition latente), qui peut engendrer des hallucinations et conduire au bad trip ou au contraire amplifier les sensations durant un spectacle musical ou devant un film, effet souvent recherché.
Effets indésirables
Dans une enquête de 2011 auprès de 292 experts cliniques en Écosse, le cannabis a été classé dernier pour le préjudice personnel et
18e pour le préjudice causé à la société, sur
19 drogues récréatives courantes
28. Voir aussi
Classification des psychotropes.
Après la consommation, l'usager peut manifester les symptômes suivants :
- tachycardie, hypertension/hypotension ;
- addiction ;
- assèchement buccal (familièrement appelé « la pâteuse » ou « moquette » souvent caractérisée par un blanchiment de la langue) ;
- anxiété ;
- altération de la mémoire immédiate ;
- troubles de la perception du temps (quelques minutes semblent être des heures, ou l'inverse) ;
- des vomissements sont possibles, mais sont surtout provoqués par les produits coupants ou l'angoisse due à la perte de repères. ;
- chez certains consommateurs, une sensation de faim imminente et relativement forte ;
- yeux rouges, mydriase29 ;
- paranoïa ;
- déclenchement d'une schizophrénie durable ou de troubles psychotiques (chez les sujets vulnérables, les effets hallucinogènes peuvent agir comme facteur précipitant).
Troubles de la mémoire
La consommation persistante de cannabis est associée à la diminution des fonctions neuropsychologiques et des troubles cognitifs sont plus fréquents chez les utilisateurs réguliers30. Le cannabis altère la mémoire immédiate, la concentration, le rappel des souvenirs ou des mots, et peut donc diminuer les capacités d’apprentissage. En l’état des connaissances en 2017, la mémoire, la capacité d'apprentissage et la concentration, ne semblent pas affectées au-delà du temps des effets du cannabis, c'est-à-dire quelques heures31. Cette amnésie est multipliée en cas de consommation associée avec de l'alcool32. Le cannabis perturbe les processus de mémorisation du cerveau en désorganisant le fonctionnement électrique de l'hippocampe33, structure clé du cerveau pour l'activation de la mémoire. Le cannabis aux doses usuellement présentes chez ses consommateurs supprime les oscillations électriques, essentielles dans le processus d'apprentissage et de mémorisation. Les processus cognitifs sont désorganisés. La principale substance active dans le cannabis, le THC, bloque aussi la libération d'un neurotransmetteur important dans l'hippocampe, l'acétylcholine, affectant le fonctionnement électrophysiologique du cerveau34. Le cannabis perturbe chez le fœtus la formation des réseaux de neurones dans le développement du cerveau, ce que confirme la proportion très élevée d'enfants ayant un retard mental chez les mères consommatrices35. Les troubles cognitifs sont plus important chez l'adolescent que chez l'adulte, avec des effets irréversibles (dont une perte jusqu'à 8 points de Q.I)36.
Troubles psychologiques
L'usage de cannabis peut traduire un mal-être psychique – parfois insoupçonné – pouvant se transformer en paranoïa, crises d'angoisses, sentiment d'oppression. Il existe aussi quelques cas de psychose cannabique aiguë37. Au niveau neuro-psychiatrique, la substance peut diminuer l'attention, aggraver ou révéler des troubles psychiques comme n'importe quel psychotrope. Un syndrome amotivationnel (démotivation) peut apparaître, ainsi que : manque d'estime de soi, intempérance, dépression et tendances suicidaires. Il existe une corrélation entre l'usage prolongé du cannabis et la dépression chez certains patients mais il reste difficile de dire si le cannabis produit la dépression ou si la dépression favorise une consommation chronique… Différentes études, à la crédibilité variable, suggèrent des liens entre schizophrénie ou psychose38 et cannabis39.
Selon une étude40, il n’y aurait aucune différence sur le plan cérébral entre ceux qui ont régulièrement fumé de la marijuana au cours de leur adolescence et ceux qui n’en ont jamais fait usage. Une autre étude41 affirme plutôt que les personnes prédestinées à la schizophrénie voient leurs symptômes précipités lorsqu'elles commencent à consommer pendant l'adolescence. La consommation intensive de dérivés concentrés, comme l'huile de haschisch, favorise, particulièrement à l'adolescence, l'apparition des troubles psychotiques. Le cannabis est un produit addictif qui peut conduire à l'addiction avec les conséquences relationnelles, sociales et personnelles que cela entraine.
En 2019, il est établi que fumer du cannabis augmente très significativement le risque de psychose ultérieure42.
Troubles physiques
Des troubles de comportement sont observés chez l'animal de laboratoire qui y est exposé, y compris chez des espèces très éloignées des mammifères comme l'araignée. Le cannabis est un des produits dont les effets ont été testés sur des araignées dès les années 1950. Comme pour d'autres drogues, les araignées qui y sont exposées, même à de faibles doses, ont produit des toiles tout à fait anormales43,44,45. Plus la toxicité du produit est élevée, plus l'araignée laisse de manques dans sa toile46.
À long terme, les effets sur l'homme ont besoin d'être étudiés. On[Qui ?] cite cependant des affections durables des voies respiratoires similaires au tabac : toux, cancer bronchique, bronchite chronique, emphysème (du fait d'inhalations profondes et prolongées). Par ailleurs, l'inhalation de la combustion de produits de coupe souvent présents dans le haschisch expose l'usager à des risques aussi aléatoires que néfastes. L'herbe a été exceptionnellement coupée à l'eau, au sable voire au verre pilé afin d'alourdir la masse et donc d'augmenter les prix47. Une dépendance physique existe, même si elle est moins marquée que pour d'autres produits, probablement du fait de la demi-vie plus longue du THC dans le corps. Il faut également signaler qu'une dépendance physique au tabac, utilisé dans la confection du joint, se manifeste très souvent chez les fumeurs réguliers de cannabis. Cependant, un joint peut également être confectionné uniquement avec la substance. Selon une étude d'une association de consommateurs, fumer trois joints équivaut à fumer un paquet de cigarettes. La fumée de cannabis contient sept fois plus de goudron et de monoxyde de carbone que la fumée du tabac seul48,49,50. Cet essai est en contradiction avec d'autres travaux scientifiques qui estiment que « fumer du cannabis n'accroît pas le risque de cancer51,52 » ou que les risques cancérigènes sont à imputer à la présence de nicotine due au mélange avec du tabac53. Alternativement à la combustion, l'usage d'un vaporisateur, en vente libre, délivre une vapeur de cannabinoïde pratiquement pure54.
La consommation à l'aide d'une pipe à eau augmente très fortement l'inhalation de produits toxiques55.
Syndrome cannabinoïde
Le syndrome cannabinoïde (ou hyperémèse cannabique, ou syndrome d'hyperémèse cannabinoïde en traduction de l'anglais : cannabinoid hyperemesis syndrome) se définit chez les consommateurs chroniques de cannabis par des épisodes récurrents de douleurs abdominales, nausées et vomissements. Les symptômes sont améliorés par des douches et bains compulsifs d'eau chaude. Le traitement définitif reste le sevrage.
La première description a été faite en 2004 en Australie par Allen et al.56. En 2009, aux États-Unis, Sontineni et al. ont proposé des critères cliniques de diagnostic57, confirmés en 2012 par une revue de la littérature menée par Simonetto et al. portant sur 98 sujets58. En 2013, Fabries et al. ont rapporté une série française à Marseille59.
Critères pour le diagnostic de syndrome cannabinoïde
Des critères diagnostiques ont été proposés58 :
| Essentiel |
Consommation chronique de cannabis |
| Majeurs |
Nausées et vomissements récurrents
Guérison des symptômes à l'arrêt de la consommation de cannabis
Amélioration des symptômes par des douches et bains d'eau chaude
Douleurs abdominales, épigastriques ou péri-ombilicales intenses
Utilisation hebdomadaire de cannabis |
| Mineurs |
Normalité des examens biologiques, radiographiques et endoscopiques
Âge inférieur à 50 ans
Amaigrissement supérieur à 5 kg
Prédominance matinale des symptômes
Absence de troubles du transit |
Conception et reproduction
La consommation régulière de cannabis chez l'homme, contribue à de nombreux facteurs comme une baisse de la fertilité (délétion de la spermatogenèse)60,61 et un doublement du risque de développer un cancer des testicules (y compris en usage thérapeutique)62. De plus, ces tumeurs sont de type non-séminomateuses, et donc relativement résistantes à la radiothérapie, ce qui implique une chimiothérapie62. Le mécanisme d'induction du cancer implique probablement les cannabinoïdes du cannabis qui interfèrent avec ceux produits par le corps humain, normalement en faible quantité et à l'occasion de certaines stimulations, notamment lors de la fécondation, permettant l'activation des spermatozoïdes. L'« hyper activation » induite par la consommation de cannabis semble entraîner une infertilité, mais aussi un développement anormal des cellules reproductrices qui pourrait être à l'origine de ce doublement du risque de cancer du testicule62 (Le cancer des testicules est devenu le premier cancer chez l'Homme entre 15 et 45 ans62 (avec environ 10 % de mortalité62).
Durant la grossesse, la consommation de cannabis risque d'entraver l'activité cérébrale du fœtus, retardant le développement du cerveau in utero63,64. La tératogénicité de la consommation de cannabis durant la grossesse semble cliniquement non significative. Cependant, après une exposition in utero au cannabis, des atteintes cognitives (déficits de l’attention, Hyperactivité, perturbation de certains tests cognitifs) et de certaines fonctions d’exécution.
pendant les années d'enfance ont été observées, avant tout sur l'attention et les tests d'hypothèses par voie visuelle65,66.
Sécurité routière
Les études concernant la conduite automobile ont des résultats hétérogènes. Une méta-étude conclut à une augmentation du risque d'accident de la route, et un doublement du risque d'accident mortel67.
La conduite sous l’emprise du cannabis double le risque d’être responsable d’un accident mortel68.
Le doublement du risque est dû aux effets du cannabis : baisse de la vigilance, mauvaise coordination, allongement du temps de réaction et diminution des facultés visuelles et auditives68.
Le cocktail cannabis/alcool multiplie par 29 le risque de causer un accident mortel68.
Aux États-Unis, pendant l'épidémie de covid-19 il a été observé dans les accidents que les cannabinoïdes sont présents chez 31,2% des usagers, et en particulier chez 32,7% des conducteurs et 31,0% des piétons. Sur cette période, les cannabinoïdes sont plus présents que l'alcool. En réalité, 64,7% des conducteurs étaient positifs à au moins une drogue69.
Autres effets
Fumer du cannabis peut être un facteur de risque de la maladie parodontale (maladie du tissu soutien des dents)70 qui est indépendant de l'utilisation du tabac.
Usage médical
Actuellement[Quand ?], dans les pays où il est autorisé, le cannabis médical est employé dans une très grande variété de maladies et de pathologies, incluant nausées et vomissements, anorexie et cachexie, spasmes, troubles du mouvement, douleurs, glaucome, diarrhées, épilepsie, asthme, dépendance et état de manque, symptômes psychiatriques, maladies auto-immunes et inflammations et insomnies71.
Consommation accidentelle
Une étude menée au Colorado entre 2005 et 2011 montre une augmentation des intoxications accidentelles au cannabis chez les enfants de douze ans et moins à partir de 2009, date de la légalisation du cannabis à usage médical dans cet État72.
En 2015, l'ANSM relève une augmentation des signalements d’intoxications pédiatriques au cannabis par ingestion accidentelle en France depuis 201473,74. En 2016, le BEH fait le même constat sur la région Paca entre 2009 et 201475.
La consommation accidentelle concerne également les animaux domestiques.
Législation
Législation sur le cannabis dans le monde
Législation sur le cannabis récréatif dans le monde
Législation sur le cannabis médical dans le monde
Législation sur le cannabis en Europe (2011)
76.
Étant donné sa rapidité de développement, ses nombreuses applications et la qualité de ses fibres, sa culture concurrencerait plusieurs secteurs industriels, c'est pourquoi le chanvre a été intégré à la convention unique sur les stupéfiants de 1961. La détention, le commerce, la promotion et la consommation de marijuana sont interdits dans la majorité des pays du monde au cours du XXe siècle : la convention unique sur les stupéfiants de 1961 proscrivant la culture du chanvre dans tous les pays signataires est indéniablement une retombée du Marihuana Tax Act de 1937 aux États-Unis. Néanmoins, les raisons historiques de cette interdiction semblent avoir été différentes de part et d'autre de l'Atlantique (bien que l'influence des prohibitionnistes américains semble déterminante). Depuis les années 2000, certains pays ont commencé à distinguer l'usage médical du cannabis de sa consommation récréative, comme c'est déjà le cas pour les autres substances psychotropes, en particulier les opiacés.
Le 77, le Canada légalise, à partir de 18 ans le cannabis acheté dans les magasins spécialisés autorisés dans la vente de ces produits. Le 1er janvier 2020, le Québec repousse l’âge légal d’en consommer à 21 ans.
La distinction entre usage médical et usage récréatif se fait dans deux pays : les États-Unis et les Pays-Bas. Aux États-Unis, le choix a été fait de tolérer la distribution de cannabis médical par l'intermédiaire de Centres de Compassion. Le patient doit au préalable être admis sur contrôle de sa maladie par le Centre Compassion. Le patient peut ensuite librement choisir la posologie et la qualité des produits mis à sa disposition pour se soigner. Néanmoins, la situation aux États-Unis reste controversée; une récente décision au niveau fédéral a contredit la politique de tolérance[réf. nécessaire]. Par le référendum du , le Massachusetts a dépénalisé la marijuana et le Michigan en a autorisé une utilisation médicale78. Aux Pays-Bas, la situation est différente. Le ministère de la Santé a depuis 2005 mis sur le marché trois qualités de cannabis médical, contenant des teneurs de tétrahydrocannabinol (THC) standardisées allant de 6 % à 18 %, et des teneurs en cannabidiol non psychoactif (CBD) allant jusqu'à 7,5 %. Ces médicaments, présentés sous forme naturelle, sont produits par la société Bedrocan et distribués en pharmacie sur prescription médicale.
La culture, la possession pour usage privé et la distribution sont généralement réglementées. Les lois varient néanmoins d'un pays à l'autre. En France, le commerce de marijuana est un délit puni de fortes amendes et de peines de prison. Dans de nombreux pays, la police exerce un pouvoir discrétionnaire, mettant en garde les usagers ou confisquant le cannabis, même en petites quantités, à usages privé ou médical.
Dépistage de la consommation
La référence est constituée par le dosage de delta-9-tetrahydrocannabinol dans le système sanguin. Le dépistage de cette substance dans la salive est possible et largement utilisé, en particulier par des contrôles policiers au bord de la route dans certains pays, comme l'Australie ou certains états des États-Unis79. Il n'existe pas de taux limite « légal » même si quelques experts estiment que le risque accidentogène est réduit en dessous d'un certain seuil80.
Notes et références
- « Parlons chanvre » [archive] dans Les Échos du chanvre, hiver 98/99, no 12 - p. 4.
- Voir sur yabiladi.com. [archive]
- Historique de la culture de cannabis au Maroc d'après l'UNODC [archive]
- Une théorie plus générale est énonce que les aspects qualitatifs dépendent de la génétique de la plante et que les aspects quantitatifs sont influencés par des facteurs environnementaux. Voir sur unodc.org. [archive]< (Fairbairn and Liebmann, 1974
- « Chemical ecology of Cannabis »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • http://mojo.calyx.net/~olsen/HEMP/IHA/iha01201.html" rel="nofollow" class="external text">Google • Que faire ?) (consulté le )
- Le cannabis sur le site du ministère de l'Intérieur français [archive]
- « spliff — Wiktionnaire » [archive], sur fr.m.wiktionary.org (consulté le )
- (en) Biga Ranx (Ft. Biffty) – Petit boze (lire en ligne [archive])
- « tarpé — Wiktionnaire » [archive], sur fr.m.wiktionary.org (consulté le )
- dagmar domenig et sandro cattacin, « Les drogues sont-elles dangereuses? : Estimations de la dangerosité des substances psychoactives », Sociograph, (lire en ligne [archive])
- « Alcool contre cannabis : l’impossible comparaison » [archive], sur www.pourquoidocteur.fr (consulté le )
- « Alcool contre cannabis : l’impossible comparaison » [archive], sur www.pourquoidocteur.fr (consulté le )
- (en) « Cannabis vs. Alcohol - Health Effects on the Body » [archive], sur www.lookah.com (consulté le )
- Robert Galibert, « Was Man Über Cannabis Wissen Sollte », www.nonaladrogue.org | www.sag-nein-zu-drogen.de, , p. 8-9 (lire en ligne [archive])
- Stéphane Eliez, pédopsychiatre et professeur à lʹUniversité de Genève, « Le lien entre cannabis et schizophrénie se précise » [archive], sur rts.ch, CQFD, (consulté le ).
- Denis Richard, Jean-Louis Senon et Marc Valleur, Dictionnaire des drogues et des dépendances, Paris, Larousse, , 626 p. (ISBN 2-03-505431-1)
- Voir sur senat.fr. [archive]
- Tableau sur la dangerosité des produits par le Pr Bernard Roques [archive]
- « CANNABIS ET SANTE - Position de l'Académie nationale de médecine » [archive], Académie nationale de médecine
- Les drogues, un piège, Marie-José Audersert, Jean-Blaise Held et Jean-François Bloch-Lainé
- Professeur Bertrand Dautzenberg, Pneumologue. Hôpital de la Pitié-Salpétrière, Paris dans l'émission Mise au Point de la TSR du 10 septembre 2006
- Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (2008) État du phénomène de la drogue en Europe [archive]: 41. (ISBN 978-92-9168-328-4)
- Rapport mondial sur les drogues, 2008 [archive] [PDF], Office des Nations unies contre les drogues et le crime.
- (en) François Beck, Romain Guignard, Jean-Baptiste Richard, Stanislas Spilka et al., « Les niveaux d’usage des drogues en France en 2010 », Tendances, no 76, , p. 1–6
- François Beck, Stéphane Legleye, Stanislas Spilka. L’usage de cannabis chez les adolescents et les jeunes adultes : comparaison des consommations européennes » [archive], Santé Publique, 2007 ;13,6:481–488.
- Rapport annuel 2006 : l’état du phénomène de la drogue en Europe [archive], qui cite CND 2006 pour l'évaluation mondiale.
- (en) P. Etevenon, « Effects of cannabis on human EEG », Adv. Biosci., 22-23, 1978, p. 659-663.
- (en) M. Taylor, K. Mackay, J. Murphy, A. McIntosh, C. McIntosh, S. Anderson et K. Welch, « Quantifying the RR of harm to self and others from substance misuse: results from a survey of clinical experts across Scotland », BMJ Open, vol. 2, no 4, , e000774–e000774 (DOI 10.1136/bmjopen-2011-000774, lire en ligne [archive], consulté le ).
- MILDT [archive].
- (en) Meier MH, Caspi A, Ambler A, Harrington H, Houts R, Keefe RS, McDonald K, Ward A, Poulton R, Moffitt TE., Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Oct 2;109(40):E2657-64. doi: 10.1073/pnas.1206820109. Epub 2012 Aug 27.
- (en) National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2017. The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research. Washington, DC: The National Academies Press DOI 10.17226/24625, p 274-275. "In sum, within the domain of learning, the Broyd et al. (2016) systematic review and the component study highlighted within that review showed strong data for the acute (immediate) impact of cannabis use on learning. However, results from three systematic reviews (Batalla et al., 2013; Broyd et al., 2016; Martin-Santos et al., 2010) reflected limited to no support for the association between the sustained effects of cannabis use after cessation and the cognitive domain of learning. Similarly, for the domain of memory, the Broyd et al. (2016) systematic review and the component study within it showed moderate to strong evidence for the acute (immediate) impact of cannabis use on memory. However, as with learning, there were limited to no data to support the association between the sustained effects of cannabis use after cessation and the cognitive domain of memory in the three systematic reviews that addressed this question (Batalla et al., 2013; Broyd et al., 2016; Martin-Santos et al., 2010)." Accéder en ligne [archive]
- Article sur Doctissimo, avec références [archive]
- David Robbe et al., Nature Neurosciences, décembre 2006.
- Jean Costentin, « Nouveau regard sur le cannabis » [archive][PDF] (page 4)
- « Cannabis : le fœtus en danger ? » [archive] [PDF], INSERM.
- Meier MH, Caspi A, Ambler A et al. Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife [archive], Proc Natl Acad Sci USA, 2012;109:E2657-E2664
- Quand la maladie psychique est aggravée d'une toxicomanie, conférence du Dr Bodenez [archive]
- (en) Moore THM, Zammit S, Lingford-Hughes A et al., Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review [archive], The Lancet, 2007, 370, p. 319-328 ; voir aussi « Une corrélation entre usage du cannabis et psychoses » [archive], Le Monde, 29 juillet 2007.
- Voir Schizophrénie : Cannabis
- (en) Study: Little damage from marijuana, United Press International (copie de l'article en ligne [archive]).
- Découverte le 18 mars 2006, télévision de Radio-Canada.
- Stéphane Eliez (pédopsychiatre et professeur à lʹUniversité de Genève), « Le lien entre cannabis et schizophrénie se précise » [archive], CQFD, sur Radio télévision suisse, (consulté le ).
- From issue 1975 of New Scientist magazine, 29 April 1995, page 5
- Images [archive] de toiles faites par des araignées exposées à 3 toxines (marijuana, caféine, benzedrine)
- Peter N.Witt & Jerome S. Rovner, Spider Communication: Mechanisms and Ecological Significance, Princeton University Press -1982.
- Paul Hillard, spécialiste araignée au Natural History Museum de Londres : « It appears that one of the most telling measures of toxicity is a decrease, in comparison with a normal web, of the numbers of completed sides [of a web]; the greater the toxicity, the more sides the spider fails to complete »
- De l'herbe coupée au verre pilé [archive], article de Libération, samedi 23 septembre 2006
- « Le cannabis - 3 joints = 1 paquet de cigarette », 60 millions de consommateurs, n° 404, avril 2006
- « Fumer trois joints équivaut à fumer un paquet de cigarettes », Le Figaro, 26 mars 2006 (lire ne ligne [archive]).
- « Le cannabis moins toxique que la clope : une idée fumeuse », Libération, 28 mars 2006 (lire en ligne [archive]).
- (en) Marijuana use and cancers of the lung and upper aerodigestive tract: results of a case-control study [archive], Morgenstern H, et al. Présentation à la Conférence ICRS sur les cannabinoïdes, 24-, Clearwater, États-Unis
- Study Finds No Cancer-Marijuana Connection par Marc Kaufman dans le Washington Post, vendredi
- (en) Melamede RJ. Harm Reduct J. 2005;2(1):21; United Press International, .
- (en) Cal NORML/MAPS Study Shows Vaporizer Can Drastically Reduce Toxins in Marijuana Smoke [archive].
- OxyRomandie, membre de l'Union internationale contre le cancer dans l'émission Mise au point de la TSR du 10 septembre 2006.
- (en) Allen JH. et al. « Cannabinoid hyperemesis: cyclical hyperemesis in association with chronic cannabis abuse » Gut 2004;53(11):1566-70. PMID 15479672 [archive]
- (en) Sontineni SP. et al. « Cannabinoid hyperemesis syndrome: clinical diagnosis of an underrecognised manifestation of chronic cannabis abuse » World J Gastroenterol. 2009;15(10):1264-6. PMID 19291829 [archive]
- (en) Simonetto DA. et al. « Cannabinoid hyperemesis: a case series of 98 patients » Mayo Clin Proc. 2012;87(2):114-9. PMID 22305024 [archive]
- (en) Fabries P. et al. « Syndrome cannabinoïde [Cannabinoid hyperemesis syndrome] » Presse Med. 2013;42(11):1531-3. PMID 23498644 [archive] DOI 10.1016/j.lpm.2012.11.013
- Cannabis : la fertilité masculine serait perturbée [archive] sur le site non officiel du débat sur la drogue.
- Cannabis, surpoids : les ennemis de votre fertilité [archive] dans la section Infertilité de Doctissimo
- (en) John Charles A. Lacson MS. et al. « Population-based case-control study of recreational drug use and testis cancer risk confirms an association between marijuana use and nonseminoma risk » DOI 10.1002/cncr.27554 (lire en ligne [archive] ; étude soutenue par le National Cancer Institute), citée par EurekAlert! : Marijuana use may increase risk of testicular cancer [archive] ; 10 septembre 2012.
- « Cannabis : le fœtus en danger ? »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • http://www.forumlabo.com/2006/actus/actus/INSERM/0705cannabis.htm" rel="nofollow" class="external text">Google • Que faire ?) (consulté le ) sur le site forumlabo.com
- (en) « Cannabis link to risk of miscarriage »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • http://www.hindu.com/thehindu/holnus/008200608012321.htm" rel="nofollow" class="external text">Google • Que faire ?) (consulté le ) sur le site du magazine The Hindu
- Michael Staub et Rudolf Stohler de la clinique universitaire psychiatrique de Zurich, dans le forum médical suisse. Texte en allemand. Page 1130
- « Cannabis - Grossesse et allaitement » [archive], sur Lecrat.fr, mise à jour : 6 mars 2018 (consulté le )
- (en) Asbridge M, Hayden JA, Cartwright JL, Acute cannabis consumption and motor vehicle collision risk: systematic review of observational studies and meta-analysis [archive], BMJ, 2012;344:e536
- https://www.securite-routiere.gouv.fr/dangers-de-la-route/la-drogue-et-la-conduite [archive]
- https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/50941/dot_50941_DS1.pdf [archive]
- Thomson WM, Poulton R, Broadbent JM, Cannabis smoking and periodontal disease among young adults [archive], JAMA, 2008;299(5):525-531
- Association Internationale pour le Cannabis Medical [archive] ou (en) Medical Uses [archive] sur le site de l'Association Internationale pour le Cannabis Medical [archive], consulté en février 2011
- (en) George Sam Wang et Genie Roosevelt, « Pediatric Marijuana Exposures in a Medical Marijuana State », JAMA Pediatrics, vol. 167, no 7, , p. 630–633 (DOI 10.1001/jamapediatrics.2013.140, lire en ligne [archive])
- « Augmentation des signalements d’intoxications pédiatriques au cannabis par ingestion accidentelle — Point d'information » [archive], sur ANSM, (consulté le )
- Martin Garret et Charlotte Pion, « Augmentation du nombre d’intoxications pédiatriques au cannabis », Vigilances, ANSM, no 67, , p. 7 (lire en ligne [archive])
- Guilhem Noel, Florian Franke, Philippe Minodier, Magali Guarella, Sophie Miramond et Gilles Viudes, « Augmentation entre 2009 et 2014 des admissions aux urgences liées au cannabis chez l’adulte et l’enfant en région Paca », BEH, no 43, , p. 775–781 (lire en ligne [archive])
- Carte établie selon les données de l'émission Un œil sur la planète diffusée sur France 2 en mars 2011.
- Le Devoir, [1] [archive].
- (en) « National ballot questions » [archive], Boston.com (consulté le )
- Hall W, Driving while under the influence of cannabis [archive], BMJ, 2012;344:e595
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Bibliographie
- Julien Lefour, La culture du cannabis en France in Alcoologie et addictologie vol.28, no 2, p. 149-154. 2006.
- Jack Herer, L'empereur est nu ! Le chanvre et la conspiration contre le cannabis, 01/10/1996, éditions du Lézard - (ISBN 2-910718-08-5)
- Dr Franjo Grotenhermen, Cannabis en Médecine : un guide pratique des applications médicales du cannabis et du THC, 04/10/2009, éditions indica - (ISBN 978-2-9534898-0-4)
- Bruno Blum, Culture Cannabis, éditions Scali, 2007.
- (en) Martin A. Lee, Smoke Signals: A Social History of Marijuana - Medical, Recreational and Scientific, éditions Scribner, 2013 (ISBN 978-1-4391-0261-9)
Articles connexes
Liens externes
-
Triéthanolamine
| Triéthanolamine |
  |
| Identification |
|---|
| Synonymes |
2,2',2-nitrilotriéthanol,
trihydroxytriéthylamine
|
|---|
| No CAS |
102-71-6 |
|---|
| No ECHA |
100.002.773 |
|---|
| No CE |
203-049-8 |
|---|
| Code ATC |
D03AX12 |
|---|
| SMILES |
|
|---|
| InChI |
|
|---|
| Apparence |
Liquide hygroscopique incolore visqueux ou cristaux d'odeur caractéristique1. |
|---|
| Propriétés chimiques |
|---|
| Formule |
C6H15NO3 [Isomères] |
|---|
| Masse molaire3 |
149,188 2 ± 0,007 g/mol
C 48,3 %, H 10,13 %, N 9,39 %, O 32,17 %, |
|---|
| Moment dipolaire |
3,57 D2 |
|---|
| Diamètre moléculaire |
0,674 nm2 |
|---|
| Propriétés physiques |
|---|
| T° fusion |
21,6 °C1 |
|---|
| T° ébullition |
335,4 °C1 |
|---|
| Paramètre de solubilité δ |
21,6 J1/2 cm−3/2 (30 °C)2 |
|---|
| Miscibilité |
dans l'eau : miscible1 |
|---|
| Masse volumique |
1,124 2 g cm−34 |
|---|
| T° d'auto-inflammation |
324 °C1 |
|---|
| Point d’éclair |
179 °C1 |
|---|
| Limites d’explosivité dans l’air |
3,6–7,2 %vol1 |
|---|
| Pression de vapeur saturante |
0,01 hPa (20 °C)[réf. souhaitée] |
|---|
| Thermochimie |
|---|
| Cp |
|
|---|
| Propriétés optiques |
|---|
| Indice de réfraction |
n D 25  1,4832 1,4832 |
|---|
| Précautions |
|---|
| SIMDUT7 |
|---|
Produit non contrôlé
|
| NFPA 704 |
|---|
|
|
| Classification du CIRC |
|---|
| Groupe 3 : Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'Homme6 |
| Écotoxicologie |
|---|
| LogP |
–2,31 |
|---|
|
| Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire. |
modifier  |
La triéthanolamine est aussi connue sous le nom de trolamine, ou le nom systématique 2,2',2-nitrilotriéthanol. Sa formule brute est C6H15NO3.
Il s'agit d'un composé organique qui est une amine tertiaire et un triol. Comme d'autres amines, la triéthanolamine agit en tant que base faible due à la seule paire d'électrons sur l'atome d'azote.
Brûlures

Échantillon liquide de triéthanolamine.
La trolamine est le principe actif de la Biafine, crème utilisée contre les brûlures et les plaies superficielles. D'après la Banque de données automatisée sur les médicaments8, la trolamine a un effet analgésique en association avec de l'aspirine. C'est aussi un émulsifiant.
Cosmétique
Cet ingrédient est employé comme compensateur de pH dans des préparations cosmétiques pour une vaste gamme de produits — lotion pour la peau, gels pour les yeux, crèmes hydratantes, shampoings, crème dépilatoire, mousse à raser, etc. La triéthanolamine est un allergène reconnu, à pouvoir allergisant modéré.
Comme toutes les amines, elle peut créer des nitrosamines, mais ceci demeure peu probable avec les basses concentrations utilisées dans les produits cosmétiques. L'efficacité des crèmes antiride repose sur la pénétration du produit dans les couches profondes de la peau, mais certains contestent cette capacité de pénétration. Il n'y a pas d'étude gouvernementale sur l'innocuité de la triéthylamine[Quoi ?] sur la peau à long terme. Les seules études qui existent ont été produites par les compagnies pharmaceutiques elles-mêmes9. Les nitrosamines sont considérées comme cancérigènes. Le manque de données sur ce produit[Lequel ?] empêche d'évaluer de façon adéquate son effet mutagène.
Elle est énumérée sous le programme 3, partie B, de la convention chimique sur les armes car elle peut être employée dans la fabrication du gaz moutarde.
Risques
La triéthanolamine est inflammable. Le feu qui en résulte peut être éteint avec du dioxyde de carbone, de la mousse, de la poudre chimique sèche ou de la mousse d'alcool ; il ne faut jamais utiliser d'eau pulvérisée car elle pourrait provoquer la formation d'écume. De plus, il faut éviter d'utiliser de la mousse pulvérisée sur un bassin chaud en flamme.
La triéthanolamine est incompatible avec les acides ainsi qu'avec les oxydants forts tels que l'ozone et l'oxygène liquide.
L'exposition à la triéthanolamine ou à ses vapeurs pourrait engendrer l'irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires. Une exposition répétée ou prolongée à ce produit peut avoir une action dégraissante sur la peau. Il peut aussi causer des rougeurs, des gerçures et de la desquamation.
Notes et références
- TRIETHANOLAMINE [archive], Fiches internationales de sécurité chimique
- (en) Yitzhak Marcus, The Properties of Solvents, vol. 4, Angleterre, John Wiley & Sons, , 239 p. (ISBN 978-0-471-98369-9, LCCN 98018212).
- Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 » [archive], sur www.chem.qmul.ac.uk.
- (en) J. G. Speight et Norbert Adolph Lange, Lange's Handbook of Chemistry, New York, McGraw-Hill, , 16e éd., 1623 p. (ISBN 978-0-07-143220-7, LCCN 84643191), p. 2.289.
- (en) Carl L. Yaws, Handbook of Thermodynamic Diagrams : Organic Compounds C8 to C28, vol. 2, Huston, Texas, Gulf Pub. Co., , 396 p. (ISBN 978-0-88415-858-5, LCCN 96036328).
- IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, « Évaluations Globales de la Cancérogénicité pour l'Homme, Groupe 3 : Inclassables quant à leur cancérogénicité pour l'Homme » [archive], sur http://monographs.iarc.fr [archive], CIRC, (consulté le )
- « Triéthanolamine [archive] » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009.
- www.biam2.org/www/Sub2163.html
Articles connexes