France-La Grande Armé(e)-Artilleries(Lourde-à cheval-Navale-Campagne-Portés)-Canonniers-Grenadiers-Cavaleries-Dragons-Contre-Maitre-inspecteurs-contrôleurs-Formateurs--états-Major-Munitions-Mitrailleuses-Chasseurs-éclaireurs-Guardes-Les Blindés(Blindages)Stratégies-Tactiques-Logistiques-Approvisionements-Couvertures-Soutiens=Appuis-Tourelle à 360 degrés d'Angle-Snipers-Mineurs=Place les Mines ou les pièges ou les bombes
Artillerie
On appelle artillerie l'ensemble des armes collectives ou lourdes servant à envoyer, à grande distance, sur l'ennemi ou sur ses positions et ses équipements, divers projectiles de gros ou petit calibre : obus, boulet, roquette, missile, pour appuyer ses propres troupes engagées dans une bataille ou un siège. Le terme serait apparu environ au XIIIe siècle, dérivant du vieux français artillier qui désignait les artisans, fabricants d'armes et équipements de guerre. Ces artisans ont été pendant longtemps les seuls spécialistes dans le service de ces armes puisqu'ils les fabriquaient et les essayaient avant livraison. C'est pourquoi, jusqu'au XVIIIe siècle, ils étaient commissionnés par les souverains pour les servir à la guerre.
Ainsi et par extension, le nom d'artillerie désigne l'ensemble des produits fabriqués par les artilleurs et par les fonctions de mise en œuvre et de soutien qui lui sont rattachées. Il finit donc par désigner aussi l'ensemble des troupes chargées de mettre en œuvre ces armes d'où la création d'unités militaires et d'armes spécialisées. L'emploi de l'artillerie nécessite le renseignement, la surveillance, l'acquisition d'objectif, le réglage du tir, la transmission des informations, une logistique complexe qui comprend le transport des pièces, la construction d'itinéraires et de moyens de franchissement à cet effet, l'approvisionnement en munitions, et l'entretien des armes. Par ailleurs, à partir d'elle se développent toutes les fonctions relatives à la fortification et aux sièges, de la conception et de la construction des places fortes ou des fortifications de campagne à l'élaboration des sapes et des mines destinées à les investir.
De ce fait, tout au long de l'histoire militaire, elle donne naissance aux armes du génie (fortifications, routes, pontonniers), des transmissions, de l'aérostation, de l'aviation légère des armées de terre, du train des équipages (d'artillerie), du matériel (parc d'artillerie) et, par transfert, aux chars de combat regroupés à l'origine sous le terme d'artillerie d'assaut.
Enfin l'artillerie à feu succédant à l'artillerie à jet, concentre toutes les fonctions relatives à l'utilisation des poudres, y compris, comme en France jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, à l'élaboration, à la fabrication et à l'utilisation des armes à feu d'infanterie.
En raison de sa complexité, elle reste longtemps l'arme scientifique par excellence, attirant nombre de savants. À partir de 1794, en France, l'École polytechnique lui fournit de manière privilégiée ses cadres jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. De plus, elle est le symbole de la puissance car elle nécessite des investissements importants. Sous Louis XIV, elle reçoit la devise d'Ultima Ratio Regum, le « dernier argument des rois ». Elle est l'arme déterminante pour beaucoup de grands chefs militaires comme Napoléon Ier (qui était artilleur de formation). Ses évolutions conditionnent profondément la manière de faire la guerre.
Histoire
L'artillerie névrobalistique
Antiquité
En Asie, la Chine est la première à maîtriser l’artillerie (pào bīng). Celle-ci est souvent reconnue comme étant l'ancêtre de l'artillerie occidentale. L’arbalète et la baliste sont apparues pendant la période des Royaumes combattants (-). C'était l'outil des tirs de saturation qui étaient une des tactiques favorites des armées asiatiques. Des exemplaires de ces « armes du diable » ont été découverts avec l’Armée de terre cuite du mausolée de l’empereur Qin shi Huang (-), dont une version améliorée pour tirer à répétition (Chu ko nu).
En Europe, au milieu du IVe siècle av. J.-C., les Grecs utilisaient une large gamme d’armes de jet lourdes : lithobolos (lanceurs de pierres) et catapeltai (lanceurs de flèches) agissant par tension d’arc, torsion à câbles ou effet de levier.
La baliste est décrite au Ier siècle av. J.-C. par l'auteur grec Héron d'Alexandrie dans un traité sur la fabrication des machines de jet (Belopoiïca). Il attribue à Ctésibios d’Alexandrie cet agrandissement de la gastrophène, ancêtre de l’arbalète, à la demande de Denys l'Ancien, tyran de Syracuse, en
Pour attaquer la Perse en , Alexandre disposait d’une forte artillerie servie par un corps d'ingénieurs spécialisés. Elle jouera un rôle essentiel dans la plupart de ses victoires. Notamment, c’est elle qui a couvert la traversée du Iaxarte. Balistes et scorpions ont permis la prise de Tyr en protégeant la construction d’une jetée pour amener à portée des murailles une catapulte géante qui a ouvert une brèche pour l’assaut final. Ils ont aussi contribué à la victoire décisive de Gaugamèles en brisant la formation compacte des Immortels de Darius, préalable indispensable à la charge définitive d’Alexandre et ses hétaires.
Les Romains ont découvert l’artillerie grecque après leurs guerres contre la Macédoine (-). Mais celle-ci n’y a pas joué de rôle, la plupart des batailles ayant été des escarmouches de hasard dégénérant en affrontements confus opposant des légions expérimentées et mobiles à des phalanges statiques formées à la hâte par des chefs incompétents. Selon leurs habitudes, les ingénieurs romains ont vite adopté et amélioré ces engins nouveaux pour lesquels leurs généraux ont codifié des doctrines d’emploi efficaces. Ils en feront un très large usage. Sous Auguste, chaque légion déploie sur le champ de bataille 55 balistes et 10 onagres, auxquels s’ajoutent des machines encore plus lourdes pour les sièges. Ces pièces sont fréquemment mentionnées dans les écrits romains (César, Végèse, Arrien…) et figurent sur plusieurs monuments, comme la colonne Trajane.
Moyen Âge
Quelques types d'engins névrobalistiques :
Fin du Moyen Âge
L’artillerie connaît un progrès important avec la découverte d'une énergie propulsive, rapidement et directement utilisable, la poudre noire. La poudre à canon elle-même est généralement reconnue pour avoir été découverte en Chine vers le IXe siècle, durant la dynastie Tang (618-907). La première mention de la formule date de 1044, dans le Wǔjīng zǒngyào 武經總要. La première utilisation semble avoir été faite le 28 janvier 1132, utilisée par le général Han Shizhong pour prendre une ville dans le Fujian.
Lors du siège de Séville entre l’été 1247 et novembre 1248, des écrits attestent que des canons ont été utilisés contre le royaume de Castille par les défenseurs maures durant le siège, ce qui serait la première utilisation de poudre à canon en Occident.
Les premières descriptions de la poudre noire en Europe datent du milieu du XIIIe siècle, dans un ouvrage daté de 1249, attribué à un moine franciscain britannique, Roger Bacon. Simultanément, on retrouve une description à Cologne chez un certain Albertus Magnus (Albert le grand). Après quelques essais décevants de fusées incendiaires, on imagina d'utiliser les gaz produits par la déflagration comme propulseur dans un tube pour lancer un boulet :la bombarde était née.
Contrairement à la légende, le moine Berthold Schwartz (1310-1384) n'a pas inventé la poudre mais il aurait conçu et développé les premiers tubes en bronze. Toutefois, certains auteurs mettent son existence en doute.
L'artillerie consiste en la réunion de la poudre comme agent de propulsion et le tube comme agent de lancement et de guidage. Sa première apparition notable a lieu à Metz, de 1324 à 1326, pendant ce que l'on a appelé la guerre des quatre seigneurs. Une couleuvrine et une serpentine ont été utilisées. Les canons de cette époque n'étaient guère puissants, et leur emploi le plus utile était la défense des places fortifiées, comme pour Breteuil où, en 1356, les Anglais assiégés utilisèrent un canon pour détruire une tour d'assaut française. À la fin du XIVe siècle, les canons pouvaient défoncer les toits d'un château, mais restaient impuissants devant ses murailles.
Canons médiévaux en métal.
Après une utilisation anecdotique de tubes en bois, les premiers tubes en métal sont construits au début du XIVe siècle en Angleterre, ainsi qu'en Italie, en France, en Allemagne et en Espagne. La première image d'un canon date de 1326, sur un manuscrit anglais.
La métallurgie médiévale ne permet pas de fondre des canons d'un seul bloc, ils sont dans un premier temps réalisés d'une manière analogue aux tonneaux, avec des pièces de fer forgé (les douelles) ou même de bois, tenues ensemble par des cerclages en fer ou même en cuir (en Italie par exemple), dans les cas de tubes à douelles. Par la suite, les tubes à douelles sont remplacés par des tubes à spirales, constitués d'un fin feuillet de fer entouré autour d'une âme en bois dur, renforcé en l'entourant à chaud de plusieurs fines barres de fer de section carrée, entourées en sens contraire.
Dans ces conditions, les tubes sont très souvent sujets à des éclatements inopinés, dangereux, voire fatals pour leurs utilisateurs au-delà d'une dizaine de coups. Les tubes étaient testés huit fois devant l'acheteur et étaient garantis pour 400 coups, d'où l'expression « faire les 400 coups ». En raison de cette fragilité, les charges de poudre propulsive sont nécessairement limitées, réduisant ainsi la portée et la puissance à l'impact. De plus, les charges perdent beaucoup d'efficacité du fait de l'importante traînée des projectiles, le vent de boulet étant difficile à maîtriser en raison du manque de régularité dans leur fabrication.
Un autre problème pour l'artillerie de siège est lié à la nature des projectiles. En pierre dans un premier temps, ils ont tendance à éclater lors de l'impact contre un objectif solide, comme une muraille d'enceinte.
À la fin du Moyen Âge, l'artillerie est pleinement entrée dans les modes de guerre. Elle est difficile à employer sur le champ de bataille en raison de son manque de mobilité. Toutefois, elle a un effet indéniable, elle tue et a un effet psychologique majeur. Elle a été utilisée par les frères Bureau à la bataille de Castillon (fin de la guerre de Cent Ans) et il en est fait mention par le Florentin Giovanni Villani dans son récit de la bataille de Crécy (1346), même si aucun autre élément ne corrobore ce seul texte (aucun chroniqueur anglais, entre autres, n'en faisant état).
Les frères Bureau, au service du roi de France, participent à une rationalisation de l'arme qui sera un élément déterminant de la victoire française à la fin de la guerre de Cent Ans.
Renaissance
Variété des pièces
Pierrier à boîte « Meurtrière », 1510 France
note 1,1.
La classification des pièces d'artillerie telle qu'établie par Maximilien d'Autriche (1459-1519) est très « poétique ».
- Pour l'artillerie lourde
- Le canon
- Le demi-canon
- Le quart de canon
- Le basilic, ou longue couleuvrine
- Pour l'artillerie de campagne
- Pour l'artillerie de marine
Canons de bronze
Peu à peu, la métallurgie trouve de meilleurs techniques et matériaux pour la fabrication des pièces. Les armes en métal coulé, chargées par la bouche, sont d'abord faites de fonte.
À partir de 1450, le bronze s'impose comme matériau de fabrication privilégié2. Bien que coûteux, il présente l'avantage d'être un métal plus « souple » que la fonte, de se déformer plutôt que d'éclater en cas de surpression. La tendance est à l'allongement des tubes pour améliorer à la fois leur précision et leur portée. L'usage des moules, comme pour fondre les cloches, permet de réaliser des pièces d'un seul tenant, de les produire en grande série avec des calibres standardisés3.
L'affût
Affût de contrescarpe de 4.
Parallèlement, on travaille aussi à rendre l'artillerie plus mobile et plus précise. Jusqu'en 1480, l'affût est un support inerte. À cette date, les frères Bureau développent l'affût à roues et les tourillons, axes fixés de part et d'autre du tube pour permettre son réglage en site. Ces innovations marquent le passage de la bombarde au canon, car elles permettent un pointage plus aisé, en portée comme en direction, et une bien meilleure mobilité.
Le projectile
Le problème des projectiles est résolu, au milieu du XVe siècle, d’abord en cerclant de fer les projectiles en pierre (innovation des frères Jean et Gaspard Bureau), puis en les remplaçant par des boulets en fer battu, plus résistants. Les boulets métalliques en fer, trois fois plus denses que la pierre (à diamètre égal, ils pèsent trois fois plus lourd) et de tailles standardisées, font plus de dégâts que les boulets de pierre : ils n'éclatent pas à l'impact comme ceux-ci le faisaient fréquemment mais, au contraire, ce sont les maçonneries qu'ils percutent qui volent en éclats et se désagrègent. Cette puissance de percussion va permettre de réduire le diamètre des boulets, donc le calibre des tubes qui deviennent plus légers, plus transportables, ce qui favorise le développement de l'artillerie de campagne très mobile3.
Par ailleurs, la fusée propulsée (ou roquette) est toujours utilisée, mais demeure un instrument de combat marginal, en raison de son manque de précision et de sa dangerosité.
Emploi opérationnel de l’artillerie
L'artillerie se révèle une arme efficace de siège et de campagne lors des campagnes d'Italie de Charles VIII à la fin du XVe siècle, où toutes les places fortes assiégées par l'armée française succombent les unes après les autres. Cette efficacité de l'artillerie se confirme au tout début du XVIe siècle, durant la Guerre de la Ligue de Cambrai, où les Italiens découvrent avec effroi que leurs murailles ne résistent pas à l'artillerie de François 1er4. Il n'existe plus alors de forteresse imprenable, car plus un mur est haut, plus il est vulnérable au tir des boulets métalliques. En outre, les dommages faits aux habitations d'une ville assiégée sont considérables, notamment grâce aux tirs paraboliques (tirs courbes) qui, passant par-dessus les murailles de l'enceinte, viennent s'abattre sur les toits des habitations qu'ils défoncent.
Au XVIe siècle, l'artillerie de siège est devenue si efficace que les techniques de fortification doivent être repensées de fond en comble. Avec la multiplication des obstacles pour parvenir à l'enceinte intérieure, le tir en enfilade ou le tir flanquant devient un des deux critères majeurs de conception. Il vise à la fois à le favoriser chez le défenseur et à le rendre le plus difficile possible à l'attaquant. Il donne naissance au tracé à l'italienne ou tracé bastionné5.
La période classique : arme de moins en moins auxiliaire et marque de puissance
L'artillerie connaît une phase importante de stagnation technologique entre le XVIIe et la première moitié du XIXe siècle. Les armes mises en œuvre par les armées de Louis XIV sont peu ou prou les mêmes que celles de Napoléon. Les variations se font surtout dans la tactique et dans l'emploi de l'artillerie. Cette période est donc dénommée "classique".
Mise en œuvre de l’artillerie classique
Outils pour le chargement d'un canon.
Le chargement des canons se fait par la gueule. La première opération est le chargement :
- la lanterne (ou cuillère, à long manche) sert à doser et déposer une charge de poudre (avant que ne soient utilisées des gargousses de toile),
- le refouloir (en forme de tampon sur un manche) sert à enfoncer et tasser les deux bourres dans le canon (l'une entre la poudre et le boulet, et l'autre devant le boulet pour éviter qu'en roulant il ne s'écarte de la poudre avant la mise à feu).
Une fois le canon chargé, la gargousse (qui contient la poudre) est crevée avec le dégorgeoir à gargousse que les artificiers enfoncent par la lumière (fin canal cylindrique percé dans le fût du canon, tout à l'arrière de celui-ci). De la poudre fine est versée dans la lumière pour amorcer la charge. Puis le feu y est mis par le boutefeu (manche autour duquel est enroulée une mèche qui reste toujours allumée).
Une fois le coup tiré, le fût du canon est débarrassé des débris du tir avec une brosse (dotée d’un long manche), puis nettoyé avec un écouvillon (doux)6.
Effets de l'artillerie
Jusqu'au milieu du XIXe siècle, les effets de l'artillerie sont essentiellement fondés sur l'énergie cinétique du projectile.
Pour ce qui est de l'artillerie de campagne, les tirs sont directs, c'est-à-dire que les canons et les objectifs sont à vue. Il n'y a donc pas de défilement possible, ni de tirs au-dessus des troupes. La visée se fait directement sur le tube.
L'artillerie est particulièrement visible, notamment parce qu'elle doit occuper des points hauts et parce qu'elle émet quantité de fumée.
Deux types d'effets physiques sont attendus. D'une part, dans le combat éloigné, le boulet renverse les lignes de fantassins, de cavaliers ou les batteries d'artillerie adverses en tombant et en rebondissant dans leur rangs (méthode dite du « tir à ricochet » qui a été systématisée par Vauban lors du siège d'Ath). En combat rapproché, d'autre part, la boîte à mitraille projette des centaines de micro-projectiles comparables aux plombs d'un fusil de chasse.
Les types de boulets sont divers : boulet simple, boulets ramés avec des chaînes, boulets encastrés avec des « ailes », boulets conjugués, boulets chauffés à blanc, etc.
Pour ce qui est de l'artillerie de siège, le tir peut être direct lorsqu'il s'agit de détruire une muraille visible ou atteindre des hommes en position sur celle-ci. Il peut être parabolique (= plongeant), c'est-à-dire avec un angle de tir supérieur à 45° pour détruire les objectifs militaires ou civils protégés au milieu de la citadelle. Cet effet physique crée un effet psychologique multiplicateur souvent décisif. C'est pourquoi se développent des systèmes de fortifications « à l’italienne » qui mettent notamment à défilement les murailles des citadelles dans des fossés pour éviter les coups directs de l'artillerie sur la maçonnerie.
Les évolutions
Au début du XVIIe siècle, l'artillerie demeure une arme auxiliaire. Sa construction, sa mise en œuvre, sa logistique et son organisation restent entre les mains d'une administrations civile. Elle reste l'apanage des puissants, ceux qui peuvent se payer des canons, « ultima ratio regum » (« l'arme ultime des rois ») proclame la devise de l'artillerie de Louis XIV. Elle déploie des matériels divers, pléthoriques et très peu standardisés. La guerre de Trente ans qui concerne toute l'Europe oblige à une rationalisation radicale qui dure jusqu'à la fin des guerres napoléoniennes.
Réorganisation de l'artillerie
En 1630, le roi de Suède Gustave-Adolphe constitue une nouvelle artillerie, plus mobile et plus légère. Il limite le nombre de calibres disponibles. Il établit une distinction entre l'artillerie lourde destinée aux sièges, à la guerre de position ou à la protection des franchissements, l'artillerie de campagne, qui appuie l'infanterie, l'artillerie légère qui est mise en œuvre par les fantassins eux-mêmes.
La compagnie d'artillerie de Ferrand de Cossoy, début
XVIIIe siècle.
En France, à partir de 1668, l'administration de l'artillerie est militarisée. Six compagnies, quatre de canonniers et deux de bombardiers sont créées. En 1671 est créé le corps des fusiliers du roi qui a pour mission la garde et le service de l'artillerie royale. Une école d'artillerie jouxtant l'université de Douai est fondée par Louis XIV en 1679. Par la suite, un grand nombre d'écoles d'artillerie, nationales et régimentaires sont créées. L'ensemble des unités est regroupé en 1693 dans un régiment, le Royal-Artillerie. En 1765, après un siècle d'organisation sous l'égide de Louis XV et de militaires comme François de Jaunay, l'artillerie française est articulée en sept régiments et dispose alors d'une solide formation dans les nombreuses écoles de France. Le modèle des pièces est rationalisé et standardisé dans un système connu sous le nom de « système de Vallière ».
L'artillerie est employée répartie sur l'ensemble de la ligne de bataille en batteries de quatre à dix pièces. Le combat commence par une canonnade, puis, alors que la bataille se développe au contact de l'ennemi, elle tire « à mitraille ».
En Angleterre, l'artillerie est militarisée à partir du 26 mai 1716, date à laquelle le roi George Ier décide de fonder deux compagnies permanentes de 100 hommes installées à Woolwich. En 1720, le terme de Royal Artillery est utilisé pour qualifier les deux compagnies. Le 1er avril 1722, le Royal Regiment of Artillery est créé à partir des deux compagnies originelles auxquelles sont jointes deux compagnies supplémentaires et deux compagnies indépendantes de Gibraltar et de Minorque. En 1741, la Royal Academy of Artillery et l'arsenal royal sont créés à Woolwich. En 1757, le régiment comprend deux bataillons de douze compagnies chacun. En 1748, trois compagnies sont créées en Inde, au Bengale, à Madras et à Bombay. En 1771, le régiment compte quatre bataillons de huit compagnies soit trente-deux au total. En novembre 1793 sont créés deux groupes de Royal Horse Artillery, destinés à accompagner les unités de cavalerie.
Développements de nouveaux modèles de pièces
Le mortier est inventé au début du XVIIe siècle pour surmonter l'amélioration des fortifications. Il est introduit peu à peu en Hollande puis en France. Le mortier est un tube court destiné à tirer des projectiles en tir plongeant par-dessus des obstacles. Les projectiles peuvent être inertes, de grosses masses, ou bien explosifs. Dans ce dernier cas, ils prennent alors le nom de bombes. Les bombes sont de gros boulets creux bourrés de poudre noire. Une petite lumière est percée dans leur paroi et une courte mèche à combustion lente y est introduite. La longueur de la mèche est calculée de manière que la bombe éclate au moment de l'impact contre l'objectif ou bien, la durée de combustion pouvant varier d'une mèche à l'autre, une fraction de seconde avant ou après l'impact. La mèche de mise à feu de la charge explosive contenue dans la bombe était allumée séparément quelques secondes avant le départ du coup, à l'aide d'un boute-feu manié par un servant ou bien par l'intermédiaire de la flamme du tir.
Un tube appelé obusier, d'une longueur intermédiaire entre celle du canon et celle du mortier, est alors développé pour lancer de tels projectiles.
Des pièces d'artillerie légère « à la suédoise » développées en 1732 sont introduites avec beaucoup de réticence dans les régiments d'infanterie français.
Au milieu du XVIIIe siècle, le roi de Prusse Frédéric II invente l'artillerie à cheval, capable de suivre et de soutenir la cavalerie.
L'artillerie prussienne sert de modèle à l'ensemble des artilleries du continent. Jean-Baptiste de Gribeauval est chargé de la réforme de l'artillerie française sur ce modèle.
Deux personnages parfois rivaux donnent aux rois de France une artillerie digne de leurs ambitions.
Jean-Florent de Vallière (1667-1759)
Directeur de l'artillerie en 1720, Jean-Florent de Vallière réorganise l'artillerie composée de deux régiments, le Royal Artillerie et le Royal Bombardiers, en cinq bataillons de huit compagnies chacun, chaque compagnie regroupant une centaine d'hommes. On lui doit la réduction du nombre des calibres désormais limités à cinq : 4, 6, 8, 12 et 24 livres. Il rationalise la production des canons, notamment par l'amélioration des techniques de coulée. Le système de Vallière est approuvé le 7 octobre 1732.
Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval (1715-1789)
Inspecteur de l'artillerie en 1764, il cherche à organiser une artillerie la plus adaptée aux tâches qui lui sont demandées.
À cet effet, il divise l'artillerie en quatre catégories :
- l'artillerie de campagne, destinée à accompagner les troupes en campagne, composée de trois types de canons : 4, 8 et 12 livres et d'un type d'obusier de 8 pouces.
- l'artillerie de siège, destinée à appuyer les sièges des places fortes, composée de 4 types de canons de 8, 12, 16 et 24 livres et de 4 types de mortiers de 8, 10 court, 10 long et 12 livres. Elle dispose de munitions propres à la destruction des fortifications et, notamment, des boulets fusants. Elle est équipée d'affûts qui permettent une certaine mobilité.
- l'artillerie de place, destinée à équiper la défense des places fortes, composée des mêmes pièces que l'artillerie de siège. La différence réside dans les affûts non mobiles, adaptés aux fortifications qu'elle protège. Les artilleurs qui la servent sont généralement des sédentaires.
- l'artillerie de côte, destinée à défendre les côtes. Elle est équipée de modèles de canons disparates. Elle est généralement mise en œuvre par des unités d'artillerie sédentaires composées d'artilleurs vétérans inaptes au service dans les autres catégories.
Pour l'ensemble de l'artillerie :
- Pour améliorer la précision, il fait adopter la ligne de mire et la vis de pointage.
- Pour améliorer la cadence de tir, il fait adopter la gargousse standard, la cartouche à boulets et à mitraille.
- Pour améliorer la maintenance et l'interopérabilité, il fait construire des affûts selon un modèle type qui comprend notamment deux positions pour les tourillons : position de transport et position de combat. Il organise l'interchangeabilité des pièces.
Pour l'artillerie de campagne :
- Il invente la prolonge, un système d'attelage articulé qui permet de manœuvrer la pièce sans dételer les chevaux, puis de dételer ceux-ci très rapidement.
- Il invente la bricole, sorte de harnais qui permet aux servants d'amener par eux-mêmes la pièce en position sur le pas de tir et mettre ainsi à l'abri les chevaux à proximité de l'ennemi.
Le système Gribeauval est approuvé par l'ordonnance du 13 août 1765. Il est le système officiel de l'armée française jusqu'en 1827, date de la mise en place du système Valée. À la Révolution, l'artillerie est devenue une arme nouvelle qui compte de plus en plus sur les champs de bataille. Elle commence à intéresser les théoriciens comme du Puget, le baron du Teil, le comte de Guibert et Scharnhorst. La France a pour réputation d'avoir la meilleure artillerie d'Europe et surtout, de savoir s'en servir.
De Vallière et Gribeauval sont à la fois complémentaires et rivaux : complémentaires parce que Gribeauval appuie sa réforme sur la standardisation des calibres de De Vallière, rivaux parce qu'ils ont une conception différentes de l'artillerie. De Vallière tend à favoriser les gros canons moins mobiles mais plus puissants ; Gribeauval, lui, préfère des canons plus petits mais plus mobiles et proches du champ de bataille. Bien que disgracié pendant dix ans par le fils de De Vallière, de 1764 à 1774, c'est Gribeauval qui l'emporte. Ses canons légers et mobiles, qu'il dit aussi puissants, aussi robustes et d'une portée équivalente à celle des gros canons lourds de De Vallière, équipent l'artillerie de la Révolution et de l'Empire.
Le système Gribeauval est modifié à la marge à la suite des campagnes de la Révolution et de l'Empire.
Au niveau de l'organisation :
- à partir de 1809 et pour faire face aux besoins immédiats de l'infanterie, chaque régiment est doté de deux canons, généralement des pièces autrichiennes de trois livres ;
- pour lutter contre les éventuelles incursions de la marine anglaise, l'artillerie de côte est notablement renforcée et comprend 114 compagnies en 1809.
Au niveau du matériel, il est supplanté en partie par le système de l'an XI qui comprend :
pour l'artillerie de campagne :
- deux calibres principaux, le canon de 12 et le canon de 6. Ce dernier, qui n'existe pas dans le système Gribeauval, est directement issu des canons pris à l'ennemi chez qui ce calibre est prépondérant. Les canons ainsi utilisés sont soit le résultat de prises, soit le réalésage du canon de 4 devenu superflu ;
- des caissons et des avant-trains allégés et simplifiés destinés à améliorer la vitesse de manœuvre.
Le système Valée lui fait suite à partir de 1827. Il reste dans la logique Gribeauval, dont il garde beaucoup d'aspects.
Il résulte des constatations faites à la fin des campagnes napoléoniennes, notamment sur l'artillerie anglaise, apparue plus mobile et plus efficace que l'artillerie française. Il consiste donc :
- dans une réadaptation des calibres Gribeauval aux situations tactiques de l'époque avec :
- 2 modèles de canons de siège de 16 et 24 livres ;
- 2 modèles d'obusiers de campagne de 25 livres et de 6 pouces (150 mm) ;
- un mortier de siège de 8 pouces ;
- un canon d'artillerie de montagne de 12 livres ;
- quatre types de mortiers de 8, 10, 12 pouces et un mortier à pierre de 15 pouces ;
- dans une standardisation, une simplification et un allégement des caissons et des avant-trains. Les équipes de pièces sont désormais transportées sur les avant-trains et se déplacent ainsi à la vitesse de l'infanterie et de la cavalerie. La distinction entre artillerie à pied et artillerie à cheval est ainsi beaucoup moins pertinente. Les régiments sont donc désormais régiments d'artillerie, sans distinction d'arme.
Influence du développement de l'artillerie sur la fortification
Des leçons tirées de la guerre de Trente ans, Vauban conçoit un nouveau système de fortification adapté aux progrès de l'artillerie car bien moins vulnérable aux projectiles. De même, il conçoit des techniques d'emploi de l'artillerie pour venir à bout de ces mêmes fortifications, notamment le tir dit de saignée pour ouvrir la brèche dans les murailles et le tir à ricochet (le boulet est tiré avec une charge de poudre plus faible de manière à avoir juste assez de vitesse et d'inertie pour passer au-dessus des parapets derrière lesquels se tient l'artillerie des défenseurs, puis à s'abattre transversalement au milieu de celle-ci en fauchant les canons et leurs servants5.
Les évolutions du XIXe siècle vers une arme déterminante
Pendant tout le XIXe siècle et jusqu'à la guerre de 1914, l'artillerie devient un élément déterminant du champ de bataille. Elle prend une nouvelle dimension avec les campagnes de la Révolution et de l'Empire, elle joue un rôle essentiel dans les batailles du XIXe et trouve l'apogée de son emploi pendant la Première Guerre mondiale où elle démontre à la fois sa puissance mais aussi ses insuffisances.
L'artillerie pendant la Révolution et l'Empire
L'artillerie prend de plus en plus d'importance de par son efficacité sur le terrain et l'origine militaire de Napoléon Ier ainsi particulièrement sensible à son emploi.
Organisation
Artilleur du train (à gauche) et à pied de l'époque napoléonienne.
Le , l'artillerie française devient une arme à part entière. Elle dispose des sept régiments à deux bataillons de dix compagnies de l'Ancien Régime. Elle conserve surtout et beaucoup mieux que l'infanterie, les cadres de l'Ancien Régime comme Bonaparte qui ont cultivé l'excellence et qui la mette à disposition des armées de la République. Tout au long de la période, elle ne cesse de s'étoffer et de s'améliorer.
Sur le plan technique, l'artillerie de la Révolution et de l'Empire n'a guère évolué car elle reste essentiellement fondée sur le système de Gribeauval, hérité de l'Ancien Régime. Il ne sera pas notablement amélioré pendant la période. La supériorité dont elle fait preuve tient à sa quantité et à son emploi stratégique et tactique.
L'emploi de l'artillerie française est caractérisé par trois points forts : sa mobilité, sa proximité de l'infanterie et sa capacité de concentration instantanée et la qualité professionnelle de ses personnels.
Mobilité
La mobilité tactique de l'artillerie tient à ses batteries d'artillerie à cheval, surnommée « artillerie volante ». Neuf compagnies d'artillerie à cheval sont créées en 1790. Elles deviennent une pièce maîtresse de la supériorité française dans les campagnes et sur les champs de bataille grâce à leur mobilité, leur souplesse, leur réactivité et leur esprit offensif. Elles acquièrent leur indépendance le sous le nom d'« artillerie légère ».
La mobilité stratégique tient en grande partie à son organisation. Un ensemble complet de soutiens adapté à ses qualités est progressivement créé. Le transport effectué par des entreprises civiles sous l'Ancien Régime est progressivement militarisé. Le train des équipages est officiellement créé le 26 mars 1807. Les pontonniers destinés à faciliter ses franchissements sont créés en une spécialité séparée attribuée au génie le .
Sont ajoutées progressivement à l'ensemble des compagnies d'ouvriers, des unités de vétérans chargés de mettre en œuvre l'artillerie de place, des unités d'artillerie côtières et des fonctionnaires chargés de l'entretien et de la surveillance des matériels au sein de parcs d'artillerie, centre de réparation et de stockage. Par ailleurs, dix sept compagnies coloniales sont créées le 3 avril 1804 pour protéger les colonies et une artillerie de la Garde est constituée.
Proximité de l'infanterie et capacité de concentration instantanée
Le principe consiste à faire en sorte que l'artillerie soit proche de l'infanterie pour la soutenir à tout moment. Dès le début de la Révolution, deux pièces sont attribuées à chacun des bataillons de la Garde nationale. Au cours des années 1810-1811, Napoléon fait distribuer deux pièces d'artillerie à chacun des régiments d'infanterie pour rapprocher l'artillerie du cœur du combat, renforcer les fantassins et compenser ainsi leur moindre qualité.
Cependant, à tout moment, l'artillerie est capable de se concentrer rapidement aux ordres de l'Empereur ou du général en chef dans une « grande batterie » pour appuyer l'effort majeur de la bataille, ouvrir la route à la cavalerie et forcer ainsi la décision.
Qualité professionnelle de ses personnels
L'artillerie bénéficie d'une gestion particulière de ses personnels. Elle cultive une excellence qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Elle reçoit les gens les plus brillants. L'artilleur est un soldat très aguerri. Son apprentissage est long et repose sur un entraînement minutieux répété incessamment et quelles que soient les conditions du combat. Les artilleurs inaptes au service en campagne sont regroupés dans des compagnies de vétérans qui ont un rôle de police sur les territoires de l'Empire.
Généralisation de ces règles d'emploi aux autres artilleries
Tout au long de la période, les adversaires de la Révolution et de l'Empire n'ont de cesse que d'imiter le modèle napoléonien qui est un des facteurs indéniables de la supériorité des armées françaises.
Des développements considérables dus à l'industrialisation
Dès le début du XIXe siècle, l'artillerie fait l'objet d'études nombreuses tant pour améliorer le matériel, tubes, poudres, etc., que pour optimiser la balistique. Ces évolutions changent son emploi et sa mise en œuvre du tout au tout.
Les poudres
Depuis le Moyen Âge, l'artillerie utilisait exclusivement de la poudre noire dont les défauts étaient clairement identifiés. Outre la fumée qu'elle générait au départ, qui la faisait immanquablement repérer et qui recouvrait le champ de bataille du « brouillard de la guerre », sa puissance laissait à désirer et son dosage précis était très difficile ce qui limitait automatiquement la maîtrise des effets et de la portée. Au XIXe siècle, des études permettent d'inventer de nouvelles poudres. Dès les années 1830, de nouveaux explosifs sont inventés. Plus puissants que la poudre noire, ils ont l'avantage de faire peu de fumée. Un mélange de coton, de sciure de bois et d'acide nitrique - le fulmicoton - est inventé par un chimiste français Henri Braconnot. De même, la nitroglycérine est découverte en Italie et la nitrocellulose aux États-Unis. Toutefois, ces explosifs sont instables et après des essais infructueux, ils ne peuvent être produits en masse. Il faut donc attendre le début des années 1880 pour trouver des formules de stabilisation. La nitrocellulose est plastifiée avec un mélange d'éther et d'alcool. Le fulmicoton et la nitroglycérine sont de même stabilisés pour donner un mélange du nom de cordite.
Ces poudres servent à la fois à l'amorçage, à la propulsion et à l'explosion des munitions.
Jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'amorçage est assuré par de la poudre noire finement moulue, le pulvérin, que l'on met dans la « lumière », sorte de trou fait dans la partie arrière du canon, et qui doit être allumé à l'aide d'un boute-feu, sorte de tige en corde dont un bout se consume. Outre le fait que le boute-feu est source de risques car il peut enflammer la poudre ambiante, le pulvérin craint l'humidité et peut faire « long feu », c'est-à-dire ne pas transmettre la flamme ou ne le faire qu'après un certain délai. Les nouvelles poudres sont conditionnées sous formes d'étoupilles, sortes de capsules hermétiques dans lesquelles sont mises des poudres relativement instables et qui sont mises à feu par la percussion d'une amorce. Ces étoupilles sont mises dans une « lumière » ou directement incluses dans les douilles des projectiles et transmettent ainsi l'explosion aux gargousses.
De même, la propulsion est assurée par de la poudre noire qui est grossièrement dosée à l'aide de cuillères, introduite par la bouche de la pièce, tassée par un écouvillon et éventuellement complétée par une bourre. Naturellement, avec des facteurs aussi approximatifs, la portée des canons est très aléatoire, et la cadence de tir très lente est dépendante de longues périodes d'entraînement des servants. Avec les nouvelles poudres dont la composition est très précisément contrôlée et dont le conditionnement, en gargousses correspondant à des charges très rigoureusement dosées, les portées sont maîtrisées. Des tables de tir, résultat d'expérimentations normées, sont établies et comprennent la portée exacte générée par la combinaison charge / angle de tir ainsi que la « fourchette » qui correspond à l'écart probable circulaire obtenu lors des essais.
À partir de 1850, l'artillerie connaît des améliorations en cascade qui amènent au summum qu'elle atteint avec la Première Guerre mondiale.
Les projectiles
Jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'effet de l'artillerie contre les troupes et contre les fortifications est essentiellement mécanique, (cf. Les effets de l'artillerie). Dès 1776, on s'aperçoit que la forme optimale d'un projectile d'artillerie est la forme cylindro-ogivale mais ce n'est qu'à partir de 1886, qu'il devient le projectile de base de l'artillerie en raison notamment de l'invention des nouvelles poudres. Très vite l'obus sonne la fin du boulet. Il est fabriqué en acier, et rempli de mélinite. Sa forme pointue permet d'obtenir une pénétration optimale dans l'air et rend les canons plus efficaces car elle augmente de manière significative leur portée. À calibre constant, elle permet une augmentation très importante de la charge explosive par rapport au boulet sphérique et permet une multiplication des types de projectiles. Enfin, elle assure une meilleure maniabilité des munitions pour le servant comme pour la logistique.
En 1784, le lieutenant anglais Shrapnel invente un projectile plein de poudre et de billes en acier qui explose en l'air à une distance donnée et qui a des effets dévastateurs sur l'infanterie. Il est utilisé en quantité à Waterloo en 1815.
À l'issue de cette évolution, la gamme des obus disponibles permet de varier de manière considérable les effets obtenus en fonction des caractéristiques de l'objectif. Cette variété est multipliée grâce à l'invention de la fusée, dispositif qui permet de commander leur explosion.
Jusqu'au milieu du XIXe siècle, les projectiles sont rarement explosifs. Lorsqu'ils le sont, les dispositifs de mise à feu du projectiles sont sommaires et peu fiables. Soit, la mise à feu est indépendante, au moment du tir, l'obus est amorcé à l'aide d'un pulvérin ou d'une mèche auquel un servant met le feu grâce à un boutefeu, soit on compte sur le feu de la poudre de propulsion pour allumer le dispositif. Outre le fait qu'ils sont dangereux, ces moyens sont très approximatifs notamment parce que le calcul du retard est très difficile. La fusée, inventée à partir des années 1880, permet de régler avec précision le moment d'explosion de l'obus. Elle est soit fusante, pour faire exploser l'obus en l'air à proximité du sol et neutraliser ainsi les fantassins et les objectifs « mous », soit percutante. La percussion peut se faire au contact ou elle peut être retardée afin de laisser l'obus s'enfoncer dans le sol par l'énergie cinétique et détruire ainsi les tranchées ou les fortifications enterrées. Leur mode de fonctionnement peut être très varié. Elles peuvent être pyrotechniques comme sur l'obus explosif fusant de 75 où un serpentin de poudre est percé au niveau de retard désiré et mis à feu avec la poudre de propulsion. Elles peuvent être percutantes, à l'aide d'un simple dispositif d'amorce qui explose au contact.
Les tubes
L'évolution de la technologie des tubes se fait selon cinq critères : la solidité, la légèreté, les rayures, le chargement par la culasse et la maîtrise du recul.
La solidité
L'amélioration de la solidité est nécessaire pour que le tube résiste aux pressions générées par les nouvelles poudres et les aménagements apportés aux projectiles.
L'acier remplace le bronze et la fonte dès le milieu du XIXe siècle et montre sa supériorité non seulement en matière de solidité mais aussi de légèreté.
La légèreté
L'amélioration de la légèreté permet de rendre l'artillerie de campagne plus mobile et plus apte à suivre au plus près les troupes de mêlée. Le remplacement du bronze et de la fonte par l'acier en est un facteur déterminant. L'enjeu consiste par ailleurs à établir un double équilibre entre la minceur des parois du tube et sa résistance à l'éclatement d'une part et entre la longueur du tube/ le calibre et les performances désirées d'autre part, tout en gardant aussi une vue sur sa longévité (coups compensés : nombre de coups à charge maximales autorisés dans la vie du canon) et sa solidité/rusticité.
Les rayures
Les rayures internes du tube, (rayures hélicoïdales dont le pas — nombre de tours sur elles-mêmes effectués sur une longueur d'un mètre — permet de déterminer la vitesse de rotation du projectile) apparues vers 1858 et systématisées très rapidement dans toute l'Europe à partir de cette date, permettent d'améliorer notablement la précision et la portée du canon. Elles sont associées à des ceintures de forcement en métal mou (initialement du plomb ou de l'étain et ultérieurement du cuivre) placées sur le corps de l'obus. D'une part, les rayures impriment au projectile un mouvement de rotation sur lui-même extrêmement rapide qui lui confèrent un effet gyroscopique assurant une stabilité et un équilibre quasi parfait sur la trajectoire. D'autre part, ces bandes de métal tendres qui ceinturent l'obus limitent les déperditions des gaz de propulsion et permettent de jouer précisément sur le dosage de la poudre pour maîtriser la portée.
Le chargement par la culasse
Le chargement par la culasse amène deux améliorations majeures. D'une part, il favorise la rapidité du tir en limitant les déplacements et les manœuvres des servants pour recharger la pièce. D'autre part, il permet d'installer sur les canons des boucliers qui protègent ces mêmes servants des tirs d'infanterie ou des éclats d'obus pour qu'ils puissent agir au plus proche des lignes de front. Il oblige, par ailleurs, un conditionnement standard de la munition, des charges pesées avec précision et conditionnées dans des gargousses numérotées et, pour certains calibres, des douilles en métal ductile (bronze, fer blanc).
La maîtrise du recul
Le maîtrise du recul favorise la rapidité du tir car elle permet de tirer plusieurs projectiles à la suite sans avoir à repointer la pièce, tâche très souvent critique dans la mise en œuvre de l'artillerie. Elle fait l'objet d'une concurrence technologique effrénée entre les nations et entre les fabricants de canon.
Depuis le Moyen Âge, de nombreuses techniques avait été recherchées pour limiter les effets du recul mais ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'il est convenablement maîtrisé.
Les premiers dispositifs anti-recul sont fondés sur des cordes qui lient la pièce à un point fixe puis des patins ou de sabots mis sur les roues de l’affût et la bêche qui permet d'ancrer la flèche dans le sol. Mais s'ils le limitent, ils ne le suppriment pas.
La deuxième génération est fondée sur le principe du frein hydraulique que Krupp développe dès les années 1880 mais que les Français maîtrisent brillamment avec le canon de 75 mm modèle 1897 qui leur donne des années d'avance en matière d'artillerie de campagne.
L'amélioration des techniques de pointage

Jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, l'artillerie agit en soutien de l'infanterie en tir quasiment direct. À quelques rares exceptions, l'artilleur voit son objectif. À partir des années 1890 grâce à l'allongement des portées, les techniques de pointage s'améliorent pour lui permettre d'effectuer des tirs indirects plongeant ou verticaux. Ce développement a plusieurs avantages. L'artillerie n'est plus à vue directe de l'adversaire et peut se placer derrière des obstacles ou des défilements, à des distances qui la protègent des tirs d'infanterie et des tirs directs de l'artillerie adverse, ce qui réduit d'autant sa vulnérabilité. Les nouvelles poudres sans fumée la rendent d'autant plus difficile à repérer. C'est pourquoi ses feux sont devenus de plus en plus imprévisibles et l'effet psychologique de ses coups en est largement augmenté. Toutefois, pour ce faire, il lui faut de nouvelles techniques et de nouvelles procédures de tir que les différentes artillerie ont du mal à intégrer dans leurs modes d'action.
Le tir indirect devient donc le mode privilégié de tir dans l'artillerie allemande en 1890. L'artillerie britannique s'y exerce à partir de cette date et l'expérimente en réel lors de la Guerre des Boers. Quant à l'armée française, elle prend du retard en la matière. Les pièces d'artillerie lourde développées au début du XXe siècle en France comme l'obusier de 155 Rimailho voient même leur portée volontairement limitée pour éviter la tentation du tir indirect à longue distance. Il faut attendre les débuts de la Première Guerre mondiale pour qu'elle se rende vraiment compte de son utilité et qu'elle l'adopte définitivement.
La problématique des techniques de pointage consiste à relier géométriquement l'objectif avec les batteries dans un système commun de référence en trois dimensions (latitude=x, longitude=y, altitude=z).
Pour acquérir l'objectif, un observateur qui doit être au plus prêt des troupes appuyées devient nécessaire. Il doit déterminer les coordonnées de l'objectif dans le système de référence commun et régler les tirs au mieux. À cet effet, il lui faut des matériels topographiques légers et performants (jumelles, longues-vues, télémètres, théodolites, boussoles, etc.) qu'il utilise au plus proche des unités d'infanterie appuyées.
La séparation entre le fantassin et ses appuis obligent au développement des matériels de transmission des données qu'il acquiert (Estafettes, téléphone, radio, etc.), nonobstant des protections pour lui permettre d'effectuer ses opérations sous le feu (boucliers, observatoires cuirassés, etc.) à partir d'une situation dominante donc facilement repérable.
Les données ainsi acquises sont transmises à la batterie où elles sont transformées en termes d'artillerie pour la batterie entière (type d'objectif, effet physique à obtenir, dimension géographique de l'effet à obtenir, modification des termes pendant le tir, etc.) et pour chaque pièce (type d'obus, type de charge, type et réglage des fusées, azimut, angle et instructions de coordination). Elles peuvent aussi servir à la coordination des feux de tous les moyens d'appui disponibles sur un champ de bataille. La batterie elle-même doit être précisément repérée dans le système de référence commun. Son efficacité se fonde donc sur une topographie précise, en situation comme en angles, acquise grâce à des théodolites et des télémètres, pour la topographie, des goniomètres et des jalons pour l'orientation des pièces et des techniques de calcul performantes mais simples, pour réagir rapidement et limiter les erreurs.
D'autres éléments sont peu à peu pris en compte, l'homogénéité des lots de poudre et d'obus, la température de la poudre, l'usure du tube, les éléments aérologiques (vitesse et orientation des vents par couche, température et densité de l'air, etc.), et même rotation de la terre pour améliorer encore la précision.
Le grand inconvénient du tir indirect est le tir fratricide, relativement commun pendant la Première Guerre mondiale. En effet, outre le fait que l'artilleur ne voit pas son objectif, plus les données du tir sont complexes et plus les chances d'erreurs sont grandes. Des systèmes d'alerte sont mis en place pour éviter cet état de fait mais ils ont du mal à s'imposer dans la mêlée du combat.
L'organisation
Avec le système Valée, la batterie de quatre à huit pièces devient l'unité élémentaire de l'artillerie. Elle regroupe la partie artillerie proprement dite et sa logistique immédiate, les trains de combat qui la rend plus autonome et permet sa répartition au sein des divisions. La logistique générale est assurée par des unités spécifiques de l'artillerie, du train des équipages, arme devenue autonome et des parcs d'artillerie. Cette répartition reste la règle quasiment jusqu'à nos jours.
Le cas particulier de l'artillerie de marine
Insigne de béret des troupes de marine.
L'artillerie de marine connaît un développement spécifique mais fondé sur les avancées technologiques de l'artillerie de campagne.
En effet, l'artillerie de marine a une double mission, une mission prioritaire, la bataille navale entre navires et une mission secondaire, qui devient de facto une mission essentielle, l'appui des troupes au sol avec une triple perspective :
- soit une perspective amphibie, où les pièces de bord assurent l'appui d'opérations de débarquement ;
- soit une perspective terrestre, avec des pièces débarquées qui assurent l'appui lors de la progression terrestre ;
- soit une perspective mixte à l'aide de pièces placées sur des canonnières, des moniteurs ou des barges fluviales qui suivent la progression le long des fleuves et des rivières.
La première perspective donne aux artilleurs de marine le surnom de "bigors" par allusion aux bigorneaux qui s'accrochent aux rochers pour pouvoir tirer.
Les relations entre l'artillerie de marine et l'artillerie terrestre sont relativement complexes dans la mesure où les deux domaines s'influencent grandement, notamment au point de vue technologique. Mais, pour des raisons à la fois, techniques, la spécificité des missions respectives, mais aussi de susceptibilité, elles connaissent un développement différencié que la nécessité fait se rapprocher.
La montée en puissance tout au long des conflits du XIXe siècle
À partir de 1850, les conflits qui suivent font montre d'une contradiction qui va en s'atténuant entre les modes d'action de l'artillerie, empreints d'un conservatisme certain et la technologie dont les conséquences sur le combat ne sont pas totalement restituées.
La guerre de Crimée
La guerre de Crimée apporte surtout des enseignements en matière d'artillerie de siège, puisque l'opération majeure de ce conflit est le siège de Sébastopol (1854-1855). Elle met essentiellement en œuvre des pièces de l'ancien modèle, en bronze ou en fonte, à âme lisse et à chargement par la bouche, boulets pleins, obus explosifs sphériques et boulets chauffés au rouge. Les pièces à âmes rayées y sont utilisées de manière anecdotique.
Ce qui la caractérise est l'ampleur et l'intensité de l'usage de l'artillerie par les belligérants ainsi que les mesures prises par les Russes pour limiter ses effets sur la ville. Des préparations d'artillerie considérables sont effectuées. Le , les alliés bombardent pour la première fois Sébastopol et la réaction russe permet, par son intensité, de faire taire les canons français et anglais. Le camp retranché est bombardé quotidiennement de manière plus ou moins intensive. À Pâques 1855, du 8 au 19 avril, il est pilonné pendant 11 jours. Mais les effets de ce harcèlement sont annihilés par l'organisation russe qui reconstruit pendant la nuit ce qui est détruit le jour. Les fortifications de circonstance, tranchées, casemates en terre et tunnels jouent un rôle fondamental dans la résistance de la place qui dure près d'un an.
L'assaut qui entraîne la chute de la place est donné sur le Redan et la tour de Malakoff après un pilonnage de trois jours du 5 au . La guerre de Crimée démontre donc les effets relativement limités de l'artillerie sur les fortifications de circonstance et sur la volonté de résistance, caractéristiques qu'on retrouve pendant la Première Guerre mondiale7.
La guerre de Sécession
canon de 12 livres, M1857, « Napoléon ». Le plus utilisé par les armées nordistes comme sudistes.
La guerre de Sécession, en matière d'artillerie, marque tout particulièrement la contradiction signalée en introduction, au point où l'artillerie de l'Union, qui comprenait une majorité de pièces rayées au début de la guerre, n'en comprend plus qu'un tiers à la fin. Cette régression tient à trois facteurs. D'abord, les distances de combat traditionnelles ne dépassent pas les 1 000 m, ce qui ne met pas en valeur la précision que les rayures apportent au tir d'artillerie à longue distance. Ensuite, le terrain bocager, agricole et boisé dans lequel se déroulent les combats ne favorise pas les tirs à longue portée. Enfin, la fiabilité des projectiles explosifs est mise à mal à la fois par leur mauvaise qualité et par le terrain meuble qui favorise les obus non explosés.
Toutefois, certains combats mettent en évidence de manière cruciale, la supériorité de l'artillerie rayée comme la bataille de Malvern Hill, le , où l'artillerie de l'Union décime l'infanterie et l'artillerie adverses par la précision de ses coups. De même, lors de la bataille de Gettysburg, du au , les tirs de contre-batterie et antipersonnel de l'artillerie de l'Union jouent un rôle déterminant dans la victoire.
En matière d'artillerie de siège, l'emploi de gros canons fabriqués par Parott, Brooks, Blakely ou Armstrong montrent la fragilité des fortifications en brique de l'époque. La bataille la plus illustrative en la matière est le siège du fort Pulaski. Les leçons en sont tirées par le général von Moltke pendant la guerre franco-prussienne, notamment dans l'attaque des places fortes de Paris et de Strasbourg, dont les forts et les murailles ont été mis en pièces8.
La guerre austro-prussienne de 1866
La guerre austro-prussienne est aussi marquée par ces conceptions conservatrices du rôle de l'artillerie dans les combats.
L'artillerie de campagne prussienne est plutôt bien équipée de matériels anciens et modernes. Les matériels modernes sont des canons rayés en acier, à chargement par la culasse fabriqué par l'inévitable Krupp. Malheureusement, l'emploi de l'artillerie dans le commandement prussien est relégué au dernier rang. L'artillerie est placée à l'arrière des colonnes de progression et elle est rarement amenée vers l'avant lors des combats de rencontre ou les batailles plus importantes. De plus, elle ne bénéficie pas d'une logistique digne de ce nom. Les batteries disposent de leur dotation initiale et, lorsqu'elles sont employées au combat, elles sont obligées de se retirer dès que cette dotation a été consommée.
De l'autre côté, les Autrichiens sont dotés de tubes en bronze certes rayés mais chargés par la bouche beaucoup moins évolués technologiquement. Toutefois, leur maîtrise tactique est beaucoup plus brillante. Ils sont employés proches de l'infanterie et font preuve d'une mobilité honorable. Aussi, la bataille de Sadowa, le , est une victoire de l'infanterie mais le commandement prussien, qui a bien compris qu'il l'avait échappé belle, s'attache, dès la paix signée, à réformer ses conceptions quant à l'emploi de l'artillerie.
La guerre franco-prussienne de 1870
La guerre de 1870 est marquée par la grande supériorité de l'artillerie allemande surtout par sa qualité et son degré d'évolution technologique.
À la suite des leçons tirées de la guerre austro-prussienne, l'artillerie est désormais placé en tête des colonnes de progression, juste derrière les avant-gardes. Elle intervient dès que ces avant-gardes sont accrochées. Toutefois, cette conception la rend vulnérable aux feux d'infanterie et elle fait l'objet de lourdes pertes, en raison notamment des excellentes performances du fusil français Chassepot. C'est le cas lors de l'accrochage confus de Borny, à l'est de Metz, le . Par ailleurs, l'artillerie française qui dispose du système Lahitte de 1859, formé de canons en bronze lisses chargés par la bouche, fait montre d'une maîtrise tactique certaine qui compense sa faiblesse technologique, notamment lors de la bataille de Gravelotte le . La supériorité de l'artillerie allemande se manifeste totalement lors du siège de Metz ou de la bataille de Sedan où elle écrase les forces françaises depuis les hauteurs qui dominent les places ; quant au canon de 7 modèle 1867, arme rayée moderne à chargement par la culasse, il est trop lourd pour servir de canon de campagne, et n'est vraiment utilisé efficacement que dans la défense de Paris.
La guerre russo-turque de 1877-1878
La guerre russo-turque de 1877-1878 est réputée pour être la première guerre moderne avec des fantassins dotés de fusils à répétition et des canons en acier rayés qui se chargent par la culasse. C'est donc le triomphe de Krupp et des producteurs d'armement allemands chez lesquels les deux belligérants se fournissent. Toutefois la tendance à maintenir le combat rapproché et à ne pas profiter des avantages que proposent les canons rayés, entre autres leur grande portée et leur meilleure précision, se manifeste encore.
Le XXe siècle et les deux guerres mondiales
La révolution industrielle, entamée à la fin du XVIIIe siècle, a pour conséquence la Première Guerre mondiale, première guerre industrielle. La France, qui n'avait que 300 canons au début de la guerre, en possède 5 200 en 1918 et a tiré 250 millions d'obus. La Grosse Bertha allemande, tirant des obus de 1 150 kg, est à elle seule un condensé de prouesses technologiques9.
Les leçons tirées des conflits de la fin du XIXe siècle
La production de canons fait la prospérité de l'entreprise Krupp, dès 1859. À Essen, les deux cinquièmes de l'acier fondu qui sortent des usines Krupp sont destinés à la fabrication de canons de tous calibres, depuis la petite pièce de campagne de quatre (boulets pesant 4 livres de fer soit un peu moins de 2 kg) jusqu'à des pièces monstrueuses tirant des projectiles de 100, 150 voire 500 kg. À terme, Krupp équipe en canons les Russes, les Britanniques, les Belges, les Italiens, les Turcs, les Autrichiens, les Néerlandais, et même les Japonaisnote 2.
Dès , les Français tirent les leçons de leur défaite. Ils se lancent dans une intense compétition entre les systèmes proposés par de Reffye, Lahitolle et de Bange. C'est le système de Bange qui en sort vainqueur en raison de sa culasse à vis interrompue — qui est encore utilisée de nos jours. Il se distingue par son système d'obturation performant fondé sur un joint de culasse élastique, la simplicité de son entretien et sa résistance à l'usure. Le canon de base du système est une pièce de 90 mm.
Les Anglais se perdent dans de multiples errements technologiques. Leur choix s'est porté en 1855 sur un canon rayé à chargement par la culasse conçu et développé par la firme Armstrong. Toutefois, ce canon qui participe notamment à la première guerre de l'opium de à s'avère si peu performant qu'il est remplacé, en 1863, par un canon Whitworth chargé par la bouche. Ce n'est qu'à partir de que les Britanniques reviennent au canon à chargement par la culasse.
Les Américains restent sur leur canon de 3 pouces (76,2 mm) qui a été le clou de la guerre de Sécession quasiment jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ils développent toutefois un canon de 3,5 pouces (81,2 mm) qu'ils déploient lors de la guerre hispano-américaine de à Cuba.
Les avertissements du début du XXe siècle
La guerre russo-japonaise
Les guerres des Balkans
La Première Guerre mondiale, la guerre de l'artillerie
Une situation initiale déséquilibrée en faveur de l'Allemagne
L'artillerie joue un rôle crucial avec la Première Guerre mondiale. Initialement, l'armée allemande qui est la mieux équipée en la matière dispose d'à peu près tous les types d'artillerie existants. Les autres armées connaissent des carences plus ou moins importantes en raison des moyens limitées dont elles ont bénéficié avant la guerre et de leurs doctrines respectives qui leur ont fait mépriser le rôle de l'artillerie lourde et de l'artillerie de tranchée. Toutefois, au long de la guerre les alliés font des efforts considérables pour s'adapter aux nouvelles conditions de combat et développer le matériel nécessaire pour atteindre le niveau des Allemands puis pour le dépasser autant en capacité qu'en innovation. Elle va donc devenir une arme essentielle sur le terrain et, finalement, sous une forme ou sous une autre, d'être un facteur déterminant de la victoire des Alliés.
En matière de recherche, développement et production
En France, en Allemagne, en Autriche-Hongrie et en Grande-Bretagne, l'industrie d'armement s'appuie sur deux pôles, un pôle d'arsenaux publics et de constructeurs privés plus ou moins contrôlés par les militaires chargés des choix stratégiques et techniques. L'équilibre entre les deux est variable et dépend de leur positionnement politique respectif. Seule la production d'artillerie de la Russie repose essentiellement sur des arsenaux d'État et des pièces achetées à l'étranger. Tous les belligérants sont surpris par la durée de la guerre qu'ils estiment en 1914 à un semestre, et qui dure quatre ans. Ils doivent donc s'adapter au nouvelles évolutions du conflit tant en volume de production pour les tubes et les munitions qu'en développement de nouveaux matériels.
En Allemagne, Krupp et les « marchands de canons » ont une place essentielle qui se manifeste par un consensus entre les militaires et les industriels quant aux caractéristiques et à l'emploi de l'artillerie. Cette domination n'est pas que nationale et elle s'étend à une grande partie de l'Europe. D'autres belligérants mineurs se sont approvisionnés avant guerre chez les industriels allemands comme la Belgique, la Serbie ou la Roumanie et ils mettent en œuvre des canons conçus et fabriqués soit sous licence soit directement par le même Krupp.
En France, les militaires tiennent à garder l'initiative en matière d'armement et d'équipement mais ils sont bridés par les politiques qui font valoir notamment des questions budgétaires et politiques. L'artillerie est plutôt l'affaire des arsenaux d’État. Ainsi, pour le canon de 75 mm Mle 1897, les tubes sont fabriqués à Bourges et Tarbes, les affûts à Tarbes et à Tulle, les caissons à Saint-Étienne et à Châtellerault, et les glissières et freins à Puteaux et Saint-Étienne. La plupart des canons portent le nom de leurs concepteurs, La Hitte, Reffye, Lahitolle, de Bange, Rimailho ou Filloux qui sont des officiers d'artillerie issus de l’École polytechnique. Les entreprises privées comme Schneider et Cie au Creusot ou Saint-Chamond sont d'abord associées à la recherche et à la production, mais ils ne comptent qu'à titre d'appoint, pour des pièces à la production limitée et souvent destinées à l'exportation. Mais, face aux nécessité de la guerre, les militaires font de plus en plus appel à eux. Et ils sont tout à fait heureux d'avoir, à côté des arsenaux d’État, des industriels qui non seulement leur proposent des modèles de pièces développés pour d'autres pays mais qui mettent aussi à disposition une capacité de recherche et de production pour faire face à la nécessaire diversification de l'artillerie.
Chez les Britanniques, un équilibre a peu près équivalent à celui de la France s'établit. Les arsenaux d’État produisent tout ce qui est du ressort de l'artillerie de masse, les constructeurs comme Armstrong-Witworth ou Stoke fournissent le matériel plus spécifique.
Chez les Autrichiens, l'équilibre repose de la même manière sur des arsenaux d’État et des industriels privés dont le plus connu est Škoda en Bohême.
Une doctrine d'emploi de l'artillerie de campagne sensiblement convergente pour tous les belligérants.
À l'origine, les doctrines d'emploi de l'artillerie de campagne des belligérants se ressemblent beaucoup et convergent vers un procédé unique. Fondée sur une guerre courte, rapide et offensive, l'artillerie n'a qu'une mission, l'accompagnement de l'infanterie. Sa « bête de somme » est un canon léger, à tir rapide et d'un calibre compris aux alentours de 75 mm, dont le tir est souvent direct. Le commandement de l'artillerie de campagne est déconcentré au niveau des divisions alors que celui de l'artillerie lourde est conservé au niveau de l'armée.
Toutefois, dès les années 1910, cette vision des choses suscite des discussions et des hésitations. En France, l'artillerie de campagne est très proche de l'artillerie allemande. Elle est exclusivement équipée du canon de 75 mm Mle 1897 répartis dans 65 régiments d'artillerie divisionnaires, 20 régiments d'artillerie de corps d'armée, 3 régiments d'artillerie coloniale et 4 régiments d'artillerie des colonies. Le nombre total de canons déployés est de 3 792 pièces réparties en 948 batteries de quatre pièces. Le concept d'emploi de l'artillerie fait l'objet d'un conflit acharné entre les partisans de l'offensive à tout prix qui veulent limiter les obstacles à la capacité de manœuvre de l'infanterie et les partisans d'une vision moins « romantique » qui voient les efforts que les Allemands ont fait en matière d'artillerie lourde de campagne. Les armées s'aperçoivent de cette carence et commencent à développer ou à faire développer des canons lourds mais ceux-ci n'arrivent sur le front que progressivement.
En Allemagne, l'artillerie de campagne dispose du canon standard de 77 mm FK 96. Elle est organisée autour d'un régiment à deux groupes par division, chacun comportant trois batteries de six pièces. Toutefois, l'artillerie a été adaptée à la fois aux leçons tirées des conflits les plus récents et aux moyens planifiés pour un bon déroulement du plan Schlieffen. Ainsi, l'artillerie de campagne fondée sur le canon de 77 mm a été renforcée par des canons de 105 mm et des obusiers de 150 mm qui font beaucoup de mal en tir de contre-batterie à l'artillerie française lors des premiers mouvements de la guerre. De même, pour venir rapidement à bout des fortifications belges, les Allemands ont développé des obusiers lourds de 420 mm et ont emprunté à leurs alliés autrichiens un certain nombre de mortiers de 210 mm Škoda.
Une carence notable de l'Entente en matière d'artillerie lourde
Effectivement, chez les Alliés, l'artillerie lourde est le parent pauvre dans le corps de bataille car les planificateurs d'avant 1914 n'ont pas prévu son usage. Il est vrai que sa lenteur de mise en œuvre et la masse de logistique qu'elle nécessite va à l'encontre de l'idée d'une guerre de mouvement courte et rapide en vigueur à l'époque. Toutefois, dire que l'armée française n'en possède pas est inexact. D'une part, l'idée stratégique consiste à confier l'artillerie lourde aux équipages des fortifications et de ne laisser au corps de bataille qu'une artillerie capable de l'appuyer sans pour autant gêner sa souplesse et ses mouvements. D'autre part, l'état-major s'est aperçu de cette carence. En 1914, cinq régiments d'artillerie lourde sont créés à raison d'un par armée. Ils déploient au total 67 batteries. Ils sont équipés de canons d'ancienne génération disponibles comme le 240 mm modèle 1887, le 155 mm long modèle 1877 ou le 120 mm long modèle 1878, de mortiers de 220 modèle 1880 ou de 270 modèle 1885 tous du modèle de Bange ou d'obusiers plus récents comme l'obusier de 120 court modèle 1890 Baquet ou le 155 C modèle 1907 à tir rapide Rimailho.
De lourds investissements dans une artillerie de forteresse qui ne sert pas beaucoup
En Allemagne, le plan Schlieffen s'appuie sur deux attaques successives, une première contre la Belgique, une deuxième contre la France. Pour combler le temps entre le déclenchement des deux offensives sur le front français et pour faire face aux attaques françaises, les Allemands mettent en place trois lignes de défense fortifiées principales, l'une en Alsace, la ligne de défense Strasbourg-Mutzig, l'une en Lorraine, la ligne de défense Metz-Thionville et une troisième sur le Rhin autour de Cologne. Ces fortifications nécessitent des développements technologiques importants accélérés par la « crise de l'obus torpille » qui met à bas toutes les certitudes acquises en la matière. Mais le développement du concept de « Fest » qu'on trouve illustré au fort de Mutzig et dans les nouvelles fortifications autour de Metz remet la fortification à l'ordre du jour. Les canons sont désormais contenus dans des tourelles rotatives blindées dont Gruson et Schumann se font les promoteurs.
En France, un effort tout particulier a été fait sur la fortification sous la férule du général Séré de Rivières, mais, en fonction de l'évolution de la doctrine, cet effort n'est pas constant. L'artillerie à pied composé de sept régiments est attachée à la fois à l'artillerie de place, à l'artillerie « de siège » et à l'artillerie de côte. Comme artillerie de siège, elle met en œuvre des pièces d'artillerie lourde mobiles destinées à neutraliser les places fortes allemandes comme Metz. Elle compte au total 358 batteries10 réparties entre l'armée de terre et la marine. Enfin, face à la crise de l'obus torpille, le béton armé se généralise en tant que matériau de construction. La maçonnerie des forts-masse de la génération antérieure construits après la guerre de 1870 sont simplement renforcés avec du béton. À l'instar des Allemands, des pièces sous coupole blindée à éclipse sont développées, les tourelles Mougin/Saint-Chamond, Bussière/Fives-Lille, Chatillon-Commentry et Galopin Mle 1890 équipée d'obusiers lourds, pour compenser la vulnérabilité des pièces servies à ciel ouvert.
Bien que largement sollicitée lors de la bataille de Verdun notamment, où les forts jouent un rôle prépondérant, l'artillerie de forteresse ne connaît pas d'évolution majeure. En revanche, l'artillerie lourde à grande puissance destinée à détruire ces fortifications connaît une évolution importante.
Une artillerie de tranchée que seuls les Allemands possèdent
Les Allemands dont la pensée militaire est très bien organisée[non neutre] ont tiré les leçons des conflits de la guerre de Crimée jusqu'à la guerre russo-japonaise où les fortifications de circonstances ont pris une grande importance. C'est pourquoi, ils ont développé, dès avant la guerre, une véritable capacité de feu autonome pour l'infanterie, de la grenade au lance-grenades et au mortier.
Les développements de l'artillerie pendant la guerre
L'artillerie dans les deux camps connait quatre type d'évolutions :
- Le développement d'une artillerie propre à l'infanterie
- Le développement d'une artillerie lourde voire très lourde
- La multiplication d'artilleries spécialisées et de spécialités annexes
- Le développement d'une stratégie et d'une tactique
Le développement d'une artillerie de tranchée propre à l'infanterie
Avec l'apparition des tranchées, les armes à tir direct montrent vite leurs insuffisance. L'artillerie de campagne faite pour la guerre de mouvement n'échappe pas à ce constat. D'une part, sa capacité en tir vertical et plongeant est très limitée contre les tranchées, elle ne sert que lors des offensives à appuyer les mouvements d'infanterie. D'autre part, le champ de bataille désormais limité à des lignes de tranchées et un no man's land lui laisse peu de place pour se mettre en batterie. Elle est donc obligée de s'enterrer loin à l'arrière de l'infanterie et à pratiquer des tirs indirects. Les liens entre les deux armes se distendent, les appuis sont soumis à un système de transmissions fragile et peu réactif . L'infanterie a donc besoin d'une artillerie proche d'elle, décentralisée, directement sous les ordres du chef sur place et qui soit adaptée aux caractéristiques du combat de tranchées, trajectoires courtes et verticales, munitions explosives massives avec un poids et encombrement des pièces minimal.
La grenade et les lance-grenades.
La première évolution est le développement de la grenade qui ne fait pas partie à proprement parler de l'artillerie mais qui revient à envoyer à la main une quantité d'explosifs limité à l'instar d'un obus.
Avec la grenade se pose le problème de la portée. Des lance-grenades sont alors inventés pour porter l'explosif dans les tranchées adverses. Les calculs nécessaires pour établir les trajectoires se rapprochent des procédés de l'artillerie. Au départ, il s'agit de simples catapultes élastiques ou de pompes à air comprimé mais peu à peu la propulsion devient pyrotechnique Ces lance-grenades peuvent être mis en œuvre à partir des fusils standards, c'est le cas du tromblon Vivien-Bessières avec des cartouches de propulsion et un appareillage de visée propre ou à l'aide de tubes de propulsion ad hoc comme les toffee pudding britanniques ou les granatwerfer allemands.
La renaissance du mortier de campagne
Des concepts anciens sont remis à l'ordre du jour comme le mortier. Faute d'en avoir construit avant-guerre, les mortiers en bronze datant du Second Empire, les crapouillots, qui donneront à l'artillerie de tranchées son surnom, sont destockés. Parallèlement, après des bricolages peu concluants, des modèles de mortiers comme le 58 mm sont développés. L'ultime système est développé par la firme britannique Stoke et restera comme le modèle indépassable des mortiers d'infanterie jusqu'à nos jours.
La construction de canons d'infanterie spécifiques
Enfin, les fantassins sont dotés de canons d'infanterie visant à leur apporter instantanément des appuis directs, par exemple un canon de 37 mm pour les Français, le canon d'infanterie de 37 mm, de 75 mm voire de 77 mm pour les Allemands.
Le développement d'une artillerie lourde voire très lourde
L'artillerie lourde
Obusier 155
mm Rimailho, Gernicourt (Aisne), janvier 1915
11.
Devant l’avènement de la guerre de positions, de grands efforts sont entrepris pour contrebalancer l'avantage allemand. Dans un premier temps, l'artillerie de campagne est renforcée de pièces au calibre et à la portée plus importants. Dans un deuxième temps une l'artillerie lourde à grande puissance (ALGP) spécifique est développée selon quatre axes principaux :
Cette artillerie est essentiellement dérivée de canons de marine ou de canons d'artillerie côtière placée sur des chassis ou des plateformes qui leur assure une souplesse d'emploi et une certaine mobilité en milieu terrestre.
L'artillerie lourde hippomobile est nécessairement de calibre et de poids limités. En outre, les chevaux dont toutes les armes ont besoin, se font rares malgré la mise en retrait de la cavalerie. Il faut donc commencer à introduire des tracteurs automobiles.
La multiplication d'artilleries spécialisées et de spécialités annexes
La topographie
Le tir indirect implique que la topographie des positions d'artillerie et des objectifs soit particulièrement soignée.
La mission de cartographie est partagée entre le génie qui en est le détenteur d'origine et l'artillerie qui en est le principal utilisateur.
L'artillerie de repérage
La guerre de tranchée fige les positions des belligérants. La guerre donne trois grandes missions à l'artillerie :
- le harcèlement de l'adversaire
- la préparation des offensives
- le tir de contre-batterie
Afin de pouvoir exécuter avec précisions le tir de contre-batterie, les belligérants et notamment les Allemands développent une artillerie de repérage qui permet de localiser les batteries ennemies afin de pouvoir les neutraliser. Ce repérage s'effectue à l'aide d'une triangulation effectuées sur deux artefacts, le son et la lumière émis par les batteries adverses. Des nouveaux matériels et des unités spécifiques sont donc créés pour assumer cette mission.
Ce repérage est complété par le travail de l'aérostation puis de l'aviation.
L'aérostation
L'aérostation a parmi ses missions majeures l'observation des tirs d'artillerie. Sa vulnérabilité, son manque de souplesse et l'avènement de l'aviation la font disparaître petit à petit du champ de bataille au profit de l'aviation. Son rôle n'est pas à négliger cependant.
L'aviation
Cette mission d'observation est dévolue à l'aviation dès que celle-ci montre suffisamment de capacités pour l'assumer. Naturellement, les militaires découvrent petit à petit toutes les vertus de la troisième dimension et son rôle dans d'autres fonctions comme le renseignement puis dans l'attaque ou l'appui au sol. En outre, elle se découvre une logique propre dans la guerre aérienne, la chasse. Aussi, elle s'autonomise petit à petit au cours du conflit et devient une arme puis, de manière différenciée par pays, une armée à part entière. La Grande-Bretagne dont l'aviation est partagée entre l'armée de Terre et la marine est la première à faire le pas dès 1919 avec la création de la Royal Air Force. Dès son réarmement, au début des années 1930, l'Allemagne créé une Luftwaffe distincte. La France attend 1936 pour créer une armée de l'Air digne de ce nom. Les Etats-Unis attendent 1947 pour créer l'US Air Force.
Cette prise d'autonomie implique alors le développement d'une branche spécifique, l'aviation d'observation ou d'appui aux troupes terrestres qui est soit partagée avec l'armée de l'air chargée de la troisième dimension, soit développée au sein même des armées de terre avec la création d'une aviation légère adaptée avec pour mission l'observation des tirs, le renseignement tactique, le transport, les liaisons et certaines missions d'appui au sol spécifiques comme la lutte antichar.
L'artillerie antiaérienne
Avec l'avènement de l'aviation, l'artillerie sol-air se développe. Dès le début, les armes d'infanterie et les mitrailleuses s'avèrent impuissantes contre des aéronefs qui volent haut et loin. Il faut donc passer à un niveau au-dessus, une artillerie spécifique pour lutter contre les avions. L'effet qu'elle doit obtenir s'apparente à l'effet fusant, il s'agit de faire éclater au plus près de l'aéronef un obus pour l'endommager au maximum. Si les pièces utilisées sont relativement proches de celles de l'artillerie de campagne, les châssis sur lesquels elles sont utilisées sont obligés de tenir compte de l'aspect vertical du tir, d'où des adaptations spécifiques : appareils de visées, système de réglage des fusées spécifique, liens élastiques renforcés, chargement rapide, doctrine propre en matière de mise en œuvre, de visée et de positionnement, utilisation systématique de télémètres, orientation rapide tous azimuts, etc.
L'artillerie d'assaut
Pendant la Première Guerre mondiale, le développement et la mise en œuvre des chars d'assaut sont confiés, chez les Britanniques à une arme spécifique, le Royal Armoured Corps, et chez les Français, à l'artillerie sous le nom d'artillerie d'assaut. En effet, le char est avant tout considéré comme un canon protégé et des mitrailleuses auxiliaires pour la défense rapprochée. Ce n'est qu'après l'armistice que les chars sont divisés en deux et confiés respectivement à l'infanterie et la cavalerie, L'infanterie les reçoit au nom de son soutien et de son accompagnement, la cavalerie, au nom de ses missions de renseignement et de reconnaissance. Cette dichotomie se poursuit jusqu'à la Seconde guerre mondiale et créée les conditions pour que les grandes unités mécanisées que réclame le colonel de Gaulle ne soit pas créés et que les capacités blindées soit dispersées dans les corps de troupe d'infanterie et de cavalerie.
La Deuxième Guerre mondiale, l'apothéose de l'artillerie
L'entre-deux-guerres dans la lancée de la Première Guerre mondiale
L'artillerie ne connaît pas d'évolution majeure pendant l'entre-deux-guerres mais continue à progresser selon des données recueillies pendant la Première Guerre Mondiale. Dans beaucoup de pays, les crédits destinés aux études et au développement d'armements sont insuffisants au goût des responsables militaires dont la charge est d'entrevoir ce que sera le prochain conflit. Les parcs et les magasins sont encore plein d'armements neufs ou très peu usagés d'ancienne génération qu'il faut prendre en compte avant d'envisager toute innovation et toute nouvelle fabrication. Des efforts marginaux sont faits par les Alliés pour développer de nouveaux matériels. Seule l'Allemagne a l'occasion de reprendre à zéro son concept de l'artillerie et plus généralement de l'appui des troupes au sol qui donne naissance à la Blitzkrieg.
L'artillerie de forteresse
Avec le développement des lignes Maginot, Siegfried et du mur de l'Atlantique, les fortifications de la dernière génération ont besoin d'une artillerie spécifique, non point par ses tubes, mais par la manière dont elle est disposée et protégée.
L'artillerie de l'infanterie
Tout de suite après la guerre, l'artillerie de tranchée est dissoute et les pièces d'appui rapprochées, essentiellement des canons légers et des mortiers de petits calibres sont directement attribuées à l'infanterie.
Les canons d'assaut
Bien que ne faisant pas partie de l'artillerie à proprement parler, les canons d'assaut sont des pièces d'artillerie montées en casemate sur des châssis blindés, de récupération ou spécifiques. Ils constituent à la fois un retour en arrière dans la conception des chars et un outil hybride, un retour en arrière car ils reviennent aux concepts initiaux type Saint-Chamond, Schneider ou blindés britanniques, avec l'artillerie principale incorporée dans le châssis, un outil hybride dans la mesure où certains d'entre eux ont une double capacité tir direct, tir indirect.
L'artillerie de saturation (lance-roquettes)
Un nouveau type d'artillerie développé par les Soviétiques (roquettes GRAD - surnommées Katioucha) fait son apparition à partir des années 1941-1942, l'artillerie de saturation, fondée sur des roquettes balistiques envoyées en masse par des lance-roquettes multiples. Son avantage est d'obtenir à moindre coût les effets recherchés le plus souvent avec l'artillerie. Son but n'est pas de détruire un objectif en particulier, la précision des roquettes ne le permet pas, mais de saturer par les feux une zone dans laquelle se trouve une concentration ennemie ou qui est le point de rupture d'une offensive.
Curieusement, après la mise en place par les Allemands d'une réplique, le Nebelwerfer, puis, après la guerre, le système MARS (Mittleres Artillerie-Raketen-System), livré à la Bundeswehr, les Occidentaux ne sont guère intéressés au procédé jusqu'à la fin de la guerre froide.
L'artillerie de la Guerre froide, un développement direct des concepts de la Deuxième Guerre mondiale.
Jusqu'à la fin de la guerre froide, l'artillerie résiste plutôt bien à l'évolution des conflits modernes.
Une doctrine d'emploi directement issue des combats de la Deuxième Guerre mondiale.
L'avènement du missile
Avec l'avènement des "dividendes de la paix" son rôle est de moins en moins évident dans les conflits asymétriques d'aujourd'hui
L'artillerie a beaucoup souffert du concept de « dividendes de la paix ». Même si chaque brigade de l'armée française comprend un régiment d'artillerie, son rôle est beaucoup moins évident dans des conflits asymétriques où son usage est plus rare. Les régiments sont souvent déployés en OPEX sous la forme d'unités Proterre, concept générique qui permet de mettre à disposition des troupes aux caractéristiques quasi identiques, quelle que soit leur spécialité d'origine.
Artillerie sol-sol
Les missiles nucléaires tactiques de type Pluton puis Hadès sont supprimés au milieu des années 1990 car leur utilité dans l'après guerre-froide n'est pas avérée et cause des dissensions politiques sérieuses avec nos alliés allemands.
L'AUF 1 qui était un obusier de la guerre froide fait pour suivre le corps de bataille avec son châssis chenillé est progressivement remplacé par le Caesar, un canon de 155 mm auto-mouvant monté sur un châssis à roues et dont l'équipage n'est pas protégé.
Dans le cadre d'un effort d’allègement et de diversification dans le cadre des conflits asymétriques, les régiments ont reçu les Mortiers 120 mm Rayé Tracté Modèle F1 en double dotation.
Le lance roquette multiple M270 MLRS est devenu lance-roquette unitaire LRU en raison de l'interdiction des armes à sous-munitions que la France a signé et ratifié.
Artillerie sol-air
L'artillerie sol-air a quasiment disparu avec les missiles Roland et les missiles Hawk. Il ne reste plus à disposition que des missiles à très courte portée de type Mistral et des canons antiaériens de petit calibre. Seule l'armée de l'air a conservé des missiles sol-air du type ASMP/T pour la défense des points sensibles.
Acquisition d'objectifs
L'artillerie est la première arme à avoir pris sérieusement le concept de drone. Bien qu'elle se soit limitée à la fonction de reconnaissance, elle a été dès 1958 au centre du projet R20, un avion cible sans pilote transformé en aéronef de reconnaissance programmé. Après une vingtaine d'années d'essais peu concluants, elle se tourne vers le système d'arme CL-89 et CL-289 et, à l'instar des Israéliens, elle commence à envisager des systèmes de drones téléguidés à courte portée, en deçà de la ligne d'horizon tel que le MART. Mais, comme pour l'artillerie sol-air, c'est l'aspect aéronautique qui l'emporte. La fonction a donc été, non sans réticence de sa part, captée par l'armée de l'air qui met en œuvre des drones de construction américaine destinés à l'attaque et au renseignement. Elle garde toutefois un système de drone de renseignement un peu résiduel, le Crécerelle.
Les grands artilleurs
- Jean Bureau révolutionne l'artillerie médiévale. Avec son frère Gaspard, il est le véritable initiateur de l'artillerie de campagne, c'est-à-dire de l'emploi de canons mobiles sur le champ de bataille. Cette mutation profonde de la technologie militaire au milieu du XVe siècle, permettra aux troupes françaises de prendre un ascendant décisif sur l'armée anglaise, et de mettre ainsi fin à la guerre de Cent Ans. Sous son impulsion, le boulet en pierre est remplacé par le boulet en fer, les tubes en fonte font leur apparition. Jean Bureau met fin au chaos des calibres utilisés en imposant les sept calibres de France.
- Choderlos de Laclos participe à la mise au point, dans les années 1795, des boulets de canon explosifs, « c’est-à-dire creux, emplis de poudre et capables – en faisant exploser la poudre qu’ils contiennent – d’envoyer des éclats à leur arrivée au sol ».
- Napoléon Ier (Napoléon Bonaparte, 1769-1821), nommé lieutenant en second d’artillerie le . Au début du mois suivant, il reçut ordre d’aller rejoindre à Valence, en Dauphiné, le régiment d’artillerie de La Fère, qui était en garnison dans cette ville ; à son arrivée, on le plaça dans une des compagnies de la brigade des bombardiers. Par la suite, tout au long de sa carrière militaire puis lors de son règne, il fut dans l'histoire le premier des stratèges militaires à concevoir ses plans de bataille d'abord et avant tout autour de l'utilisation de l'artillerie, notamment lors du siège de Toulon (1793) ou de la bataille d'Austerlitz (1805), inaugurant ainsi l'ère moderne de la stratégie militaire par une gestion rationnelle de la puissance de feu et de ses effets. Son intérêt pour la cartographie, sa manière de préparer ses plans de bataille très à l'avance à partir des éléments cartographiques, et sa gestion rigoureuse de la logistique sont également typiques d'un artilleur qui se devait de baliser le terrain sur lequel il aurait à déclencher des feux en utilisant ses munitions disponibles.
- Émile Rimailho (1864-1954) apporta divers perfectionnements aux canons en usage dans l'armée française après la défaite de 1870 : limitation du recul, sécurisation de la mise à feu, meilleure mobilité. Ses travaux sont notamment à l'origine du canon de 75 et de l'Obusier de 155 mm CTR modèle 1904, appelé « Rimailho » (du nom de son concepteur) pendant la Première Guerre mondiale.
- Ferdinand Foch.
- Louis Filloux (1869-1957), concepteur entre autres du canon de 155 mm GPF
L'artillerie aujourd'hui
En France
| Artillerie |

Insigne de béret de l'Arme de l'Artillerie dans l'armée française. |
|
| Pays |
 France France |
|---|
| Branche |
Armée de Terre |
|---|
| Type |
Arme |
|---|
| Rôle |
appui par le feu. |
|---|
| Couleurs |
Bleu et écarlate |
|---|
| Devise |
Ultima ratio regum (« Le dernier argument des rois ») |
|---|
| Anniversaire |
Sainte Barbe
(4 décembre) |
|---|
modifier  |
Après Versailles, Strasbourg, Metz et Chalons-sur-Marne, Draguignan est la « capitale » française de l'artillerie : elle accueille depuis 1976 l'école de spécialisation de cette arme. Sainte Barbe, fêtée le 4 décembre, est la patronne des artilleurs.
La chanson des artilleurs la plus célèbre est « L'artilleur de Metz », cette ville ayant accueilli dès 1720, une école d'application d'artillerie, fusionnée en 1794 avec l’École d'application du génie de Mézières puis avec l’École d'artillerie de Châlons en 1807 et fermée en 1871 lors de l'annexion allemande.
Durant la Première Guerre mondiale, 1 373 000 hommes furent mobilisés dans cette arme et eurent à déplorer 82 000 morts soit 5,96 % de pertes12.
Durant ce conflit, cette arme a pris une part de plus en plus importante au sein des forces françaises :
En France, on désigne sous le terme d'« artillerie sol-sol » les unités et systèmes d'armes qui prennent à partie des objectifs au sol et « artillerie sol-air » ceux qui prennent à partie des aéronefs. L'artillerie sol-sol est, de manière générale, l'arme des tirs indirects. Les unités d'artillerie utilisent des armements d'un calibre supérieur ou égal à 20 mm. Comme le génie, l'artillerie est une arme d'appui (par opposition à l'infanterie et à l'arme blindée cavalerie qui sont les armes de mêlée). L'artillerie française possède différents types d'unités.
Les unités d'appuis indirects servent le TRF1 (canon tracté de 155 mm), l'AUF1 (canon automoteur de 155 mm). Toutes les unités « AIN » (appuis indirects) ont le mortier de 120 mm en double dotation.
Canon F2 de 20
mm de la Marine française.
Les unités de défense sol-air servent le ROLAND, le MISTRAL ou le HAWK (qui sont trois missiles sol-air différents et complémentaires).
Il existe également un régiment spécialisé dans la mise en œuvre de télédynes légers télé-pilotés appelés drones pour obtenir des images numériques des zones survolées. L'information tirée de l'analyse de ces images sert à élaborer ce que l'on appelle le « renseignement d'origine image » (ROIM).
Autrefois, la distinction entre « canon » et « mortier » se faisait sur la hausse. Les canons tiraient en tir plongeant (angle de hausse inférieur à 45° - ou 800 millièmes en termes d'artillerie) et les mortiers tiraient en tir vertical (angle de hausse supérieur à 45°). Aujourd'hui, tous les canons d'artillerie sont capables d'effectuer des tirs tendus (pour lesquels la flèche de la trajectoire est inférieure à la demi-hauteur de l'objectif), comme les chars et du tir vertical. Le critère de la hausse est donc inadéquat et le critère pour différencier un canon d'un mortier est le nombre de calibres qui est un nombre sans dimension déterminé par le rapport entre la longueur de la partie rayée et le calibre. En France, une pièce d'artillerie dont le nombre de calibres est inférieur à 20 est un mortier, un canon si ce nombre est supérieur ou égal à 20. Aux États-Unis, par exemple, cette valeur est de 25 et variable selon les pays.
Matériel de l'Armée française
Le matériel de l'Armée française des années 1990-2000 est composé de :
- canon de 155 mm appelé TRF1 (TRacté modèle F1), utilisé notamment pendant la guerre du Golfe par la France en Irak ;
- canon de 155 mm monté sur châssis de Char AMX 13 appelé AMF3 (AutoMouvant modèle F3). Pièce mise en œuvre par une équipe de 10 soldats (canonniers) ;
- canon de 155 mm monté sur châssis de char AMX-30 appelé AuF1 (AUtomoteur modèle F1), à grande cadence de tir (GCT, chargement automatique). En cadence de tir maximale, appelée « efficacité », l'AuF1 peut tirer jusqu'à 6 obus à la minute à une distance de 30 kilomètres ;
- canon de 155 mm sur camion appelé Caesar13 ;
- mortier 120 mm Rayé Tracté Modèle F1 (MO 120 RT) ;
- systèmes sol-air Hawk (retiré), Roland (châssis d'AMX-30) (retiré), Mistral ;
- le lance-missile nucléaire Hadès (retiré) ;
- le VOA ou véhicule d'observation d'artillerie, la plupart du temps monté sur un châssis d'AMX-10, permettant aux officiers observateurs de se déplacer sur la ligne de front tout en réglant les tirs déclenchés plusieurs kilomètres à l'arrière par les batteries de canons (artillerie sol-sol) ;
- le LRM (Lance-roquettes multiples) (retiré) pouvait tirer 12 roquettes jusqu'à 30 km contenant 644 grenades chacune. Une roquette couvrait l'équivalent de la superficie d'un terrain de football. Les grenades sont à double effet : anti-personnel (rayon des éclats dangereux : 30 m) et anti-blindé léger (transperce 70 mm d'acier).
En 2014, on prévoit, après de grandes coupes dans le parc :
- 13 LRU (Lance Roquettes Unitaire)14. Le LRU consiste en une modernisation du parc LRM avec une dotation de munitions à précision métrique, guidée par GPS et dotée d’une charge unitaire. L'aspect lance-roquette multiple a été supprimé à la suite de la signature par la France de la Convention sur les armes à sous-munitions en 2008. Il offre une capacité de tir de frappe de précision avec des effets modulables à longue portée (70 km) par tous temps ;
- 37 AuF1 (au 40e régiment d’artillerie uniquement à terme) ;
- 77 Caesar15 ;
- 43 TRF1 ;
- 128 MO 120 RT ;
- 144 postes de tir Mistral.
Unité de base de l'artillerie dans l'Armée française
L'unité de base de l'artillerie française est la batterie. Elle est composée d'une centaine d'hommes, commandée par un capitaine avec quatre lieutenants — ou ayant rang — pour le seconder. Une batterie comprend :
- six à huit canons, positionnés à l'arrière et commandés par le lieutenant de tir. Elle peut être divisée en deux sections indépendantes pour limiter le volume des tirs, séparer les pièces pour qu'elles ne soient pas vulnérables aux tirs de contre-batterie ou permettre d'assurer une continuité des feux tout en se déplaçant par demi-batterie ;
- un train de combat qui lui permet de se ravitailler en munitions et d'effectuer des réparations sommaires de tubes ou de véhicules ;
- une section de reconnaissance, ou équipe de reconnaissance topographique (ERT), commandée par le lieutenant de reconnaissance et qui sert à reconnaître les positions où se déplacera la batterie, déterminer ses coordonnées géographiques et effectuer l'orientation des pièces afin de les rattacher au système de référence ;
- des équipes d'observation, ou encore appelées DLOC, se chargent de la composante « avant » de l'artillerie française. Elles repèrent les objectifs, déterminent leurs coordonnées géographiques, déterminent les types de tirs et de munitions qu'il faut pour les traiter et effectuent éventuellement des réglages pour concentrer le tir sur eux. Elles sont équipées de VOA, RATAC, VAB OBS.
Notes et références
Notes
- Mais qui est en fait un veuglaire, avec une boîte de culasse mobile, laquelle est munie d'une poignée de manutention. Cette boîte, qui renfermait la charge de poudre, était verrouillée et plaquée contre l'âme du canon au moyen de la clavette conique que l'on voit sur la photo?
- « Il y en avait tant et de si gros que nous, qui ne sommes pas artilleurs, nous avons eu un moment d'inquiétude naïve pour notre pays et nous avons demandé humblement s'il n y en avait pas un peu aussi pour la France. » Dans Fabrique d'acier fondu de Friedrich Krupp, publié à Essen (Prusse), 1866. Consulter en ligne [archive].
Références
- « Pierrier à boîte » [archive], sur basedescollections.musee-armee.fr (consulté le )
- « Histoire de l’artillerie terrestre à travers ses grandes évolutions. 2- Un long et lent parcours » [archive], sur http://basart.artillerie.asso.fr [archive].
- Stéphane W. Gondoin, Châteaux forts : assiéger et fortifier au Moyen Âge, Éditions Cheminements, , p. 282-283.
- Philippe Contamine, « L'artillerie royale française à la veille des guerres d'Italie », Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, t. 71, no 2, , p. 221-261 (lire en ligne [archive]).
- (en) Ian V. Hogg, The History of Fortifications, Londres, Orbis Publishing Limited, , 256 p. (ISBN 978-0-85613-028-1, BNF 42531511), p. 96 à 120
- § d’après Françoise Deshairs et Véronique Faucher, Briançon, ville forte du Dauphiné, livre + CD-ROM, La Maison d'à-côté et Fortimédia, (ISBN 2-930-38415-8), 2006, sur le CD-ROM.
- Curt Johnson, Artillerie, Paris, Fernand Nathan, , 145 p., p. 12 à 17
- Curt Johnson, Op. cit., p. 18 à 27
- Histoire de l'Europe au XXe siècle Tome 1: [1900-1918]. Éditions Complexe, 1994. p. 319 Lire en ligne [archive]
- François Vauvillier, « Notre artillerie en campagne en 1914 », Guerre, blindés et matériels, no n°110, .
- « Artillerie lourde » [archive], sur http://www.verney-grandeguerre.com [archive] (consulté le )
- Nicolas, Meaux, Marc Combier, Regard de soldat, Acropole, 2005, (ISBN 2-7357-0257-X).
- www.giat-industries.fr [archive].
- https://www.defense.gouv.fr/dga/equipement/terrestre/le-lru-lance-roquettes-unitaire [archive].
Bibliographie
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Liens externes
Artillerie française pendant la Première Guerre mondiale
L'artillerie française pendant la Première Guerre mondiale prend au cours de ce conflit un rôle essentiel au sein de l'Armée de terre française. Au début elle est composée essentiellement d'une artillerie légère de campagne, avec une fonction d'appui auprès de l'infanterie. Mais la stabilisation du front et la transformation du conflit en une guerre de tranchées et une guerre industrielle conduisent cette arme à muter, se développer, et prendre le premier rôle. Avant 1914 les militaires, sans négliger l'artillerie, attribuaient encore au fusil un rôle prépondérant, causant six fois plus de pertes que les canons ; au cours de la guerre, la proportion s'inverse complétement et passe à trois victimes de l'artillerie pour une par balle, de sorte qu'elle cause environ 75 % des pertes militaires 1.
Ses effectifs et sa puissance de feu augmentent considérablement, avec des canons de plus en plus gros, tandis que sa doctrine d'emploi s'adapte aux nouvelles conditions de combat : préparations massives pendant plusieurs jours, harcèlement permanent, tirs de barrage roulant, concentration des feux, etc. Ce développement donne naissance à l'« artillerie lourde à grande puissance » (composée d'énormes pièces provenant de l'artillerie de côte et de l'artillerie navale), à l'artillerie de tranchée, à l'artillerie anti-aérienne, à l'artillerie chimique (répandant des gaz toxiques), à l'artillerie spéciale (ou artillerie d'assaut : les chars de combat), à l'artillerie anti-char et, à la fin, à l'artillerie automotrice.
Sur le front occidental comme sur les autres théâtres d'opérations, pendant cinq ans, l'artillerie française a tiré environ trois cents millions d'obus, labourant les sols, pilonnant les retranchements et poursuivant son duel avec les artilleries adverses. Une telle puissance de feu a nécessité un effort industriel considérable.
Situation à l'entrée en guerre
L'artillerie est une arme (une subdivision) de l'Armée de terre française, dépendant du ministère de la Guerre. La gestion de son personnel et de son matériel relèvent de la direction de l'artillerie, complétée par la direction des poudres et salpêtres, ainsi que la direction des troupes coloniales (pour le personnel de l'artillerie coloniale, qui n'est pas du ressort du ministère des Colonies)2. Mais toute l'artillerie ne dépend pas du même ministère : si l'artillerie navale est attachée au ministère de la Marine, l'artillerie de côte est partagée entre la Guerre et la Marine, la seconde reprenant à partir de le contrôle des forts et batteries des rades de Cherbourg, de Brest, de Toulon et de Bizerte (avec application en catastrophe lors de la mobilisation)3.
Au sein de l'Armée, l'artillerie est considérée comme un auxiliaire de l'infanterie, lui fournissant l'appui de ses feux ; l'infanterie est considérée comme la « reine des batailles », hormis le cas du siège d'une place forte. L'armement, l'organisation et la doctrine d'emploi de l'artillerie française sont déterminés par ces principes : il s'agit donc essentiellement d'une artillerie légère et mobile. Malgré cette subordination, l'artillerie française a alors une réputation prestigieuse : c'est, avec le génie, l'arme savante, une affectation prioritaire (à 70 %) pour les polytechniciens (la promotion 1913 est intégralement versée dans l'artillerie de campagne)4, avec une spécialisation à l'École d'application de Fontainebleau.
L'uniforme est traditionnellement bleu nuit, couleur jugée moins salissante, avec des bandes écarlates sur les pantalons et les culottesn 1. L'habillement et l'équipement sont légèrement différents entre le personnel monté (les conducteurs et les hommes des batteries à cheval) et celui non monté (les servants des batteries montées et de l'artillerie à pied) : dans le premier cas les effets sont inspirés de ceux de la cavalerie (ceinturons de sabre en cuir fauve, culottes et éperons), dans le second de ceux de l'infanterie (ceinturons en cuir noirci, cartouchières, jambières et pantalons)5. Le képi est généralisé comme couvre-chefn 2.
Armement
Les pièces d'artillerie sont classées en fonction de leur calibre (le diamètre intérieur du tube, donc celui des projectiles tirés), exprimé en millimètres pour l'artillerie terrestre et en centimètres pour l'artillerie de côte (et l'artillerie allemande). Les mortiers correspondent aux pièces ayant un tube très court et tirant sous un angle élevé avec une très faible vitesse initiale, les canons courts (qu'on appelle maintenant « obusiers ») sont à faible vitesse initiale et donc à tir courbe et enfin les canons longs sont à forte vitesse initiale et donc à tir tendu.
L'armement individuel est composé d'une part du sabre modèle 1822/1899 et du revolver modèle 1892 pour les officiers, sous-officiers et hommes montés, d'autre part du mousqueton d'artillerie modèle 1892 avec sabre-baïonnette pour les hommes non montés5.
Modèles en dotation
L'armement de l'artillerie de campagne française en 1914 est composé presque uniquement d'un modèle de canon, le 75 mm modèle 1897 : la dotation totale est de 4 986 pièces de 75 mm, dont 3 680 font partie du corps de bataille déployé en métropole6 et 364 sont dans les places fortes (les autres canons de 75 mm servent à l'instruction, sont aux colonies ou font partie des réserves). Cette homogénéité a l'avantage de faciliter la logistique et l'entretien. Cette dotation est complétée par 128 canons de 65 mm M modèle 1906 (M pour « de montagne ») destinés aux troupes alpines, ainsi que par quelques canons de 75 mm modèle 1912 pour l'artillerie à cheval.
L'artillerie lourde de campagne est assez limitée en 1914, surtout par rapport à son homologue allemande : la faute en revient aux désaccords entre les services, au manque de financement et à la domination du 75 mm7. Les armées emportent tout de même avec elles 84 obusiers de 120 mm C modèle 1890 (C pour « court », surnommés 120 mm Baquet ; 126 autres obusiers sont à l'arrière) et 104 obusiers de 155 mm C TR modèle 1904 (C TR pour « court à tir rapide », surnommés 155 mm Rimailho)8.
L'artillerie de siège affectée à l'armée de campagne est réduite, composée de pièces d'artillerie plus anciennes du système de Bange sur affût SP (« de siège et de place ») : 60 canons de 120 mm L modèle 1878 (L pour « long ») et 24 mortiers de 220 mm modèle 188010.
L'artillerie de forteresse, appelée à l'époque « artillerie de place », arme les forts et batteries du système Séré de Rivières (principalement dans les quatre « camps retranchés » de l'Est : Verdun, Toul, Épinal et Belfort). Elle compte quelques pièces modernes à tir rapide : il y a 73 tourelles à deux canons de 75 mm R modèle 1905 (R pour « raccourci »), dont 57 tourelles sont en place sur un fort et 16 sont dans les dépôts (pas encore installées)11, ainsi que 44 casemates de Bourges armées chacune avec deux canons de 75 mm modèle 1897 sur affût de casemate12. Mais la majorité des fortifications françaises sont armées avec les canons plus anciens notamment du système de Bange, avec 778 de 80 mm modèle 1877, 3 994 de 90 mm modèle 1877, 1 524 de 95 mm modèle 1875, 2 296 de 120 mm L modèle 187813, 1 392 de 155 mm L modèle 187714, 331 mortiers de 220 mm modèle 1880 (et 1880 modifié 1891), ainsi que 32 de 270 mm modèle 1885 et modèle 188915. Cinq casemates de Bourges sont armées avec chacune deux canons de 95 mm modèle 1888 sur affût de côte12.
Enfin, se rajoutent les pièces d'artillerie de côte (celles défendant les littoraux dépendent du ministère de la Guerre, tandis que celles protégeant les ports militaires de celui de la Marine, du 37 mm jusqu'au 37 cm, dont une dizaine de canons de 75 mm)16, l'artillerie anti-aérienne (limitée à un prototype d'autocanon, avec huit autres en construction en août 1914), ainsi que les vieux canons stockés dans les dépôts, notamment les canons de 95 mm modèle 1875 (surnommé 95 mm Lahitolle), les canons de 90 mm modèle 1877 et 80 mm modèle 1877 (de Bange).
Pour le déplacement des pièces d'un endroit à un autre des villes ou ports fortifiés, on utilise le système Péchot de chemin de fer à voie étroite (voie 60). C'est après le Premier conflit mondial que la responsabilité des chemins de fer à voie étroite passe à l'arme du génie.
Caractéristiques
Le canon de 75 mm est, lors de son entrée en service en 1897 (la date de la première commande donne le numéro du modèle), une pièce d'artillerie assez révolutionnaire. Comme les autres pièces de sa génération, son tube est en acier, le canon est rayé et le chargement se fait par la culasse ; mais il a la particularité d'avoir un système de chargement rapide, et surtout un frein de recul lui permettant de ne presque pas bouger lors du tir, remettant tout seul le tube en position et d'atteindre ainsi des cadences records. En prime, la relative légèreté de son affût et la traction hippomobile (il faut 168 chevauxn 4 pour une batterie avec 22 véhicules ; chaque canon est tracté par six chevaux) lui donne une bonne mobilité pour l'époque.
Le tir du 75 mm est plutôt tendu (ce qui permet de faire des ricochetsn 5 pour frapper derrière une crête)18, mais l'empêche de battre les replis de terrain. L'instruction des canonniers prévoit donc l'emploi d'une charge réduite et d'une plaquette permettant un tir beaucoup plus courbe, mais court (la distance moyenne de combat est de 2 500 m)19. Les artilleurs disposent du choix entre plusieurs projectiles : l'obus à balles (le shrapnel, utilisé contre le personnel), l'obus explosif (contre le matériel, un bois, une localité ou un retranchement), la boîte à mitraille (pour le tir à très courte portée), l'obus fumigène, l'obus traceur (pour le tir antiaérien), l'obus incendiaire, l'obus éclairant (pour le tir de nuit, contenant un parachute) et l'obus lacrymogène. La dotation pour chaque pièce de 75 est composée majoritairement d'obus à balles, utilisés en tir fusant (explosant en l'air), complétés par des obus explosifs, ceux-ci utilisés en tir fusant ou percutant (explosant au sol) ; le choix entre fusant et percutant se fait par réglage de la fusée de l'obus.
Pièces d'artillerie de campagne en dotation en août 191420,21
|
| Canon de 65 mm M modèle 1906 |
400 kg |
10 à 15 coups/min |
5,5 km |
obus à balles (4,4 kg) ou explosif (3,8 kg) |
| Canon de 75 mm modèle 1897 |
1 140 kg |
12 à 18 coups/minn 7 |
6 à 10 kmn 8 |
obus à balles modèle 1897 (7,2 kg) |
| obus explosif modèle 1900 (5,5 kg) |
| Canon de 75 mm modèle 1912 |
960 kg |
12 à 18 coups/min |
7,5 km |
obus à balles (7,2 kg) ou explosif (5,5 kg) |
| Canon de 120 mm C modèle 1890 |
1 475 kg |
2 coups/min |
5,7 km |
obus à balles (19,2 kg) ou explosif (18,7 kg) |
| Canon de 155 mm C TR modèle 1904 |
3 200 kg |
5 à 6 coups/min |
6,3 km |
obus à balles (40,8 kg) ou explosif (41,3 kg) |
Pièces d'artillerie de siège et place20,25
|
| Canon de 90 mm modèle 1877 |
1 210 kg |
un à deux coups/min |
6,8 km |
obus à balles (8,6 kg) ou explosif (8 à 8,4 kg) |
| Canon de 95 mm modèle 1875 |
1 450 kg (C) ou 1 850 kg (SP) |
un coup/min |
6,4 km |
obus à balles (12,3 kg) ou explosif (11 kg) |
| Canon de 120 mm L modèle 1878 |
2 750 kg |
un coup/min |
8,9 km |
obus explosif (18,7 kg) ou à balles (19,2 kg) |
| Canon de 155 mm L modèle 1877 |
5 800 kg |
un coup/min |
9,6 km |
obus à balles (40,8 kg) ou explosif (41 kg) |
| Mortier de 220 mm modèle 1880 |
4 145 kg |
un coup/3 min |
7,1 km |
obus explosif (98,4 à 102,7 kg) |
| Mortier de 220 mm mle 1901 (1880-1891) |
8 500 kg |
un coup/2 min |
| Mortier de 270 mm modèle 1885 et 1889 |
16 500 kg |
un coup/3 min |
7,9 km |
obus explosif (149,5 kg) |
Organisation
L'unité tactique élémentaire dans l'artillerie est la batterie (commandée par un capitaine, secondé par deux lieutenants ou sous-lieutenants), composée de quatre canons (chacun servi par un peloton de pièce, avec un maréchal des logis comme chef de pièce, secondé par deux brigadiers) et 171 hommes.
« L'unité de tir est la batterie. L'unité tactique est le groupe. »
— Règlement provisoire de manœuvre de l'artillerie de campagne, 1910, article 1er.
Trois batteries forment un groupe (sous les ordres d'un chef d'escadron), trois à quatre groupes forment un régiment d'artillerie (RA, dirigé par un colonel, secondé par un lieutenant-colonel). Au début du conflit, il n'y a aucune unité tactique d'artillerie supérieure au niveau régimentaire.
Temps de paix
L'organisation de l'artillerie française juste avant la mobilisation (déclarée le , avec effet le ) est fixée par la loi sur les cadres de 1909, modifiée en avril 191426 :
- 62 régiments d'artillerie de campagne (RAC), dont 32 à neuf batteries (servant d'artilleries divisionnaires, AD) et 30 à douze batteries (vingt servant d'artilleries de corps, AC, les dix autres fournissant en plus d'une AD un groupe d'artillerie à cheval) ;
- neuf régiments d'artillerie à pied (RAP, fournissant les batteries pour les places fortes et les batteries de côte)n 10 ;
- cinq régiments d'artillerie lourde (RAL, fournissant les artilleries d'armée) ;
- sept régiments d'artillerie coloniale (RA col., quatre dans les colonies et trois en métropole, ces dernières fournissant l'artillerie des trois divisions d'infanterie coloniale) ;
- deux régiments d'artillerie de montagne (RAM, fournissant de l'artillerie aux troupes alpines) ;
- dix groupes autonomes d'artillerie, appelés groupes d'artillerie d'Afrique, dont deux à pied et huit de campagne ou de montagnen 11,28.
En temps de paix, ces unités sont casernées sur l'ensemble du territoire métropolitain (avec une concentration le long de la frontière franco-allemande), mis à part les groupes autonomes d'Afrique déployés en Afrique du Nord, le 4e RA col. qui est au Tonkin, le 5e en Cochinchine, le 6e au Sénégal et le 7e à Madagascar. Les régiments en garnison dans chaque région militaire (en général trois RA) sont regroupés administrativement pour former une brigade (formant un total de 20 brigadesn 12), sous les ordres d'un général d'artillerie2.
Chaque division d'infanterie (DI) dispose d'un RAC, constitué de trois groupes soit neuf batteries, alignant un total de 36 canons de 75 mm. Ces divisions d'infanterie sont regroupées par deux (sauf dans la 3e région militaire qui a trois DI) pour former un corps d'armée, avec comme élément organique un RAC supplémentaire, à quatre groupes soit douze batteries, c'est-à-dire 48 canons de 75 mm29. Les dix divisions de cavalerie n'ont chacune qu'un groupe d'artillerie à cheval (le 4e groupe d'un RAC), composé de trois batteries à cheval. Les régiments d'artillerie de campagne ou de montagne comprennent une section d'ouvriers (rattachée au peloton hors-rang), tandis que les régiments d'artillerie à pied comprennent une compagnie d'ouvriers30. Les batteries de montagne utilisent des mulets à la place des chevaux, tandis qu'un groupe du 4e RAL utilise des véhicules automobiles pour tracter ses canons de 120 mm longs8.
Mobilisation
Pendant la période de mobilisation d'août 1914, les effectifs de l'artillerie française gonflent en application du plan XVII grâce à l'arrivée des réservistes et des territoriaux, avec passage du nombre d'unités de 855 à 1 527 batteries31. Il n'y a aucune création de nouveau régiment.
Ces nouvelles batteries entrent dans la composition des nouvelles divisions d'active créées lors de la mobilisation : la 44e DI reçoit douze batteries (formant quatre groupes) venant de six RAC différents ; la 37e DI, la division de marche du Maroc et la 45e DI, formées par l'Armée d'Afrique, reçoivent des batteries appartenant aux groupes d'artillerie d'Afrique ; la 38e DI, qui part d'Alger dès le et débarque à Cette le n 13, a la particularité d'avoir trois groupes du 32e RAC venant de Fontainebleau, qui rejoignent la division à Chimay le 32. Au total, 405 batteries de 75 (soit 1 620 canons) font partie des divisions d'active6.
Les divisions de réserve créées elles aussi pendant la mobilisation reçoivent chacune trois groupes d'artillerie nouvellement formés chacun par un RACn 14, soit un total de 201 batteries (804 canons)6. Les divisions d'infanterie territoriale mises sur pied à la fin de la mobilisation n'ont chacune qu'un (pour les divisions territoriales de place) ou deux groupes d'artillerie (pour les divisions territoriales de campagne), pour un total de 48 batteries (soit 192 canons)6. En plus, sont créés 75 groupes territoriaux d'artillerie (chacun créé par un des RAC, RAP et RAM).
Au-dessus des divisions, chaque corps d'armée a comme élément organique un RAC supplémentaire, à quatre groupes soit douze batteries (groupes souvent affectés aux divisions), c'est-à-dire 48 canons de 75 mm29, soit 264 batteries (1 056 canons)6 supplémentaires qui se rajoutent aux artilleries divisionnaires. Encore au-dessus, chaque armée est renforcée par quelques groupes (d'un à cinq) de 120 mm Baquet et de 155 mm Rimailho. Enfin, au niveau du théâtre d'opérations du Nord-Est, le Grand Quartier général dispose d'une « artillerie lourde mobile » composée de quinze batteries de canons de 120 mm long et de six batteries de mortiers de 220 mm.
En plus des unités combattantes, chaque division, corps d'armée et armée reçoit un parc d'artillerie, comprenant des sections de munitions d'artillerie (284 sont mises sur pied pour l'artillerie de campagne, ainsi que 121 sections de parc, 13 sections mixtes alpines de munitions, 47 colonnes légères de munitions de 120 mm et 26 sections de munitions de 155 mm C TR)34, des sections de munitions d'infanterie (137), ainsi que des canons de réserve (les parcs des cinq armées reçoivent un total de 246 canons de 75 mm), destinés à remplacer les pertes. Les arsenaux de l'intérieur disposent en plus de 420 canons de 75 pour servir de rechange6, auxquels se rajoutent les pièces d'instruction dans les dépôts régimentaires.
Étienne-Prosper Berne-Bellecour,
Le canon de 90 de Bange aux écoles du feu, 1898. En 1914, le
canon de 90 mm modèle 1877 est une pièce obsolète, mais toujours en service dans les places. Cette peinture nous montre l'uniforme de l'artilleur, bleu foncé (peu salissant) rehaussé de rouge.
L'artillerie de place, composée des régiments d'artillerie à pied renforcés par des groupes territoriaux, est sous les ordres des gouverneurs des différentes places fortes et ne fait pas partie de l'armée de campagne. Dans la 1re région militaire, Dunkerque reçoit trois batteries, tandis que la place de Maubeuge a 16 batteries à pied (du 1er RAP) et quatre montées (ces dernières destinées à la « défense mobile de la place »). Dans la 2e région, il y a deux batteries à Charlemont, une aux Ayvelles, une et demie à Longwy et une à Montmédy. Dans la 6e région, la place de Verdun est défendue par 27 batteries à pied (du 5e RAP) et neuf montées, tandis que les forts des Hauts de Meuse le sont par trois batteries à pied ; dans la 20e région, la place de Toul est protégée par 26 batteries à pied (du 6e RAP) et neuf montées, tandis que les forts de la trouée de Charmes le sont par quatre batteries à pied ; dans la 21e région, la place d'Épinal a 23 batteries à pied (du 8e RAP) et neuf montées, tandis que les forts du rideau de la Haute Moselle ont trois batteries à pied ; enfin dans la 7e région, la place de Belfort a 24 batteries à pied (du 9e RAP) et neuf montées, complétées par une batterie à pied au Montbard et au Lomont35. La frontière des Alpes est couverte par les 7e et 11e RAP ainsi que les 1er et 2e RAM. Chacune des quatre places de l'Est aligne de 500 à 600 pièces d'artillerie dans les forts avec une division de réserve pour les sorties, tandis que le camp retranché de Paris dispose d'environ 1 700 pièces d'artillerie, sans compter l'artillerie des sept divisions de réserve et territoriales qui renforcent la garnison. En cas de besoin, il est prévu la constitution de deux équipages de siège d'artillerie, en puisant dans l'artillerie des places fortes36.
Enfin l'artillerie de côte, qui était de la responsabilité du ministère de la Guerre en temps de paix, doit passer à celui de la Marine pour la défense des grands ports de guerre juste avant la mobilisation (ce n'est effectif qu'en septembre). En conséquence, si le 1er RAP conserve sous ses ordres les batteries de côte à Dunkerque, Boulogne et Calais, les autres récupèrent leur personnel d'active et de réserve (remplacés par des inscrits maritimes et des territoriaux) : le 3e RAP cinq batteries à Cherbourg et quatre à Brest ; le 7e RAP trois batteries à Nice, une à Ajaccio et une à Bonifacio ; le 10e RAP six batteries à Toulon et une à Porquerolles. Quant aux batteries au Havre, à Lorient, Quiberon, Belle-Isle, Saint-Nazaire, Ré, Aix, Oléron, Rochefort, bordant la Gironde et à Marseille, elles sont armées par des groupes d'artillerie de côte de l'artillerie coloniale37.
Emploi tactique
Avant guerre, la mission dévolue à l'artillerie de campagne est de soutenir l'infanterie par sa puissance de destruction contre le personnel à découvert ou protégé par des boucliers, des levées de terre ou des retranchements. Lors d'une phase offensive, l'artillerie ouvre la voie et doit engager toutes les unités qui pourraient gêner la progression de l'infanterie. En phase défensive, l'artillerie recueille l'infanterie et doit arrêter la progression de l'infanterie adverse38. Les tirs doivent donc se faire à vue directe, à une distance d'environ trois à quatre kilomètres maximum (au-delà, la précision est moindre).
« Une coopération intime des différentes armes est indispensable pour la réussite d'une attaque. [...] L'artillerie a pour mission essentielle d'appuyer le mouvement en avant de l'infanterie. En particulier, dans la période de crise qui précède l'assaut, elle bat, coûte que coûte, les objectifs de l'attaque. »
— Service des armées en campagne, décret du 2 décembre 191339.
Le règlement préconise de placer des batteries en position de surveillance en limitant le nombre de tirs afin que les troupes et l'artillerie adverses se dévoilent pour les engager avec le minimum de batteries pour toujours conserver des batteries disponibles. Le règlement suppose que les unités adverses tenteront de se protéger de la puissance de feu de l'artillerie de campagne dans des retranchements ou de se masquer à la vue de l'artillerie et devront être fixées par des tirs de neutralisation et rarement de destruction. Ces préconisations sont liées à la faiblesse de l'approvisionnement en munitions comparée à la puissance et au débit du matériel employé. Chaque canon de 75 mm est doté d'une réserve de 1 000 à 1 300 coups au début du conflit. Cette quantité correspond en fait à quatre jours de feu continu d'un canon de 7538.
Concernant l'artillerie lourde, elle est en 1914 tellement nouvelle (fondée le ) et embryonnaire que son emploi et ses caractéristiques ne sont pas évoqués dans le Règlement sur la conduite des grandes unités (RCGU du ) et le Règlement de service en campagne (RSC du ). Pour le service des pièces, l'aménagement des batteries et l'observation, il existe le Règlement de manœuvre de l'artillerie à pied, artillerie de siège et place dont les différents textes datent de 1910 à 1913.
L'identification des objectifs et le réglage des tirs ont une importance capitale dans l'utilisation de l'artillerie de campagne, le règlement de 1913 (ainsi que le Règlement de manœuvre de l'artillerie de campagne du )40 préconise l'emploi d'observateurs sur des points hauts du champ de bataille lorsqu'ils existent ou à défaut l'usage d'une échelle d'observation pouvant se fixer sur les caissons de munitions et permettant de s'élever de 4,2 m41. En cas de tirs directs, le capitaine est debout sur un des caissons et assure le réglage des pièces avec ses jumelles. Des « lunettes de batterie » sur trépied, en dotation, permettent de mesurer les angles ainsi que les hauteurs d'éclatement des obus.
Afin de pouvoir établir une communication entre les batteries et les observateurs ou le chef de groupe, le règlement propose l'utilisation de signaux à bras ou avec des fanions pour des distances comprises entre 700 et 2 500 m42, l'utilisation d'agent de liaison ou l'utilisation d'un matériel microtéléphonique d'une portée de 500 m43. Le règlement recommande dans le cas d'un commandement à distance de s'assurer de deux moyens de transmission des informations.
L'usage de l'aviation est recommandé par le règlement de 1913, lorsque la localisation des objectifs n'est connue que par les effets de leurs tirs ou par des renseignements imprécis à des distances moyennes de combat pour l'artillerie. L'avion peut, en se plaçant dans l'axe de tir de la batterie, observer les zones d'impact des obus, il peut également identifier des troupes masquées par des replis de terrain. Ces observations doivent être retranscrites sur un bulletin qui est lancé sur la ou les batteries ayant demandé le concours de l'aviation44.
Autres belligérants
L'Armée française de la période 1871 à 1914 ne cesse de se comparer à sa puissante voisine l'Armée allemande, qui elle-même surveille la française. Dans le domaine de l'artillerie, cette comparaison se fait d'une part entre les deux principaux canons de campagne, le 75 mm français comparé au 7,7 cm allemand, à l'avantage du matériel français surtout en termes de cadence de tir. Elle se fait d'autre part sur l'artillerie lourde, avec un très net avantage côté allemand. À la suite de l'apparition du canon de 75 (le groupe du 20e RA envoyé contre les Boxers en 1900-1901 avait fait forte impression), l'artillerie allemande a doté ses canons de 77 d'un frein semblable, ses batteries comportent six pièces (quatre chez les Français) et surtout elle s'est dotée d'obusiers capable de faire du tir courbe à portée moyenne, pour neutraliser les batteries françaises. D'autre part, la ligne de fortifications que représente le système Séré de Rivières nécessite une artillerie de siège importante. C'est pourquoi en Allemagne les obusiers légers de 10,5 cm sont affectées directement aux divisions, ceux lourds de 15 cm aux corps d'armée et les mortiers de 21 cm au niveau des armées.
Si côté français chaque corps d'armée dispose en août 1914 de 120 canons de 75 mm45, un corps d'armée allemand d'active aligne 162 pièces d'artillerie, dont 108 canons de 7,7 cm, 36 obusiers de 10,5 cm et 18 obusiers de 15 cm46. L'ensemble de l'armée de campagne allemande (qui déploie un huitième de ses forces face à l'Armée russe) aligne un total de 4 350 à 4 690 canonsn 17 de 7,7 cm, 40 canons de 10 cm, 950 à 1 450 obusiers de 10,5 cm, 440 obusiers de 15 cm et 140 mortiers de 21 cm. Elle est complétée par l'artillerie de siège : 176 canons de 10 cm, 32 canons de 13 cm, 400 obusiers de 15 cm, 80 mortiers de 21 cm, dix mortiers de 30,5 cm et sept obusiers de 42 cm, sans compter l'artillerie à pied garnissant les fortifications (notamment celles autour de Metz-Thionville, de Strasbourg-Mutzig et de Thorn)47.
Pièces d'artillerie de l'armée de campagne allemande en août 191448,49
|
| 7,7 cm FK 1896 n.A. |
971 kg |
10 à 12 coups/min |
8,4 km |
obus à balles ou explosif (6,8 kg) |
| 10,5 cm lFH 1898/1909 |
1 225 kg |
4 coups/min |
6,3 km |
obus à balles (12,8 kg) ou explosif (15,7 kg) |
| 15 cm sFH 1902 ou 1913 |
2 100 kg |
2 à 3 coups/min |
7,4 km |
obus explosif (40,5 kg) ou à balles (39 kg) |
Pièces d'artillerie de siège allemandes en août 1914
|
| 10 cm K 1904 |
2 755 kg |
un coup/2 min |
10,4 km |
obus explosif ou à balles (17,8 à 18,7 kg) |
| 13 cm K 1909 |
5 800 kg |
|
16,5 km |
obus explosif ou à balles (40 kg) |
| 21 cm Mörser |
6 630 kg |
2 coups/min |
9,4 km |
obus explosif (119 kg) |
| 28 cm Mörser |
6 200 kg |
? |
11 km |
obus explosif (338 kg) |
| 30,5 cm s.Kst.Mrs 1896 ou 1909 |
30 000 kg |
|
8,2 km |
obus perce-cuirasse (410 kg) ou allongé (335 kg) |
42 cm Kurze-Marine-Kanone 1912 (Gamma)
42 cm Kurze Marine-Kanone 1914 (M) |
150 kg (Gamma)
42,6 kg (M) |
dix coups/h |
14,2 km (Gamma)
9,2 km (M) |
obus explosif (795, 930 ou 1 160 kg) |
L'artillerie allemande dispose donc d'une artillerie lourde plus nombreuse et plus moderne que la française ; sa doctrine d'emploi est elle aussi différente. Le règlement de l'artillerie lourde de campagne du prévoit de l'employer dès la prise de contact, en la poussant en avant pour frapper les colonnes en marche (repérées par les avions) ; ensuite elle doit détruire les batteries repérables, permettant le déploiement de l'artillerie légère ; enfin, elle prépare l'assaut de l'infanterie en détruisant les obstacles et retranchements (pendant que l'artillerie légère se consacre à l'appui rapproché)50.
La guerre des Boers en 1899-1902, la guerre russo-japonaise de 1904-1905 et les deux guerres balkaniques en 1912-1913 permirent de confronter les méthodes allemandes (imitées par les Japonais et les Ottomans) et françaises (utilisées par les Russes, les Serbes et les Bulgares) ainsi que le matériel (canons Schneider contre canons Krupp ou Škoda) : les missions envoyées par les deux futurs belligérants firent quelques rapports alarmants mais dans l'ensemble confortèrent leurs états-majors respectifs dans leur anticipation du conflit à venir51.
Début du conflit
En août et septembre 1914, les matériels et méthodes développés avant-guerre sont mis à l'épreuve. Les désillusions face à une nouvelle forme de guerre sont nombreuses, concernant aussi bien la cavalerie, l'infanterie que l'artillerie de toutes les armées belligérantes.
Premiers engagements
Les difficultés d'action de l'artillerie française en août 1914 peuvent être illustrées par quelques exemples consignés dans les journaux de marches et d'opérations des régiments d'artillerie. En résumé, lors de la bataille des Frontières, les artilleurs français arrosent copieusement l'infanterie adverse, mais subissent aussi les tirs de contre-batterie de leurs homologues allemands. Pour les fortifications, l'artillerie française périmée qui y est positionnée est incapable d'affronter les pièces modernes que les Allemands déploient contre elle.
Le premier coup de canon a lieu le à Philippeville en Algérie, où deux canons de côte de 19 cm modèle 1878 de la batterie el Kantara, armées par quelques hommes du 6e groupe autonome à pied d'Afrique, tirent sur le croiseur allemand Goeben : le quatrième coup (le télémètre n'étant pas opérationnel) rase sa poupe, ce qui le décide alors à s'éloigner à grande vitesse52.
Trois exemples permettent d'illustrer les conditions d'engagement de l'artillerie française en août 1914.
4e RAC en Alsace
Le 31 juillet 1914 au matin, soit deux jours avant la publication du décret de mobilisation générale, les unités casernées le long des frontières du Nord-Est reçoivent l'ordre d'établir une « couverture », prévue au plan XVII, afin de protéger les mouvements de troupes. Cette mesure concerne neuf divisions d'infanterie et sept de cavalerie, comprenant un total de 138 batteries montées et 21 batteries à cheval53. L'extrémité droite de ce dispositif, couvrant les cols vosgiens méridionaux et la trouée de Belfort, est confiée au 7e corps (comprenant 120 canons des 4e, 5e et 47e RAC) renforcé par la 8e division de cavalerie (rajoutant douze pièces du 4e groupe à cheval du 4e RAC) et une batterie de 155 mm long du 9e RAP de Belfort.
Le , ces forces se portent en avant. Le jour même, le 4e RAC, qui sert d'artillerie divisionnaire à la 41e division (AD 41), ouvre le feu pour la première fois : après avoir passé les cols de Bussang et d'Oderen dès 4 h 30, le régiment envoie un de ses canons de 75 mm en appui de la tête de colonne, bloquée par des mitrailleuses allemandes à la sortie de Wesserling. Le tir des obus est efficace, se faisant à courte distance, en tir direct, si proche que les servants se font tirer dessus par les fantassins allemands.
Le , nouvel engagement : à Cernay, deux batteries du 3e groupe du 4e RAC en batterie sur le versant sud-est du contrefort vosgien (donc à contre-pente, en tir indirect) bloque avec leurs obus explosifs l'attaque allemande débouchant le matin de Wattwiller. Après l'évacuation de Cernay en début d'après-midi, la troisième batterie du groupe, établie en lisière nord du bois de Nonnenbruch, contrebat l'artillerie allemande déployée à l'est d'Uffholtz : « tir réglé 3000-3200 efficace. » Le 2e groupe du régiment est à Lutterbach, tirant là aussi sur l'infanterie allemande, mais subissant de nombreux tirs de contre-batterie bien dissimulée dans le bois :
« Observ. - Artie ennemi - bien cachée ; tir réglé au Télémètre ou d'après la carte ; extrêmement violent ; peu efficace. Eclatement trop hauts. - Mélange de shrapnels et de l'ex. - Artie française - Efficacité certaine du shrapnell et de l'explosif. Eclatements bas. Résultats puissants - Ht Moral de la Troupe. »
Le combat de Cernay se solde par la retraite française. À partir du 11, la division est sur la défensive le long de la frontière à l'est de Belfort. Le 12 au matin, une des batteries essuie encore quelques tirs de 105 mm allemand54.
39e RAC en Moselle
Le , cinq corps d'armées des 1re et 2e armées françaises se lancent dans une offensive à travers le plateau lorrain. Parmi eux, le 20e corps commandé par le général Foch comprenant les 60e RAC (AC 20), 8e RAC (AD 11) et 39e RAC (AD 39), se trouve sur l'aile gauche. La contre-attaque allemande au matin du met en fuite toute l'armée : au 39e RAC, deux groupes sont d'abord pris d'enfilade par des tirs croisés de l'artillerie adverse dès 6 h, plusieurs caissons sautent et les munitions s'épuisent.
« A 8 h 30 l'infanterie ennemie approchant librement, le 1er groupe donne l'ordre d'amener les avant-trains. Le 3e groupe ne peut le faire à cause de la visibilité des pièces et de la violence du feu. Son personnel ne se retire qu'après le départ de l'infanterie et sous les balles allemandes. Le 1er groupe plus heureux peut faire prévenir les avant train (déjà entrainés dans la retraite générale) [...] 6 canons et 4 caissons sont enlevés à toute allure par les avant trains de la 2e Bie. Ceux de la 1re Bie se rapprochent, mais trop tard l'Infie ennemie approche des pièces. Les officiers se replient à pied jusqu'à 302 poursuivis par la canonnade et la fusillade. »
Quant au 2e groupe, isolé sur le flanc et étalé sur trois kilomètres, mais mis en batterie de façon défilée, avec des postes d'observation sur les crêtes, il tire sur l'infanterie et l'artillerie allemande qui débouche. Vers midi, la 6e batterie est :
« criblée de feux, la situation devient intenable. Ordre de se retirer. Mais sa position est repérée. Première tentative pour amener les av. tr. échoue, 3 conducteurs, et plusieurs chevaux hors de combat. Deuxième tentative. Voiture par voiture, de quart d'heure en quart d'heure, au galot, on sauve successivement 2 canons, 4 caissons, qu'on ramène au sud de 272. La pièce de droite visible est balayée par rafale dès qu'on l'approche. Un canon hors service. Un abandonné, inapprochable. Capitaine de S. blessé à la cuisse, quitte en dernier avec ses servants. [...] A 14 h, les 4e et 5e Bies, le 49e colonial et quelques fractions du 146e restent seuls, entourés de tous côtés, sur 272. La 4e tire obliquement sur les Allemands qui viennent d'enlever Faxe, et arrête leur attaque. La 5e maintient les assaillants sortant des bois de Viviers et d'Oron. Le 49e colonial, écrasé de shrapnells, évacue enfin la croupe 270, à la course. Les 2 bies se retirent par la forêt [...]55. »
Canon de 75
mm français capturé, exposé en
trophée devant des civils allemands. Parmi les centaines de canons de prise, plusieurs furent
réalésés au calibre 7,7
cm pour faire des
pièces antiaériennes sur
affût permettant le tir à 50°, sous le nom de « 7,7
cm L/35 Flak (franz) ».
Bilan : ce régiment a perdu 23 de ses pièces (sur les 36) ainsi que 26 caissons56 ; le colonel a été tué.
Chute des places
Les défaites françaises de la bataille des Frontières ont pour conséquence la retraite des armées françaises, laissant isolées en avant les fortifications frontalières du Nord-Est. Les troupes allemandes purent investir, assiéger et finalement prendre la citadelle de Longwy (du 8 au 26 août), le fort de Manonviller (du 23 au 27 août), le fort de Charlemont (du 24 au 31 août), le fort des Ayvelles (du 25 au 27 août), Montmédy (du 25 au 28 août) et les forts de la place de Maubeuge (du 24 août au 7 septembre). La place de Lille fut désarmée et évacuée à partir du 24 août, tandis que les places de Calais et Dunkerque restèrent isolées, protégées par les inondations préventives de la plaine maritime.
Dans tous les cas, l'artillerie de siège allemande, plus moderne et nombreuse, domina rapidement l'artillerie de place française ; la prise du fort de Manonviller en fut exemplaire. Il s'agissait d'un vaste fort d'arrêt modernisé, plutôt bien armé avec six tourelles d'artillerie, dont quatre équipées chacune de deux canons de 155 mm (deux tourelles Mougin modèle 1876 et deux tourelles Galopin modèle 1890) et deux tourelles Bussière 1893 pour deux canons de 57 mm57, complétées accessoirement avec deux canons de 80 mm sur affût de campagne, six mortiers de 220 mm et quatre de 150 mm, le tout servi par une batterie du 6e RAP58. Le pilonnage allemand commença le par des obus explosifs de 210 mm, lancés par des batteries parfaitement défilées ce qui empêcha la contre-batterie française : dès le premier jour, une des tourelles de 155 fut mise hors service et un stock de 2 200 obus de 57 et 80 sauta. Le 26, deux autres tourelles de 155 furent éliminées et un stock de 800 obus de 155 sauta. Le 27 dès 4 h 20, deux obusiers allemands de 420 mm entrèrent en action ; la quatrième tourelle de 155 fut bloquée, la garnison fut asphyxiée ; le drapeau blanc fut hissé vers 15 h 3059. Au total, les assiégeants tirèrent sur et autour du fort 979 coups de 150 mm, 4 596 de 210 mm, 134 de 305 mm et 59 de 420 mm60.
Devant l'avancée allemande, ordre fut donné de remettre en état les places déclassées de la seconde ligne de défense. Du 15 au 25 août, le fort d'Hirson reçut de nouveaux canons et une garnison pour épauler le 4e GDR, puis évacué et détruit par explosif le 27 août. Le , les places de la Fère et de Laon (déclassées par le décret du ) passèrent sous les ordres du général de la 5e armée : les vieux canons de 90 mm modèle 1877 furent retirés des arsenaux de place (26 à la Fère et 22 à Laon) pour être mis en batterie61. L'ensemble fut finalement abandonné avant l'arrivée des troupes allemandes.
Enseignements
« [...] offensive ennemie se développe de plus en plus vers le sud, renforcée par un tir incessant d'obusiers qu'il est impossible de voir et par suite de contrebattre. Le tir, très précis, éteint peu à peu une partie de l'artillerie établie sur la crête à l'ouest de Walscheid. La brigade coloniale renonce à l'offensive et limite ses efforts à l'occupation des hauteurs de la rive gauche de la Bièvre. [...] la brigade, après avoir éprouvé de lourdes pertes, cède du terrain, et ses éléments dissociés se replient sur les hauteurs à l'ouest de la Valette. »
— Rapport du général Legrand (ancien sapeur, chef du 21e corps) sur l'attaque de Harreberg le 20 août (bataille de Sarrebourg)62.
« Les attaques dans la journée d'hier ont échoué uniquement parce qu'elles n'ont pas été préparées par l'artillerie, ni même par le feu de l'infanterie. Il est essentiel que l'infanterie ne se porte jamais à l'attaque sans que l'artillerie ait préparé cette attaque et soit prête à l'appuyer. On ne peut admettre les charges à la baïonnette dans les conditions où elles se sont produites jusqu'ici la plupart du temps. »
— Instruction du général Ruffey (ancien artilleur, chef de la 3e armée) à ses unités, à la suite des combats du 22 août autour de Longwy (bataille des Ardennes)63.
Pendant la période de guerre de mouvement, les obusiers allemands purent plusieurs fois contrebattre les artilleurs français, qui ne survivent que grâce à la mobilité des batteries montées de 75 mm (il faut du temps pour régler le tir indirect)64. Si certains combats de la bataille des Ardennes (du 20 au ) se sont limités à des rencontres d'infanterie, la bataille des Frontières correspond à un tournant, l'artillerie dominant désormais le champ de bataille et les obus devenant la principale cause des pertes65. Comme prévu avant-guerre, les batteries françaises à quatre canons de 75 mm font au moins jeu égal avec les batteries allemandes à six canons de 77 mm dans le soutien à l'infanterie ou le tir d'interdiction : les canons français tirent plus vite et leurs obus sont plus efficaces (plus de charge explosive). La coordination avec l'infanterie est insuffisante : les artilleurs, laissé à eux-mêmes, tirent alors sur les objectifs visibles66. Les rares cas de contre-batterie concernent des tirs à courte portée, par exemple le tir explosif de deux groupes du 5e RAC (AC 7) le , fauchant à 4 875 m le personnel et les chevaux de tout un groupe allemand déployé sur les hauteurs au sud de Brunstatt (18 canons capturés) :
« Enseignements : une artillerie visible est vouée à la destruction. Quand on veut frapper à mort un objectif, lisière de Dornach, artillerie ennemie, il faut tout de suite y mettre le prix, ne pas lésiner sur le nombre des batteries à engager, taper le plus fort possible. Le tir d'efficacité à obus explosifs est seul efficace contre l'artillerie, il l'est aussi en raison de son efficacité réelle et de ses effets moraux contre le personnel. Il est nécessaire d'augmenter encore la proportion d'obus explosifs, de la porter au moins au ⅔. »
— JMO du 5e RAC (alors commandé par le colonel Nivelle)67.
La stabilisation du front, dès la fin août 1914 en Haute-Alsace puis à la mi-septembre au centre et en octobre plus au nord, modifie encore le type de combat : si de son côté l'infanterie s'enterre pour survivre, l'artillerie lourde prend une place dominante ; on recherche les hauteurs, on engage le feu à des distances de plus en plus longues, en tir indirect à partir de positions fixes, en concentrant les tirs, tandis que la consommation d'obus dépasse largement les prévisions. L'artillerie de campagne s'adapte lentement, grâce à quelques initiatives individuelles : par exemple le colonel Estienne arrive au 22e régiment d'artillerie lors de sa nomination avec deux avions Blériot pour l'observation d'artillerie, qu'il utilise lors de la bataille de Charleroi. Les observations seront importantes lors de la bataille des Deux Morins. Mais comme les Français n'ont pas assez d'artillerie lourde pour tirer sur les retranchements et contrebattre l'artillerie allemande, le ministre de la Guerre met à disposition de Joffre le 108 canons de 155 mm court modèle 1881-1912 de Bange (la modification de 1912 porte sur une plateforme de tir en bois plus transportable que l'affût de siège et place) et 120 mortiers de 220 mm modèle 1881-1891 (la modification de 1891 consiste en l'ajout d'un frein hydropneumatique à l'affût)68.
« Ce n'est un secret pour personne que nous nous trouvions en état d'infériorité marquée vis-à-vis de nos adversaires, surtout en ce qui concerne l'Artillerie lourde qui n'existait chez nous qu'à l'état embryonnaire. Nombre d'entre nous ont dans la mémoire le souvenir des heures graves où le sentiment de notre impuissance se fit jour en face de canons qui, à l'abri de nos atteintes, ne prenaient même pas la peine de se masquer et pouvaient nous écraser en toute sécurité. »
— Capitaine Leroy, Historique et organisation de l'artillerie, 1922, p. 5.
Crise des obus
Au moment de l'entrée en guerre, le stock de munitions du calibre 75 mm est de 4 866 167 cartouches (obus + douille), soit un peu plus de 1 000 coups par canon6. L'artillerie lourde, qui était censée consommer moins, est approvisionnée avec : 1 280 000 coups de 120 mm, commun à l'obusier Baquet et au canon de Bange, dont 400 à 450 coups pour ceux de l'armée de campagne ; 78 000 coups de 155 mm pour le canon Rimailho, soit 540 coups par pièce ; et 1 400 000 coups de 155 mm pour les 155 mm de Bange des places fortes8. Ces quantités correspondent aux besoins d'une guerre de mouvement.
L'État-Major a prévu en plus un « plan de fabrication du temps de guerre » pour compléter ces stocks, en assemblant les obus, douilles et explosifs encore dans les arsenaux de Bourges, Lyon, Tarbes et Rennes (de quoi faire 800 000 cartouches, à raison de 25 000 par jour)69, puis, à partir du 65e jour après le début de la mobilisation, lancer la fabrication à raison de 13 600 coups par jour8, dont 3 500 par l'industrie privée.
Manque de munitions
En fait, les dotations en munitions de 75 mm sont à moitié consommées lors de la bataille des Frontières et celle de la Marne. Dès le , le général directeur de l'arrière informe le ministre de la Guerre que les six entrepôts de réserve générale (à Bourges, Angers, Rennes, Clermont, Lyon et Nîmes) sont presque vides. Le , la consommation moyenne depuis le début de la guerre est estimée à 700 coups de 75 par pièce (pour un seul mois de combat) ; il reste environ 650 autres coups au front dans les fourgons et parcs, plus 45 coups à l'arrière dans les entrepôts, gares et arsenaux70. Le 20, Joffre écrit au ministre : « ou la fabrication de munitions d'artillerie devra être considérablement augmentée, ou nous n'aurons plus les moyens de continuer activement la guerre à partir du 1er novembre ». Il estime les besoins minimum à 50 000 coups par jour, soit une moyenne de douze coups par pièce et par jour71 (alors qu'un tir d'un quart d'heure en consomme une centaine). Le même jour, le ministre de la Guerre réunit autour de lui à Bordeaux les principaux industriels de la métallurgie, qui se lancent dans la production, promettant 20 000 coups par jour à la fin octobre et 40 000 en début décembre ; elle fut en réalité de 23 400 par jour en octobre, puis de 11 300 en novembre à cause du manque d'ouvriers, de machines-outils et de matériaux72.
Le , le GQG essaye de limiter la consommation d'obus sur les fronts stabilisés (ce qui ne concerne pas alors les troupes au nord de l'Oise) par une note aux armées : « L'artillerie ne doit jamais tirer sans objectifs bien définis, ni sur des zones larges, à des moments où ces tirs ne sont pas nécessaires soit pour faciliter la progression de notre infanterie, soit pour arrêter des attaques ennemies. En un mot, il faut proscrire les canonnades sans but défini ». Il recommande en plus d'utiliser de préférence des obus à balles, délaissés par les batteries qui utilisent désormais surtout des obus explosifs73. Le , Joffre recommande aux commandants d'armée de « renoncer aux attaques générales, qui usent la troupe sans procurer des avantages suffisants, et à procéder par attaques localisées, exécutées en accumulant successivement les moyens d'action sur les points choisis ». Il les invite à faire plutôt des attaques de nuit, qui économisent les munitions d'artillerie74. Puis toujours le 24 : « Actuellement arrière épuisé. Si consommation continue même taux, impossible continuer guerre faute de munitions dans quinze jours... conserver toutes munitions disponibles pour reprise offensive violente quand sera possible. Ne puis trop appeler toute votre attention sur importance capitale cette prescription d'où dépend le salut du pays75. »
Le , on passe au rationnement : l'approvisionnement aux armées est désormais limité à 300 coups par pièce (y compris les munitions stockées dans les parcs), le restant devant être rendu au service de l'arrière pour constituer une réserve76. En plus, aucune livraison n'est prévue avant le , pour concentrer les approvisionnements sur les unités engagées dans la course à la mer. En conséquence, les attaques de la 9e armée en Champagne sont suspendues faute d'obus dès le 27 au soir77 :
« En vue de restreindre la consommation des munitions d'artillerie, pendant la période défensive destinée à permettre le développement de la manœuvre de notre gauche, les CA maintiendront en principe une attitude défensive. [...] Les batteries d'artillerie, au lieu de régler leur tir ou de repérer par salves, exécuteront ces opérations avec une pièce ; elles n'effectueront par salves que des tirs réglés sur des buts bien déterminés et bien vus : elles éviteront tout tir sur zone. [...] Les consommations devront être réglées avec la plus stricte économie il y aura lieu de les limiter, jusqu'à nouvel ordre, de manière à ne pas dépasser pour l'ensemble du CA le chiffre moyen de 13 coups par pièce et par jour. »
— Général Ferdinand Foch, Instruction personnelle secrète, 78.
Le , le GQG ordonne « que tous les soirs ou toutes les nuits avant six heures, chaque armée fera connaître par télégramme chiffré au directeur de l'arrière le nombre de coups de 75 consommés dans la journée ». La consommation journalière est alors de l'ordre de 38 000 cartouches par jour en octobre (soit un million de coups par mois), dont la moitié par la 2e armée. Par exemple le , sur un total 38 759 obus tirés pendant la journée, la 2e armée en utilise à elle seule 31 300 en Picardie, tandis que son voisin le GDT se limite à 950, les 6e et 5e en tirent respectivement 1 088 et 191 sur l'Aisne, la 9e 483 autour de Reims, la 4e 1 259 en Argonne, la 3e se limite à 658 sur les Hauts de Meuse et la 1re armée 2 830 sur le plateau lorrain et dans les Vosges79.
Ordre est donné d'envoyer les stocks d'obus des camps retranchés et des colonies vers le front80. Une partie des canons de 75 mm sont remplacés pendant l'automne 1914 par 500 vieux canons de 90 mm, qui tirent lentement et disposent encore de munitions en stock ; ces munitions de 90 commencent rapidement à manquer, malgré une production d'environ 2 000 coups de ce calibre par jour, d'où le retrait progressif de ces canons à partir d'avril 191581. Il faut attendre les premiers mois de 1915 pour que la production française couvre les besoins de l'artillerie, fournissant en plus des cartouches d'artillerie aux armées belges, serbes et russes82.
Munitions défectueuses
Au manque chronique de cartouches de 75 se rajoute rapidement un problème supplémentaire : des obus de ce calibre se révélèrent défectueux. Des obus ne détonnent pas, explosent trop vite, ou pire au départ du coup, faisant alors éclater le tube du canon, hachant menu les servants. Ces éclatements de tube se firent nombreux à partir de décembre 1914, alarmant les services : un rapport établit qu'il y en eut six entre août et décembre, soit un éclatement pour 500 000 coups tirés, puis 236 entre le et le , dont 176 rien qu'à la 4e armée, soit un éclatement pour 3 000 coups83. L'usage du cordon se développe, permettant de mettre le personnel à distance lors du déclenchement du tir.
La fabrication des cartouches fut mise en cause à partir de janvier 1915, que ce soit la mauvaise qualité des matériaux, les nouvelles façons de fabriquer les obus (en les usinant pour s'adapter aux machines disponibles dans les ateliers privés, au lieu de les emboutir) ou les malfaçons entraînées par les rendements excessifs. Les contrôles de qualité et les tolérances lors des recettes furent donc revus, pour se rapprocher des façons de faire du temps de paix : les éclatements se firent plus rares, à raison d'un pour 11 000 coups au printemps, puis d'un pour 50 000 à la fin de l'été 191584.
Des problèmes se poursuivirent pendant tout le conflit malgré les mesures prises. On enquêta sur des détonations incomplètes (dues à un tassement ou une cristallisation de l'explosif lors du chargement), des ratés de percussion (étoupilles détériorées ou malfaçons), des douilles brisées (on réutilise les douilles usagées jusqu'à huit fois avant réforme, d'où des fissures), des obus qui tombent à un tiers de l'objectif (à cause d'une charge propulsive incomplète, ou à cause de l'humidité), avec des trajectoires erratiques (usure, encrassement et encuivrage du tube), on retrouve des corps étrangers dans les charges propulsives (clous, vis, morceaux de bois, ficelles, chiffons, gants...)85, etc.
Les tolérances dans le chargement des charges d'explosif et l'usinage des obus sont si importantes qu'à partir du printemps 1915 les cartouches d'artillerie d'un même calibre sont triées selon leur masse pour retrouver un peu de précision lors des tirs. Par exemple pour les obus explosifs de 75 mm, ceux de 4,85 à 5 kg sont désormais marquées à la peinture avec la lettre « L », ceux de 5 à 5,15 kg d'une croix, ceux de 5,151 à 5,3 kg de deux croix et ceux de 5,301 à 5,45 kg de trois croix86. Pour les obus de l'artillerie lourde, leur masse est peinte directement en kilogrammes.
Propagande
Malgré ces difficultés, la propagande va mettre en avant l'artillerie français, notamment son canon de 75 mm :
« Le canon allemand a pour lui de ne pas exiger d'abatage et, une fois en batterie, d'être plus léger et d'avoir un caisson plus léger aussi, enfin de présenter une surface de boucliers plus grande. En revanche, il est notablement inférieur sur des points essentiels : stabilité, pointage, fauchage, réglage des fusées, tir en profondeur, rapidité du tir et qualités balistiques. Au résumé, on pouvait prévoir que les 120 pièces de 75 par corps d'armée que nous possédons vaudraient mieux que les 144 pièces du corps allemand. »
— Théophile Schloesing (le fils du chimiste (sv)), Le "75" : le canon, le tir, les projectiles, 191587.
Médaille commémorative de la « Journée du 75 » de 1915.
REFRAIN
Le canon léger que la France
Acclame et fête, tour à tour,
Nous donnera par sa puissance,
La grande Victoire, un beau jour.
Nous aimons sa forte éloquence ;
Sa voix nous promet le retour,
Après l'heure de la vengeance,
À la douce loi de l'amour.
|
I
Le sol de l'Alsace et Lorraine,
Grâce à lui, sera déblayé :
Plus d'Allemands au cœur de hyène,
Sans foi, sans pudeur, ni pitié !
|
II
C'est le maître de la bataille,
Le protecteur de nos soldats,
Bien qu'il soit tout petit de taille,
Les grands ne lui résistent pas.
|
III
Quand le "75" gronde,
Affolés, redoutant leur sort,
Les boches, fils de race immonde,
Poings crispés, attendent la mort.
|
IV
Avec vous, Anglais, Russe, Belge,
Il prend le chemin de Berlin.
Guillaume II, le sacrilège,
Ne règnera plus sur le Rhin.
|
| Le « 75 » : chant patriotique, créé par M. Jean Aubert de l'opéra de Nice, paroles de François Armagnin et musique de F. Giraud. |
En 1915, le slogan « Des canons ! Des munitions ! » du sénateur Charles Humbert, publié plusieurs fois dans son quotidien Le Journal, devient le refrain d'une chanson88. L'obus de 280 mm est même surnommé à l'occasion le « Charles Humbert » parce qu'il a une grosse voix et qu'il fait des dégâts89.
Montée en puissance
Face à la transformation du conflit en une guerre de tranchées à partir de l'automne 1914, comparée à l'époque à un gigantesque siège, l'artillerie adapte son matériel, son organisation et sa doctrine d'emploi.
Plus de canons
En attendant la fabrication de nouveaux modèles plus modernes, l'artillerie française vit d'expédients : dans un premier temps elle envoie au front les vieux canons, puis réemploie des canons de marine ou de l'artillerie de côte, improvise des mortiers de tranchée et saisit chez les industriels des canons destinés à être exportés (par exemple le canon de 75 mm modèle 1914, qui était destiné à l'Armée russe sous le nom de Schneider PD07). Des programmes successifs, toujours plus ambitieux, fournissent toujours plus de pièces d'artillerie, avec application progressiven 18 : décisions ministérielles du (« barrière de Bange »), du (réorganisation de l'artillerie lourde) et du (triplement du nombre des 155 mm courts)90.
Premiers expédients
Un
155 mm L modèle 1877 culasse ouverte pour le chargement de l'obus (la
gargousse de
poudre va suivre). L'affût
SP (qui fait 3,2
t) est complété par des cingolis
n 19 et des coins de retour en batterie ; l'installation d'un tel canon prend une heure, sans parler de la fosse, de la plate-forme en bois et du
camouflage.
Le , le GQG demande au ministère de la Guerre qu'il mette à sa disposition les pièces d'artillerie des places fortesn 20, puis les ayant obtenues le 24, les propose aux commandants des différentes armées92. Il s'agit de vieux modèles, plusieurs sur affûts « de siège et place » (SP) donc peu mobiles, aux cadences de tir lentes, utilisant des gargousses et non des douilles (ce qui permet de faire des économies de laiton), mais disponibles en grands nombres : les canons de 90 mm modèle 1877 doivent remplacer les canons de 75 mm dans une centaine de batteries de campagne pour économiser les munitions de 75, les canons de 95 mm modèle 1875 et les canons de 120 mm modèle 1878 doivent armer de nouvelles batteries de campagne confiées aux corps d'armée (les 120 pour faire notamment de la contre-batterie), tandis que les canons de 155 mm modèle 1877 et les mortiers de 220 mm modèle 1880 restent aux mains de l'artillerie à pied, en batteries lourdes affectées à l'échelon de l'armée et destinées à frapper les retranchements93,94. Cette « barrière de Bange » permet à l'Armée de tenir le front en attendant l'arrivée de matériels lourds plus modernes.
Au cours de l'automne 1914, l'arrivée en nombre des canons lourds de siège et des disparités dans leur affectation entre les différentes grandes unités décide le GQG, le , à affecter organiquement un groupe (à deux batteries de quatre canons) d'artillerie lourde (du 105, 120 ou 155 mm long) à chaque corps d'armée et groupe de divisions de réserve95. D'autres batteries lourdes restent attachées à l'armée, qui les garde en réserve ou les confie temporairement à ses corps d'armée. Par exemple, le , juste avant sa participation à l'offensive de Champagne, la 4e armée (composée de cinq corps) aligne un total de 488 canons de 75 mm (au lieu de 600), 144 canons de 90 mm, 16 de 65 mm, 14 de 80 mm, 30 de 120 mm long, 16 de 155 mm court à tir rapide, 34 de 155 mm court modèle 1912, 26 mortiers lisses de 15 cm et six auto-canons ; le général de Langle a en plus demandé le 11 décembre d'être renforcé avec quatre canons de 155 mm long et deux mortiers de 220 mm96.
À partir de février 1916, 120 canons de 155 mm long modèle 1877 sont montés sur un nouvel affût construit par Schneider (semblable à celui du 105 mm) avec un frein permettant le recul du tube, un bouclier et un pointage en hauteur jusqu'à 42° : cette pièce modernisée, appelée canon de 155 mm L modèle 1877-1914 (le marché datait de 1913, mais avait été suspendu en août 1914) permettait de tirer jusqu'à trois coups à la minute97. Les autres pièces de 120 et 155 mm sont équipées de cingolisn 19. Toutes ces pièces doivent être complétées avec des moyens hippomobiles (chevaux, avant-trains et caissons) et le personnel nécessaire (venant des places, des batteries de côte ou des dépôts). Ces prélèvements concernent les fortifications de l'arrière (places de Langres, de Besançon, de Dijon, de Lyon, de Grenoble, de Toulon et de Brest), mais aussi celles proches du front (places de Paris, de Verdun, de Toul, d'Épinal et de Belfort)94.
Pièces d'artillerie récupérées98
| Matériels | Masse en batterie | Cadence de tir | portée max. | Munitions (masse) |
|---|
| 80 mm C modèle 1877 de Bange |
955 kg |
un à deux coups/min |
8,7 km |
obus à balles (6,3 kg) ou explosifs (5,9 à 6,1 kg) |
| 80 mm M modèle 1878 de Bange |
305 kg |
un à deux coups/min |
4,1 km |
| 155 C modèle 1881 de Bange |
2 080 kg |
un coup/min |
6,2 km |
obus à balles (40,5 à 40,8 kg) ou explosifs (41,3 à 43,7 kg) |
| 155 C modèle 1881-1912 Filloux |
4 660 kg |
un à deux coups/min |
7,8 km |
| 155 C modèle 1890 Baquet |
3 115 |
un à deux coups/min |
Nouvelles pièces de campagne
Le canon de 75 mm est maintenu comme pièce majeure de l'artillerie française. La production en série est donc relancée dès l'automne 1914, pour remplacer les pertes (447 canons sont abandonnés ou pris par l'adversaire entre août 1914 et février 1915) et satisfaire les besoins de création de nouvelles batteries. 160 canons de 75 mm modèle 1897 et 80 canons modèle 1912 sont commandés à la société Schneider, avec livraison à partir du printemps 1915. En attendant, ordre fut donné dès le de prélever 240 canons de 75 en Algérie101, puis en février 1915 de faire passer temporairement les batteries à trois pièces au lieu de quatre102. En mai 1915, 200 canons de 75 mm modèle 1912 sont commandés à Schneider et 200 autres modèles 1915 à Saint-Chamond ; quant à la production du modèle 1897, elle atteint 200 canons par mois pendant l'été 1915, puis 500 environ en 1916-1917 et près de 700 en 1918 : 27 000 canons de 75 sont sortis des usines pendant le conflit103. Mais ces canons manquent de puissance et de portée pour détruire les retranchements et contrebattre l'artillerie adverse ; l'artillerie française a donc besoin d'artillerie lourde.
Heureusement, la société Schneider dispose de modèles modernes, développés à l'origine pour l'exportation (notamment pour l'Armée russe)104, dont certains sont en commande pour l'Armée française depuis 1913. En août 1914, le nouveau canon de 105 mm long modèle 1913 (à l'origine le 42 lignes russe, soit 106,7 mm) est entré en production ; le premier groupe de douze canons (sur une commande initiale de 220 pièces) vient juste d'être livré au moment de la mobilisation : il arrive à la 6e armée le 105 (IV/2e RAL). Le même fabricant a reçu commande en novembre 1913 de 18 mortiers de 280 mm TR modèle 1914 (en fait un gros obusier à chargement par la culasse de 279,4 mm, soit le 11 pouces russe) : les livraisons devaient commencer en 1915106. En plus, l'Armée saisit au Creusot onze batteries d'obusiers de 120 mm destinées à la Bulgarie ; ces pièces rejoignent finalement l'Armée française d'Orient.
En juin 1915, Joffre réclame des canons courts (c'est-à-dire des obusiers) de 155 mm à tir rapide pour détruire les retranchements adverses : 512 de ces pièces sont commandées en octobre 1915 auprès de Schneider (les 155 mm C 1915 et 1917 S, dérivés de son obusier de six pouces pour la Russie) et de Saint-Chamond (155 mm C 1915 CH, développé pour le Mexique), mais ne commencent à être livrées qu'à partir de l'été 1916 à raison de 60 canons par mois, ce qui est très loin des besoins. Toujours en octobre 1915, 40 exemplaires du mortier de 220 mm TR modèle 1915 sont commandés à Schneider (c'est l'adaptation de son mortier de neuf pouces russe), qui commence à les livrer pendant l'hiver 1916-1917.
L'Armée a aussi demandé des canons à longue portée ; en attendant le développement de ces nouveaux matériels, 48 canons de marine de 100 mm TR (« à tir rapide ») modèle 1897 utilisés antérieurement par l'artillerie de côte sont retirés de leurs plateformes bétonnées pour être placés sur des affûts SP, ce qui fait passer leur cadence de tir de six à seulement un coup par minute. Mais la puissance de leurs cartouches et la longueur de leur tube offrent une vitesse initiale de 760 m/s, soit au pointage maximal de 28° une portée de 9,5 km avec l'obus modèle 1898-1908, puis de 13,5 km pour l'obus modèle 1915 type D. Six groupes de 100 mm (à deux batteries de quatre pièces) sont progressivement constitués du printemps 1915 à celui de 1916, puis cinq des groupes sont retirés fin 1916 à cause de l'usure des tubes ; trois groupes sont reformés au printemps 1917 avec 24 canons réalésés au calibre 105 mm, pour être finalement renvoyés aux batteries de côte fin 1917107.
Pour tirer encore plus loin, on réutilise 39 canons de 14 cm (en fait 138,6 mm) de marine, dont 15 tubes sont neufs, 12 proviennent des vieux cuirassés Carnot et Charles Martel et 12 autres, trop usés, sont réalésés au calibre 145 mm, pour les placer sur des affûts de campagne construits spécialement. Ces pièces sont commandées en janvier 1916 et sont livrées de septembre 1916 à juillet 1917108. Après ces expériences, la production de 200 canons neufs de ce type est commandée en 1916, sous le nom de canon de 145 mm modèle 1916 (le tube est produit à la fonderie de Ruelle, tandis que l'affût est monté par Saint-Chamond) : les livraisons s'étalent jusqu'au début de 1918. La vitesse initiale est telle (794 m/s) que le réalésage est prévu au calibre 155 mm, avec application à partir de l'automne 1918109. En 1916, sont adoptés deux modèles de canons longs au calibre 155, le 155 mm L modèle 1917 S (sur l'affût du 155 modèle 1877-1914) et le 155 mm modèle 1917 GPF (sur un affût biflèche permettant de pointer en direction sur 60°), qui n'arrivent au front qu'à partir de l'été 1917110.
Nouvelles pièces d'artillerie111
|
| 75 mm modèle 1914 S |
1 096 kg |
12 à 18 coups/min |
6,3 km |
obus à balles (7,2 à 7,4 kg) ou explosifs (5,5 à 7,2 kg) |
| 75 mm modèle 1915 CH |
1 090 kg |
12 à 18 coups/min |
6,5 km |
| 100 mm TR modèle 1897 |
6 000 kg |
un coup/min |
13,5 km |
obus explosifs (13,3 à 14,3 kg) |
| 105 mm modèle 1913 S |
2 350 kg |
6 à 8 coups/min |
12,5 km |
obus à balles (16,9 kg) ou explosifs (15,4 à 16 kg) |
| 120 mm modèle Schneider |
2 150 kg |
dix coups/min |
8,1 km |
obus explosifs (19,7 à 21 kg) |
| 14 cm modèle 1891 |
10 940 kg |
un coup/min |
15,8 km |
obus explosifs (30,5 à 36,5 kg) |
| 14 cm modèle 1910 |
11 935 kg |
un coup/min |
17,4 km |
| 145 mm modèle 1910 |
12 000 kg |
deux coups/min |
17,6 km |
obus explosifs (33,7 à 36 kg) |
| 145 mm modèle 1916 |
12 500 kg |
trois coups/2 min |
18,5 km |
obus à balles (36,4 kg) ou explosifs (33,7 à 36 kg) |
| 155 mm C modèles 1915 et 1917 S |
3 220 et 3 300 kg |
quatre coups/min |
11,9 km |
obus explosifs (41 à 44,8 kg) |
| 155 mm C modèle 1915 CH |
2 860 kg |
trois coups/min |
9,3 km |
| 155 mm L modèle 1917 S |
8 710 kg |
trois coups/min |
15,9 km |
| 155 mm modèle 1917 GPF |
11 200 kg |
3 à 4 coups/min |
16,3 km |
| 220 mm TR modèles 1915 et 1916 S |
7 455 et 7 792 kg |
deux coups/min |
10,8 km |
obus explosifs (100,5 kg) |
| 280 mm modèle 1914 S |
16 000 kg |
un coup/min |
10,9 km |
obus explosifs (202 à 275 kg) |
Artillerie lourde à grande puissance

Dès septembre 1914, la forte probabilité du siège du camp retranché de Paris justifie le recours à la marine pour fournir des batteries à longue portée (comme pour le siège de 1870-1871). Les premières pièces servies par leurs canonniers-marins arrivent finalement à l'arsenal de Verdun (pour la partie nord de la région fortifiée) et à celui de Toul (pour le Grand Couronné de Nancy) à partir d'octobre : il s'agit de canons de 14 cm (en fait 138,6 mm) modèle 1910 (destinés à l'origine à la classe Bretagne) et de 16 cm (164,7 mm) modèles 1887, 1891 et 1893 (pour les classes République, Suffren et Iéna). Ces pièces étant livrées sur leur affût de bord, elles sont installées à poste fixe, parfois dans des casemates semi-enterrées (plusieurs seront capturés en février 1916, par exemple aux bois le Fays et de la Vauche)112. Toujours en septembre, une batterie sur affût-truck (c'est-à-dire sur wagon) est saisie au Creusot, armée avec deux canons courts de 200 mm Schneider Pérou (car commandée par le gouvernement péruvien en 1908, mais pas encore livrée). Ces deux premières pièces d'artillerie lourde sur voie ferrée (ALVF) ouvrent le feu le pour couvrir la retraite de l'Armée belge à la fin du siège d'Anvers113.
Le , le GQG fait une demande au ministre de la Guerre pour utiliser des pièces d'artillerie très puissantes provenant de l'artillerie navale, de l'artillerie de côte ou de pièces stockées ou en cours de production dans l'industrie privée (chez Schneider et Saint-Chamond), à placer sur des plateformes bétonnées, ou sur des châssis de locomotive94. Un premier groupe de canons de 19 cm de côte est formé, il est enrichi par l'arrivée de pièces de 240 mm ou de 270 mm114 pris à l'artillerie de côte, dont les batteries sont progressivement envoyées au front. En novembre 1914, un gros (sa masse est de 53 tonnes) canon G de 240 mm modèle 1884 sur son affût circulaire est transféré de Calais à Pérouse (au bois des Fourches, à l'est du fort de la Justice) pour défendre le camp retranché de Belfort en cas de siège ; puis en décembre 1914, quatre canons de 24 cm modèle 1870-1887 de la batterie des Couplets près de Cherbourg sont envoyés au front, malgré la colère de l'amiral préfet maritime115.
Le , le GQG établi une liste des canons à grande puissance qu'il souhaite ; ce programme est approuvé par le ministre de la Guerre le , qui passe commande auprès des arsenaux et des industriels : un canon de 305 mm de marine, deux 274 mm de marine, huit 240 mm de côte et douze 19 cm de côte116. Si les canons de marine doivent être d'abord tourillonnés, tous doivent être montés sur un affût, qu'il soit ferroviaire (sur affût-truck) ou à échantignolles (une structure fixe en bois). Ces canons n'arrivent sur le front qu'au début de l'année 1915, constituant des batteries au sein des régiments d'artillerie à pied ou de groupes autonomes, affectés temporairement par le GQG aux différentes armées, complétés par quatre péniches-canonnières dès novembre 1914 et seize autres canons de 240 mm en février 1915. Un nouveau programme de construction est lancé le pour atteindre un total de 201 pièces (dont huit de 400 mm), augmenté les , , et (ce dernier pour 318 nouvelles pièces) : les industriels ont du mal à satisfaire ces commandes, étalant les livraisons sur un voire deux ans. Le est créé un commandement de l'artillerie lourde à grande puissance (ALGP, regroupant l'ALVF, les péniches et plusieurs autres gros tubes) confié au général Vincent-Duportal, avec mission d'assurer la formation et de fixer les conditions d'emploi. L'ensemble est confié à la réserve générale d'artillerie lourde lors de la création de cette dernière le , avec réorganisation en six puis huit régiments d'artillerie lourde à grande puissance (RALGP, nos 70 à 78)117.
- Des pièces encombrantes
-
-
-
Canonniers-marins et leur train blindé, armé de canons de 19 cm modèle 1870-1893 sur affût-truck tous azimuts (TAZ) Schneider.
Pour les matériels d'ALVF, le type d'affût-truck (souvent écrit « truc » à l'époque) dépend de leur masse. Les pièces jusqu'au 240 mm sont montées sur des affûts tous azimuts (TAZ) pivotants, ancrés au sol par des vérins. Les pièces les plus lourdes sont fixées sur des affût-poutres qui ne peuvent tirer que dans l'axe de la voie : un tronçon courbe, appelé épi, sert de circulaire de pointage en direction. Pour les modèles à glissement, le recul est freiné par des traverses en chêne frottant sur des poutrelles parallèles aux rails118. Pour les modèles à berceau, le tube glisse dans celui-ci, pour revenir ensuite en position119.
Les trois calibres les plus utilisés pour l'ALGP furent les 190, 240 et 320 mm, essentiellement des canons de côte modifiés (les dénominations 19, 24 et 32 cm indiquent que les frettes sont en fonte, enserrant le tube en acier). S'y rajoutent huit obusiers de 370 mm modèle 1915 et douze de 400 mm modèles 1915 et 1916, qui sont des canons de marine (de 305 mm et de 340 mm) réalésés : ils défoncèrent le fort de Douaumont en octobre 1916, les tunnels du mont Cornillet en mai 1917 et du Mort-Homme en août 1917.
Au moment de l'armistice, un obusier de 520 mm modèle 1916 est disponible (son jumeau a explosé le lors d'un tir d'essai à Saint-Pierre-Quiberon), le développement d'une pièce très longue portée (TLP) est en cours (chemisage d'un 340 mm avec un tube plus étroit et très long), tandis que le nouveau 220 mm long modèle 1917 Schneider commence à être livré.
ALGP sur le front120,121
| Calibres | 30/11/1914 | 1/05/1915 | 1/10/1915 | 1/02/1916 | 1/08/1916 | 1/12/1916 | 1/07/1917 | 1/01/1918 | 11/11/1918 |
|---|
| 14 cm modèles 1887, 1891, 1893 et 1910 |
0 |
22 |
18 |
24 |
16 |
28 |
12 |
3 |
4 |
| 16 cm modèles 1887, 1891, 1893 et 1893/96 |
0 |
5 |
17 |
22 |
20 |
28 |
30 |
30 |
37 |
| 19 cm modèles 1870/93 (en), 1916 (en) et 1917 (en) |
0 |
0 |
16 |
24 |
23 |
24 |
46 |
78 |
100 |
| 200 mm Pérou (en) |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| 240 mm modèles 1870/87, 1884, 1893/96, 1903 (en), 1916 et 1917 |
0 |
2 |
8 |
23 |
33 |
40 |
112 |
148 |
213 |
| 270 mm modèle 1889 |
0 |
0 |
12 |
24 |
24 |
48 |
68 |
80 |
84 |
| 274 mm modèles 1887, 1893 et 1893/96 |
0 |
0 |
2 |
4 |
9 |
6 |
10 |
10 |
7 |
| 293 mm danois |
0 |
0 |
0 |
6 |
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
| 305 mm modèles 1893/96 et 1917 (en) |
0 |
0 |
2 |
6 |
10 |
13 |
11 |
11 |
10 |
| 320 mm modèles 1870/81 (en), 1870/84 (en) et 1870/93 (en) |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
40 |
44 |
44 |
44 |
| 340 mm modèles 1893 (en) et 1912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
4 |
4 |
4 |
6 |
| 370 mm modèle 1915 (en) |
0 |
0 |
4 |
10 |
10 |
10 |
6 |
8 |
4 |
| 400 mm modèle 1915 et 1916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
8 |
8 |
12 |
| 520 mm modèle 1916 (en) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Mortiers de tranchée
Fin septembre 1914, les fantassins français déployés dans l'Argonne subissent des tirs à courte portée, plutôt précis et surtout puissants, tirés des tranchées allemandes : il s'agit des minenwerfen (« lance-mines ») que les pionniers du 16e corps allemand du général von Mudra (lui-même un sapeur) ont apporté des arsenaux de la place de Metz122. Ils sont un atout important dans ce massif boisé, au terrain raviné limitant l'observation et le tir tendu des canons : le 2e corps français voit ses pertes s'accumuler, d'où des demandes d'un matériel correspondant qui remontent la chaîne hiérarchique.
Mortiers de 58
mm au premier plan (chargé avec sa torpille) et de 240
mm LT au second (avec sa bombe).
La première réponse est de faire sortir des stocks une centaine de mortiers de 15 cm modèle 1838 (en bronze, surnommés « crapouillots » à cause de leur silhouette trapue rappelant le crapaud) qui tirent des bombes sphériques chargées à la poudre noire. Rapidement, de nombreux autres mortiers improvisés apparaissent sur le front, montés à partir de matériaux de récupérations (corps d'obus, tube de vieux canons, etc.) ou même produits en usines pour répondre aux besoins urgents du front : le lance-bombe Cellerier, le lance-mines Gatard ou la sauterelle type A d'Imphy. La mise au point de matériels spécifiques commence pendant l'hiver 1914-1915 : en les 70 premiers mortiers de 58 mm T sont envoyés sur le front d'Artois, tirant une torpille équipée d'ailettes. Les 58 mm T no 1 bis (amélioré) et no 2 (plus gros) sont fabriqués à plusieurs milliers d'exemplaires à Saint-Étienne (usines Leflaive à La Chaléassière). À partir de , les mortiers de tranchée à grande puissance sont confiés exclusivement à l'artillerie (organisés en batterie de douze pièces), tandis que ceux de faible puissance sont laissés à l'infanterie (canons de 37 mm, mortiers Stokes de 81 mm, etc. des pelotons de bombardiers)123. Le Centre d'instruction de l'artillerie de tranchée (CIAT) est créé la même année à Bourges. Étant donné le mépris des autres artilleurs pour ces unités, le personnel affecté à l'artillerie de tranchée (AT) comprend dans un premier temps des condamnés avec sursis des conseils de guerre venant de toutes les armes, encadrés par des officiers de réserve volontaires qui échappent ainsi à la domination des officiers d'active124.
La très courte portée de ces pièces de l'AT est compensée par la faible vitesse initiale (70 m/s pour le 57 mm T no 1 bis), qui permet d'utiliser des projectiles aux parois peu épaisses, contenant beaucoup d'explosifs : un obus explosif de 75 mm fait théoriquement 5,4 kg dont 0,775 kg d'explosif, tandis qu'une bombe type LS pour mortier de 58 mm T no 2 en fait 18 dont 5 kg d'explosif. De plus, environ 1 500 000 obus explosifs de 75 mm défectueux (produits lors de l'hiver 1914-1915) furent recyclés comme projectiles du mortier Schneider de 75 mm tirant à basse pression, à partir d'octobre 1915.
Pièces d'artillerie de tranchée125
| Matériels | Masse en batterie | Cadence de tir | portée max. | Munitions (masse) |
|---|
| 15 cm modèle 1838 |
150 kg |
un coup/2 min |
600 m |
bombe sphérique (7,5 kg, dont 0,3 d'explosif) |
| 450 m |
bombe Nicole (10 kg dont 6 d'explosif) |
| 225 m |
bombe Cernesson (16 kg dont 7 d'explosif) |
| Lance-mines Gatard |
105 kg |
un coup/3 min |
174 à 480 m |
mines Gatard (40 à 102 kg) |
| 58 mm T no 1 |
114 kg |
un coup/min |
300 m |
bombe (16 kg dont 6 d'explosif) |
| 58 mm T no 1 bis |
181 kg |
un coup/min |
450 à 530 m |
bombe (16 kg dont 6 d'explosif) |
| 58 mm T no 2 |
417 kg |
un coup/min |
650 m |
bombes type A et B (16 kg dont 6 d'explosif) |
| 1 250 m |
bombe LS (18 kg dont 5 d'explosif) |
| 450 m |
bombe D (40 kg dont 10 d'explosif) |
| 70 mm VD modèle 1915 |
350 kg |
3 à 4 coups/min |
600 m |
bombe VD (19 kg dont 6 d'explosif) |
| 75 mm mle 1915 type A Schneider |
300 kg |
quatre coups/min |
1 700 m |
obus explosif mle 1900 (5 kg dont 0,8 d'explosif) |
| 150 mm T modèle 1916 |
510 kg |
trois coups/min |
1 900 m |
bombe mle 1915 (21 kg dont 8 d'explosif) |
| 1 930 m |
bombe mle 1916 (18 kg dont 5 d'explosif) |
| 2 120 m |
bombe mle 1917 (17 kg dont 5 d'explosif) |
| 150 mm T modèle 1917 Fabry |
615 kg |
quatre coups/min |
1 980 m |
| 240 mm CT modèle 1915 |
1 003 kg |
un coup/6 min |
1 025 m |
bombe M (87 kg dont 47 d'explosif) |
| 1 440 m |
bombe T (83 kg dont 42 d'explosif) |
| 240 mm LT modèle 1916 |
3 600 kg |
un coup/6 min |
| 2 140 m |
bombe S (85 kg dont 42 d'explosif) |
| 2 150 m |
bombe AB mle 1918 (83 kg dont 40 d'explosif) |
| 2 850 m |
bombe DH mle 1918 (50 kg dont 22 d'explosif) |
| 340 mm T |
2 260 kg |
un coup/6 min |
2 375 m |
bombe mle 1915 (195 kg dont 93 d'explosif) |
Plus de munitions
Si la guerre de mouvement limitait les tirs d'artillerie à des frappes rapides mais peu nombreuses, délivrées par une artillerie légère et très mobile, le passage à la guerre de positions allonge considérablement la durée des tirs (pendant plusieurs heures voire pendant plusieurs jours d'affilée) qui sont désormais réalisés par des batteries peu mobiles et de plus en plus lourdes. La consommation des cartouches d'artillerie connaît alors une très forte croissance : les témoignages parlent de déluge d'obus, de matraquage ou de pilonnage.
« À la rumeur nombreuses, ténue et souple des 75 qui passaient bas dans un bruissement de soie déchirée, se mêlait le souffle grave et sans pause des 155, celui, plus lent, des 120. Au-dessus, gros cuivres de cet orchestre sans chef, les lourds obus de 220 coupaient sans hâte les hautes couches de l'air en ronflant dur comme un homme enrhumé. Et, plus haut encore, l'œil guidé par l'oreille suivait, en s'étonnant de ne pas pouvoir les surprendre au passage, les trajectoires des pesants 270, qui avançaient par saccades et dont la chute accélérée en gamme chromatique semblait se suspendre un instant avant de s'achever en un monstrueux éventail de blocs arrachés à la craie sèche. »
— Description de la préparation d'artillerie pour l'offensive de Champagne de l'automne 1915126.
Consommations quotidiennes moyennes de l'artillerie française par calibre127
| Calibres | Déc. 1914 | juin 1915 | septembre 1915 | décembre 1915 | juin 1916 | septembre 1916 |
|---|
| 65 mm |
780 |
1 002 |
1 000 |
780 |
1 150 |
569 |
|---|
| 75 mm |
24 077 |
62 160 |
148 404 |
20 330 |
171 610 |
226 290 |
|---|
| 80 mm |
340 |
710 |
1 058 |
335 |
1 804 |
975 |
|---|
| 90 mm |
6 350 |
2 636 |
7 600 |
1 630 |
6 119 |
8 920 |
|---|
| 95 mm |
2 080 |
3 020 |
3 890 |
1 760 |
8 352 |
11 210 |
|---|
| 105 mm |
150 |
1 291 |
1 895 |
125 |
5 754 |
4 206 |
|---|
| 120 mm |
2 760 |
3 740 |
9 130 |
1 564 |
13 635 |
12 818 |
|---|
| 155 mm |
3 080 |
5 697 |
11 210 |
1 787 |
19 456 |
28 230 |
|---|
| 220 mm |
70 |
541 |
1 586 |
157 |
1 420 |
2 475 |
|---|
Nouvelles munitions
Un obus de 155
mm type D (Desaleux), aux formes élancées (ici les marquages sont finlandais).
Les performances balistiques des projectiles français sont améliorées grâce à des charges propulsives plus puissantes, ainsi qu'à des profils plus allongés et des culots chanfreinés (de forme tronconique) : par exemple l'obus explosif de 75 mm modèle 1917 type D atteint les 11 km de portée au lieu des 8 km des modèles précédents (1900 et 1915). L'efficacité des obus est étudiée de près : dès la fin de 1914, on fabrique désormais des obus en fonte (obus FA) plutôt qu'en acier, par souci d'économie mais aussi parce qu'ils se fragmentent en un plus grand nombre d'éclats.
De nouvelles fusées entrent en production, notamment celles à double effet qui permettent de faire au choix du tir fusant (des barillets gradués servent au réglage du temps avant détonation) ou percutant avec le même obus (fusée DE 24/31 mm modèle 1915, remplaçant la DE 22/31 1897, avec réglage de 0 à 24 secondes), qu'il a fallu adapter aux obus type D (fusées DE 24/31 A 1916 et 1918, avec réglage jusqu'à 32 s) et aux longues portées de l'artillerie lourde (DE LD 24/31 1917 et 1918, jusqu'à 51 s). Les percutantes se diversifient entre celles instantanées (explosant au ras du sol : fusées I 24/31 modèle 1914 et IA 24/31 1915, remplaçant la 24/31 1899) et celles retardées (avec des retards de 0,05 ou 0,15 s, creusant un entonnoir)128.
Si lors de la guerre de mouvements d'août et septembre 1914 les obus à balles ont été principalement utilisés, les obus explosifs sont plus utiles dans la guerre de tranchées qui s'éternise ensuite : les lots (composés chacun de 5 976 cartouches de 75 mm, théoriquement conditionnées dans 664 caisses de neuf coups) livrés aux parcs sont donc modifiés, composés initialement de 2 952 obus explosifs et 3 384 obus à balles129, en novembre 1914 ils passent à 5 688 explosifs et 288 à balles, puis à 5 391 explosifs et 585 à balles en juin 1915130.
L'artillerie tire des obus explosifs par millions, complétés par des obus à balles, mais aussi des fumigènes (chargés au phosphore), des incendiaires (contenant des mèches goudronnées et du magnésium), des lacrymogènes et des toxiques (avec une petite charge qui éventre l'obus, libérant le gaz), des perforants (type AL, aux parois épaisses, avec fusée de culot), des éclairants (éjectant par l'arrière un cylindre contenant un parachute retenant une cartouche éclairante), les traçants et même quelques obus à tracts.
Obus chimiques
Le développement des armes chimiques en 1914-1918 a donné lieu à une course entre les belligérants, se répondant l'un l'autre. Dès octobre 1914, l'infanterie française utilise des grenades lacrymogènes-irritantes (au bromacétate d'éthyle) pour le nettoyage des tranchées et abris. Le , l'artillerie allemande tire 3 000 obus de 7,7 cm lacrymogènes (au bromoacétone) à Neuve-Chapelle. La première attaque massive au gaz toxique sur le front occidental a eu lieu le lors de la deuxième bataille d'Ypres : les troupes allemandes lâchèrent devant eux une nappe de gaz chloré jaune-vert à partir de cylindres posés au sol, ce qui permit de faire une percée de trois kilomètres de large entre Steenstrate et Langemark à travers les deux lignes de tranchées, l'artillerie française perdant dans l'affaire 29 canons de 90 mm (l'AD 87), 16 canons de 75 mm (AD 45), six canons de 95 mm et quatre de 120 mm L (ces derniers repris le 25 avril)131. Une semaine après cette attaque, le GQG demande du matériel et des projectiles libérant des gaz. La première attaque chimique française par nappe de chlore a lieu en juillet 1915.
Tous les belligérants développent ensuite une artillerie chimique, solution plus pratique et précise que les nappes dérivantes (qui dépendent trop du vent). Le premier « obus spécial » français, baptisé obus no 1, est produit en juin 1915 : la partie interne de l'obus explosif de 75 est isolée et remplie avec du tétrachlorosulfure de carbone, une molécule suffocante. Les premiers obus spéciaux no 1 sont tirés le sur le bois Allemand à Fricourt au cours d'un coup de main de la 151e division d'infanterie et en plus grand nombre lors de la bataille de Champagne en septembre 1915. L'interrogatoire des prisonniers révéla que ces obus n'avaient provoqué que des picotements au niveau des yeux et très peu de gêne au niveau respiratoire, l'obus explosif de 75 n'ayant pas alors la contenance suffisante pour atteindre une concentration toxique du produit. Dans le même temps des nouveaux obus spéciaux baptisés no 2 et no 3 sont mis au point sur la base de l'obus de 75 explosif. L'obus spécial no 2 est un obus incendiaire-suffocant composé de phosphore et de sulfure de carbone, l'obus spécial no 3 est un obus incendiaire-fumigène chargé uniquement de phosphore.
Face à l'emploi français de gaz suffocants, les Allemands passent au diphosgène (surnommé « croix verte » à cause des marques sur les obus) qu'ils utilisent lors d'attaques chimiques en mai 1916 autour de Verdun. Les Français répondent avec les obus spéciaux no 4 et no 5, mis au point au cours de l'année 1915 mais gardés en réserve, employés à partir de février 1916 pour l'obus no 5 lors de la bataille de Verdun et de juillet 1916 pour l'obus no 4 lors de la bataille de la Somme. L'obus no 4 est chargé de « vincennite », un mélange d'acide cyanhydrique, la molécule toxique, de chlorure d'arsenic, de chloroforme et de chlorure d'étain chargés d'alourdir le nuage créé par l'explosion de l'obus. L'obus no 5 est chargé de « collongite », du phosgène associé au chlorure d'arsenic.
En 1917-1918, les tirs toxiques se multiplient, tandis que l'escalade se poursuit. En juillet 1917, les Allemands commencent à utiliser du cyanodiphénylarsine (« croix bleue », qui provoque des vomissements, obligeant à retirer le masque à gaz), puis à partir de juillet le sulfure d'éthyle dichloré (« croix jaune », vésicant surnommé gaz moutarde par les Britanniques et ypérite par les Français après la bataille de Passchendaele près d'Ypres en 1917). Le , l'artillerie française déclenche un tir de sept jours et sept nuits à base d'obus au phosgène pour préparer une attaque sur le Chemin des Dames. En 1918, d'autres obus spéciaux français sont remplis de substances toxiques, notamment les obus no 7 chargés à la chloropicrine (un lacrymogène suffocant, mais mortel à haute dose), les obus no 16 chargés à la « rationite » (vésicant à effet mortel immédiat) et les obus no 20 chargés au sulfure d'éthyle dichloré (ypérite), ces derniers seulement à partir de juin 1918.
Au cours de la guerre, de juillet 1915 à novembre 1918, le Service du matériel chimique a chargé 18,2 millions d'obus spéciaux (calibres 75, 90, 105, 120 et 155 mm, ainsi que des bombes de crapouillot), dont 9,2 millions sont des obus nos 4 et 5, 4,4 millions sont des fumigènes, 2,3 millions contiennent de l'ypérite et 870 000 sont des lacrymogènes ; s'y rajoutent 1 140 000 grenades suffocantes132,133. 200 000 soldats allemands ont été mis hors de combat par les gaz, dont 9 000 en moururent ; 190 000 Français furent intoxiqués, dont 8 000 décédèrent134.
« C'est sans doute le tour de force le plus extraordinaire auquel il ait jamais été donné d'assister : improviser de toutes pièces une industrie sans personnel, sans matières premières, sans même pratique de fabrication. En quelques mois, en effet, il a fallu transformer en procédés industriels des procédés de laboratoire. »
— Alexandre Millerand, ministre de la Guerre d'août 1914 à octobre 1915, à propos de l'industrie chimique française135.
Problèmes de production
Stockage des
douilles de 75
mm : fabriquées avec du
laiton, il fallut importer pour satisfaire les besoins, d'où leur récupération après usage et l'emploi des
gargousses en toile pour la charge propulsive des gros calibres.
Quand le ministère de la Guerre ordonne de lancer la production massive de cartouches d'artillerie, rapidement tout manque, que ce soient les matières premières (acier, cuivre, explosifs et poudres), les machines-outils, les usines ou le personnel. Facteurs aggravants, d'une part la majorité des régions industrielles du Nord-Est est sous occupation (la France perd ainsi 63 % de sa production d’acier et 81 % de sa production de fonte)136, d'autre part les principaux fournisseurs d'avant-guerre étaient allemands (mais quelques usines localisées en France sont saisies).
Une fois les stocks presque vidés, on remplace l'acier par la fonte aciérée (obus FA en « fonte grise », plus pauvre en carbone que la fonte brute), moins chère et qui se coule ; pour l'explosif, on remplace la crésylite (trinitrocrésol) à partir d'octobre 1914 par de la schneidérite (à base de nitrate d'ammoniac et de dinitronaphtaline), de la tolinite ou tolite (trinitrotoluène), de la mélinite (trinitrophénol), de la xylite (trinitrométaxylène) et de la cheddite137 ; la poudre B utilisée comme charge propulsive est en partie importée des États-Unis ; on produit du phénol à partir du gaz de ville, on lance la production industrielle d'éther, de nitrocellulose et d'acide sulfurique, même si l'industrie chimique française, en partie relocalisée dans le Sud-Ouest (Angoulême, Bassens, Toulouse, Saint-Médard, Bergerac, etc.), dépend entre autres du nitrate de soude chilien et du nitrate d'ammonium norvégien138.
L'industrie de l'armement a utilisé comme main d'œuvre essentiellement des militaires réaffectés (les « affectés spéciaux », un demi-million en 1918), des femmes (430 000 « munitionnettes » à la fin de la guerre, le plus souvent d'anciennes ouvrières du textile) et des ouvriers civils, complétés par des adolescents, des étrangers (notamment des engagés chinois), des coloniaux (surtout Algériens, Indochinois, Marocains et Tunisiens), des prisonniers de guerre volontaires et des mutilés139.
Production de projectiles en France par année (sans compter les importations)140
|
| 3 396 000 |
24 152 000 |
80 319 000 |
101 341 000 |
70 588 000 |
Problèmes logistiques
Convoi d'obus de 220
mm (chacun fait 100
kg) sur
voie étroite près de la gare du
Quesnel en août 1916.
Les énormes consommations de munitions nécessitent une infrastructure logistique adaptée ; avoir assez de munitions pour alimenter une offensive devient tellement important que la responsabilité passe de la direction de l'arrière à celle du 1er bureau du GQG. Les usines livrent les cartouches ou leurs éléments aux entrepôts de réserve générale, situés à l'arrière (Besançon, Lyon, Clermont, Bourges, Angers, Rennes et Nevers). Ces entrepôts sont agrandis en août et septembre 1915 (en rajoutant des hangars et des voies ferrées) et complétés par ceux de Héricy (pour des munitions de 75 et 105 mm), Cosne (pour l'artillerie de tranchée) et Vincennes (pour les obus « spéciaux »). Chacun de ces entrepôts est relié à une armée par au moins une ligne ferroviaire, avec au minimum quatre trains par jour141.
Chaque train de munitions est composé de 30 à 35 wagons, soit une capacité de 300 à 350 tonnes. Les armées stockent leurs réserves sous forme d'« en-cas mobiles », c'est-à-dire des trains chargés et stationnés sur des voies de garage. Ces parcs sur rails sont en août 1915 à Vaivre (dépendant de la GR de Gray), Brienne (GR de Troyes), Noisy-le-Sec, Le Bourget, Creil et Dunkerque, soit un total de 3 440 wagons, auxquels se rajoutent les stocks des places fortes, entamés par les armées voisines142.
Par exemple, pour l'offensive de Champagne de septembre-octobre 1915, la préparation concerne notamment les services de l'arrière, avec pendant tout le mois d'août le développement des réseaux ferroviaires et routiers, ainsi que le stockage d'énormes piles d'approvisionnements. En cas de percée, des convois automobiles de ravitaillement en munitions sont prévus entre les terminus ferroviaires et les échelons hippomobiles de ravitaillement des corps ou des armées143. Le parc au nord-est de Brienne, sur la ligne de Jessains à Éclaron, est aménagé avec un faisceau de vingt voies de garage pour les en-cas (capacité de 800 puis 1 000 wagons), ainsi que six vastes hangars à munitions (chacun de 200 sur 16 mètres, desservis par des voies ferrées, avec capacité moyenne de 700 000 coups de 75 et 200 000 d'AL). La sécurité est confiée à de simples murets de sac à terre, des pompes à bras et des moto-pompes, avec pour la manutention deux détachements de grand parc et pour la garde une compagnie de territoriaux et un peloton de cavalerie (des canons de DCA et des projecteurs arrivent à partir du milieu 1916)144. En avant de ce parc, les gares de Saint-Dizier, Résigny et Châlons servent elles aussi au garage d'autres en-cas (chacune de cent à deux cents wagons). Juste derrière le front, la ligne de Suippes à Sainte-Menehould, mise à deux voies, est en plus doublée à six kilomètres plus au sud par une ligne nouvelle de 33,8 km de long de Cuperly à Dampierre.
Livraisons françaises de projectiles lors des offensives de 1915-1916145
| Calibres | Artois et Champagne
(août-octobre 1915) | pour défendre Verdun
(février-juillet 1916) | pour la Somme
(mai-octobre 1916) |
|---|
| 58 mm de tranchée |
0 |
13 598 |
653 968 |
|---|
| 75 mm de tranchée |
239 350 |
0 |
196 000 |
|---|
| 150 mm de tranchée |
0 |
0 |
98 780 |
|---|
| 240 mm de tranchée |
1 950 |
1 220 |
36 430 |
|---|
| 65 mm |
9 648 |
55 476 |
0 |
|---|
| 75 mm |
5 497 920 |
12 513 744 |
17 378 208 |
|---|
| 75 mm à gaz |
460 000 |
180 000 |
1 329 000 |
|---|
| 80 mm |
39 700 |
103 500 |
13 400 |
|---|
| 90 mm |
285 800 |
368 800 |
290 500 |
|---|
| 95 mm |
104 700 |
556 000 |
740 800 |
|---|
| 100 mm |
8 400 |
33 100 |
33 600 |
|---|
| 105 mm |
112 200 |
508 000 |
415 500 |
|---|
| 120 mm |
430 500 |
1 361 200 |
902 900 |
|---|
| 120 mm à gaz |
0 |
5 200 |
88 200 |
|---|
| 155 mm |
535 000 |
1 425 200 |
2 310 000 |
|---|
| 155 mm à gaz |
0 |
0 |
269 000 |
|---|
| 220 mm |
75 460 |
55 120 |
360 390 |
|---|
| 270 mm |
9 900 |
700 |
24 150 |
|---|
nombre de wagons nécessaires
(moyenne par jour) |
13 297
(200 par jour) |
27 671
(211 par jour) |
46 483n 21
(263 par jour) |
|---|
Nouvelles organisations
L'artillerie française se développe largement pendant le conflit, passant d'un effectif de 434 000 hommes en août 1914 (soit 16 % de l'ensemble de l'armée) à 771 000 en 1918 (soit 26 % du total), sans compter le train qui assure la logistique des munitions146. Le recrutement du personnel pose moins de problèmes que dans l'infanterie, l'attrition étant beaucoup moins forte. Les régiments d'artillerie à pied, les dépôts ainsi que les classes 1914 à 1919 (cette dernière de façon anticipée dès avril 1918) couvrent les besoins. Toutes les catégories sociales sont concernées, avec des préférences pour les urbains ayant un métier technique (ouvriers, mécaniciens, chauffeurs, etc.) jusqu'au ruraux pour s'occuper des milliers de chevaux (conducteurs, charretiers, maréchaux-ferrants, etc.)147.
À partir de janvier 1915, le commandement de l'Armée prend conscience des pertes parmi les cadres des unités d'artillerie existantes et de la nécessité de former de nouveaux officiers pour les nouveaux régiments d'artillerie lourde et de campagne. Entre janvier 1915 et décembre 1917, 6 000 officiers sont directement nommés par le général commandant en chef. Les sous-officiers ayant dix mois de grade et au moins douze mois de service actif aux armées désignés par leurs supérieurs hiérarchiques sont envoyés en cours de perfectionnement à l'école de Fontainebleau ; cette voie de recrutement a permis, entre janvier 1915 et décembre 1917, la formation de 4 000 sous-lieutenants et de 800 sous-lieutenants spécialisés dans l'artillerie de tranchée au cours de 14 promotions. Les sous-officiers de moins de huit mois d'ancienneté désigné par le Grand Quartier général aux cours d'élève-aspirants en étant exempté du concours d'entrée, ils sont rejoints dans ces cours par les soldats des nouvelles classes ayant réussi à obtenir au moins 12 au concours de connaissances générales. Cette dernière voie de recrutement a permis de recruter respectivement 3 500 sous-officiers et 5 000 appelés qui obtiennent le grade d'élève-aspirant148.
Création d'unités
Pour fournir l'artillerie nécessaire à la création de nouvelles divisions (jusqu'à la 170e DI formée en décembre 1916) et de nouveaux corps d'armée (jusqu'au 40e CA lui aussi créé pendant la même période), leur dotation se fait en regroupant les quatrièmes groupes des régiments de CA existant, les quelques batteries de 75 mm tirées des colonies, ou en créant quelques batteries à partir des stocks de vieilles pièces de 80 mm modèle 1877 et de 90 mm modèle 1877 (du système de Bange). Le , l'ensemble de ces groupes forment des nouveaux RAC numérotés de 201 à 276.
L'artillerie lourde de campagne, qui s'est beaucoup développée pendant l'hiver 1914-1915, est réorganisée le en 20 régiments d'artillerie lourde hippomobile (RALH nos 101 à 121) et en cinq puis dix (le ) régiments d'artillerie lourde tractée (RALT nos 81 à 90). Ces régiments ont une vocation administrative et non tactique ; les RALH doivent être à 20 batteries pour fournir les groupes (à deux batteries) d'artillerie lourde des corps d'armée et des armées, tandis que les RALT sont théoriquement (l'industrie peine à fournir les canons nécessaires) à 24 batteries et servent de réserve mobile pour les offensives, affectés aux armées puis à la réserve générale d'artillerie. Le , les RALH passent sur le papier à 36 batteries pour fournir les groupes lourds divisionnaires (armés des nouveaux 155 mm C, la dotation se faisant progressivement jusqu'à l'été 1918)149. Le , ordre est donné de dédoubler les RALT qui passent de 10 à 20 régiments (nos 281 à 290, les 289e et 290e en début 1918) sans augmenter le nombre de groupes. Le c'est au tour des RALH qui doivent passer de 20 à 32 régiments (nos 130 à 145 avec quelques vacants) pour former le régiment organique de chaque corps d'armée. en février 1918, quatre groupes sont retirés de chaque RALH pour être affectés à la réserve générale et former 30 nouveaux RALH (nos 301 à 456, en rajoutant 200 au numéro du régiment d'origine)150.
En 1917, les divisions d'infanterie subissent une refonte : l'échelon de la brigade est supprimé, l'infanterie est réduite à trois régiments d'infanterie (au lieu de quatre auparavant), tandis que l'artillerie divisionnaire est augmentée d'un groupe d'artillerie lourde hippomobile (armé de 155 mm C, organique par décision du , avec application jusqu'à l'été 1918) et d'une batterie de tranchée en plus du régiment d'artillerie de campagne (et ses 75 mm). Au niveau du corps d'armée se rajoutent le régiment d'artillerie de campagne monté, progressivement transformé en RAC porté (des 75 mm sur camion), ainsi que deux groupements (chacun à deux groupes) d'un régiment d'artillerie lourde (avec des 105 mm et 155 mm L, souvent remplacés par des vieux 120 mm L).
Réserve générale d'artillerie
Le est créée l'« artillerie à grande puissance » (ALGP), regroupant les unités équipées de pièces de marine ou de côte de très gros calibre, notamment l'artillerie lourde sur voie ferrée (ALVF)117. S'appuyant sur les leçons des combats de 1915 et de 1916, le général Buat (artilleur de formation) recommande la création d'une réserve d'unités permettant une « manœuvre d'artillerie » (la concentration des feux) ; écouté par le nouveau commandant en chef le général Nivelle (lui aussi artilleur), la « Réserve générale d'artillerie lourde » est créée en janvier 1917, progressivement organisée et définie par la note du . Cette réserve dépend directement du GQG, comprend un état-major (avec Buat à la tête puis en 1918 le général Herr), tous les groupes armés des plus gros calibres, un centre à Mailly (pour la maintenance et l'instruction), des escadrilles d'aviation (pour l'observation et le réglage) ainsi que ses propres services de transport (y compris des groupes de « constructeurs de voie normale », des dépôts de matériels, une école de chauffeurs et de mécaniciens à Langres, un service automobile, etc.)151. La réserve est organisée en trois divisions : la première regroupe l'ALGP (comprenant l'ALVF), la deuxième l'artillerie lourde à tracteurs et la troisième les pièces servies par les canonniers-marins.
Renommée « réserve générale d'artillerie » (RGA) le , elle est alors composée de toutes les unités d'artillerie n'entrant pas dans la composition organique des grandes unités. Elle comprend 3 200 pièces d'artillerie de campagne tractée, 4 480 pièces d'artillerie lourde tractée ou attelée, ainsi que 200 pièces d'artillerie lourde à grande puissance (ALGP). Avec l'intégration de l'artillerie à pied et des groupes d'artillerie de tranchée, une 4e division est rajoutée152 :
- la 1re division (commandée par le colonel puis général Maurin), constituée par l'artillerie lourde à grande puissance (ALGP, dont l'ALVF), soit les RA numérotés de 70 à 80 ;
- la 2e division formée des régiments à tracteurs numérotés de 81 à 90 (pour les régiments dotés de canons longs) et 281 à 290 (pour les régiments dotés de canons courts) ; elle est renforcée par des groupements de caterpillars porteurs et tracteurs ainsi qu'en 1918 par des régiments hippomobiles (nos 101 à 118, 120 et 121, 130 à 138, 141 et 142) ;
- la 3e division (commandé par un contre-amiral) formée des canonniers-marins servant des batteries à tracteurs et une flottille armée (canonnières et péniches utilisant le réseau des cours d'eau) ;
- la 4e division formée par les régiments d'artillerie à pied (1er, 3, 5 à 11), les batteries à pied des 1er, 2e et 3e régiments d'artillerie coloniale et les régiments d'artillerie de tranchée numérotés de 175 à 178153.
Une 5e division de la RGA est formée en juin 1918 avec les régiments portés d'artillerie de campagne, confisqués aux corps d'armée154. Le remplacement du matériel est assurée par les armées pour les 2e et 4e divisions et par la RGA en ce qui concerne les 1re et 3e divisions. L'inspection générale de l'artillerie est formée en janvier 1918, elle est dirigée par un général de division et a pour objet de diriger et surveiller l'instruction de l'artillerie au sein des armées. Le général inspecteur de l'artillerie dirige également la réserve générale d'artillerie (RGA).
Nouvel uniforme
L'uniforme de l'artilleur (l'« artiflot » en argot) s'adapte lui aussi au conflit, en suivant la même évolution que celui des autres armes : le passage progressif en 1915 au drap de laine bleu horizon (teint à l'indigo) et le port du casque Adrian (de 0,7 mm d'épaisseur, recouvert d'un vernis « gris artillerie », puis gris mat à partir de 1916). Quelques signes distinctifs de l'artillerie sont tout de même conservés : l'insigne de col reste rouge écarlate ainsi que le passepoil du pantalon-culotte, tandis que le casque porte à l'avant deux canons croisés.
Dans la pratique, les artilleurs ayant à assurer des tirs de harcèlement ou de préparation pendant plusieurs heures et ayant à manier des munitions et pièces de plus en plus lourdes remplacent leur tenue de combat par la tenue de corvée, c'est-à-dire un pantalon de treillis et une blouse de bougeron en forte toile de lin écrue. S'y rajoutèrent dans un premier temps des pièces d'uniforme non réglementaires, en velours côtelé brun, beige ou bleu-gris (par manque de drap bleu horizon) ainsi que des effets civils en hiver (écharpes, chandails, gants et bonnets).
Nouveaux emplois
Devant l'incapacité de l'infanterie française à percer les lignes allemandes, l'État-Major réplique en accumulant toujours plus d'artillerie et de munitions pour préparer la seconde offensive de Champagne à l'automne 1915, l'offensive de la Somme de l'été 1916 et la seconde offensive de l'Aisne au printemps 1917. Pour cela, l'Armée française renforce considérablement son artillerie et surtout change sa façon de l'utiliser. Cette adaptation est progressive, car chaque offensive apporte une nouvelle leçon à appliquer lors de la bataille suivante, mais aussi parce que l'application de ces innovations se heurte au conservatisme d'une partie des officiers d'état-major, y compris de la part d'artilleurs155.
En 1915
La nouvelle doctrine d'emploi de l'artillerie est élaborée à partir des pratiques expérimentées dans plusieurs grandes unités dès l'automne 1914. Leur description remonte la hiérarchie, puis les états-majors des différentes armées et le GQG les diffusent, ce dernier sous le titre Instruction relative à l'emploi de l'artillerie le , puis par la Note sur le rôle de l'artillerie des attaques du . Selon cette dernière, l'artillerie a désormais quatre missions :
- la préparation, pour ravager le réseau de barbelés et neutraliser la ligne de tranchées adverse (avec une densité théorique d'une pièce pour dix mètres de front) ;
- le barrage, sur les flancs et en avant de l'attaque sur 100 à 200 mètres, interdisant les contre-attaques et l'intervention de renforts ;
- la destruction des mitrailleuses de flanquement sur 7 à 800 m de largeur sur les flancs de l'attaque ;
- la contre-batterie, pour faire taire ou détruire l'artillerie adverse, avec repérage et réglage par avion ou ballon156.
À partir de 1915, chaque corps et armée dispose d'un service de renseignement de l'artillerie (SRA), qui regroupe les informations provenant des sections de recherche de renseignements par observation terrestre (SROT), des sections de repérage par le son (SRS), des ballons captifs, ainsi que de l'aviation d'observation et de réglage (avec une escadrille par CA). Des officiers de liaison sont détachés auprès des unités d'infanterie pour assurer la coordination, tandis que le colonel de chaque régiment d'artillerie devient le conseiller de son général157. L'artillerie de chaque division et de chaque corps est désormais dirigée par un petit état-major, soutenu au niveau de l'armée par le groupe de canevas de tir (composé de membres du Service géographique de l'Armée, le SGA) chargé des travaux cartographiques158. Des réseaux téléphoniques doivent relier les groupements, batteries, états-majors, terrains d'aviation, postes d'observation, etc.159 Pour le réglage, la liaison se fait par TSF ou par signaux160.
Désormais, des plans d'emploi de l'artillerie sont établis avant chaque attaque ; deux exemples de ces plans montrent l'application des directives. Le , le 5e corps attaque Vauquois, Boureuilles et la cote 263 : les ordres sont de précéder l'assaut de l'infanterie par une préparation d'artillerie de deux heures, avec deux interruptions de dix minutes pour surprendre les fantassins allemands dans leurs tranchées. « Dès que le mouvement de l'infanterie sera entamé, l'artillerie allongera son tir pour effectuer des barrages, atteindre la 2e ligne et les réserves de l'ennemi et paralyser ses contre-attaques »161.
Fin février 1915, le 21e corps prépare une nouvelle attaque vers Souchez, entre la colline de Lorette et la crête de Vimy (devancée par les Allemands en début mars, l'attaque française est finalement menée en mai) : là aussi deux heures de préparation sont prévues à l'aube, par 120 pièces de campagne (AC 21, AD 43, 58 et 92 et un groupe du 2e CC) et 106 d'artillerie lourde (le groupement nord de la 10e armée). Les batteries de campagne sont en moyenne positionnées à seulement 2 600 mètres de leurs objectifs, à des distances extrêmes variant entre 1 600 et 4 000 m (ce positionnement permet d'améliorer la précision et ensuite d'allonger le tir), tandis que les batteries lourdes sont jusqu'à 6 km (la moitié est réservée à la contrebatterie). Le réglage est assuré par des observateurs placés en première ligne et par deux avions162.
L'offensive de l'automne 1915 en Champagne est marquée par une préparation encore plus puissante, du 22 au : pour un front d'attaque de 35 km furent déployés 872 pièces d'artillerie lourde, soit une pièce lourde pour 40 m en moyenne et un canon de 75 mm pour 33 m, d'où la consommation de 300 000 obus lourds et 1,3 million de 75 mm163. L'offensive permit de prendre la première ligne allemande (matraquée par les obus), mais piétina devant la deuxième (intacte), avant d'être interrompue faute de munitions.
En 1916
Les offensives françaises du printemps et de l'automne 1915 font à leur tour l'objet d'une analyse (rapports de Foch sur l'Artois et de Pétain sur la Champagne)164, avec diffusion pendant la période hivernale (plus calme) des conclusions sous la forme des instructions du sur l'emploi de l'artillerie lourde et du sur le but et les conditions d'une offensive d'ensemble165.
Le premier jour de la bataille de Verdun, le , voit l'application d'une nouvelle tactique : si la préparation d'artillerie allemande est encore plus puissante que celle française de 1915 en Champagne, elle est surtout plus courte, durant neuf heures au lieu de trois jours, ce qui surprend les états-majors français (l'artillerie lourde française, composée alors surtout de vieilles pièces, tire plus lentement). Les enseignements de la première phase des combats autour de Verdun sont publiés dans l'instruction du sur l'emploi de l'artillerie dans la défensive166, avec notamment la « contre-préparation offensive » (CPO) qui doit être exécutée pendant la préparation adverse, juste avant son attaque, au moment où les tranchées de départ ennemies sont remplies167. La préparation d'artillerie déclenchant une contre-préparation, tout accroissement du tir dégénère donc en un duel (une guerre d'usure), chaque artillerie frappant les lignes adverses.
L'attaque de la 6e armée (commandée par le général Fayolle, un artilleur) dans le cadre de la bataille de la Somme se fait sur un front de 15 km, après une semaine de préparation d'artillerie. Pour la réaliser puis accompagner l'assaut, chaque division et corps d'armée dispose d'une artillerie lourdement renforcée : la concentration représente 444 canons de campagne, 360 mortiers de tranchée, 228 canons courts et 300 longs d'artillerie lourde, ainsi qu'un déploiement de 56 mortiers et 61 canons longs d'ALGP168. Les tirs des nouveaux obusiers français de 400 mm ont écrasé les villages fortifiés d'Herbécourt, Estrées et Belloy-en-Santerre169. Grâce à cela, l'assaut d'infanterie lancé le conquiert la première ligne allemande : « grâce à la préparation d'artillerie, destruction complète des défenses accessoires, bouleversement des tranchées, écrasement des abris » (le 21e RIC devant Dompierre)170. Par contre la deuxième ligne allemande, peu touchée par la préparation et hors de portée de l'artillerie de tranchée, arrête la vague d'assaut. Pour atteindre ce maigre résultat, la consommation de munitions a été de deux millions d'obus de 75 mm et d'un demi-million d'obus lourds (du au )163. L'offensive se poursuit donc, comme prévu par la « conduite scientifique de la bataille », par une série de nouvelles poussées (les , et ), la période entre deux attaques étant nécessaire pour faire avancer l'artillerie sur un terrain bouleversé, mais comme les Allemands réorganisent leurs défenses en profondeur, la percée est impossible171.
En 1917
L'évolution de la doctrine d'emploi interarmes (et son instruction aux états-majors) est confiée au Centre d'études de l'artillerie (CEA), fondé le à Châlons-sur-Marne, tandis que l'École d'artillerie de Fontainebleau adapte rapidement son enseignement pour fournir les nouveaux officiers172. L'expérience acquise sur la Somme engendre l'instruction du , appliquée lors de la seconde offensive de l'Aisne (au Chemin des Dames) avec un pilonnage sur 40 km de large par quatre millions d'obus de 75 mm et 1,2 million d'obus lourds (du 7 au ). Il y avait un canon de 75 mm et un canon lourd par 20 m de front à attaquer. L'échec fut en partie attribué au mauvais temps (rendant difficile le réglage) et le terrain difficile (les 1 650 pièces d'artillerie de tranchée déployées furent incapables de suivre l'infanterie)173.
Mortier de 220
mm TR Schneider sur la
côte du Talou en août 1917 : quatre artilleurs portent un obus (100
kg) jusqu'à la
culasse ouverte, tandis qu'un autre amorce une
fusée.
Pendant l'été 1917, les offensives limitées sont basées sur d'énormes concentrations d'artillerie. Celle de la 2e armée au nord de Verdun sur les deux rives de la Meuse, est préparée puis soutenue par environ 600 batteries, soit 2 256 pièces, servies par 60 000 artilleurs, le tout pour appuyer 50 000 fantassins (huit divisions) sur un front de seulement 18 km (soit une pièce pour huit mètres de front). Sont déployés 1 195 canons de 75 mm pour l'appui tactique (soit un groupe pour chaque bataillon) ; 1 016 mortiers de tranchée, 435 canons de 155 mm courts (160 de Bange, 140 S et 135 CH), 122 mortiers de 220 mm et huit de 270 mm pour la destruction des retranchements ; 16 canons de 100⁄105 mm, 50 de 105 mm, 140 de 120 mm longs de Bange, 24 de 145 mm, 250 de 155 mm longs de Bange, 55 de 155 mm longs S et huit de 155 mm GPF pour la contrebatterie174 ; enfin, une centaine de canons de l'ALGP (17 de 240 mm, 28 de 270 mm, 16 de 32 cm, quatre de 370 mm et quatre de 400 mm) pour frapper les gares, dépôts de munitions, ainsi que les tunnels du Mort-Homme et du bois des Corbeaux175. La mise en place de l'artillerie, qui concerne environ un tiers de toute l'artillerie lourde française, s'étale sur cinq semaines176. La préparation commence le (à J-4 avant le 17, finalement reportée au 20), culmine les 19-20, puis les tirs se poursuivent jusqu'au 23. Pendant ces onze jours, 3,5 millions de coups sont tirés (dont 311 000 chimiques), soit 82 400 tonnes de munitions177.
Emploi des gaz
La doctrine française sur l'emploi des obus à gaz évolue avec le temps et avec l'arrivée de nouveaux produits toxiques. Les obus à gaz ont pour fonctions de tuer les occupants des zones visées par des tirs de destruction ou de neutraliser des zones par des tirs sporadiques. L'efficacité des obus à gaz est tributaire des conditions météorologiques dont le paramètre le plus important est le vent, devant la température, l'humidité et le rayonnement solaire. Lorsque la vitesse du vent dépasse les 3 m/s, les gaz sont rapidement dispersés et ne peuvent atteindre des concentrations létales, seuls des tirs de neutralisation sont possibles178.
Les premiers tirs de destruction visant à éliminer les occupants des tranchées ciblées sont réalisés en juillet 1915 en Champagne mais la faible toxicité des produits employés ne permet pas d'obtenir ce résultat. L'utilisation du phosgène permet à partir de mai 1916 des tirs de destruction. Ces derniers visent les troupes occupant un objectif de faible dimension : des batteries, des portions de tranchées, des abris ou des points de ravitaillement. Le tir de destruction avec des obus à gaz consiste à tirer dans un laps de temps réduit, entre deux et cinq minutes (temps qui correspond à un homme entrainé pour positionner correctement son masque à gaz179), de 200 à 500 coups de canons de 75 mm ou 50 à 100 coups de 155 mm ou 20 à 50 coups de mortiers de 58 mm pour atteindre par surprise les occupants des objectifs visés180.
Au cours de l'année 1916, les obus toxiques sont employés pour des tirs de neutralisation. Ces tirs ne sont pas suffisamment nombreux pour que la concentration en toxique tue les personnes occupant les zones ciblées, mais ils obligent les occupants à porter leur protection. Ces tirs à cadence lente et monotone sur des temps variant entre quatre et douze heures181 ont pour but de gêner les déplacements de l'adversaire et le démoraliser. Pour neutraliser une largeur de front de 100 m, il faut tirer 500 obus de 75 mm, 250 obus de 120 mm ou 200 obus de 155 mm. Cette technique est perfectionnée en entrecoupant les phases de neutralisation par des tirs de destruction à obus explosifs182.
Les obus lacrymogènes sont utilisés en 1916 pour des tirs de zone, l'action des molécules étant persistante. Il est admis qu'un obus de 75 mm couvre une surface de 5 m2, alors qu'un obus de 155 mm couvre une surface de 50 m2182. L'arrivée de l'ypérite à partir de juin 1918 permet de modifier l'emploi des tirs de zones. L'ypérite s'attaque aux voies respiratoires, à la peau et contamine la zone où elle est utilisée pendant plusieurs semaines. Les obus à l'ypérite sont utilisés comme moyen de défense, empêchant les troupes adverses de passer. En phase offensive, les tirs d'obus à l'ypérite sur les batteries allemandes ou dans les zones proches les rendent inutilisables en absence de décontamination, les tirs de flanquement ou sur des carrefours vont permettre de bloquer ou de limiter l'arrivée des renforts.
Protection
Quatre canons factices de 155
mm en bois, en batterie près de la
ferme des Wacques pendant l'été 1916.
L'invention de la poudre B à la fin du XIXe siècle avait apporté un avantage à l'artillerie : il s'agit d'une poudre sans fumée, rendant les pièces beaucoup plus discrètes qu'avec la poudre noire. À l'entrée en guerre, le matériel ancien est de couleur vert olive mat (pour ne pas faire de reflet), tandis que celui plus moderne est en gris perle, surnommé « gris artillerie », depuis une décision du , à l'origine pour limiter l'échauffement des caissons à munitions quand ils sont exposés au soleil183.
La transformation du conflit en guerre de position entraine le développement du camouflage militaire. À partir du mois d'octobre 1914, plusieurs artilleurs du 6e régiment d'artillerie lourde entreprennent de façon individuelle de camoufler leurs pièces d'artillerie. Le 12 février 1915, le ministère de la Guerre crée une équipe de camouflage, composée de peintres et de décorateurs non mobilisés, dirigée par Guirand de Scevola (un artiste peintre mobilisé dans l'artillerie à pied)184. Face à l'observation aérienne, l'invisibilité est recherchée par la peinture des pièces par tâches irrégulières imitant l'environnement (de l'ocre jaune, du brun rouille, du rouge terre de Sienne, du vert foncé, du noir, etc.) et surtout brisant la régularité des formes. Les matériels neufs sortent d'usine de nouveau en vert olive, auquel les peintres aux armées rajoutent le camouflage en plusieurs tons185. Les autres solutions utilisées sont de recouvrir la pièce d'une toile bariolée, d'un filet de camouflage ou de branchages.
Pour survivre aux tirs arrivant malgré tout sur les positions, celles-ci sont aménagées : des abris ou des tranchées sont creusés à côté de la plateforme de tir, la pièce peut être semi-enterrée dans une fosse, parfois épaulée par des traverses-abris, ou elle est installée dans une casemate à toiture en rondins ou en rails de chemin de fer, voire dans quelques cas bétonnée (régions fortifiées de Dunkerque et de Verdun). Enfin, des faux canons en bois sont utilisés pour attirer les tirs de contrebatterie adverses ou faire croire au déploiement d'artillerie lourde sur une portion du front.
L'apogée
La fin du conflit correspond à l'apogée de l'artillerie française en termes d'effectifs et de nombre de pièces, mais elle montre aussi quelques signes de déclin, notamment pour les canons longs. L'usure des tubes est importante, due aux fortes vitesses initiales et à leur emploi intensif (ils participent à toutes les batailles), tandis que l'industrie ne peut pas fournir les pièces de remplacement au même rythme. Fin 1918, la perte par usure est de 30 pièces de 155 mm GPF par mois, tandis que les 100 mm repartent en usine pour réalésage au calibre 105 et que les 145 mm subissent le même procédé en 155. Ces pièces modernes retirées des batteries sont, en attendant mieux, remplacées par des vieux canons de 155 mm L modèle 1877186. Dans l'ALGP l'usure oblige à réaléser des 305 mm modèle 1893/96 en 320 mm (appelés modèle 1917), des 274 mm modèle 1893/96 en 285 mm (dans un cas il y a un second réalésage à 288)187. Le retubage au calibre inférieur, qui permet d'obtenir un canon capable de résister à une plus forte pression, est envisagé à la fin et fut réalisé pour huit canons de 24⁄19 cm G188.
Dernières adaptations
Artillerie spéciale
L'apparition des premiers véhicules blindés avant même le début du conflit (la Charron-Girardot & Voigt en 1902)189 avait entraîné la naissance de l'artillerie antichar sous forme d'autocanons (AC) chargés de détruire les automitrailleuses (AM) adverses. Cette idée est proposée par le capitaine Lesieure Desbrières, puis acceptée par le gouverneur de Paris Joseph Galliéni le 6 septembre 1914 ; la première section est créée le 19 septembre 1914 à Vincennes (où se trouvait le parc automobile du camp retranché de Paris), avec des canons de 37 mm modèle 1885 ou 1902 TR (à « tir rapide ») de marine montés sur différents véhicules, notamment des Peugeot 146 (avec un moteur de 18 chevaux)190. Début 1915, un groupe de quatre autocanons armées de canons de 47 mm TR modèle 1902 de marine sur châssis de camion Renault est mis sur pied191. Tous ces autocanons sont affectés à la cavalerie, mais servis par des marins (formant des groupes mixtes d'automitrailleuses et d'autocanons de la Marine) jusqu'en , d'où le surnom pour ces véhicules de « torpilleurs à roulettes »192.
L'idée d'un véhicule d'accompagnement de l'infanterie, capable d'ouvrir une brèche dans les barbelés et de faire taire les mitrailleuses adverses, fait son chemin dès le début du conflit : en , le colonel Estienne (un artilleur) affirme que « la victoire appartiendra dans cette guerre à celui des deux belligérants qui parviendra le premier à placer un canon de 75 sur une voiture capable de se mouvoir en tout-terrain »193. Les recherches commencent en 1915, menées par Eugène Brillié (ingénieur chez Schneider) et Jules-Louis Breton (député et bientôt sous-secrétaire d'État aux Inventions), qui s'intéressent notamment aux tracteurs à chenilles (caterpillar) de la société californienne Holt (en). Le , le général Joffre, après la venu au GQG d'Estienne, demande au sous-secretariat d'État à l'Artillerie et aux Munitions de passer commande de « cuirassés terrestres » : ces engins doivent être composés d'un canon de 75 mm monté sur un tracteur à chenilles, le tout recouvert de blindage.
Après des tests par le Service technique automobile pendant l'année 1916194, deux modèles de chars sont développés et commandés à 400 exemplaires chacun, le Schneider CA1 et le Saint-Chamond. En parallèle, les Britanniques mènent leur propres recherches au sein du Landships Committee, débouchant sur la conception du tank Mark I ; 49 de ces véhicules, affectés au Machine Gun Corps sont engagés au combat le 15 septembre 1916 à Flers : à cause des pannes et du terrain seuls 25 partent à l'attaque, dont neuf atteignent les tranchées allemandes, finalement repoussés par l'artillerie allemande.
Cet échec est pourtant jugé encourageant. Le , l'« artillerie spéciale » (AS) est officiellement créée, elle est sous la direction d'Estienne, nommé général de brigade. Très rapidement, le 9 octobre, le général Estienne établit les bases de la tactique de l'artillerie d'assaut195. Les engins sont confiés aux 80e, 81e et 82e batteries du 81e régiment d'artillerie lourde, composées de volontaires, qui s'entrainent au camp de Champlieu, en forêt de Compiègne. Ils montent pour la première fois au front pour la seconde bataille de l'Aisne : les Schneider attaquent le 16 avril 1917 sur Juvincourt (au nord de Berry-au-Bac), puis les Saint-Chamond (livrés plus tardivement) le 5 mai au moulin de Laffaux. Eux aussi manquent de mobilité et ont une mécanique peu fiable : sur les 128 chars Schneider déployés, 52 sont frappés par l'artillerie allemande (15 par tir direct), dont 35 flambent (le réservoir n'est pas protégé), auxquels se rajoutent 21 autres chars tombés en panne ou embourbés196.
Fin 1916, pour contrer la probable apparition de blindés allemands sur le front occidental, l'Armée française prévoit le développement de la défense antichar, confiée au canon de 37 mm modèle 1916 TR de l'infanterie et au canon de 75 mm modèle 1897 de l'artillerie, ce dernier canon pouvant être installé sur une plate-forme de tir permettant un battement en azimut de 60° et en utilisant à tir tendu l'obus de rupture modèle 1910 de marine. En , 35 batteries antichars sont déployées sur le front, toutes dépendant du 176e régiment d'artillerie de tranchées197.
Le général Estienne étant écouté par le GQG ainsi que par les industriels, il obtient de Louis Renault qu'il lance à partir de l'étude d'un char léger, plus rapide mais moins armé. 150 de ces engins sont commandés le 22 février 1917, portés à 1 000 le 9 avril suivant après les premiers essais198 : la production de masse du Renault FT modèle 1917 de 6,7 tonnes est lancée à la fin de l'année, avec une unique arme montée en tourelle, une mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914 ou un canon de 37 mm SA 1918 (SA pour « semi-automatique »). Le premier engagement des chars Renault FT a lieu devant Saint-Pierre-Aigle le 31 mai 1918, pendant la troisième bataille de l'Aisne.
D'autres modèles furent envisagés : les FCM proposèrent un char de 40 tonnes avec un canon de 105 ou de 75 en tourelle ; Peugeot fit un prototype de huit tonnes ; des Mark V* de 26 tonnes furent achetés aux Britanniques. Un « char de rupture » fut étudié, commandé pour 1919 à 300 exemplaires, dont seulement dix seront livrés après-guerre sous le nom de FCM 2C, pesant 69 tonnes, avec quatre mitrailleuses et un canon de 75 mm199.
Artillerie antiaérienne
L'artillerie de défense contre les aéronefs (DCA, bientôt renommée en « défense contre avions ») s'est progressivement étoffée, composée d'autocanons de 75 mm De Dion-Bouton modèle 1913 (pointage en site jusqu'à 85°), de canons de 75 mm sur plate-forme modèles 1915 et 1917 (tirant jusqu'à 75° en site un obus modèle 1917 spécifique à la DCA), ainsi que des 75 mm sur remorque et des 105 mm fixes. En 1918, l'artillerie française aligne 760 canons antiaériens de 75 mm et 70 de 105 mm, affichant un total de 218 victoires pour cette année là200, malgré le fait que les vitesses initiales commencent à devenir insuffisantes (les avions volant de plus en plus vite et haut) et qu'y sont affectés de nombreux anciens blessés et des territoriaux.
Cette DCA est dispersée en une multitude de postes (composés d'une seule pièce) et de sections (deux pièces). En , ils sont tous rattachés administrativement au 62e RAC, sauf ceux des forts du camp retranché de Paris qui restent au 12e RAC. En , trois régiments d'artillerie de défense contre les aéronefs (RADCA) sont créés pour les regrouper (sans fonction tactique) : le 63e pour la DCA aux armées, le 64e pour la DCA parisienne et le 65e pour celle de l'arrière (hors Paris). En , devant l'augmentation des effectifs, le 63e sert à former trois régiments, le nouveau 63e RADCA (pour les 75 mm fixes), le 66e RADCA (pour les 75 mm mobiles) et le 166e RADCA (pour les 105 mm)201. Se rajoutent des détachements de mitrailleuses, de projecteurs et de ballons de protection. Tous ces régiments furent réorganisés en 1919, se détachant de l'artillerie.
Percer par surprise
Les offensives allemandes de la seconde moitié de 1917 (Riga en août et Caporetto en octobre) et du début de 1918 (offensive du Printemps sur la Somme en mars, la Lys en avril, l'Aisne en mai, le Matz en juin et en Champagne en juillet) sont marquées par des préparations d'artillerie beaucoup plus courtes (quelques heures) mais violentes (en utilisant beaucoup plus de pièces à tir rapide) avec un emploi très large des obus à gaz, puis par l'encagement des secteurs d'attaque (empêchant tout soutien des secteurs voisins) et par des infiltrations d'infanterie d'assaut qui collent au tir de barrage roulant (tactique développée par le colonel Georg Bruchmüller commandant l'artillerie de l'armée du général von Hutier). Les Britanniques attaquent eux-aussi par surprise en à Cambrai en submergeant la ligne Hindenburg à l'aide de chars d'assaut.
Côté français, ces pratiques sont imitées puis théorisées dans l'instruction du sur le tir d'artillerie202. Désormais, pour une attaque, la mise en place des batteries se fait de nuit, le réglage d'artillerie est fait sur carte, sans aucun tir de réglage (qui prennent du temps) ni usage du téléphone, pour maintenir l'effet de surprise. La préparation est courte, jusqu'à seulement une heure de tir ; le barrage roulant précède la vague d'assaut théoriquement de seulement 200 m ; les tirs de destruction (grosses consommatrices de munitions) sont remplacés par des tirs de neutralisation, notamment au gaz, y compris pour la contre-batterie. Après la percée de la première ligne, une partie de l'artillerie (y compris les mortiers de tranchée) est portée en avant pour soutenir l'assaut (favorisé par la préparation courte, qui ne laboure pas complètement le terrain)203.
L'amélioration de la mobilité de l'artillerie française, grâce aux camions et aux tracteurs, permet de concentrer des moyens rapidement et de faire jouer l'effet de surprise. Elle a été développée dès la fin 1916 pour faire face à la pénurie de chevaux, concerne le quart des batteries204 et est à l'origine du ralentissement puis du blocage des différentes percées allemandes du printemps et de l'été 1918. Cette mobilité stratégique est un facteur déterminant dans la succession rapide des trois séries d'offensives « coups de poing » des armées alliées (avec participation britannique et américaine : l'« offensive des Cent-Jours ») pendant l'été et l'automne 1918. L'artillerie allemande est, à partir de 1917, en pénurie de chevaux ce qui limite ses déplacements. Elle est essentiellement tributaire du chemin de fer pour des déplacements stratégiques et donc beaucoup moins mobile que l'artillerie française utilisant un parc automobile considérable (environ 80 000 véhicules en 1918). Le général Ludendorff considère donc dans ses mémoires que « la victoire française de 1918 c’est la victoire du camion français sur le rail allemand »205.
Vitesses de marche206,207
|
| Roue en bois cerclées de fer |
Batterie lourde montée |
5 km/h |
20 à 40 km |
| Batterie légère montée |
5 (au pas) à 7 km/h |
20 à 40 km |
| Batterie à cheval |
5 à 8 km/h (alternance trot/pas) |
25 à 50 km |
| Bandage plein en caoutchouc |
Batterie lourde tirée par tracteurs |
6 à 10 km/h |
50 à 70 km |
| Batterie légère portée par camions |
10 à 15 km/h |
70 à 100 km |
| Train-rouleur |
Batteries lourde ou légère |
15 à 20 km/h |
150 à 200 km |
| Pneumatique |
20 à 25 km/h |
200 à 250 km |
Artillerie automotrice
Les retours sur expérience des offensives de 1915, 1916 et 1917 ont montré que si l'assaut d'infanterie réussissait à prendre la première ligne de tranchées adverses, il échouait devant les deuxième et troisième lignes, faute de soutien d'artillerie, les pièces ne pouvant se déplacer sur un terrain labouré par les obus. D'où dans un premier temps le déploiement de plusieurs batteries de montagne (bâtées sur mulet) et l'emploi de tracteurs d'artillerie, puis le développement des premiers canons automoteurs sur roues et à la fin sur affûts chenillés. Ces derniers matériels, appelés « artillerie d'exploitation » et devant constituer la 7e division de la RGA, étaient prévus pour les offensives de 1919.
Furent étudiés des canons de 75 mm et de 105 mm L sur châssis Renault FT, mais c'est l'artillerie lourde qui fut privilégiée. Il était prévu de commander des affûts chenillés pour 130 tubes de 155 mm GPF, 50 de 194 mm GPF (en plus de 150 autres sur affût biflèche à tracteurs, le même que le 155 GPF), 20 de 220 mm L 1917 S, 75 de 220 mm TR CH et 25 de 280 mm TR S. Seuls les automoteurs à chenilles pour un canon de 194 mm GPF et pour un mortier de 280 mm TR auront le temps d'être expérimentés et de commencer à entrer en production. Toutes les commandes sont réduites le puis annulées sauf quelques exemplaires208.
|
| Canon de 194 mm GPF sur affût chenillé Saint-Chamond |
28 000 kg |
2 coups/min |
18 km |
obus explosifs (de 80,8 ou 83 kg) |
| Mortier de 280 mm sur affût chenillé Saint-Chamond |
28 000 kg |
2,5 coups/min |
10,9 km |
obus explosifs (202 à 275 kg) |
État des lieux à l'armistice
Au , l'artillerie française est organisée en 105 régiments d'artillerie de campagne (RAC) et 84 régiments d'artillerie lourde (RAL), déployant sur le front un total de 4 968 canons de 75 mm, 5 128 pièces lourdes et 112 canons de montagne.
Les 105 artilleries divisionnaires (AD) composées de 105 RAC (numérotés de 1 à 62 et de 200 à 280) chacun à trois groupes de trois batteries de 75 mm et de 105 groupes divisionnaires de 155 mm court (rattachés aux RALH numérotés de 101 à 145). Les 32 artilleries lourdes de corps d'armée (ALCA) sont formées chacune d'un groupe de 105 mm long (ou de 120 mm L de Bange) et d'un groupe de 155 mm long (RALH nos 101 à 145, dont les 141e, 142e et 143e coloniaux)209.
La réserve générale d'artillerie (RGA) regroupe la masse de manœuvre de l'artillerie : dix RALT à canons longs (nos 81 à 90), dix RALT à canons courts (nos 281 à 290), cinq RALH armés de 105 mm (nos 451 à 456), dix RALH armés de 155 mm L (nos 407 à 421), dix-sept RALH armés de 155 mm C (nos 301 à 345, dont le 343e colonial)186, huit RALGP pour l'ALGP (nos 71 à 78, le 72e en formation et le 70e pour la construction des voies ferroviaires à écartement normal) et cinq RAT (nos 175 à 179).
S'y rajoutent les trois RAM (nos 1 et 2 et le 13e colonial), les dix régiments coloniaux d'artillerie de campagne (nos 1, 2, 3, 21, 22, 23, 41, 42 et 43 et le régiment d'artillerie coloniale du Maroc), les treize RAP (nos 151 à 161, ainsi que les 182e et 183e coloniaux), les deux régiments chargés des voies de 60 cm (le 68e pour la construction, le 69e pour son exploitation), le régiment de repérage (163e, composé des SROT et SRS), les dix groupes autonomes d'Afrique (nos 1 à 10), les huit régiments d'artillerie d'assaut (nos 501 à 508), les six RADCA (nos 63 à 66 et 166, 67e servant les projecteurs), les 20 escadrilles d'artillerie et les 21 escadrons du train des équipages militaires et du service automobile210. La vingtaine de péniches-canonnières ont été rendues au ministère de la Marine en novembre 1917 (mais quatre d'entre-elles sont réarmées en novembre 1918 pour former la flottille du Rhin)121, ainsi que toutes les batteries de côte depuis les décrets du et 211.
De son côté, l'artillerie allemande est organisée en 243 artilleries divisionnaires formées d'un régiment de campagne à neuf batteries de quatre pièces (au lieu de douze de six pièces au début de la guerre) représentant au total 8 748 pièces, complété d'un bataillon mixte de deux batteries d'obusiers de 155 mm et d'une batterie de canons de 105 mm, représentant 2 700 pièces212. Les 30 artilleries de corps d'armée allemands sont composées de deux bataillons mixtes de deux batteries de mortiers de 210 mm et d'un bataillon de canons de 155 mm représentant 480 pièces. Des régiments indépendants servent de réserve, avec 3 200 pièces de campagne, 4 480 lourdes et 200 sur voie ferrée212, le renforcement des divisions se faisant aussi par emprunt temporaire aux unités des secteurs calmes213.
L'Armée allemande a capturé de nombreuses pièces d'artillerie françaises pendant le conflit. Pour les canons de 75 mm, il s'agit de 447 exemplaires en 1914 (notamment les 36 du 2e régiment d'artillerie colonial lors de la bataille de Rossignol le ), 26 en 1915, 14 en 1916, 0 en 1917 et 383 en 1918 (lors des percées sur le Chemin-des-Dames et le Matz)214. S'y rajoutent principalement les 460 pièces d'artillerie du camp retranché de Maubeuge, dont des canons lourds de Bange, le , ainsi que les gros canons de l'ALGP capturés le car impossibles à évacuer : deux canons de 16 cm, six de 19 cm, 14 de 240 mm, trois de 274 mm, un de 305 mm et quatre de 340 mm121. De leur côté, les captures françaises lors des offensives alliées de 1918 furent tout aussi importantes, très largement complétées par les exigences de la convention d'armistice du : l'Armée allemande doit abandonner aux alliés 5 000 de ses canons, dont 2 500 lourds et 2 500 de campagne, en bon état215.
Après les armistices
La guerre se terminant officiellement après la signature des différents traités de paix en 1919-1920, l'artillerie s'adapte à la nouvelle situation par la dissolution de presque toutes les unités de l'artillerie de tranchée. La démobilisation entraîne la réduction des effectifs d'artilleurs, avec comme conséquences la dissolution progressive de plusieurs régiments d'artillerie de campagne et d'artillerie lourde, ainsi que le regroupement de l'ALVF dans un seul régiment216. Le matériel surnuméraire est stocké en entrepôts, voire temporairement à l'air libre. Les chars sont rattachés à l'infanterie le .
Côté doctrine, on tire les derniers enseignements pour rédiger les nouveaux règlements. L'Instruction provisoire sur le service de l'artillerie en campagne du annonce en introduction : « la puissance des feux est le facteur prédominant du succès, dans la bataille moderne. L'attaque d'une position tenue par un ennemi disposant jusqu'au dernier moment, de feux bien ajustés sur le terrain de l'assaut, est vouée à l'échec. » Sur le plan tactique on insiste sur la préparation d'artillerie, qui peut être courte, le « rideau mouvant » ainsi que la concentration des tirs sur un noyau de résistance (il faut « manœuvrer par les feux ». À l'échelle opérative, on insiste sur le maintien d'une réserve générale d'artillerie, ainsi que sur la mobilité du matériel permettant la « manœuvre stratégique de masses d'artillerie » par la voie ferrée et surtout par la route. La puissance est mise en valeur, il faut être doté de matériels de tous calibres à tir rapide, à grand champs de tir et à grande portée (l'artillerie de tranchée doit être capable de tirer jusqu'à 2,5 km, la légère jusqu'à 10 km, la lourde courte de 10 à 15 km, la lourde longue de 15 à 20 km et l'ALGP au-delà de 20)217.
Pour le matériel, l'Armée française dispose de stocks considérables de canons et de munitions (notamment dix millions de coups de 75 mm)218 tandis que le nouveau mot d'ordre est de réduire les dépenses de façon drastique : mis à part quelques expérimentations dans les années 1920 (par exemple le 145 mm GPF, finalement abandonné), il faut attendre le réarmement lancé à partir de 1936 pour que de nouveaux modèles entrent en dotation (105 mm modèle 1936, 25 mm AA 1938, 75 mm TAZ 1939, 90 mm AA 1939, 25 mm AC 1937 et 47 mm AC 1937)219 et que la motorisation reprenne (75 mm 1897-1938 sur pneus TTT). Les programmes d'automoteur d'artillerie sont eux aussi relancés et des commandes sont passées en urgence, avec livraison des Sau 40 et ARL V 39 prévues à partir d'octobre 1940220. Après juin 1940, les stocks de matériels français sont largement utilisés par l'Armée allemande (sur le front de l'Est comme sur le mur de l'Atlantique) ; quant à l'armée de la Libération, elle fut équipée de matériels américains221.
Enfin, le déminage de l'ancien champ de bataille doit être réalisé. Dès les premières reconquêtes des territoires occupés du Nord-Est, la « récupération » et le « désobusage » commence, le terrain étant farci d'obus non explosés, d'éclats métalliques, de produits chimiques, de pièces d'équipement et d'ossements. Si l'Armée française a tiré environ 300 millions de cartouches d'artillerie, en rajoutant les tirs allemands et britanniques on atteint le milliard, dont 200 millions d'obus non explosés222, surtout concentrées sur l'étroite bande de terrain où s'est déroulée la guerre de position sur le front ouest. En France, elle prend le nom de « zone rouge ». Après un déminage superficiel et la reconstruction des infrastructures, cette zone est majoritairement remise en culture dès le début de l'entre-deux-guerres. De vastes surfaces sont tout de même rachetées par l'État qui les boise (notamment autour de Verdun) ou en fait des terrains militaires (le camp de Suippes), mais les sols ne sont pas dépollués en profondeur. Un siècle après les combats, les métaux lourds y sont toujours présents (notamment le plomb des balles de shrapnel et le mercure des amorces), tandis que l'eau du robinet de plusieurs communes contient encore trop de perchlorate223.
Notes et références
Notes
- La culotte désigne au début du XXe siècle l'équivalent d'un pantalon pour le personnel monté.
- Des casques modèle 1901 type bourguignotte ont été distribués aux 13e (11e et 12e batteries), 25e et 32e RAC, ainsi qu'au 4e groupe à cheval du 54e RAC ; il s'agit d'essais en temps de paix, remplacés par le képi à la mobilisation, envoyés au front pour ces unités à partir d'octobre 19145.
- L'idée d'un autocanon anti-aérien est proposée au Comité d'artillerie en 1908 face au développement des dirigeables et de l'aviation. Est retenu un canon de 75 mm modèle 1897 monté sur un affût permettant un pointage jusqu'à 70°, le tout installé sur une automobile. Cet autocanon est expérimenté au camp de Châlons en 1910, puis lors des grandes manœuvres. Après la sélection d'un châssis De Dion-Bouton (avec un moteur V8 de 35 chevaux pour propulser les cinq tonnes du véhicule) en , une commande de 30 exemplaires est passée9.
- Il faut 168 chevaux pour une batterie montée de 75, dont 36 de selle et 132 d'attelage. Il faut 215 chevaux pour une batterie à cheval, dont 82 chevaux de selle et 133 d'attelage17.
- Lors d'un tir à angle très faible (moins de 15°), la fusée 24/31 mm modèle 1899-1908 utilisée sur les obus de 75 mm le fait détoner avec un retard de 0,05 seconde, permettant au projectile de rebondir sur le sol et d'exploser juste après, à très faible altitude.
- La vitesse initiale et la portée maximale de tir (à l'angle maximal que permet l'affût) dépendent entre autres du type de munitions. Dès la fin de 1914, les cartouches reçoivent plus de charge propulsive et les projectiles sont allongés avec un culot plus restreint, augmentant la portée de 5 à 18 % selon le modèle22.
- La cadence de 28 coups en une minute a été atteinte par le prototype du canon de 75 mm lors d'un test en 1894. Au combat, les cadences sont beaucoup plus faibles, déterminées notamment par la durée du tir, qui surchauffe et use la pièce tout en épuisant les artilleurs, ainsi que par l'approvisionnement en munitions : la pratique avec un canon de 75 est plutôt d'environ 12 coups en une minute, 40 en cinq minutes (8 coups/min), 60 en un quart d'heure (4 coups/min), 150 en une heure (2,5 coups/min), 300 en trois heures (1,6 coup/min), 600 en dix heures (un coup/min) et 1 000 en une journée entière (0,7 coup/min)23.
- Si la portée maximale théorique du canon de 75 mm est de 10 700 m, dans la pratique c'est une charge réduite qui est utilisée (permettant un tir courbe et réduisant l'usure), limitant le tir à un maximum de 6 400 m. L'affût spécial utilisé dans les casemates de Bourges limite l'élévation à +15° (avec un battement horizontal de 54°) et la portée à 5,6 km24.
- Le poids et la portée des projectiles ont changé dans les années 1880, avec le remplacement de la poudre noire par de nouvelles charges propulsives (la poudre sans fumée à base de nitrocellulose) et l'emploi d'explosifs plus puissants (la mélinite).
- Les 2e et 4e régiments d'artillerie à pied, ainsi que 13 batteries de côte sont dissous à partir du pour participer à la formation des 1er et 4e régiments d'artillerie lourde.
- Les 9e et 10e groupes d'artillerie d'Afrique ont été constitués le 27.
- Chaque brigade d'artillerie du temps de paix porte le numéro de sa région militaire, sauf la 19e région (l'Algérie) qui n'a pas de brigade et la 21e région (celle d'Épinal) qui reçoit la 19e brigade.
- Voir le détail de la concentration des troupes dans Recherche:Mobilisation de 1914 sur Wikiversité.
- Les quatre DR mises sur pied par les 14e et 15e régions ont la particularité de comprendre chacune trois batteries de 75 mm et six de 65 mm, au lieu des neuf de 75 mm.
- Quatre divisions d'active, 19 divisions de réserve et 11 divisions d'infanterie territoriale ne sont pas affectées au corps de bataille dès le début de la mobilisation, restant à la disposition du général en chef ou du ministre de la Guerre : ce sont les 37e et 38e (venant d'Algérie), la 44e DI (venant des Alpes), la division de marche du Maroc, les six divisions des 1er et 4e GDR, les six DR et cinq DIT affectées aux places fortes (57e, 61e, 62e, 71e, 72e et 73e DR, 83e DTC, 84e, 85e, 86e et 89e DTP), les quatre divisions des Alpes (64e, 65e, 74e et 75e DR), ainsi que les trois DR et six DTC des côtes atlantiques (61e, 62e et 67e DR ; 81e, 82e, 88e, 87e, 90e et 92e DTC). S'y rajoutent les cinq groupes alpins, composés chacun d'un BCA et d'une batterie de montagne.
- Sans compter les divisions de sortie et les batteries de côte.
- Le nombre de canons de l'Armée allemande varie énormément en fonction des sources.
- Pour la planification industrielle, l'application des programmes prend du temps, nécessaire pour la conception, la production et la formation des matériels et du personnel ; le décalage atteint parfois une année pleine, l'industrie française ayant du mal à suivre.
- Les cingolis (de l'italien cingoli, chenilles) sont des ceintures de roue articulées, utilisées à partir de 1913 pour absorber une partie du recul (les roues frottant à l'intérieur) des canons de Bange de 120 mm et 155 mm. Ils ont été inventés par le capitaine puis major italien Crispino Bonagente, pour augmenter la largeur des roues (ce qui facilite le transport en tout-terrain) et diminuer la pression au sol (ce qui évite de raviner la batterie).
- Le Règlement sur le service des places de guerres, promulgué par le décret du , donnait aux gouverneurs des places fortes une certaine autonomie vis-à-vis du général en chef, notamment à travers l'article 151 : « le commandant en chef ne peut enlever à une place sous ses ordres aucune fraction de la garnison de défense déterminée par le Ministre »91. Le décret du modifie ce règlement, plaçant les places situées dans la zone des armées sous les ordres du général en chef, qui « dispose, sans restrictions, de toute la garnison des places fortes sous ses ordres et de toutes les ressources de guerre ou de bouche qui se trouvent soit dans la place, soit dans ses zones de réquisition ».
- Non compris les 1 829 wagons de l'ALGP, chargés avec 88 651 obus des calibre 240 à 400 mm.
Références
- Général Frédéric-Georges Herr, L'Artillerie : ce qu'elle a été, ce qu'elle est, ce qu'elle doit être, Paris, Berger-Levrault, , 344 p. (BNF 32241245), pages 3, 229 et 230
- État-Major de l'Armée, Répartition et emplacement des troupes de l'armée française, Paris, Imprimerie nationale, , 119 p..
- François 2010, p. 5 et 6.
- Marie-Christine Thooris et Claudine Billoux, École polytechnique : une grande école dans la Grande Guerre, Palaiseau, École polytechnique, , p. 43.
- Louis Delpérier, « L'artilleur de 1914 », Uniformes : les armées de l'histoire, no 89, , p. 8-16.
- AFGG 1936, tome 1, volume 1, p. 521.
- Michel Goya, « Comment ne pas adopter une innovation militaire essentielle » [archive], sur https://lavoiedelepee.blogspot.fr [archive], .
- AFGG 1936, tome 1, volume 1, p. 522.
- « L’auto-canon de 75 mm modèle 1913 » [archive], sur basart.artillerie.asso.fr.
- Joseph Joffre, Mémoires du maréchal Joffre, Paris, Plon, (réimpr. 1935 et 2008), 491 et 468 p., deux volumes (lire en ligne [archive]), p. 170.
- « La tourelle de 75 R 05 » [archive], sur www.fortiffsere.fr.
- « Les casemates dites de Bourges pour pièces de 95 et de 75 » [archive], sur www.fortiffsere.fr.
- « Canon de 120mm L Mle 1878 (et 1878/16) de Bange » [archive], sur www.passioncompassion1418.com.
- « Canon de 155mm L Mle 1877 (et 1877/16) de Bange » [archive], sur www.passioncompassion1418.com.
- AFGG 1937, tome 11, p. 940.
- François 2010, p. 9.
- « Tableaux d'effectif de la batterie montée et de la batterie à cheval de 75 sur le pied de guerre » [archive], sur canonde75modele1897.blogspot.fr.
- Règlement provisoire de manœuvre de l'artillerie de campagne, 1910, article 192, p. 88.
- Règlement provisoire de manœuvre de l'artillerie de campagne, 1910, article 191, p. 87.
- Challeat 1935, tome 2, pages 17, 285 et 532.
- Touzin et Vauvillier 2009, p. 10, 13, 16-17 et 19.
- Patrick Renoult, « Les munitions de l'artillerie française de la Grande Guerre », dans Un milliard d'obus, des millions d'hommes, p. 99-100.
- Aide-mémoire pour l'exécution des travaux d'études, Centre d'études de l'artillerie, 1918.
- « Le canon de 75 modèle 1897 » [archive], sur www.fortiffsere.fr.
- Touzin et Vauvillier 2009, p. 26-27, 31, 33 et 38-41.
- Loi du 24 juillet 1909 relative à la constitution des cadres & des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale en ce concerne l'artillerie, Paris, Henri Charles-Lavauzelle, , lire en ligne [archive] sur Gallica (modifiée par la loi du ).
- AFGG 1936, tome 1, volume 1, p. 519.
- Leroy 1922, p. 2-3.
- Leroy 1922, p. 4.
- Loi sur les cadres du 24 juillet 1909.
- AFGG 1936, tome 1, volume 1, p. 519 et 529.
- Journal des marches et opérations du 32e RAC, du 12 août 1914 au 25 juillet 1915, « SHD, cote 26 N, carton 963, dossier 1 » [archive], sur www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr.
- AFGG 1936, tome 1, volume 1, p. 538-585.
- AFGG 1936, tome 1, volume 1, p. 532.
- AFGG 1936, tome 1, volume 1, p. 538.
- AFGG 1936, tome 1, volume 1, p. 526.
- François 2010, p. 6-8.
- Maitre 1920, p. 3.
- Ministère de la Guerre, Décret du 28 octobre 1913, portant règlement sur la conduite des grandes unités (service des armées en campagne), Paris, Berger-Levrault, , 63 p., article 125, lire en ligne [archive] sur Gallica.
- Règlement provisoire de manœuvre de l'artillerie de campagne, Annexe III au titre IV, approuvée par le ministre de la guerre le 18 janvier 1912 : Emploi des aéroplanes dans le tir de l'artillerie de campagne (règlement commun à l'aviation et à l'artillerie), , 17 p., in-16 (BNF 43643792), lire en ligne [archive] sur Gallica.
- Règlement de 1913 sur la conduite des grandes unités, p. 176.
- Règlement de 1913 sur la conduite des grandes unités, p. 179.
- Règlement de 1913 sur la conduite des grandes unités, p. 183.
- Règlement de 1913 sur la conduite des grandes unités, p. 186-188.
- [PDF] « Composition des unités de l'armée française » [archive], sur www.pages14-18.com.
- Jean-Claude Laparra, La machine à vaincre, de l'espoir à la désillusion : histoire de l'armée allemande, 1914-1918, Saint-Cloud, 14-18 éditions, , 323 p. (ISBN 2-9519539-8-4), p. 50.
- Laparra 2006, p. 73-74.
- « Base de données des canons survivants : Allemagne » [archive], sur www.passioncompassion1418.com.
- 2e bureau de l'état-major, Artillerie allemande : les projectiles, Paris, Imprimerie nationale, .
- Laparra 2006, p. 75-76.
- Olivier Cosson, Préparer la Grande Guerre : l'armée française et la guerre russo-japonaise (1899-1914), Paris, Les Indes savantes, , 379 p. (ISBN 978-2-84654-330-9), p. 119-128 et 268-269.
- François 2010, p. 7-8.
- AFGG 1936, tome 1, volume 1, p. 527.
- « JMO du 4e RAC du 1er août au 29 septembre 1914 » [archive], sur www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr (SHD, cote 26 N 909/1, p. 34-35).
- « JMO du 39e RAC du 31 juillet au 31 décembre 1914 » [archive], sur www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr (SHD, cote 26 N 975/1, p. 13-15).
- Situation du 20e C.A. vers 9 h 30, 21 août, le 21 août 1914 à 13 h, cité dans AFGG 1922, volume 1, tome 1, annexe no 790, p. 672-673.
- « Le fort de Manonviller ou fort Haxo » [archive], sur fortiffsere.fr.
- AFGG 1925, tome 1, volume 2, p. 427.
- AFGG 1925, tome 1, volume 2, p. 430-432.
- Laparra 2006, p. 77.
- AFGG 1925, tome 1, volume 2, p. 425-426.
- Compte rendu des opérations du 20 août 1914, le 21 août à 5 h 30, cité dans AFGG 1922, volume 1, tome 1, annexe no 791, p. 673-674.
- Minute d'une instruction générale à la 3e armée, le 23 août à 9 h 30, cité dans AFGG 1922, volume 1, tome 1, annexe no 1088, p. 865.
- Jean-Claude Delhez, Le jour de deuil de l'armée française, t. 2, Thonne-la-Long, Delhez, , 656 p., p. 473-480.
- Jean-Claude Delhez, La bataille des Frontières : Joffre attaque au centre 22-26 août 1914, Paris, Economica, coll. « Campagnes & stratégies » (no 106), , 198 p. (ISBN 978-2-7178-6588-2), p. 159-160.
- Goya 2014, p. 186.
- Journal de marche du 5e régiment d'artillerie, 5 août - 10 septembre 1914, « SHD, cote 26 N 913/1, p. 15 » [archive], sur www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr.
- Leroy 1922, p. 8.
- AFGG 1930, tome 2, p. 52.
- AFGG 1930, tome 2, p. 9-10.
- AFGG 1930, tome 2, p. 53.
- AFGG 1930, tome 2, p. 55-56 et 64.
- AFGG 1933, tome 1, volume 4, p. 393-394.
- AFGG 1933, tome 1, volume 4, p. 391.
- AFGG 1930, tome 2, p. 11.
- Note du général en chef aux armées, no 7413 du , AFGG 1933, tome 1, volume 4, p. 394-395.
- AFGG 1933, tome 1, volume 4, p. 486-487.
- AFGG 1933, tome 1, volume 4, annexe no 1495, p. 300-301.
- AFGG 1933, tome 1, volume 4, p. 555.
- AFGG 1930, tome 2, p. 56.
- AFGG 1931, tome 2, annexe 942, p. 276-277.
- AFGG 1930, tome 2, p. 68-69.
- AFGG 1930, tome 2, p. 391.
- AFGG 1930, tome 2, p. 392.
- Patrick Renoult, « Les munitions de l'artillerie française de la Grande Guerre », dans Un milliard d'obus, des millions d'hommes, p. 102-103.
- AFGG 1937, tome 11, p. 204.
- Théophile Schlœsing, Le "75" : le canon, le tir, les projectiles, Paris et Nancy, Berger-Levrault, coll. « Pages d'histoire » (no 32), , 39 p., p. 37-38, lire en ligne [archive] sur Gallica.
- « Des canons ! Des munitions ! » [archive], sur www.histoiredefrance-chansons.com.
- Bertrand Dicale et le Chœur de Radio France, « "Des canons ! Des munitions !" » [archive], sur www.francetvinfo.fr, .
- Touzin et Vauvillier 2009, p. 22-23.
- Ministère de la Guerre, Décret du 7 octobre 1909, portant règlement sur le service de place, Paris, L. Fournier, , 172 p., p. 62-63, lire en ligne [archive] sur Gallica.
- AFGG 1930, tome 2, p. 45-46.
- AFGG 1933, tome 1, volume 4, p. 395.
- Demande de Joffre au ministre du 14 octobre 1914 et réponse du 24, AFGG 1931, tome 2, annexe no 66 et 68, p. 46-48 et 49-51.
- AFGG 1931, tome 2, p. 268-269, annexe 213.
- AFGG 1930, tome 2, p. 203-204.
- Touzin et Vauvillier 2009, p. 53.
- Touzin et Vauvillier 2009, p. 25, 28, 34.
- AFGG 1937, tome 11, p. 1008-1009 et 1077-1078.
- Touzin et Vauvillier 2009, p. 22.
- AFGG 1937, tome 11, p. 71.
- AFGG 1930, tome 2, p. 393.
- Touzin et Vauvillier 2009, p. 42.
- Catalogue des matériels d'artillerie mis en service sur les fronts alliés en 1914-1917, Paris, Schneider et Compagnie, , 241 p. (lire en ligne [archive]).
- AFGG 1937, tome 11, p. 72.
- AFGG 1936, tome 1, volume 1, p. 523.
- Touzin et Vauvillier 2009, p. 28.
- Touzin et Vauvillier 2009, p. 44-45 et 50-51.
- Touzin et Vauvillier 2009, p. 52.
- Touzin et Vauvillier 2009, p. 54-55.
- Touzin et Vauvillier 2009, p. 47-48, 52, 54-55, 58, 60-61.
- François 2008, p. 10 et 12.
- François 2008, p. 13 et 21.
- Leroy 1922, p. 15
- François 2010, p. 8, 19 et 22.
- François 2010, p. 16.
- François 2010, p. 18.
- Règlement de manœuvre de l'artillerie : titre V7, description et entretien des matériels sur affût-truc à glissement à deux bogies et de leurs munitions, Paris, ministère de la Guerre, Imprimerie nationale, , 112 p., p. 2 et 50, lire en ligne [archive] sur Gallica.
- « Le matériel de l’ALVF » [archive], sur basart.artillerie.asso.fr.
- AFGG 1937, tome 11, p. 1008-1009 et 1078.
- François 2008, p. 20.
- Laparra 2006, p. 103.
- François 2010, p. 35-36.
- François 2010, p. 37.
- François 2010, p. 40-52.
- Louis Guiral, « Je les grignote... » : Champagne, 1914-1915, Paris, Édition Le Livre d'histoire, coll. « Des faits et des hommes », (1re éd. 1965), 210 p. (ISBN 978-2-7586-0232-3), p. 130.
- AFGG 1937, tome 11, p. 1006-1007, 1088-1089.
- « Quelques fusées françaises » [archive], sur www.passioncompassion1418.com.
- AFGG 1937, tome 11, p. 61.
- AFGG 1937, tome 11, p. 203-204.
- AFGG 1930, tome 2, p. 700.
- Patrick Renoult, « Les munitions de l'artillerie française de la Grande Guerre », dans Un milliard d'obus, des millions d'hommes, p. 111.
- Patrice Delhomme, « La guerre des gaz de 1915-1918 », 14-18, le magazine de la Grande Guerre, Boulogne, SOTECA, no 38, , p. 52-53 (ISSN 1627-6612).
- Thierry Simon, « L'artillerie au service de la guerre des gaz », dans Un milliard, p. 134-137, reprenant les chiffres de (en) Augustin Mitchell Prentiss, Chemical in War : A treatise on chemical warfare, Londres, McGraw-Hill publishing co., , 739 p. (lire en ligne [archive]).
- Alexandre Millerand, La guerre libératrice, Paris, A. Colin, , 160 p. (BNF 30947887), p. 53.
- Véronique Goloubinoff, « Modernisations industrielles et fabrications traditionnelles dans la Grande Guerre à travers la photographie et le cinéma militaires », In Situ, no 23 , (lire en ligne [archive]).
- Patrick Renoult, « Les munitions de l'artillerie française de la Grande Guerre », dans Un milliard d'obus, des millions d'hommes, p. 101.
- Charles Gabel, « Les explosifs pendant la guerre 1914-1918 » [archive] [PDF], sur histoire.ec-lyon.fr, , p. 27-44.
- Gern Hardarch, « La mobilisation industrielle en 1914-1918 », dans Jean-Jacques Becker, Patrick Fridenson et alii, 1914-1918 : l'autre front, Paris, Éditions ouvrières, coll. « Cahiers du mouvement social » (no 2), , 235 p. (ISSN 0338-6252).
- Patrick Renoult, « Les munitions de l'artillerie française de la Grande Guerre », dans Un milliard d'obus, des millions d'hommes, p. 108.
- AFGG 1937, tome 11, p. 199-200.
- AFGG 1937, tome 11, p. 198 et 200.
- AFGG 1937, tome 11, p. 151.
- AFGG 1937, tome 11, p. 201 et « Schéma du parc annexe de Brienne » [archive], sur www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr.
- AFGG 1937, tome 11, p. 952, 1082-1087 et 1139-1140.
- Général J. E. Valluy et Pierre Dufourcq, La première guerre mondiale, t. 2 : de Verdun à Rethondes, Paris, Hachette, , p. 322.
- Johanne Berlemont, « Artilleurs », dans Un milliard d'obus, des millions d'hommes, p. 14.
- Bulletin de renseignement de l'artillerie 1917, no 3, p. 11-12.
- Touzin et Vauvillier 2009, p. 23.
- Touzin et Vauvillier 2009, p. 45-46.
- Edmond Buat et Frédéric Guelton (présentation et annotation), Journal : 1914-1923, Paris, Perrin et le ministère de la Défense, , 1481 p. (ISBN 978-2-262-06503-4, lire en ligne [archive]).
- AFGG 1930, tome 6, annexe no 295, p. 580-587.
- AFGG 1930, tome 6, annexe no 296, p. 580-587.
- « Organisation de l’artillerie pendant la guerre 1914-1918 » [archive], sur basart.artillerie.asso.fr.
- Maitre 1920, p. 8.
- AFGG 1931, tome 2, annexe no 873, p. 160-163.
- Goya 2014, p. 187.
- « Organisation et attributions des groupes de canevas de tir des armées » [archive], sur basart.artillerie.asso.fr.
- AFGG 1931, tome 2, annexe no 87, p. 78.
- AFGG 1931, tome 2, annexe no 99, p. 103.
- AFGG 1931, tome 2, annexe no 866, p. 148-149.
- AFGG 1931, tome 2, annexe no 941, p. 270-276.
- Maitre 1920, p. 17.
- Rémy Porte, Rompre le front ? : novembre 1914 - mars 1918, comment percer les lignes ennemies et retrouver la liberté de manœuvre ?, Saint-Cloud, SOTECA 14/18, , 201 p. (ISBN 979-10-91561-84-6), p. 196.
- Maitre 1920, p. 9.
- Maitre 1920, p. 12.
- Groupe d'armées du centre, Emploi de l'artillerie dans la défensive, Paris, Impr. nationale, , 35 p. (BNF 33409448), lire en ligne [archive] sur Gallica.
- Maitre 1920, p. 14.
- François 2010, p. 22.
- Journal des marches et opérations du 21e régiment d'infanterie coloniale, 25 septembre 1915 - 31 décembre 1916, « SHD, cote 26 N 865/2, p. 33, » [archive], sur www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr.
- Goya 2014, p. 264-265.
- Gilles Aubagnac, « L'émergence de l'artillerie dans la bataille, en 1914 et 1918 », Un milliard d'obus, des millions d'hommes, p. 155.
- Maitre 1920, p. 16-17.
- AFGG 1936, tome 5, vol. 2, p. 1286-1287.
- AFGG 1936, tome 5, vol. 2, p. 943-945.
- AFGG 1936, tome 5, vol. 2, p. 958.
- AFGG 1936, tome 5, vol. 2, p. 1289-1290.
- Bulletin de renseignement de l'artillerie 1917, no 7, p. 33-34.
- Bulletin de renseignement de l'artillerie 1917, no 7, p. 37.
- Instruction sur le tir d'artillerie 1917, p. 149.
- Bulletin de renseignement de l'artillerie 1917, no 7, p. 40.
- Instruction sur le tir d'artillerie 1917, p. 150.
- Touzin et Vauvillier 2009, p. 11.
- Lettre No 1738-D, Service historique de la Défense, Château de Vincennes, dossier 7 N 410
- Touzin et Vauvillier 2009, p. 21.
- Touzin et Vauvillier 2009, p. 46.
- François 2008, p. 38-39 et 43.
- François 2008, p. 55.
- « Automitrailleuses et autocanons » [archive], sur https://www.chars-francais.net/ [archive].
- « Auto-canon Peugeot » photographie de l'agence Meurisse, 1915, lire en ligne [archive] sur Gallica.
- (ru) « Autocanon de 47 mm Renault Пушечный бронеавтомобиль » [archive], sur http://aviarmor.net/ [archive], .
- Général François Lescel, « Naissance de notre armée blindée » [archive], sur http://www.farac.org/ [archive], .
- Henri Ortolan, La Guerre des chars 1916-1918, Paris, Bernard Giovanangeli Éditeur, , 216 p. (ISBN 978-2-286-04901-0), p. 24.
- Jean-Pierre Fouché, « 1916 Les Chars Fouché » [archive], sur www.chars-francais.net, .
- AFGG 1932, tome 5, annexe no 49, p. 88-89.
- « Berry-au-Bac : mémorial des chars d'assaut » [archive], sur www.cheminsdememoire.gouv.fr.
- Stéphane Ferrard, France 1940 : l'armement terrestre, Boulogne, ETAI, , 239 p. (ISBN 2-7268-8380-X), p. 74-75.
- « 1917 Renault FT » [archive], sur www.chars-francais.net.
- Antoine Misner, « Chars » [archive], sur www.chars-francais.net.
- Ferrard 1998, p. 165.
- « http://basart.artillerie.asso.fr/article.php3?id_article=678 » [archive], sur basart.artillerie.asso.fr.
- Ministère de la Guerre, Instruction sur le tir d'artillerie : approuvée par le ministre de la Guerre le 19 novembre 1917, Paris, Impr. nationale, , 236+263, 2 volume in-12, premier fascicule [archive] sur Gallica, ainsi que les « appendices et annexes » [archive].
- Maitre 1920, p. 21.
- Goya 2014, p. 390.
- « Évolution de l'armée de terre durant la Première Guerre mondiale » [archive], sur musee-du-genie-angers.fr, p. 8.
- Instruction provisoire sur le service en campagne de l'artillerie, Limoges, Charles-Lavauzelle et Cie, , 132 p., p. 26, lire en ligne [archive] sur Gallica.
- Ferrard 1998, p. 206.
- Touzin et Vauvillier 2009, p. 65.
- Leroy 1922, p. 20
- « Liste des unités gravée sur le Monument aux Morts de l’Ecole d’Artillerie. » [archive], sur basart.artillerie.asso.fr.
- François 2010, p. 8.
- Leroy 1922, p. 27
- Laparra 2006, p. 152-153.
- Guy François, « Quand les "trophées" témoignent du succès ou de la défaite » [archive], sur pages14-18.mesdiscussions.net.
- Voir le document Convention d'armistice du 11 novembre 1918, disponible sur Wikisource.
- Leroy 1922, p. 33-36.
- 3e bureau et inspection générale de l'artillerie, Instruction provisoire sur le service en campagne de l'artillerie : 15 juin 1919, Paris et Limoges, Charles-Lavauzelle et Cie, , 132 p., lire en ligne [archive] sur Gallica.
- Ferrard 1998, p. 187.
- Ferrard 1998, p. 90, 185 et 201-202.
- Ferrard 1998, p. 208.
- Gilles Aubagnac, « L'artillerie terrestre de la Seconde Guerre mondiale : quelques aspects des grands tournants technologiques et tactiques et leur héritage », Guerres mondiales et conflits contemporains, no 238, , p. 43-59 (www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2010-2-page-43.htm).
- « Les archéologues se penchent sur la Grande Guerre » [archive].
Voir aussi
Bibliographie
Sources contemporaines du conflit
- Colonel Pierre Alvin et commandant Félix André (préf. maréchal Joseph Joffre), Les Canons de la Victoire : 5e édition du Manuel d'artillerie lourde, revue et considérablement augmentée, Paris, Lavauzelle & Cie, (réimpr. 1930), 572 p. (BNF 31719852).
- Capitaine Aublet, « L'artillerie française de 1914 à 1918 », Revue militaire française, t. 33, , p. 356-357.
- Général Louis Baquet, Souvenirs d'un directeur de l'Artillerie, Paris, H. Charles-Lavauzelle, , 187 p., lire en ligne [archive] sur Gallica.
- Louis Baudry de Saunier, Oui !... mais le 75 arrose mieux : le fonctionnement complet du canon de 75, Paris, Publications Omnia, , 62 p. (BNF 31775726).
- Commandant Jules Challeat, Artillerie de campagne : la manœuvre appliquée, Paris, Henri Charles-Lavauzelle, , 248 p., lire en ligne [archive] sur Gallica.
- Général Jules Challéat, L'artillerie de terre en France pendant un siècle : Histoire technique (1916-1919), t. 2, Charles-Lavauzelle et Cie, , 546 p., lire en ligne [archive] sur Gallica.
- Notre 75 : Une merveille du génie français, par un artilleur, Paris, Aristide Quillet, , 53 p. (BNF 33483854).
- Général Gascouin, L'évolution de l'artillerie pendant la guerre, Paris, Flammarion, (BNF 32147547).
- Général Frédéric-Georges Herr, La Guerre des Balkans : quelques enseignements sur l'emploi de l'artillerie, Paris, Berger-Levrault, , 39 p. (BNF 30598676) (Extrait de la Revue de l'artillerie de février 1913).
- Général Frédéric-Georges Herr, L'Artillerie : ce qu'elle a été, ce qu'elle est, ce qu'elle doit être, Paris, Berger-Levrault, , 344 p. (BNF 32241245).
- Inspection Générale de l'Artillerie, Bulletin de renseignement de l'artillerie : décembre 1917, vol. 3, Paris, Grand Quartier Général, Imprimerie nationale, , 114 p., lire en ligne [archive] sur Gallica.
- Inspection Générale de l'Artillerie, Bulletin de renseignement de l'artillerie : mars 1918, vol. 6, Paris, Grand Quartier Général, Imprimerie nationale, , 123 p., lire en ligne [archive] sur Gallica.
- Inspection Générale de l'Artillerie, Bulletin de renseignement de l'artillerie : avril-mai 1918, vol. 7, Paris, Grand Quartier Général, Imprimerie nationale, , 122 p., lire en ligne [archive] sur Gallica.
- Commandant Hippolyte Langlois, L'Artillerie de campagne en liaison avec les autres armes, L. Baudoin, (réimpr. 1908) (BNF 30735715).
- Général Louis Lepelletier, Rapport de la sous-commission d'informations sur les enseignements à retirer de la guerre en matière de munitions d'artillerie, Commission centrale d'Artillerie de l'État-major de l'Armée, , 176 p.
- Capitaine Leroy, Historique et organisation de l'artillerie : l'artillerie française depuis le 2 août 1914, École militaire de l'Artillerie, , 199 p., lire en ligne [archive] sur Gallica.
- Chef d'escadron Jean Lucas, La D.C.A. (défense contre aéronefs), de ses origines au 11 novembre 1918, Paris, Baudinière, , 478 p., lire en ligne [archive] sur Gallica.
- Colonel Maitre, Évolution des idées concernant l'emploi de l'artillerie pendant la Guerre, Paris, Centre d'études tactiques d'artillerie, , 31 p., lire en ligne [archive] sur Gallica.
- (cours à l'École supérieure de guerre) : La leçon d'une guerre [archive] sur Gallica ; problèmes des temps modernes [archive] sur Gallica ; annexes [archive] sur Gallica.
- Ministère de la Guerre, Règlement provisoire de manœuvre de l'artillerie de campagne : approuvé par le ministre de la guerre le 8 septembre 1910 : mis à jour au 1er octobre 1913, Paris, Chapelot, , 202 p., lire en ligne [archive] sur Gallica.
- Ministère de la Guerre, Instruction sur le tir d'artillerie : Premier fascicule, Paris, Imprimerie nationale, , 209 p., lire en ligne [archive] sur Gallica.
- Colonel Louis Maurin, Artillerie lourde sur voie ferrée, Centre d'études tactique d'artillerie, .
- Lieutenant-colonel Émile Rimailho, Artillerie de campagne, Paris, Gauthier-Villars, , 506 p. (BNF 31218192).
- André Tudesq (ill. Louis Comte), Le Canon merveilleux : les mémoires d'un "75", Paris, Éditions et librairie, , 256 p. (BNF 31504037).
Les Armées françaises dans la Grande Guerre
- Service historique de l'état-major des armées, Les Armées françaises dans la Grande Guerre, Paris, Imprimerie nationale, 1922-1939, onze tomes subdivisés en 30 volumes, plus des volumes d'annexes (BNF 41052951) :
- AFGG, t. 1, vol. 1 : Les préliminaires, La bataille des frontières, (1re éd. 1922), 602 p., lire en ligne [archive] sur Gallica ;
- AFGG, t. 1, vol. 1 : annexes, , 1026 p., lire en ligne [archive] sur Gallica ;
- AFGG, t. 1, vol. 2 : La manœuvre en retraite et les préliminaires de la bataille de la Marne, , 842 p., lire en ligne [archive] sur Gallica ;
- AFGG, t. 1, vol. 4 : La bataille de l'Aisne, la course à la mer, la bataille des Flandres, les opérations sur le front stabilisé (14 septembre - 14 novembre 1914), , 568 p., lire en ligne [archive] sur Gallica ;
- AFGG, t. 2 : La stabilisation du front - Les attaques locales (14 novembre 1914 - 1er mai 1915), , 728 p., lire en ligne [archive] sur Gallica ;
- AFGG, t. 2 : annexes premier volume, , 1262 p., lire en ligne [archive] sur Gallica ;
- AFGG, t. 2 : annexes 2e volume, , 1210 p., lire en ligne [archive] sur Gallica ;
- AFGG, t. 5, vol. 1 : annexes, , 840 p., lire en ligne [archive] sur Gallica ;
- AFGG, t. 5, vol. 2 : annexes 2e volume, , lire en ligne [archive] sur Gallica ;
- AFGG, t. 6, vol. 1 : L'hiver 1917-1918 (1er novembre 1917 - 20 mars 1918), , 520 p., lire en ligne [archive] sur Gallica ;
- AFGG, t. 6, vol. 1 : annexes, , 1003 p., lire en ligne [archive] sur Gallica ;
- AFGG, t. 10, vol. 1 : Ordres de bataille des grandes unités : grands quartiers généraux, groupe d'armées, armées, corps d'armée, , 966 p., lire en ligne [archive] sur Gallica ;
- AFGG, t. 10, vol. 2 : Ordres de bataille des grandes unités : divisions d'infanterie, divisions de cavalerie, , 1092 p., lire en ligne [archive] sur Gallica ;
- AFGG, t. 11 : La direction de l'arrière, , 1209 p. (BNF 31642507).
Ouvrages actuels
- lieutenant-colonel Gilles Aubagnac (préf. général Thierry Durand), « Les deux batailles de la Marne : 1914 et 1918 », dans Au son du canon : vingt batailles de l'Artillerie, Lyon, EMCC, , 144 p. (ISBN 978-2-35740-083-2).
- Gilles Aubagnac, Johanne Berlemont, Marjolaine Boutet et al., Un milliard d'obus, des millions d'hommes : l'artillerie en 14/18, Paris, Lienart éditions, , 207 p. (ISBN 978-2-35906-175-8) (expo de 2016 au musée de la Grande Guerre du pays de Meaux).
- Christian Benoît, Le canon de 75 : une gloire centenaire, Vincennes, Service historique de l'Armée de terre, , 80 p. (ISBN 2-86323-102-2).
- Colonel Roger Bonijoly, « L'Artillerie française pendant la Première Guerre mondiale », Bulletin semestriel des Amis du musée de l'Artillerie à Draguignan, no 30, .
- Général R. Bresse, « Histoire de l'artillerie de terre française », CERMA, no Hors-série n° 1, .
- Michel Goya, L'Invention de la guerre moderne : du pantalon rouge au char d'assaut, 1871-1918, Paris, Tallandier, coll. « Texto / le goût de l'histoire », , 479 p. (ISBN 979-10-210-0460-3).
- Général Guy François, Le canon de 75, modèle 1897, Louviers, Ysec, coll. « Armes & véhicules de la Grande guerre », , 31 p. (ISBN 978-2-84673-176-8).
- Pierre Touzin, François Vauvillier et général Guy François, Les Canons de la Victoire 1914-1918, Paris, Histoire et Collections, coll. « Les matériels de l'armée française » (no 3, 4 et 5), 2008-2010, trois tomes :
- op. cit., t. 1 : L'Artillerie de campagne : pièces légères et pièces lourdes, Paris, Histoire et collections, (réimpr. 2008), 65 p. (ISBN 978-2-35250-106-0) ;
- op. cit., t. 2 : L'Artillerie lourde à grande puissance, Paris, Histoire collections, (réimpr. 2015), 66 p. (ISBN 978-2-35250-085-8 et 978-2-35250-408-5) ;
- op. cit., t. 3 : L'Artillerie de côte et l'artillerie de tranchée, , 67 p. (ISBN 978-2-35250-161-9).
Articles connexes
Artillerie à cheval de la Garde impériale

L'histoire des artilleurs à cheval de la Garde commence le lorsque Napoléon Bonaparte, alors à la tête de l'armée d'Italie, crée une section d'artillerie à cheval composée de 30 canonniers à partir de ses compagnies de guides d'escorte1. Satisfait de cette organisation qui allie puissance de feu et mobilité, il réitère l'opération à l’Armée d’Orient, formant cette fois une demi-compagnie de 60 hommes1.
Après le coup d'État du 18 brumaire, Bonaparte crée la Garde des Consuls, qui comprend notamment une compagnie d’artillerie à cheval, qui se distinguera tout particulièrement aux batailles de Montebello et de Marengo1. Les artilleurs à cheval sont portés à la taille d'un escadron, après qu'une seconde compagnie a vu le jour le , incorporant les derniers guides-canonniers de l'Armée d’Orient1.
Le , la Garde impériale est constituée par décret impérial, intégrant l'escadron d'artillerie à cheval2. Ce dernier prend part à la bataille d'Austerlitz le , où il appuie l'attaque de la cavalerie de la Garde avec 16 pièces réparties en deux batteries.
Organisation
Le régiment d'artillerie à cheval de la Garde impériale est créé par décret impérial du , organisé en trois escadrons, deux de vétérans et un de vélites, divisés chacun en deux compagnies de 60 hommes, formant un total théorique de 360 artilleurs2. L'artillerie à cheval de la Garde subira de nombreux changements, dont le passage à 80 hommes de chaque compagnie, et sera remaniée plusieurs fois, notamment en 1808, où le 3e escadron de vélites est incorporé dans le régiment de Jeune Garde d'artillerie à pied de la Garde impériale à sa création, réduisant l'effectif à 320 artilleurs2.
Le , deux nouvelles compagnies sont créées, ce qui sera entériné par décret impérial du . À cette date, le régiment compte 190 pièces d'artillerie, dont l'essentiel se compose de canons de 6 livres pris à l'ennemi au cours des batailles. En 1814, il s'ajoute au régiment une 7e compagnie, constituée à partir de la Garde de Joseph Bonaparte, rentrée en France après la bataille de Vitoria3.
À la suite de l'abdication de l’Empereur, l'artillerie de la Garde est dissoute par ordonnance royale du , et les artilleurs à cheval sont reversés dans les régiments de ligne3.
L'artillerie à cheval de la Garde est reformée en 1815 pendant les Cent-Jours, à quatre compagnies. Elle est définitivement dissoute le , mais l'essentiel des hommes servent à constituer les régiments d’artillerie de la Garde royale nouvellement créés4.
L'unité dispose de son propre chirurgien en la personne du chirurgien-major Therrin, promu officier de la Légion d'honneur le 5.
Campagnes militaires
Campagne de Prusse et de Pologne
Napoléon vérifiant le pointage d'un canon sur le champ de bataille. Autour de lui, les artilleurs à cheval de la Garde impériale se préparent à mettre le feu à l'étoupille. Illustration de
Job.
En 1806 et 1807, les artilleurs à cheval de la Garde participent à la campagne de Prusse et de Pologne.
Lors de la bataille d'Iéna, ils soutiennent l'attaque du maréchal Ney contre les positions prussiennes. Ce dernier, très enthousiaste, se retrouve vite au milieu des lignes ennemies, et le soutien de l'artillerie est décisif lorsque le général prussien Hohenlohe décide de contre-attaquer avec toute sa cavalerie6.
L'artillerie à cheval s'illustre une nouvelle fois à la bataille d'Eylau en pilonnant les Russes, sous le commandement du général Baston de Lariboisière qui est à la tête de l'artillerie de la Garde impériale. Elle soutient toute la journée du le centre de l'armée avec une batterie de 40 pièces de canon7.
Les artilleurs à cheval participent aussi à la bataille de Friedland sous le commandement des généraux Baston de Lariboisière et Sénarmont, le second étant à la tête de toute l'artillerie de la Grande Armée. Alors que la cavalerie du général Latour-Maubourg se met au galop et repousse une charge russe, une batterie de 30 pièces de canon est rapidement et habilement mise en place, faisant de lourdes pertes chez l'ennemi8.
Guerre d'Espagne
L'artillerie à cheval de la Garde impériale prenant position, par
Alphonse Lalauze.
En 1808, Napoléon intervient personnellement en Espagne à la tête de la Grande Armée. Les artilleurs à cheval de la Garde sont du voyage, et concourent à la prise de Madrid le 3 décembre où quatre de leurs officiers sont blessés9. L'unité bivouaque à Chamartin, en périphérie de la capitale. Le lieutenant Bosc peut écrire à sa famille : « les officiers sont logés avec les soldats dans leur quartier. Il n’y a pas le moindre meuble, ni lit, ni chaise, ni banc. Nous couchons sur le carreau. J’aime à peu près autant le bivouac où je suis aujourd'hui qu’un tel logement. Il est inutile de vous dire qu’on n’a pas tous nos aises en Espagne. »9.
Le , un convoi de deux pièces de l'artillerie à cheval de la Garde commandé par Bosc est pris à partie par les Espagnols et doit se replier, non sans avoir laissé sur le terrain trois tués et deux blessés10.
Campagne d'Autriche
L'artillerie à cheval de la Garde à
Wagram, par
Job.
Les deux régiments d'artillerie de la Garde (artilleurs à cheval et artilleurs à pied) sont réunis sous les ordres du général Lauriston pour participer à la campagne d'Autriche de 1809, et notamment à la bataille de Wagram où l'artillerie joue un rôle décisif dans la victoire française11.
Alors que les troupes du maréchal Masséna ont essuyé de lourdes pertes dans la matinée du et ont été contraintes de se replier, les Autrichiens décident de renforcer leurs ailes, et de facto affaiblissent leur centre12. Napoléon décide alors de faire intervenir son artillerie au centre afin de préparer sa contre-offensive, et ordonne au général Lauriston d'y concentrer toutes ses batteries. L'artillerie de la Garde déploie quarante-huit pièces dont vingt-quatre à cheval, et est rejointe peu après par l'artillerie de ligne pour un total de cent pièces sur un front de 1 400 mètres12. Ces efforts conjugués permettent d'ouvrir une brèche dans le centre autrichien et les troupes de Macdonald s'y engouffrent, coupant l'armée autrichienne en deux et forçant l'archiduc Charles-Louis à se replier en Moravie, avec une armée diminuée d'environ 50 000 hommes. L’artillerie française aura tiré au cours de la bataille près de 96 000 coups de canon et utilisé environ 250 000 livres de poudre12.
Campagne de Russie
Artilleur à cheval et vétéran, dessin de Lacoste.
L'artillerie à cheval de la Garde participe également à la campagne de Russie avec le 3e corps de cavalerie du général Grouchy, et s'illustre notamment aux batailles de la Moskowa et de la Bérézina.
Le , le régiment assiste à l'attaque de Chevardino par le général Compans, à la tête de la 5e division du 1er corps de Davout, qui résonne comme un air de fête pour le major Griois : « Un ciel superbe et le soleil couchant qui se reflétait dans les fusils et les sabres ajoutaient à la beauté du spectacle. De ses positions, le reste de l'armée suivait des yeux ces troupes qui marchaient fières d'être appelées les premières à l'honneur de combattre, et les accompagnait de ses acclamations. »13.
Dans la nuit du 6 au , Griois avance ses pièces d'artillerie pour rejoindre le 4e corps d'Eugène de Beauharnais sur le flanc gauche, en vue de la bataille de la Moskowa14. Il a beaucoup de mal à franchir « les ravins escarpés et fangeux qu'il fallait traverser sans guide, tantôt dans l'obscurité la plus profonde, tantôt au milieu de feux de bivouac qui [les] éblouissaient et [leur] faisaient perdre toute direction. »15. L'artillerie a un rôle déterminant pendant la bataille de la Moskowa, où pas moins de 60 000 coups de canons sont tirés par les artilleurs français et alliés selon un bilan officiel dressé par le général Baston de Lariboisière, inspecteur général de l'artillerie de la Grande Armée. En se basant sur 50 000 coups de canons russes, on obtient un chiffre de 3 coups de canon par seconde pour les dix heures de bataille16.
Campagnes d'Allemagne et de France
Les artilleurs à cheval de la Garde prennent encore une part active à la campagne d'Allemagne en 1813 et à celle de France en 1814.
Le , ils participent à la bataille de Montmirail. Le colonel-major Griois décrit l'engagement de son régiment en ces mots : « À quelque distance en avant du bourg, nous rencontrâmes l'avant-garde ennemie. Elle fut soutenue par de nombreuses troupes russes et prussiennes, et bientôt l'affaire devint générale, particulièrement vers la gauche où j'étais avec une partie de l'artillerie »17.
Ils prennent également part à la bataille de Montereau le Notes 1. Vers 7 heures du matin, l'artillerie à cheval se met en route pour Villeneuve-les-Bordes avec le reste de la Garde impériale, où Napoléon doit la rejoindre18. Aux alentours de 16 heures, après une charge de cavalerie des généraux Delort et Pajol, une pièce de gros calibre est installée et a le temps de tirer six coups sur l'ennemi dans la plaine de Saint-Maurice avant qu'il soit hors de portée18. Napoléon pointe lui-même l'une des pièces de deux batteries d'artillerie à cheval en direction de la route de Fossard : les boulets de canon ricochent sur le pavé et font de gros dégâts chez l'ennemi18.
Campagne de Belgique
L'artillerie à cheval de la Garde impériale aux prises avec l'infanterie britannique à
Waterloo.
Aquarelle de
Denis Dighton, 1819. Un officier est visible en avant-plan. Par erreur, l'auteur donne les cavaliers coiffés d'un
colback à visière.
Dissoute sous la Restauration, l'artillerie à cheval de la Garde est reconstituée en 1815 lors des Cent-Jours. Durant cette période, elle combat lors de la campagne de Belgique, à Ligny et Waterloo, sous le commandement des généraux Duchand de Sancey et Desvaux de Saint-Maurice, le second étant à la tête de l'intégralité de l'artillerie de la Garde.
Le , Napoléon observe que la position des Quatre-Bras tant disputée la veille n'est plus tenue que par Lord Uxbridge et l'arrière-garde du duc de Wellington, dont l'armée s'est repliée en direction de Bruxelles. L'Empereur s'y porte au galop avec l'artillerie à cheval de la Garde qu'il fait mettre en batterie pour canonner l'arrière-garde alliée19. Six pièces d'artillerie marchent en première ligne à la poursuite de l'ennemi en retraite, aux côtés de Napoléon, à la tête de cette colonne sur un petit et très léger cheval arabe20. L'Empereur est constamment auprès des pièces, exaltant les artilleurs à cheval de la Garde par sa présence et ses paroles, et plus d'une fois au milieu des boulets de canon et des obus, il leur crie avec un accent de haine : « Tirez ! Tirez ! Ce sont des Anglais ! »21.
Le lendemain, les artilleurs à cheval participent à la bataille de Waterloo. Vers 17h30, Napoléon détache deux batteries qui viennent se placer sur la gauche de la ferme de la Haie Sainte et infligent des pertes sévères à l'ennemi22. Néanmoins, sans appui de cavalerie ni d'infanterie, aucun résultat décisif n'est obtenu de deux heures d'échanges très meurtriers d'obus et de boulets de canon23. Aux alentours de 19h30, l'artillerie à cheval de la Garde participe avec quatre batteries à l'attaque de la Garde impériale sur le plateau du Mont-Saint-Jean. Avant la fin de la bataille, le général Desvaux de Saint-Maurice sera atteint par un boulet et périra sur le coup24,Notes 2.
Après cet ultime fait d'armes, l'unité est dissoute définitivement après l'abdication de Napoléon et le retour des Bourbons4.
L'artillerie à cheval de la Garde canonnant les positions ennemies.
Uniformes et équipement
Note : les descriptions d'uniformes renvoient aux illustrations des galeries.
Troupe et sous-officiers
Grande tenue (Figure 1)
Les artilleurs à cheval de la Garde portent l'habit à la hussarde, avec le dolman et la pelisse, bordée de fourrure noire, « bleu impérial » à brandebourgs écarlates. Le collet du dolman est bleu, liseré de rouge, les parements « en pointe » sont rouges. La ceinture de laine est écarlate avec cordons jaunes. Les boutons sont tous de couleur jaune. La culotte est bleue à nœuds hongrois rouges. Les bottes « à la hongroise » de cavalerie légère sont noires avec ornements rouges25.
La coiffure consiste en un colback noir à cordons et jugulaires surmonté d'un plumet vermillon et d'une cocarde tricolore. Le tout est décoré de raquettes et d'une flamme rouges25.
Les buffleteries sont blanches et la giberne est de couleur noire. Les cavaliers portent également la sabretache bleue avec ornements rouges et aurores, avec en son centre un aigle impérial brodé (en 1811, il sera en cuivre).
Petite tenue et tenue de route
Le petit uniforme des artilleurs à cheval est semblable à celui des chasseurs à cheval de la Garde mais de couleur bleue. L'habit-veste (frac) est à basques longues à retroussis rouges et timbrées de l'aigle impérial. Le revers en pointe et le collet droit sont passepoilés de rouge. Il est porté par-dessus un gilet bleu. Une fourragère rouge est portée sur l'épaule gauche. Pantalons et bottes sont ceux de la grande tenue mais le charivari, renforcé de basanes en cuir noir sur sa face interne depuis l'entre-jambes et avec sous-pieds, est également porté. Un pantalon de nankin peut également être porté en été26. Le bicorne peut être porté avec cette tenue.
La tenue de route est une version sobre de la grande tenue, sans la pelisse - qui peut toutefois être « chaussée » (enfilée par-dessus le dolman) par mauvais temps - et sans le plumet du colback, ou de la petite tenue, portée avec le charivari. Les artilleurs sont dotés de l'ample « manteau à rotonde » de la cavalerie pour le mauvais temps (voir figure 3).
La tenue des sous-officiers ne diffère que très peu de celle de la troupe. On note toutefois des galons de grade dorés au-dessus du parement25. Une fourragère rouge et jaune est portée avec la petite tenue.
Armement
L'armement consiste en un sabre en acier recourbé à la façon de la cavalerie légère avec une garde en cuivre (voir figure 5) et un pistolet de cavalerie An XIII (voir figure 6), les artilleurs étant dépourvus de mousqueton.
Officiers (Figures 2, 3 et 4)
Canonnier à pied et officier d'artillerie à cheval, dessin de Lacoste.
Petite et grande tenue des officiers sont du même style que celles de la troupe mais d'une coupe plus seyante, les officiers de la Garde se faisant régulièrement confectionner leurs uniformes par des tailleurs privés, et d'une allure plus chatoyante. Tous les ornements (cordon et raquettes du colback, brandebourgs, nœuds hongrois et autres passementeries, fourragère de petite tenue) sont de couleur or, de même que les garnitures des bottes. La pelisse est bordée de fourrure blanche. Les sabretaches sont d'un modèle plus brillant que celles de la troupe, rouges à garnitures et galons dorés (voir figures 2 et 8). La banderole de giberne est rouge rehaussée de galons et de garnitures or27.
Les officiers sont généralement armés de sabres de cavalerie légère « de fantaisie », aux gardes ouvragées (voir figure 7) et aux fourreaux richement décorés.
Trompettes (Figure 4)
Comme il est d'usage dans les troupes montées des armées napoléoniennes, les trompettes portent une tenue distincte plus chamarrée que celle des hommes du rang. À l'instar de celles des officiers, grande et petite tenue des trompettes sont de même coupe que celles de la troupe mais de couleur bleu ciel, flamme et plumet de colback, couverture de selle et portemanteau de même. Le colback est blanc et, comme pour les officiers, toutes les garnitures et passementeries du grand uniforme sont dorées. La pelisse est rouge, bordée de fourrure blanche, la sabretache à fond bleu ciel et garnitures dorées28.
Uniformes
-
-
Figure 2 : officier par Tanconville. À l'arrière plan, un postillon du train d'artillerie de la Garde.
-
Figure 3 : officiers artilleurs en tenue de route, illustration de Job. Ils portent le manteau à rotonde et le pantalon charivari de la cavalerie.
-
Figure 4: officier et trompette, dessin de Victor Huen.
Armement et équipement
-
-
Figure 6 : pistolet de cavalerie An XIII.
-
-
Chevaux et harnachement
La selle est composée d'une chabraque blanche et rouge, avec portemanteau bleu à galons rouges25 mais d'autres peintres ou illustrateurs militaires du XIXe siècle, comme Édouard Detaille ou Hippolyte Bellangé, représentent les chevaux recouverts d'une housse ou manteau de selle à la manière des lanciers, bleue, galonnée de rouge et ornée de l'aigle impérial, dans les pointes couvrant l'arrière-train (voir figure 1)Notes 3. Les officiers s'équipaient de chabraques « de fantaisie » en peau de panthère agrémentée d'un galon jaune bordé de rouge et festonnée de rouge, de bleu ou d'or (voir figures 2 et 4). Harnachement, étrivières et rênes sont de cuir noir pour la troupe, cloutés ou rehaussés de pièces de cuivre doré pour les officiers.
Chefs de corps
Louis Doguereau est nommé major à la création du régiment en 1806. Le , Augustin Marie d'Aboville devient major de l'artillerie à cheval de la Garde29. Il se fait remarquer à la bataille de Wagram où son bras droit est emporté par un boulet. En récompense, il est promu général de brigade le , fait baron de l'Empire et on lui confie le commandement de l'école d'artillerie de La Fère29. Six jours plus tard, Jean-Jacques Desvaux de Saint-Maurice est nommé major du régiment24. Le , Charles Pierre Lubin Griois devient major du régiment, fonction qu'il occupe jusqu'à la dissolution de l'artillerie de la Garde le 30.
Pendant les Cent-Jours, Jean-Baptiste Duchand de Sancey est nommé colonel-général du régiment et Jean-Jacques Desvaux de Saint-Maurice à la tête de toute l'artillerie de la Garde. Lors de la bataille de Waterloo, le premier se précipite à portée de fusil avec 6 canons sur un carré écossais, si bien que Napoléon déclare : « Ne dirait-on pas que Duchand déserte ? »31. Le second est atteint par un boulet pendant la bataille et meurt sur le coup24.
Notes et références
Sur les autres projets Wikimedia :
Notes
- Au cours de la bataille, Napoléon pointe lui-même une des pièces de l'artillerie à cheval de la Garde. Alors que plusieurs artilleurs sont tués à ses côtés et que son état-major l'implore de se retirer, l'Empereur répond : « Allons, mes amis, le boulet qui doit me tuer n'est pas encore fondu ! ». Une autre version dit que, alors que Napoléon passait en revue les grenadiers de la Garde pendant la bataille d'Arcis-sur-Aube, un boulet roule devant lui. Poussant son cheval sur l'explosif, celui-ci éclate et Napoléon roule à terre. Se relevant indemne, c'est là qu'il aurait prononcé sa phrase passée à la postérité…
- Gustave de Pontécoulant situe la mort du général Desvaux de Saint-Maurice vers 16 heures (voir de Pontécoulant 1866, p. 301).
- Ce détail est repris par de nombreux uniformologues contemporains : voir liens externes.
Références
- Mané 2014, p. 2.
- Mané 2014, p. 3.
- Mané 2014, p. 4.
- Mané 2014, p. 6.
- Viton de Saint-Allais 1811, p. 69.
- Blin 2003.
- Mullié 1852, t2, p. 173.
- Lievyns, Verdot et Bégat 1844, p. 552.
- Bosc 2011, p. 5.
- Bosc 2011, p. 7.
- Collectif 2009, p. 1.
- Collectif 2009, p. 2.
- Cate 2012, p. 377.
- Cate 2012, p. 386.
- Cate 2012, p. 385.
- Cate 2012, p. 390.
- Boudon 2014, p. 5.
- Bienvenu 1964.
- de Pontécoulant 1866, p. 180.
- de Pontécoulant 1866, p. 185.
- de Pontécoulant 1866, p. 185-186.
- de Pontécoulant 1866, p. 315-316.
- de Pontécoulant 1866, p. 316.
- Lievyns, Verdot et Bégat 1844, p. 177.
- Rousselot 1958, planche 60.
- de Saint-Hilaire 1847, p. 120.
- Rousselot 1980, planche 74.
- Voir l'illustration de Maurice Orange en lien externe.
- Mullié 1852, t1, p. 13.
- Griois 1909.
Annexes
Bibliographie
 : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
- Diégo Mané, Les régiments d’artillerie de la Garde impériale sous le Premier Empire (1804-1815), Lyon, , 11 p. (lire en ligne [archive]).

- Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, [détail de l’édition].

- A. Lievyns, Jean Maurice Verdot et Pierre Bégat, Fastes de la Légion d'honneur : biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre, vol. 3, Bureau de l'administration, [détail de l’édition].

- Charles Pierre Lubin Griois, Mémoires du Général Griois, Paris, Plon-Nourrit, (lire en ligne [archive]).

- Collectif, Petit journal de l'exposition « Napoléon, l'histoire et la légende » : Bicentenaire de Wagram 1809-2009, Draguignan, Musée de l'artillerie, , 8 p. (lire en ligne [archive]).

- Curtis Cate (trad. de l'anglais), La campagne de Russie : 22 juin - 14 décembre 1812, Paris, Tallandier, , 725 p. (ISBN 978-2-84734-928-3, BNF 42663170).

- Émile Marco de Saint-Hilaire, Histoire anecdotique, politique et militaire de la Garde impériale, Paris, E. Penaud, , 712 p. (OCLC 7044648, BNF 31281692) lire en ligne [archive] sur Gallica.

- Gustave de Pontécoulant, Souvenirs militaires. Napoléon à Waterloo, ou précis rectifié de la campagne de 1815, Paris, J. Dumaine, (lire en ligne [archive]).

- Julien Bosc, Lettres du Capitaine Bosc (1807-1809), Compilation, présentation et commentaires par Diégo Mané, d’après des documents communiqués par Jean-Luc Marie, , 13 p. (lire en ligne [archive]).

- Nicolas Viton de Saint-Allais, Histoire générale des ordres de chevalerie, civils et militaires, existant en Europe, , 135 p. (lire en ligne [archive]).

- Jacques-Olivier Boudon, Napoléon et la campagne de France : 1814, , 368 p. (lire en ligne [archive]).

- Arnaud Blin, Iéna : Octobre 1806, Paris, Perrin, , 239 p. (ISBN 978-2-262-01751-4, BNF 38969049).

- Jacques Bienvenu, La Bataille de Montereau, Impr. du Progrès, , 24 p. (lire en ligne [archive]).

- Lucien Rousselot, Artillerie à cheval de la Garde : 1800-1815, .

- Lucien Rousselot, Artillerie à cheval de la Garde : officiers et trompettes : 1800-1815, .

- (en) André Jouineau, The French Imperial Guard : Cavalry and Horse Artillery (1804-1815), vol. 4, Histoire and Collections, , 80 p. (ISBN 978-2-35250-002-5).
Articles connexes
Liens externes
Général
Uniformes
Artillerie navale
Artillerie navale en action :
l'USS Iowa dans un exercice de tir près de Porto Rico.
L'artillerie navale désigne l'artillerie qui est utilisée sur les navires de combat.
L'artillerie désigne les armes collectives ou « lourdes » servant à envoyer, à grande distance, sur l'ennemi ou sur ses positions et ses équipements, divers projectiles de gros calibre : obus, boulet, roquette, missile, pour appuyer ses propres troupes engagées dans une bataille ou un siège.
Origines
L'idée d'utiliser le canon comme une arme navale apparut très tôt en Europe, sûrement dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. On trouve par la suite des références à des canons à main, à vocation anti-personnels, vers 1350. Le combat naval au Moyen Âge, se livre comme un siège sur la terre ferme. Les deux navires s'amarrent l'un à l'autre, puis on combat pour s'emparer du navire ennemi. Les bâtiments de l'époque sont les nefs, ou caraques, pourvues de deux grands châteaux, l'un à la proue, l'autre à la poupe, d'où les archers surplombant les ponts criblent de flèches les assaillants sur les ponts. Comme sur terre, le canon va s'intégrer à ce type de combat, des pièces légères, sortes de grosses arquebuses, vont seconder les archers, permettant de mieux combattre les fantassins cuirassés. Au XVe siècle, ces canons portatifs sont dotés d'un croc qu'on fiche sur la muraille pour tirer, ce qui absorbe une bonne partie du recul redoutable de ces armes. Progressivement, apparaissent aussi des pièces fixes de plus gros calibre, réparties sur les différents ponts et étages des châteaux. Le Christopher anglais possède par exemple vers 1410, trois canons en fer, le Grâce Dieu de 1485 en a vingt et un, et le Mary of the Tower, cinquante-huit.
Les canons de cette époque sont en fer forgé, construits selon une méthode d'assemblage rappelant les tonneaux, des plaques de fer légèrement arrondies sont maintenues ensemble par des anneaux successifs extérieurs. Le chargement s'effectue par la culasse, la chambre étant amovible. Les affûts sont à deux roues, ou sans roues, le canon reposant dans un berceau de bois qui l'enserre. Les qualités balistiques sont très faibles, du fait du manque d'étanchéité des tubes et de la présence de jeux important entre le boulet et la paroi (vent du boulet). Les projectiles sont en fer, voire en pierre, pour les pierriers. De façon extrêmement rapide, les tubes ont tendance à éclater, se révélant ainsi très dangereux pour leurs servants. Les premiers canons construits en bronze par moulage commencent aussi à apparaître. Ils sont plus fiables, car moins soumis à l'éclatement, mais six à sept fois plus chers, du fait du coût du bronze, que leur équivalent en fer1. Les barces, généralement en fonte, étaient autrefois très utilisés sur mer2.
L'époque des galions
Une innovation du brestois Descharge, vers 1500, va permettre une révolution dans le placement de l'artillerie. Le sabord, ce volet de bois qui peut obturer la position de la pièce en dehors du combat, va permettre de placer les canons sur les ponts inférieurs des navires car, jusque-là, le risque d'embarquer de l'eau par grosse mer était trop important.
L'artillerie, étant plus basse sur l'eau, gêne moins la stabilité du navire, ce qui permet d'embarquer des canons plus lourds. Le nombre de canons, qui avait grandement augmenté vers la fin du XVe siècle, va diminuer, mais leur calibre va croître. Le Sovereign anglais, par exemple, qui, à son lancement en 1488, embarquait 141 pièces, va être reconstruit en 1509, avec 69 canons. Mais les calibres et les longueurs de tube augmentent.
Parallèlement, les navires changent aussi, notamment avec l'apparition du galion qui, plus stable et plus manœuvrable, supplante la caraque pour la guerre. Leur artillerie se dispose en outre sur deux ponts, bien que celui inférieur ne soit armé que sur la moitié arrière, car la courbure de la coque le rapproche trop de l'eau vers la proue. Avec l'expérience, les ponts seront construits de façon plus rectiligne, ce qui permettra le placement de canons sur toute la longueur de ce pont. À la fin du XVIe siècle, on voit donc apparaître des navires de guerre avec deux ponts-batteries complets. Les nouvelles tactiques, inaugurées par les Anglais contre l'Invincible Armada, privilégient le tir à distance par des canons de travers. Le but de l'artillerie est moins de tuer l'équipage de l'ennemi, à courte portée, que de désemparer leur navire pour lui faire perdre toute valeur militaire. De nouveaux canons, aux tubes plus longs, chargés par la bouche, commencent à apparaître pour armer les flancs des navires. Le Repulse de 1596 illustre cette tendance ; il porte seulement vingt couleuvrines de 18 livres, vingt demi-couleuvrines de 9 livres et huit fauconneaux de 5 livres 1/4, tous disposés sur un pont de batterie et le pont principal. Ces galions, dérivés améliorés de ceux des Espagnols, donnent naissance aux premiers vaisseaux de ligne.
L'époque des vaisseaux de ligne
Parc d'artillerie navale à Toulon en 1755.
XVIIe siècle
Comme pour l'artillerie terrestre, on va progressivement standardiser les types et les calibres des canons. Les Anglais, au milieu du siècle, n'ont plus que dix modèles de canons : 42, 32, 24, 18, 12, 9, 6, 4, 3 et 1/2 livres.
Les canons d'un même pont sont dotés d'un calibre unique, ce qui tend à simplifier l'approvisionnement des pièces. Les plus gros calibres, donc les plus lourds, sont placés sur le pont inférieur pour nuire le moins possible à la stabilité du navire, puis les ponts supérieurs embarquent des calibres de plus en plus petits. Les pièces disposées pour le tir en chasse et en retraite disparaissent, mais on conserve des sabords où une pièce peut être rapidement mise en batterie. Les navires français, en particulier, ayant à combattre des galères en Méditerranée, gardèrent longtemps cette caractéristique, leur permettant de se défendre, même si l'absence de vent empêchait de manœuvrer.
Le chargement par la culasse disparaît progressivement, malgré l'allongement des pièces. La méthode de construction par assemblage de pièces forgées aussi, les canons sont dorénavant - qu'ils soient en bronze ou en fer - coulés dans un moule, puis la chambre est forée (l'autre solution est de mettre un noyau dans le moule, mais cela fragilise le canon). Les affûts évoluent vers un modèle à quatre petites roues qui va devenir classique pendant plus de deux siècles, sur lequel le canon repose maintenant par l'intermédiaire de ses tourillons. Lors du tir, la pièce recule, ce qui permet de la recharger par la gueule facilement, puis les servants la replacent au sabord grâce à un système de palans pour procéder à un nouveau tir. Le recul est amorti par le poids de la pièce, par la pente transversale du pont et en ultime recours par un gros cordage, appelé « brague », relié de part et d'autre du canon à la muraille du navire.
En 1686, les Français, lors d'une expédition contre Alger, conçoivent un nouveau type de bateau spécifiquement destiné au bombardement des côtes et des fortifications, la galiote à bombe ou bombarde, armée d'un ou de plusieurs mortiers, installés sur une structure directement liée à la charpente de la coque, généralement en avant du grand mât. Ces navires, à l'ossature solidement construite pour supporter les chocs des tirs, sont gréés en ketch. La Royal Navy les imite très rapidement. Dès 1687, elle lance le HMS Salamander, copié sur le modèle français. Par la suite, elle fait évoluer le concept en montant les mortiers en ligne mais sur pivot, ce qui permet de les pointer en azimut et en gréant les navires en phares carrés. Les mortiers fixés en site à environ 45°, réglaient leur portée en dosant la masse de la charge propulsive. Les Britanniques employèrent trois calibres de mortiers 13, 10 et 6 pouces, les Français des 32, 27 et 15 cm. Un mortier de 13 pouces pouvait envoyer une bombe de 200 livres à une distance de 4 200 yards, le temps de vol était d'environ 30 secondes, la fusée préalablement coupée à la bonne longueur mettait le feu à une charge de plus de six livres de poudre, contenue dans le projectile.
XVIIIe siècle
L'armement des navires se standardise. Côté britannique autour des canons de 32, 24, 18, 12, 9 et 4 livres ; côté français les canons de 36, 24, 18, 12, 8, 6 et 4 livres.
Les innovations notables du XVIIIe siècle sont :
- l'installation de platines à silex pour la mise à feu des canons, en remplacement du boutefeu trop imprécis (expérimentées par les Britanniques dès 1745, généralisées dans la Royal Navy à la fin du XVIIIe siècle, peu utilisées par les Français jusqu'à la fin de l'Empire) ;
- l'invention de la caronade, une pièce d'artillerie plus courte et légère qu'un canon, se chargeant trois fois plus rapidement et de gros calibre (68, 42, 32, 24, 18 et 12 livres) mais tirant qu'à faible portée (expérimentée par les Britanniques en 1777, généralisée sur les gaillards à partir de 1779 ; la réponse française a été l'obusier de vaisseau, en bronze, encore plus court, tirant des obus explosifs de 36 livres (adopté en 1787, il sera remplacé par des caronades en fer sous l'Empire à partir de 1806).
Artillerie d'un vaisseau de ligne
Canons du système anglais. Le
calibre 42, essayé sur les plus puissantes unités du
XVIIe siècle, est abandonné en usage naval et utilisé pour la défense des côtes, le 32 devenant le plus gros calibre, employé sur les batteries basses des vaisseaux de
1er,
2e et
3e rangs. Le canon de
9 livres sert de
pièce de chasse. En France, les batteries basses des grands vaisseaux sont armées de pièces de
36 livres, et les calibres 8 et 12 servent pour les pièces de chasse.
Avec le nombre de pièces en augmentation, un navire de guerre représente désormais un lourd investissement pour les États voulant s'équiper de navires puissants.
Voici l'exemple du HMS Victory, le navire amiral de Nelson durant la bataille de Trafalgar (en 1805), qui fut armé en 1778. C'est un vaisseau de ligne qui transporte 104 canons sur trois ponts. Les canons les plus lourds sont placés plus bas pour stabiliser davantage le navire.
Son artillerie navale est composée pour la première batterie de 30 canons de 32 livres. Chacune de ces pièces pèse 3,5 tonnes (2,75 pour le canon lui-même et 0,75 pour son affût en bois). Ils tirent des boulets de 32 livres soit 14,5 kilogrammes. Propulsés par 5 kilogrammes de poudre, ils sortent du canon deux mètres au-dessus de l'eau à une vitesse de 487 mètres par seconde pour atteindre une distance de 1 600 mètres et pénétrer le chêne sur 60 centimètres à bout-portant3.
Deux canons à l'arrière sont prévus pour tirer sur les navires « qui ont pris chasse » c'est-à-dire poursuivant le navire (on les appelle aussi « pièces de retraite » dans ce cas ; les canons tirant sur l'avant étant appelés « pièces de chasse »).
La deuxième batterie est constituée de 30 canons de 24 livres. La troisième batterie, sur le pont principal, comporte 22 canons longs de 12 livres et 8 canons courts de 12 livres. Devant la dunette, sur le pont des gaillards, une batterie plus légère est formée par 12 canons courts de 12 livres et 2 caronades de 68 livres situé sur le pont supérieur à bâbord et à tribord tirant des boulets de 31 kilogrammes.
Canon français de 30 livres long, non gréé.
Pour les navires français, les calibres étaient à la fin du XVIIIe siècle :
- pour un vaisseau de 118 canons (trois-ponts) du 36 livres en première batterie, du 24 en deuxième, du 12 en troisième (remplacé par du 18 livres à partir de l'Impérial), du 8 et des caronades de 36 sur les gaillards ;
- pour un vaisseau de 80 canons (deux-ponts) du 36 livres en première batterie, du 24 en seconde, du 12 et des caronades de 36 sur les gaillards ;
- pour un vaisseau de 74 canons (deux-ponts) du 36 livres en première batterie, du 18 en seconde (deux unités, le Cassard et le Vétéran, sont armées avec du 24), du 8 et des caronades de 36 sur les gaillards ;
- pour un vaisseau de 64 canons (deux-ponts) du 24 livres en première batterie, du 12 en seconde et du 6 sur les gaillards ;
- pour une frégate de 24 du 24 livres dans la batterie et du 8 ou du 12 sur les gaillards ;
- pour une frégate de 18 du 18 livres dans la batterie et du 8 sur les gaillards ;
- pour une frégate de 12 du 12 livres dans la batterie et du 6 sur les gaillards.
En France, en 1838, on uniformisa tous les calibres en un calibre unique : 30 livres avec des canons longs et courts et des caronades. Le canon de 30 long mesure 2,706 m de long pour un poids de 3 100 kg. Le canon de 30 court mesure 2,525 m de long pour un poids de 2 540 kg.
L'armement d'un vaisseau de 120 canons devint alors le suivant :
- 1re batterie : 30 canons de 30 longs ;
- 2e batterie : 30 canons de 30 courts + 4 canons-obusier de 80 (au centre de la batterie) ;
- 3e batterie : 30 canons-obusier de 30 ;
- gaillards : 16 caronades de 30 + 4 canons-obusiers de 30.
Le tir à boulets rouges
Ce système particulier consiste à chauffer dans un four (appelé four à boulets) des boulets en fonte de fer pour les porter au rouge. Le but recherché étant d'incendier le navire frappé par de tels boulets (les navires en question étaient construits en bois). Pour ce faire, le résultat recherché est l'encastrement dans la coque du navire adversaire du dit boulet afin que ce dernier propage efficacement un incendie. Le boulet est d'un calibre spécial, plus petit que le boulet normal pour tenir compte de la dilatation que le chauffage lui apportera.
Le plus grand inconvénient du tir à boulet rouge n'était pas le danger de l'incendie pour le vaisseau même qui usait de ce moyen de destruction : c'était surtout la perte d'un temps précieux, l'intervalle qui séparait deux coups de canon étant généralement avec ce nouveau projectile de six ou huit minutes. On en peut juger par le tableau récapitulatif ci-dessous, extrait d'un mémoire de l'ingénieur Forfait, qui dirigea toutes ces expériences4.
| Calibres | Intervalle entre deux coups de canon | Temps nécessaire pour faire rougir les boulets |
|---|
| pour du 8 |
4 minutes |
20 minutes |
| pour du 12 |
4 1/2 |
24 |
| pour du 18 |
5 |
30 |
| pour du 24 |
6 |
46 |
| pour du 30 |
8 |
50 |
Si ce système de tir est concevable pour des canons installés sur les côtes, il est beaucoup plus risqué de l'utiliser sur un navire. Il faut déjà disposer d'un four et de pouvoir l'alimenter en combustible. Il faut aussi le temps de porter le four à une température suffisante pour chauffer les boulets. Le feu est tellement redouté sur les navires de l'époque que l'extinction des feux de la cuisine fait partie de la procédure normale de branle-bas de combat. Ensuite, le transport du boulet chauffé vers le canon, avec un bateau que la mer ou les évolutions font bouger augmente le risque d'un accident malheureux. Pour ces raisons, rares sont les exemples de navires tirant à boulets rouges.
XIXe siècle
La première innovation du XIXe siècle dans le domaine de l'armement naval est l'installation de fusées à la Congreve à bord de bricks et de cotres de la Royal Navy. Pendant la nuit du 8 au , une flottille commandée par le commodore Edward Owen lance plusieurs centaines de fusées de 32 livres contre le port de Boulogne, qui, bien qu'imprécises, déclenchent nombre d'incendies. L'opération est renouvelée contre Copenhague en 1807 (la ville est incendiée), contre la flotte française lors de la bataille de l'île d'Aix en 1809 et contre Danzig en 1813.
L'artillerie navale va profondément évoluer à compter de 1823. À cette époque, un Français, Henri-Joseph Paixhans invente le concept des « canons-obusiers ». Il s'agit de canons, destinés à remplacer les carronades, tirant des obus explosifs. Jusqu'alors, les seuls projectiles explosifs sont tirés par des mortiers, en tirs courbes. Les canons, à trajectoire tendue, tirent des projectiles pleins. L'idée de Paixhans est de faire tirer des projectiles explosifs en trajectoire tendue.
Son projet est présenté au ministre de la Marine et deux prototypes sont aussitôt commandés aux fonderies d'Indret. Deux séries d'essais ont lieu en janvier et septembre-octobre 1824, en utilisant comme cible le vieux vaisseau le Pacificateur. Ces essais montrent les effets dévastateurs des projectiles explosifs contre les navires à coque en bois.
À partir de 1827, on commence à commander des canons « à la Paixhans » et, à compter de 1835, ces canons sont embarqués à raison de quatre pour les vaisseaux et deux pour les frégates. Toutes les marines vont rapidement adopter ce type de canon qui vont avoir pour conséquence d'imposer la construction de navires cuirassés.
La première application au combat de cette nouvelle artillerie sera le fait des Français lors de la bataille de San Juan de Ulúa en 1838, contre le fort qui défend l'entrée de Vera-Cruz, sur la côte mexicaine et qui devra se rendre. La première utilisation lors d'une bataille navale interviendra quelques années plus tard et sera le fait des Russes à la bataille de Sinope, en 1853 contre une flotte turque qui sera anéantie.
Pour percer ces cuirasses, il va falloir obtenir une puissance plus importante. Pour cela on peut en théorie agir soit sur la vitesse à la bouche du projectile, soit sur sa masse. La première solution n'est pas possible tant que la poudre noire utilisée n'a pas été remplacée par autre chose. On va donc assister à une course au calibre.
La guerre de Sécession
À la veille de ce conflit, l'artillerie navale a encore évolué et atteint des calibres de plusieurs dizaines de livres. Les principales innovations sont dues à Dahlgren et à Robert Parker Parrott.
Dahlgren et un de ses canons
L'augmentation des calibres liées à l'augmentation des charges de poudre conduit à épaissir les tubes en leur donnant un aspect caractéristique de « bouteille de soda ». Une autre méthode prisée consiste à renforcer le tube avec des bandes en acier forgé.
Le système de Parrott sera repris et adapté par les Sudistes (en particulier par John M. Brooke).
Il y a encore très peu de pièces se chargeant par la culasse, principalement pour des raisons de sécurité.
Après la guerre de Sécession
XXe siècle
Intérieur d'une tourelle pendant une séquence de tir de pièces de 300
mm sur un cuirassé français en 1910.
La situation de l'artillerie navale à la veille de la guerre — le cuirassé, capital ship et le retour de la ligne — la révolution du dreadnought.
La Première Guerre mondiale
Les armes
La conduite de tir
L'efficacité de l'artillerie embarquée ne réside pas simplement dans la taille des canons. Il s'agit de viser vite et bien. Pour cela se développe la « conduite de tir », que d'aucuns iront jusqu'à présenter comme une science. (Les exemples seront pris dans la bataille du Jutland).
La conduite de tir est confiée à un officier5. Pour lui assurer la meilleure visibilité, il sera installé en hauteur, parfois dans la mâture6. Une hune blindée doit lui permettre d'observer, à plusieurs dizaines de kilomètres de distance, en dépit de la fumée des canons, des rideaux de fumée, des gerbes des tirs, des cibles se déplaçant à des vitesses de 40 à 50 km/h. Et ces cibles ne sont en général visibles que par leur propre mâture. Au niveau des tourelles, l'adversaire est alors totalement hors de vue.
L'officier de conduite de tir utilise un ou des télémètres pour déterminer les distances. Les Britanniques utilisent des télémètres à coïncidence, les Allemands des télémètres stéréoscopiques. Il semble que ces derniers aient été plus précis. En plus de l'officier, il y a dans la hune de tir plusieurs marins accomplissant chacun une tâche précise. Par exemple, régler continuellement un télémètre, ou recevoir les ordres du commandant.
L'officier de tir est obligé à une telle concentration qu'il ignore même ce qui se passe autour de lui. Ainsi, un Britannique mettra plusieurs heures à se rendre compte que deux des six navires de sa division ont coulé.
Les indications de l'officier de tir sont transmises au poste de calcul, local abrité au fond du navire. Là seront calculés les deux éléments indispensables aux tourelles, l'élévation (pointage en hauteur des canons) et le gisement (pointage en direction des canons). Pour déterminer ces paramètres, sont pris en compte la distance du but, sa route, sa vitesse relative, mais aussi le vent, l'hygrométrie, la durée du trajet des projectiles, la latitude (pour le calcul de la force de Coriolis), voire la qualité des poudres. Rappelons qu'il n'existe pas d'ordinateurs et les calculs sont faits à la main.
Le résultat des calculs est transmis aux tourelles et renvoyé à l'officier de tir pour observation des résultats. Il n'y a pas de télécommande. Dans les tourelles, l'élévation et le gisement calculés par le poste central de calcul sont affichés et leurs indications sont répétées par les marins en manœuvrant les volants de réglage. Rappelons que, dans leur tourelle fermée, les marins ne savent pas sur quoi ils tirent.
Les erreurs de transmission sont inévitables avec une telle procédure. L'officier de tir du Derfflinger racontera ainsi que ses corrections de tir transmises au poste de calcul semblaient sans effet. Il multiplia par deux les données transmises et eut alors la satisfaction de voir les gerbes encadrer son but7.
Le tir est déclenché par l'officier de tir. Il est fréquent que les canons tirent successivement et non ensemble, d'une part pour ménager la structure du navire, d'autre part pour apprécier plus facilement le résultat du tir.
Il y a deux sortes de tir : le « tir de réglage » et le « tir d'efficacité ». Le premier permet de déterminer les bons paramètres de tir. Pour cela, l'officier de tir surveille l'arrivée des obus qu'il vient de lancer. Pour l'aider, des horloges sont réglées sur le temps de vol prévu. Elles sonnent alors, autant pour réveiller l'attention des marins que pour permettre de faire la distinction avec les gerbes des tirs des autres navires8.
En fonction des résultats observés, l'officier de tir va effectuer des « bonds » en gisement et en distance. Quand les gerbes encadreront la cible, il déclenchera le « tir d'efficacité », où tous les canons tireront le plus rapidement possible. Il peut aussi choisir le type d'obus. Les navires de ligne de l'époque emportent des « obus explosifs », qui éclatent au contact, et des « obus de rupture » qui doivent pénétrer le blindage avant d'exploser. L'efficacité de ces derniers décroît avec la portée. Ce sont trois obus de ce type, envoyés par SMS Von der Tann, qui couleront le HMS Indefatigable.
Le nombre de coups au but est faible : 3 %9.
La Seconde Guerre mondiale
Schéma d'une tourelle tritube de 16 pouces (406
mm), l'armement principal de la
classe Iowa.
Les armes
- anti navires (le 280 mm, le 305 mm, le 330 mm, le 340 mm, le 356 mm, le 380 mm, le 406 mm, le 456 mm et le 460 mm),
- contre avions (le 127 mm, le 100 mm, le 90 mm, le 75 mm, le 57 mm, le 40 mm Bofors, le 20 mm Oerlikon).
La conduite de tir
- Le radar,
- La direction de tir (contre navire, contre avion),
- Quelques exemples (Matapan, Savo).
La Guerre froide
La situation au XXIe siècle
Canon de 113
mm du
HMS Cardiff (D108) après un appui-feu durant la
guerre des Malouines avec les douilles des obus tiré sur le pont.
Exemples : France, États-Unis, Russie, Italie.
L'une des pièces d'artillerie navale parmi les plus répandues depuis les années 1970 est l'Otobreda 76 mm.
- Les missions actuellement dévolues à l'artillerie navale :
- Appui-feu des troupes débarquées (conséquences sur les types de canons nécessaires).
- Défense rapprochée (anti-aérien, mer/mer, mer/terre).
Lors de l'opération Harmattan en 2011, la Marine nationale française a eu recours au « tir contre terre » (appui-feu naval) pour la première fois depuis la crise de Suez en 1956. Sur l'ensemble de l'opération, environ 3 300 obus ont été tirés par les frégates françaises à partir de canons de 76 et 100 mm10.
Le futur
Le système d'arme AA
Phalanx de 20
mm
L'artillerie navale devrait toujours disposer d'une place dans l'armement des futurs navires de combat. En premier lieu, certaines missions, comme l'autodéfense à très courte portée ou le traitement de petites cibles, seront toujours remplies de manière plus efficace par le canon. Le prix d'un missile, associé à la quantité transportée, rend aussi attractif le projectile d'artillerie.
Cependant, d'autres missions pourraient requérir une artillerie différente des canons actuels de moyen calibre. C'est le cas de l'appui-feu de troupes débarquées. Cet appui, pour être efficace, suppose une capacité de destruction importante. Il convient aussi d'assurer la protection des navires d'appui contre le feu adverse ; par exemple, en effectuant des tirs hors de portée des armes de l'ennemi.
Ceci ouvre plusieurs voies à la recherche. On donnera deux exemples.
Les canons sans poudre et à projectiles auto-propulsés
Les projectiles auto-guidés, comme le ERGM (Extended Range Guided Munition) existent déjà, comme pour les destroyers de classe Arleigh Burke. Équipés de GPS et d'une centrale inertielle, ces obus ont une précision de 10-20 mètres. Le calibre est du 127 mm.
L'étape suivante consiste à allonger la distance de tir, en passant à un calibre de 155 mm (au lieu du 127 mm) et une vitesse initiale de 4 000 m/s (au lieu de 900 m/s actuelle). Ces nouveaux canons, entièrement automatiques, avec un tube de 14 calibres (9,6 mètres), auraient une cadence de tir de 12 coups par minute et seraient refroidis par eau. C'est le type de canons qui serait prévu pour équiper les destroyers US de classe Zumwalt, dont l'entrée en service est prévue en 2016.
Ce type de canon comprend l'AGS (Advanced Gun System), développé pour l'US Navy et la Royal Navy. Il s'agit de tourelles automatiques monotube, d'un calibre de 155 mm, pouvant tirer des projectiles auto-propulsés comme le LRLAP (Long Range Land Attack Projectile). D'un poids de 102 kg, ces obus devraient atteindre une portée de 180 km11, utilisant un système de correction de trajectoire (CCF, Course Correcting Fuses). Le début de la production industrielle des LRLAP est donné pour 2011.
Les munitions intelligentes coûtent environ dix fois plus cher qu'un obus classique (on annonce 50 000 $ pour un ERGM et 35 000 $ pour un LRLAP). Mais leur prix reste bien en deçà de celui d'un missile.
Le programme ERGM a été abandonné par l'US Navy en 2008, le prix unitaire d'un obus ERGM étant passé de 45 000 à 191 000 dollars entre 1997 et 2006 d'une part et l'ERGM étant moins fiable et plus coûteux que le copperhead d'autre part.
Il existe un programme en cours de développement par L'US Navy avec Alliant Techsystems, le BTERM : Ballistic Trajectory Extended Range Munition.
Les canons électriques et électro-magnétiques
Ces armes n'ont plus grand-chose à voir avec les canons classiques. Leur concept vient des recherches pour l'Initiative de défense stratégique lancé par le président des États-Unis Ronald Reagan dans les années 1980.
Une telle arme offre moyen d'obtenir une vitesse à la bouche supérieure à celle qu'atteint tout obus tiré par une pièce à charge propulsive classique, ce qui augmente l'énergie cinétique du projectile donc sa portée et son pouvoir de pénétration. De surcroît elle rend inutile de transporter des charges propulsives.
Le principe est simple : un courant électrique de très forte intensité passe le long de deux rails parallèles entre lesquels est placé le projectile. Le courant génère un puissant champ magnétique qui propulse le projectile.
Si le principe est simple, la réalisation est compliquée. Il faut d'abord être capable de fournir une intensité de l'ordre du million d'ampères. Les navires actuels sont bien entendu incapables de générer de tels courants. Il faut ensuite être en mesure de dissiper la chaleur produite sous peine d'endommager les rails et le tube. Ceux-ci étant de plus soumis à des forces énormes qui chercheront à les écarter.
Le projectile, d'une vingtaine de kilogrammes, aura, selon les attentes du programme de recherches de l'US Navy, une portée attendue de 320 à 400 km qu'il franchira en moins de 6 minutes avec une précision terminale de 5 mètres12. La parabole qu'il décrit le fait monter à une altitude de l'ordre de 150 km, c'est-à-dire qu'il sort de l'atmosphère terrestre. Dans sa descente, il pourra corriger sa trajectoire pour percuter sa cible et la détruire par sa seule énergie cinétique, sans recours à une charge explosive.
Notes et références
- Jean Peter, L'artillerie et les fonderies de la marine sous Louis XIV, éditions Economica, 1995, p. 28 à 42.
- Nicolas Aubin : Dictionnaire de marine, contenant les termes de la navigation page 400
- Il était extrêmement rare de voir un boulet traverser une muraille de chêne ; en revanche le choc détachait de longues échardes de bois qui voltigeaient et causaient des sérieuses blessures à l'équipage.
- Jurien de La Gravière, « La Dernière Guerre maritime », Revue des Deux Mondes, tome 16, 1846.
- Par exemple, sur le SMS Derfflinger, il s'agira du KorvettenKapitan Georg von Hase, sur HMS Invincible, du capitaine de frégate Hubert E. Dannreuther.
- Ce qui explique la réapparition, sur les navires de ligne, de mâts qui avaient disparu lors du passage à la vapeur.
- Pour illustrer les difficultés rencontrées, il est persuadé de tirer sur HMS Princess Royal alors qu'il tire sur HMS Queen Mary.
- D'autres systèmes sont utilisés. Ainsi les Français utiliseront parfois des colorants. La couleur des gerbes indiquant immédiatement l'origine du tir.
- F-E Brezet, p. 130.
- Elie Tenenbaum, « Entre ciel et terre. Le débat air-sol et les défis de l'appui-feu », Focus stratégique, no 35, février 2012 [1] [archive].
- En juin 2005, un tir d'essai à 59 milles nautiques a été annoncé.
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Bibliographie
 : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
- Ouvrages en français
- Jean Peter, L'artillerie et les fonderies de la marine sous Louis XIV, Paris, Economica, , 212 p. (ISBN 978-2-7178-2885-6, BNF 35846045).

- Jean Peter, Les artilleurs de la Marine sous Louis XIV, Paris, Economica, , 158 p. (ISBN 978-2-7178-2821-4).

- Jean Boudriot, L'artillerie de mer : marine française 1650-1850, Paris, Ancre, coll. « Archéologie navale française », , 198 p. (ISBN 978-2-903179-12-0) (recueil de textes extraits pour la plupart de la revue Neptunia).
- Ouvrages en anglais
- (en) Norman Friedman, A.D. III Baker et W.J. Jurens, Naval Firepower, battleship guns and gunnery in the dreadnought era, US Naval Institute Press, , 319 p. (ISBN 978-1-59114-555-4).

- (en) Peter Hodges, The big gun, Battleship main armament 1860-1945, Conway Maritime Press, .

- Articles
- Jean Boudriot, « L'artillerie de mer : munitions et dispositions de combat », Neptunia, no 93, année 1969
- Jean Boudriot, « L'artillerie de mer : les obusiers », Neptunia, no 94, année 1969
- Jean Boudriot, « L'artillerie de mer : les caronades », Neptunia, no 95, année 1969
- Jean Boudriot, « L’artillerie de mer : Les canons obusiers », Neptunia, no 96, année 1969
- Jean Boudriot, « L’artillerie de mer : Les mortiers », Neptunia, no 97, année 1970
- Jean Boudriot, « L’artillerie de mer : Les navires porte-mortiers », Neptunia, no 98, année 1970
- Jean Boudriot, « L’artillerie de mer : Les navires porte-mortiers autres que la galiote », Neptunia, no 99, année 1970
- Jean Boudriot, « L’artillerie de mer : La petite artillerie des hunes, des bastingages et des embarcations », Neptunia, no 100, année 1970
- Jean Boudriot, « La caronade dans la marine française », Neptunia, no 185, année 1992
Article connexe
Lien externe
Artillerie de campagne durant la guerre de Sécession
L'artillerie de campagne durant la guerre de Sécession couvre le domaine des pièces d'artillerie, de leurs équipements, de leur mise en œuvre et des tactiques utilisées durant la Guerre de Sécession. L'artillerie de campagne est entendue comme celle ayant pour objet de soutenir l'infanterie et la cavalerie sur le champ de bataille. Cet article ne couvre pas le domaine de l'artillerie de siège, l'artillerie statique placée dans des fortifications, ni l'artillerie côtière. Elle ne comprend pas non plus les armes de petit calibre, artillerie spécialisée, que l'on retrouvera dans les articles sur les armes de l'infanterie.
Les armes
Les principales pièces d'artillerie utilisées sur le terrain sont listées dans le tableau ci-après.
Démonstrations de l'utilisation de canons rayés type ordnance au
Springfield Armory, en juin 2010
Pièces d'artillerie de campagne et caractéristiques1
| Nom | Tube | Projectile
(lb) | Charge
(lb) | Vitesse du projectile
(ft/s) | Portée
(yd at 5°) |
|---|
| Matériaux | Calibre (in) | Longueur du tube (in) | Poids (lb) |
|---|
| 6-livres |
bronze |
3.67 |
60 |
884 |
6.1 |
1.25 |
1,439 |
1,523 |
| M1857 12-livres "Napoleon" |
bronze |
4.62 |
66 |
1,227 |
12.3 |
2.50 |
1,440 |
1,619 |
| 12-livres Obusier |
bronze |
4.62 |
53 |
788 |
8.9 |
1.00 |
1,054 |
1,072 |
| 12-livres Mountain Obusier2 |
bronze |
4.62 |
333 |
220 |
8.9 |
0.5 |
--- |
1,005 |
| 24-livres Obusier |
bronze |
5.82 |
64 |
1,318 |
18.4 |
2.00 |
1,060 |
1,322 |
| 10-livres Parrott rifle |
fer |
2.9
or 3.0 |
74 |
890 |
9.5 |
1.00 |
1,230 |
1,850 |
| 3-inch Ordnance Rifle |
fer
forgé |
3.0 |
69 |
820 |
9.5 |
1.00 |
1,215 |
1,830 |
| 14-livres James Riflenote 1,4. |
bronze |
3.80 |
60 |
875 |
14.0 |
1.25 |
---- |
1,530 |
| 20-livres Parrott rayé |
fer |
3.67 |
84 |
1,750 |
20.0 |
2.00 |
1,250 |
1,900 |
| 12-livres Whitworth rayé à chargement par la culasse |
fer |
2.75 |
104 |
1,092 |
12.0 |
1.75 |
1,500 |
2,800 |
| Les caractères en italiques se rapportent aux obus, non aux boulets. |
|---|
Les pièces d'artillerie utilisées durant la guerre de Sécession peuvent être réparties entre deux catégories : les canons à âme lisse et les canons rayésnote 2. La première catégorie intègre aussi les obusiers.
Canons à âme lisse
Les canons à âme lisse sont ceux dont l'intérieur du tube ne porte pas de rayures. Historiquement, c'est le type de canon le plus ancien. À l'époque de la guerre de Sécession, la métallurgie et autres techniques apparentées avaient suffisamment évolué pour être en mesure de produire de grandes quantités de canons de campagne rayés. Cependant, les canons lisses étaient toujours en usage et en production ; et ce, jusqu'à la fin du conflit. Les canons lisses de l'artillerie de campagne comprenant les canons au sens strict et les obusiers. On peut aussi classer les pièces d'artillerie selon le type de métal utilisé ; on aura alors, d'un côté, les canons en bronze et, de l'autre, les canons en fer, ce dernier étant soit coulé, soit forgé. Il existe aussi des exemples de canons en acier. Enfin, les pièces d'artillerie sont généralement identifiées par leur type (modèle et année de prise en compte par le « Ordnance department »)5.
Les canons à âme lisse sont aussi différenciés par leur calibre, celui-ci étant donné par le poids, en livres, du projectile (boulet plein, en fer) qu'ils tirent. Pour donner un exemple, un canon de campagne de 12 livres tire un boulet de 12 livres dont le diamètre (4,62 pouces (117,348 mm) correspond à celui de l'âme du canon. Selon une tradition remontant au XVIIIe, il était courant de mélanger, au sein d'une même batterie, des canons avec des obusiers. L'organisation prévalant au début du conflit voyait des obusiers de 12 livres entrer dans les batteries alignant des canons de 6 livres ; des obusiers de 24 livres pour celles alignant des 9 ou des 12 livres. L'augmentation rapide du nombre de canons au sein des armées combattantes, l'arrivée en masse des canons rayés ainsi que la polyvalence du canon de 12 livres « Napoleon » ont largement contribué à un renouvellement des modes de mélanges de pièces au sein des batteries.
Canons
Canon modèle 1841 tirant des boulets de 6 livres. C'était le modèle de base lors de la
Guerre contre le Mexique ; obsolète à l'époque de la Guerre de Sécession.
Les canons à âme lisse sont prévus pour tirer des projectiles pleins (boulets) avec une grande vitesse initiale, à tir tendu, en visant des cibles à découvert. D'autres types de projectiles, comme les obus ou les boîtes à mitraille peuvent aussi être tirées par ce type de pièces d'artillerie. Ils ont un tube plus long que celui des obusiers, et utilisent des charges de poudre plus importantes pour obtenir le résultat désiré. Les pièces d'artillerie de campagne existent en différentes tailles, nommées par le poids du boulet, en livres, qu'elles utilisent : 6-livres (diamètre interne du tube de 3.67 inch), 9-livres (4.2 inch), et 12-livres (4.62 inch). En dehors de la remise en service de pièces d'artillerie en fer anciennes, et du fait que les confédérés réalisèrent un certain nombre de canons neufs en fer, la plupart des canons présents sur les champs de bataille étaient en bronze6.
Au début du conflit, les canons de 6 livres utilisés étaient des modèles 1835, 1838, 1839, et 1841. Quelques canons en fer, modèle 1819, furent même remis en service. En 1861, chaque camp alignait plusieurs centaines de ces canons de 6 livres. Mais ses projectiles, considérés comme trop légers, amenèrent à se tourner vers d'autres modèles. En 1863, les 6 livres avaient quasiment disparu des armées nordistes. En revanche, les sudistes continuèrent à les utiliser jusqu'à la fin du conflit7.
Les canons de calibre supérieur, 9 et 12 livres, ont été moins bien représentés. Le canon de 9 livres figurait encore sur les manuels de l'Artillerie et de l'Ordnance en 1861, mais très peu avaient été mis en service après la guerre de 1812. Ils avaient quasiment tous été réformés avant la Guerre contre le Mexique et rares sont les traces les concernant pendant la Guerre de Sécession. Les pièces de campagne de 12 livres sont représentés par une série de modèles similaires aux 6 livres, mais en nombre plus restreint. Au moins une batterie nordiste, le 13e Indiana, mit en service des pièces de 12 dans les premiers temps de la guerre. Le principal reproche fait à ces pièces était leur poids, entravant leur mobilité, imposant des attelages de 8 chevaux là où 6 suffisaient pour des pièces plus légères. Un petit nombre de 12 livres furent rayés au début du conflit, mais plus à titre expérimental, les sources n'indiquent pas que ces pièces soient apparues sur le champ de bataille8.
Le canon à âme lisse le plus populaire était, et de loin, le 12 livres, modèle 1857 dit « Napoléon ». Ce canon était moins lourd que les précédents types de canons de 12 livres. Il pouvait être déplacé avec l'attelage habituel de 6 chevaux, tout en offrant les avantages d'un calibre plus gros que les autres canons. Il est aussi parfois qualifié de canon-obusier, en ce qu'il possédait les caractéristiques des deux types (ce qui est détaillé plus bas dans ce article).
Obusiers
Obusier de 24-livres d'origine autrichienne importé par la Confédération. Son tube est plus court et plus léger que les obusiers de 24-livres fédéraux.
Les obusiers étaient des canons dont le tube était court et destinés au tir oblique d'obus, mais aussi d'obus et de mitraille à une portée inférieure des canons classiques.Si l'artillerie de campagne est plutôt prévue pour tirer sur des cibles à découvert, les obusiers sont plus prévus pour pratique le tir indirect, c'est-à-dire sur des cibles abritées, par le terrain ou des fortifications. Les obusiers avaient cet avantage d'utiliser des charges poudre inférieures à celles utilisées par les canons de même calibre. Les obusiers de campagne, mis en œuvre durant la guerre de Sécession, étaient de 12 livres (4.62 inch bore), 24-livres (5.82 inch bore), et 32-livres (6.41 inch bore). Les obusiers étaient généralement en brouze, sauf pour certaines productions sudistes9.
Associés aux canons de 6 livres dans la période précédant la guerre, les obusiers de 12 livres étaient représentés par des modèles 1841, 1835 et 1838. Grâce à un poids relativement léger et un projectile assez lourd, cet obusier faisait partie des inventaires pour être remplacé par les 12 livres Napoléon. Il subsistera dans les armées confédérées jusqu'à la fin du conflit.
Comme les canons de gros calibre, les obusiers lourds étaient disponibles en quantité limitée au début de la guerre. Les archives sudistes comme nordistes donnent des exemples d'obusiers de 24-livres livrés durant le conflit, et l'on conserve des exemplaires d'obusiers de ce type, autrichiens, importés par les confédérés. Ces obusiers ont trouvé place dans les réserves d'artillerie des différentes armées. Ils céderont place, au fil du temps, aux canons rayés de gros calibre. Le seul obusier de 24-livres répertorié dans l'armée de Virginie du nord faisait partie de la batterie Woolfolk (ultérieurement devenu bataillon alignant 2 batteries de 4 pièces). Si l'on excepte les combats les plus à l'ouest du territoire (c'est-à-dire la batterie Halls à la bataille de Valverde, au Nouveau-Mexique), l'armée fédérale n'a pas utilisé d'obusiers de 24-livres sur le terrain10. Ces obusiers de 24 et 32 livres ont plutôt été utilisés dans des places fortifiées ; une exception est celle de la compagnie « L » du 1er régiment d'artillerie du Connecticut, en 1864 ; elle alignait 2 obusiers de 32 et un de 24 et repousse le 2 juin l'assaut du 22e régiment de Caroline du sud en utilisant des boites à mitraille11.
Moins connu, l'obusier de montagne de 12-livres fut utilisé dans les opérations de l'ouest et, plus tard, dans les guerres indiennes. Cette pièce polyvalente pouvait utiliser soit un affût, pouvant être déplacé par un seul cheval, voire être démontée pour être transportée par des animaux de bât, soit placée sur un affût plus large, déplaçable par deux chevaux12,13. Vestige de la Guerre américano-mexicaine14, plusieurs centaines de ces pièces furent mises en service par les fonderies nordistes durant la guerre, tandis que la fonderie sudiste de Tredegar en produisait 21 de plus15. A la bataille de Glorieta, une batterie nordiste de 4 de ces obusiers se révéla particulièrement efficace16. Pour sa part, Nathan Bedford Forrest eu recours fréquemment à ces obusiers de montagne dans les combats à courte distance qu'il cherchait à provoquer17.
12-livres Napoleon
Le canon lisse de 12 livres, dit "Napoleon", a été le plus populaire des canons utilisés durant la Guerre de Sécession. Il tient son nom de Napoléon III et recevait des louanges pour sa sécurité qu'il offrait aux artilleurs, sa fiabilité et son efficacité, en particulier à courte distance. Dans les manuels d'artillerie de l'époque, il est dénommé canon léger de 12 livres, pour le différencier des autres 12 livres, plus lourds, au tube plus long et rarement déployés sur le champ de bataille18. Arrivé aux USA en 1857note 3, il est le dernier représentant des canons coulés en bronze mis en œuvre par l'armée américaine. Les types utilisés par les nordistes sont reconnaissables à la forme de leur bouche évasée (voir illustrations ci-après). Ceci étant, il était comparativement plus lourd que les autres canons de campagne et plus difficile à déplacer en terrain varié.
Les « Napoléons » fabriqués par les sudistes sont de six types différents et reconnaissables, généralement, à leur bouche droite, non évaséenote 4. Les fonderies de Tredegar, à Richmond), auraient produit 125 « Napoléons » dont 4 subsisteraient actuellement19. Au début de 1863, Robert Lee renvoie aux fonderies de Tredegar la quasi-totalité des canons de 6 livres de l'Armée de Virginie du Nord pour être refondus et transformés en « Napoléons »20. Le cuivre, requis pour obtenir le bronze, devenait difficile à obtenir pour les sudistes, surtout après que les mines de Ducktown (dans la région de Chattanooga) soient tombées aux mains des nordistes, en novembre 1863. La fonte de « Napoléons » de bronze cesse pour les sudistes et, en janvier 1864, Tredegar commence à produire des « Napoléon » de fonte21.
Un artilleur confédéré a écrit : « Nos canons étaient des 12 livres Napoléon en bronze, à âme lisse, mais reconnus comme les meilleurs canons pour tout ce que l'on pouvait avoir à faire sur le terrain. Ils tiraient des boulets, des obus, des boites à balles (grapeshots) ou de la mitraille, et étaient précis jusqu'à 1 milles (1,61 km). On ne les aurait pas échangés contre des Parrott ou un autre type de canon. Ils étaient beaux, parfaits dans leur forme, gracieusement effilée de la bouche à la culasse, sans anses ou ornement de quelque sorte que ce soit. Nous étions fiers d'eux au point de presque les considérer humainsnote 5,22... ».
-
M1857 12-livres "Napoléon"
-
M1857 12-livres "Napoléon"
-
12-livres "Napoléon" Confédéré
-
M1857 12-livres "Napoléon" (1864)
Canons rayés
Le canon de 3 pouces d'ordonnance
Le canon rayé de 3 pouces (76,2 mm) est la pièce d'artillerie la plus largement utilisée pendant le conflit. Imaginé par John Griffen, il était extrêmement robuste, avec un tube fait en fer forgé produit à l'origine par la Phoenix Iron Works (sise à Phoenixville, Pennsylvanie). Rares sont les incidents rapportés concernant le bris ou l'explosion de ce type de tube, à l'inverse des tubes de canons en fonte, largement concernés, eux, par ces problèmes. Les canons rayés offraient une remarquable précision. Lors de la bataille d'Atlanta, un artilleur sudiste écrit : « Le canon rayé de 3 pouces des Yankees était très précis pour toute distance inférieure à un mille. Ils étaient capables de toucher le haut d'un tonnelet de farine plus souvent que le rater, du moins tant que le pointeur gardait son sang-froid. ». La batterie d'artillerie légère du 1er Minnesota reçoit des canons rayés de 3 pouces d'ordonnance le ; ils sont décrits par le 1er lieutenant Henry S. Hurter, dans un courrier qu'il adresse le 11 novembre 1864 à l’Adjudant Général du Minnesota, comme des « 3-pouces « Rodman »note 6 ».
Les confédérés n'étaient en mesure de produire des tubes de canon en fer forgé comme ceux des 3 pouces. Aussi la capture de ce type de pièces nordistes était particulièrement appréciée. Sans atteindre l'efficience de ces canons, différents types de canons de 3 pouces rayés furent fabriqués par les sudistes en bronze ou en fonte. Néanmoins, aucune de ces copies n'offrait la fiabilité de l'original, les copies en fonte ayant tendance à se fendre au niveau de la culasse.
-
Artilleurs du Ft. Riley avec une réplique d'un modèle 1855 de canon de 3 pouces (2012).
-
« 3-inch ordnance rifle » (vu de face)
-
« 3-inch ordnance rifle » (vue arrière)
Les canons rayés type Parrott
Le canon rayé Parrott, inventé par Robert Parker Parrott, est le nom d'une série de canons, du 10-livres au rare 300-livres. Les modèles de 10 et 20 livres furent mis en œuvre dans les deux camps. Le plus petit étant le plus fréquent ; il existait en deux calibres, 2,9 pouces (73,66 mm) et 3,0 pouces (76,2 mm). Les confédérés utilisèrent les deux calibres tout au long du conflit, compliquant l'approvisionnement des batteries avec le bon type de munitions. Jusqu'en 1864, les batteries nordistes n'utilisèrent que le 2,9 pouces (73,66 mm) Parrott, mais ils utilisaient aussi les 3 pouces d'ordonnance. Au premier jour de la bataille de Gettysburg, 3 canons Parrott durent rester silencieux après avoir reçu par erreur des munitions pour 3 pouces. Après cet incident, des plans furent établis pour rectifier tous les 2.9" Parrotts pour les passer au standard 3" ; cette standardisation simplifia l'approvisionnement en munitions et aucun 2.9" Parrotts ne fut plus produit23. Le modèle M1863, au calibre de 3 pouces (76,2 mm), avait des caractéristiques similaires aux modèles antérieurs ; Il est reconnaissable à son tube droit, sans renflement au niveau de la bouche.
Les canons rayés Parrott participèrent à toutes les grandes batailles de la guerre ; l'armée fédérale, à la Première Bataille de Bull Run, en alignait un certain nombre de 10-livres et un unique 30-livres. La production des 20-livres Parrott commence au milieu de l'été 1861 et les premières livraisons n'intervinrent qu'à la fin de l'année.
Les Parrotts étaient fabriqués en mélangeant deux techniques, fer coulé et fer forgé. Le fer coulé donnait la précision au canon, mais était susceptible de se briser. Une large bande de fer était forgée, enroulée autour de la culasse et lui donnant sa silhouette caractéristique. Les Parrott, bien que précis, n'étaient pas regardés comme étant sûrs et évités par de nombreux artilleurs. Le 20-livres était la plus grosse pièce d'artillerie de campagne utilisée pendant la guerre, avec un poids du tube seul de plus de 1 800 livres (816,47 kg). Après la Bataille de Fredericksburg, Henry J. Hunt, chef de l'artillerie de l'armée du Potomac essaya de faire retirer des inventaires de l'armée les pièces de 20-livres Parrott, faisant valoir que son poids excessif obligeait à utiliser des attelages de huit chevaux au lieu des 6 utilisés pour tous les autres types de canon et que la fiabilité de ses obus à longue portée était douteuse.
Les canons rayés type James
Avant même le déclenchement du conflit, le Bureau de l'Artillerie (« ordnance board ») avait recommandé de garnir de rayures les tubes des pièces de campagne de 6 livres, dans le but d'améliorer leur précision. En décembre 1860, le Secrétaire à la Guerre, John B. Floyd, écrivait : « Les résultats des tests effectués avec des canons rayés et leurs projectiles mettent en évidence la supériorité des munitions à expansion type James. Le canon réglementaire de 6 livres, avec un tube rayé (d'un poids de 884 livres) peut tirer un projectile James de 13 livres »24. Les canons de type James furent une solution ponctuelle pour répondre au besoin de canons rayés au début du conflit. Les pièces de 6 livres en bronze pouvaient être adaptées pour que leur tube rayé puisse accepterles projectiles inventés par Charles Tillinghast James. Certains d'entre eux reçurent des rayures à partir de leur calibre initial de 3.67" ; d'autres furent alésés à 3.80" avant de graver les rayures. Cet alésage avait pour but d'éliminer les déformations présentes dues aux tirs déjà effectués25. Les documents de l'époque oublient souvent de faire la différence entre les deux calibres. Cependant les descriptions des pièces avec un calibre de 3.67" sont 6-livres rayé ou 12-livres James rayé ; pour celle de 3.80", le nom est 14-livres James rifle26. Pour ajouter à la confusion, les pièces avec calibre de 3.80" se trouvent sous deux profils (« 6-livres » et « Ordnance »), deux types de fabrication (bronze et fer), trois types de rayures (15, 10, et 7 rayures), et des poids différents24.
En dépit de leur précision reconnue, les canons rayés de type James, en bronze, souffraient de l'usure rapide de leurs rayures. Aussi connurent-ils une perte de faveur. Il n'y a pas trace de canons James produits après 186227. Le nombre de pièces de type James produits n'est pas précisément connu. Pour sa part, le rapport annuel du « Quartermaster General » de l'Ohio, pour 1862, compte 82 pièces de bronze rayées type James(dont 44 notés comme des canons rayés James de 3.80) sur un total de 162 pièces d'artillerie, tous modèles confondus. Les canons hors-normes ou tombés en défaveur furent migrèrent vers le théâtre occidental d'opérations28.
-
12-livres James rifle: Rifled Model 1841 6-livres field gun
-
14-livres James rifle: Ordnance profile (New Model/Model 1861)
-
Obus type James 3.8". Il est présenté sans l'enveloppe en plomb couvrant les cotes et se déformant pour garnir les rayures lors du tir.
Les canons rayés type Whitworth
Les Whitworth, dont les plans ont été établis par Joseph Whitworth et fabriqués au Royaume-Uninote 7, sont des canons peu fréquents durant la guerrenote 8. Il annonce l'artillerie moderne en ce qu'il autorise le chargement par la culasse et par sa précision, même à grande distance. En 1864, une revue technique écrit : « A 1600 yards [1500 m], le canon Whitworth a tiré 10 projectiles avec un écart latéral de seulement 5 pouces (12,7 cm). » Cette précision rendait ce canon précieux pour les tirs de contre-batterie, à l'image des armes des tireurs d'élite, comme pour les tirs au dessus de pièces d'eau. Son rôle comme arme anti-personnel était plus discuté. Son calibre était de 2,75 pouces (69,85 mm). L'âme du tube ne présentait pas les rayures habituelles, mais avait une forme hexagonale hélicoïdale ; le projectile était ogivo-cylindrique, et présentait sur sa longueur des aplatissements pour l'adapter à la forme de l'intérieur du tube. On rapporte que les projectiles Whitworth en vol produisaient un sifflement particulier les faisant reconnaître à coup sûr29.
-
Canon rayé de 12 livres, type Whitworth, à chargement par la culasse.
-
à droite, le système Whitworth (à gauche, système Armstrong) ; fig. 5 montre la forme de l'âme, fig. 8 montre celle d'un projectile.
Les types de canons à Antietam
Le tableau ci-dessous liste les pièces d'artillerie présentes sur le champ de bataille d'Antietam en Septembre 186230. Si les deux adversaires ont employé des canons de 6-livres et des obusiers de 12-livres au début du conflit, ces pièces ont été reconnues comme inférieures au 12-livres Napoleon et sont retirées des armées de l'union sur le théâtre oriental. Cependant, nordistes comme sudistes continuèrent à les utiliser sur le théâtre d'opérations occidental. Certains canons de 6-livres furent reconvertis en canons de type James, de 12 ou 14 livres31. Le poids de l'obusier de 32 livres empêchait de l'employer sur le champ de bataille et l'unique batterie le mettant en œuvre fut rapidement rééquipée en canons rayés de 3 pouces d'ordonnance32. Le canon de 12 livres de type Blakely est aussi rapidement tombé en disgrâce à cause du recul violent qu'il montrait à chaque tir33.
Pièces d'artillerie déployées à la Bataille d'Antietam30
| pièce | nordistes | sudistes |
|---|
| Modèle 1841 6-livres canon de campagne |
0 |
41 |
| Modèle 1841 12-livres obusier |
3 |
44 |
| Modèle 1841 24-livres obusier |
0 |
4 |
| Modèle 1841 32-livres obusier |
6 |
0 |
| Modèle 1857 12-livres Napoleon canon-obusier |
117 |
14 |
| 12-livres James rayé |
10 |
0 |
| 12-livres Dahlgren obusier de marine |
5 |
0 |
| 12-livres Naval obusier |
0 |
2 |
| 3-inch Ordonnance rayé |
81 |
42 |
| 10-livres Parrott rayé |
57 |
43 |
| 20-livres Parrott rayé |
22 |
0 |
| canon Whitworth rayé |
0 |
2 |
| 12-livres canon Blakely rayé |
0 |
7 |
| non identifié |
0 |
42 |
Les munitions
Les munitions d'artillerie sont aussi diverses que variées, en ce qu'elles sont chacune destinée à traiter un type de cible particulier. Une batterie typique, équipée chez les nordistes de 6 canons de 12 livres Napoléon, avait à sa disposition immédiate sur le terrain 288 boulets, 96 obus, 288 obus à balles et 96 boîtes à mitraille34.
Les projectiles pleins
Un projectile plein, comme un boulet, est un projectile qui ne comprend pas de charge explosive. Le boulet est le projectile plein du canon à âme lisse. Pour un canon rayé, le projectile plein est de forme « ogivo-cylindrique ». Il est nommé : « bolt ». Ces deux variétés de projectiles comptent sur leur énergie cinétique pour détruire leur cible. Ils sont particulièrement utiles pour démonter les canons ennemis, détruire les avant-trains et les caissons ainsi que les chariots de transport. Ils étaient aussi efficaces contre les colonnes d'infanterie, la cavalerie en ordre serré, et avec un effet psychologique avéré. En dépit de ses avantages, de nombreux artilleurs préféraient avoir recours aux projectiles explosifs. La précision de ces projectiles était le critère prépondérant. Ils avaient aussi l'inconvénient d'user plus rapidement les tubes des canons que les projectiles explosifs.
En moyenne, les tirs des canons rayés étaient plus précis que ceux des canons lisses. Un boulet rond, de son côté, présentait l'avantage de pouvoir effectuer des tirs par ricochet, allongeant la zone dans laquelle il pouvait faire des dégâts, sur terre ou à la surface de l'eau, alors que les projectiles « ogivo-cylindriques » avaient tendance à s'enfouir dans le sol35.
-
A gauche, boulet pour canon lisse ; à droite, projectile pour canon rayé.
-
Les obus
Un obus est un projectile contenant une charge explosive, destiné à éclater en petits morceaux au milieu de troupes ennemies. Pour les canons lisses, le projectile était appelé « obus sphérique » (« spherical shell »). Les obus avaient une efficacité plus importante que les projectiles pleins contre les troupes abritées ou derrière des retranchements ; ils étaient aussi efficaces contre les constructions en bois, qu'ils pouvaient incendier. En revanche, ils n'étaient que de peu d'effet contre les constructions maçonnées de bonne qualité36. L'une des principales limitations de l'obus résidait dans le petit nombre de fragments qu'il envoyait en explosant, ce nombre étant fonction de sa taille. Une amélioration apparut vers le milieu du conflit, dans le camp sudiste, peut-être sous l'influence de munitions britanniques importées. Elle consistait à créer à l'intérieur des lignes de faiblesse qui augmentaient le nombre de fragments, une douzaine généralement, et de taille similaire, à l'explosion de l'obus. Ce modèle segmenté était assez commun pour les obus sphériques, mais on le retrouve aussi sur certains des obus pour canons rayés37,38.
L'explosion des obus était commandée par une fusée. Pour les obus sphériques, il s'agissait de fusées à retardement. Pour les obus des canons rayés, les fusées étaient des fusées à retardement ou des fusées à percussion. La fiabilité des fusées était un problème ; un obus s'enfonçant dans le sol avant d'exploser n'avait que très peu d'effet sur sa cible. Les obus de gros calibres, comme celui de 32-livres, pouvaient tout de même avoir une efficacité contre les retranchements39.
-
types d'obus pour canon lisse ou rayé.
Les obus à balles (shrapnels)
Les obus à balles (dénommés « spherical case » par les anglo-saxons pour désigner ceux de ces projectiles destinés aux canons à âme lisse, et connus aussi sous le nom de l'inventeur d'un projectile similaire, Henry Shrapnel) étaient des armes anti-personnels. Porteurs d'une charge de poudre inférieure à celle des obus, mais plus effectifs contre des cibles humaines à découvert. Alors que l'obus ne produit qu'un nombre limité de fragments, l'obus à balles est rempli de balles de fer ou de plomb ; il est prévu pour éclater au dessus et en avant de la ligne ennemie, l'arrosant d'une quantité plus importante d'éléments vulnérants, ce qui le rapproche de la boite à mitraille. Avec l'obus à balles, l'efficacité est liée à la vélocité des fragments issus de l'éclatement du projectile40. L'obus à balles, de forme sphérique, du canon de 12-livres Napoléon contenait 78 balles.
La principale limite dans l'usage de ce projectile résidait dans la fusée requise pour son activation. Il fallait correctement estimer la distance pour calibrer la fusée, mais aussi disposer de fusées suffisamment fiables pour que la détonation se produise bien au moment désiré.
-
Shrapnels pour canon lisse et canon rayé
Les boîtes à mitraille
La boîte à mitraille était le plus meurtrier des projectiles d'artillerie, constitué d'un conteneur en métal de faible épaisseur, garni de balles de fusil maintenues dans de la sciure de bois. À la sortie du tube du canon, l'enveloppe se désintégrait, et les balles se dispersaient comme une énorme charge de chevrotines. La portée utile d'une boite à mitraille n'était que de 400 yards (365,76 m), mais pouvait tuer ou blesser des douzaines de fantassins d'une colonne d'attaque. IL était aussi possible aux artilleurs tirer ensemble deux boites à mitraille, à très courte portée, avec la même charge de poudre pour avoir un effet encore plus dévastateur sur l'attaquant.
Les « grapeshots »
Le « Grapeshot », littéralement « projectile en grappe de raisin » est, à l'origine, un projectile de l'artillerie navale destiné à hacher les cordages des navires à voiles ou éliminer les marins se tenant sur le pont du navire visé. C'est un ancêtre, et une variante, de la boite à mitraille. Ce type de projectile n'a pas vraiment de correspondance avec les projectiles utilisés dans l'armée ou la marine française. Il consistait en un nombre plus réduit de projectiles, plus gros que des balles de fusil, réunis ensemble. Il était utilisé surtout quand les canons ne supportaient qu'une quantité limitée de poudre sous peine d'éclater. Quand la résistance des canons fut améliorée, la boîte à mitraille devint le projectile de référence.
Un « grapeshot » utilisé par un canon de 12-livres Napoléon contenait 9 balles, par rapport aux 27 contenues dans une boite à mitraille. A l'époque de la Guerre de Sécession, les « grapeshot » étaient obsolètes et remplacées par les boites à mitraille (canister). Les règlements de l'époque interdisent ce genre de munition pour les usages sur le champ de bataille et en montagne41. Seuls les confédérés utilisèrent parfois de telles munitions.
-
Type de grapeshot (sans son emballage de toile, ni son sabot en bois)
Les équipements
La pièce d'équipement la plus généralement nécessaire à l'artillerie était le cheval.
Une arme hippomobile
Les chevaux étaient indispensables pour déplacer la masse importante du canon et de ses munitions ; en moyenne, un cheval devait tirer une charge de 700 pounds (317.5 kg)42. Chaque canon d'une batterie utilisait deux attelages de 6 chevaux (attelage standard pour l'artillerie de campagne les pièces plus lourdes requéraient des attelages comportant plus de chevaux). L'un des deux attelages était chargé de tirer le canon et son avant-train ; l'autre tirait le caisson attaché lui aussi à un avant-train43. Le grand nombre de chevaux a gérer était un défi pour l'artillerie parce qu'il fallait les nourrir, les entretenir et les remplacer quand ils étaient blessés ou hors d'état de servir. Les chevaux de l'artillerie étaient ceux qui avaient été jugés impropres au service dans la cavalerie44. La durée de service d'un cheval d'artillerie était inférieure à 8 mois44, à cause des maladies, de l'épuisement causé par les marches (typiquement 16 milles (25,75 km) en 10 heures) et, enfin, des blessures sur le champ de bataille.
Les chevaux étaient plus sujets à paniquer que les hommes quand soumis à des tirs de contre-batterie ; leur liberté de mouvements étant limitée par le harnachement qui les maintenaient dans l'attelage. Robert Stiles écrit au sujet d'une batterie sudiste, soumise à un tir de contre-batterie nordiste, à Benner's Hill pendant la Bataille de Gettysburg :
« Quelle scène que celle présentant les canons démontés et hors service, les affûts déchiquetés et écrasés, les coffres à munitions explosés, les avant-trains renversés, les chevaux blessés secouant la tête et jetant des coups de sabot, répandant la cervelle des hommes prisonniers du harnachement ; tandis que les canonniers, le pistolet à la main, circulaient entre les débris, abattant les chevaux agités pour sauver les hommes blessés. »
L'appellation d'Artillerie à cheval désigne des batteries capables de déplacements rapides, telles celles rattachées aux unités de cavalerie. Artillerie volante est un terme synonyme parfois rencontrés. Dans ces types de batteries, tous les artilleurs sont à cheval, par opposition aux batteries classiques qui voient les artilleurs se déplacer à pied (quoique les artilleurs de l'armée régulière pouvaient monter les chevaux des attelages, quand un mouvement rapide était requis, et montaient habituellement sur les avant-trains, les caissons et les chariots pendant les marches, en dépit des règlements)45. Dans l'armée nordiste, l'unité la plus représentative était la U.S. Horse Artillery Brigade.
avant-train (droite) et Caisson
Les avant-trains
Les avant-trains sont des attelages à deux roues, portant un coffre à munitions. A l'aide de six chevaux, ils peuvent tirer une pièce d'artillerie ou un caisson. Dans les deux cas, cela donnait l'équivalent d'un véhicule à quatre roues, répartissant la charge sur deux essieux plus facile à déplacer en terrain varié. Un canon de type Napoléon et son avant-train avaient un poids de 3 865 livres (1 753,13 kg)46.
Les caissons
Le caisson est aussi un véhicule à deux roues. Il transporte deux coffres à munitions. Construits en chêne, les caissons, à pleine charge, pesaient 3 811 livres (1 728,64 kg)46.
Les avant-trains, caissons et affûts des pièces d'artillerie étaient réalisés en chêne. Chaque coffre à munitions renfermait 500 livres (226,8 kg) de munitions ou approvisionnements. En plus de ces attelages, la batterie disposait de chariots de ravitaillement et d'une forge de campagne.
Histoire et organisation
Artillerie nordiste

L'armée nordiste entre dans le conflit avec un grand avantage en termes d'artillerie. Ses capacités de production étaient soutenues par les capacités des lieux de production dans les états nordistes ; elle disposait aussi pour mettre en action son artillerie d'un corps d'officiers professionnels et bien entraînés. Le Brigadier général Henry J. Hunt, commandant l'artillerie de l'Armée du Potomac pendant une partie du conflit, était reconnu comme un officier d'artillerie tout à fait compétent et il avait quelques collègues aussi compétents dans les domaines du tir et de sa pratique comme pour la logistique. Un autre exemple est celui de John Gibbon, auteur de l'influent « Manuel de l'artilleur », publié en 1863 (étant fait remarquer que la réputation de Gibbon tiendra plus à son action en tant que général d'infanterie pendant la guerrenote 9). Peu après le déclenchement des hostilités, le Brigadier General Ripley, Chef dans l'Artillerie, ordonne la conversion des vieux canons lisses en canons rayés et la production de canons Parrott.
L'unité tactique de base pour l'artillerie, dans l'armée fédérale, était la batterie, en théorie équipée de 6 pièces47. Dans la mesure du possible, l'uniformisation était recherchée pour qu'une batterie ne soit équipée que d'un seul type de pièce d'artillerie48, simplifiant entraînement et logistique. Chaque pièce était servie par une équipe de 8 artilleurs avec 4 autres servants chargés plus spécifiquement de s'occuper des chevaux et des matériels. Une batterie est divisée en 3 sections de 2 pièces ; chaque section est commandée par un lieutenant. L'ensemble de la batterie est sous les ordres d'un capitaine. 5 batteries donnent une brigade47, sous les ordres d'un colonel. La brigade est affectée au support d'un corps d'infanterie. Dans l'armée du Potomac, cinq brigades d'artillerie supplémentaires formaient la réserve d'artillerie de l'armée. Dans le but d'assurer la qualité de son artillerie, George McClellan regroupait les batteries par cinq en plaçant une batterie de l'armée régulière à côté de 4 batteries des volontaires afin que celle-là donne l'exemple à celles-ci.
Cette organisation en brigades, soutenue par Hunt, permit l'emploi de masses d'artillerie au service des objectifs de l'ensemble de l'armée, au lieu de la voir dispersée aux quatre coins du champ de bataille. Fantassins et artilleurs pouvaient avoir des vues divergentes sur l'emploi des canons. Un exemple peut être donné en considérant le troisième jour de la bataille de Gettysburg. Lors du bombardement confédéré de « Cemetery Ridge », Hunt eut des difficultés à faire comprendre aux commandants de l’infanterie, comme le général Hancock, qu'il valait mieux économiser les munitions en attente de l'assaut sudiste plutôt que les épuiser dans un duel avec l'artillerie ennemie. Ce choix se révéla judicieux lors de la Charge de Pickett49.
À l'entrée en guerre, l'armée fédérale avait à sa disposition 2 283 pièces d'artillerie. Sur ce nombre, 10% seulement étaient des pièces d'artillerie de campagne. Vers la fin du conflit, l'armée disposait de 3 325 pièces dont 53% étaient des pièces de campagne. Pendant la durée du conflit, l'armée nordiste, selon ses statistiques, a reçu 7 892 pièces d'artillerie, 6 335 295 projectiles d'artillerie, 2 862 177 munitions encartouchéesnote 10, 45 258 tonnes de plomb, ainsi que 13 320 tonnes de poudre50.
Artillerie sudiste
Les sudistes étaient relativement désavantagés face aux nordistes en ce qui concerne la mise en œuvre de l'artillerie. Le nord, industriel, avait, et de loin, des capacités plus importantes pour fabriquer des armes. Le blocus instauré devant les ports sudistes limitait la possibilité de faire venir des armes achetées à l'étranger pour les armées confédérées. Ces dernières devaient se contenter de ce qu'elle avait pu récupérer dans les arsenaux dont elles avaient pu prendre le contrôle, comme celui de Harpers Ferry, ou de ce qu'elle pouvait capturer sur le champ de bataille. Le manque de ressources en métaux, associé au manque de savoir-faire de sa main-d’œuvre dans ces domaines, ont eu pour conséquence une qualité parfois insuffisante des productions. La qualité des munitions était aussi en cause ; par exemple, celle des fusées indispensables pour les obus est souvent soulignée comme étant non satisfaisante, causant des explosions prématurées ou trop tardives. Ceci, couplé avec la compétence initiale des artilleurs nordistes et de leur expérience grandissante au fil du temps, a conduit les forces sudistes à redouter les assauts d'infanterie contre des positions nordistes soutenues par de l'artillerie. Pour un officier sudiste, « La réunion de l'artillerie nordiste et de l'infanterie sudiste aurait donné une armée invincible ». Cette artillerie nordiste eut maints fois l'occasion de malmener l'Armée de Virginie du Nord, en particulier durant les Batailles des sept jours, à Malvern Hill et à Gettysburg.
Avec les déficiences connues de son artillerie, Robert Lee a eu tendance à privilégier les combats dans des environnements comme la Wilderness limitant l'avantage des tirs à longue portée qui favorisaient les nordistes, et privilégiant les combats à courte portée où le grand nombre de pièces d'artillerie à âme lisse de l'Armée de Virginie du nord était plus efficace.
Chez les sudistes, les batteries d'artillerie n'alignaient que 4 pièces, alors que leurs adversaires nordistes avaient des batteries de 6 pièces. Si la théorie confédérée visait à mettre aussi en ligne des batteries de 6 pièces, le nombre de canons disponibles les a obligé à rester à 4 piècesnote 11. Pour les mêmes raisons, si les batteries nordistes étaient relativement homogènes, celles alignées par les sudistes offraient des mélanges de canons de types différents. Les batteries d'artillerie sudistes ont été rattachées aux brigades d'infanterie, au moins pendant la première moitié de la guerre. Une réorganisation de l'artillerie confédérée a amené la création de bataillons d'artillerie, de 3 batteries sur le Théâtre occidental et 4, autant que possible, sur le théâtre oriental. Ces bataillons d'artillerie étaient attachés aux divisions d'infanterie pour leur fournir le support requis. Chaque corps d'armée disposait aussi de sa réserve d'artillerie sous la forme de 2 bataillons d'artillerie. En revanche, il n'y avait pas de réserve d'artillerie au niveau de l'armée. Du fait de cette organisation, le responsable de l'artillerie pour l'Armée de Virginie du Nord de Robert Lee, le brigadier général William N. Pendleton rencontra de grandes difficultés pour masser de l'artillerie et en obtenir le meilleur effet.
Après les batailles des Sept Jours, l'armée de la Virginie du Nord est réorganisée en 2 corps, dirigés respectivement par James Longstreet et « Stonewall » Jackson, Lee rattache à chaque corps deux bataillons d'artillerie à titre de réserve, en plus de la batterie rattachée à chaque brigade d'infanterie. Les officiers désignés pour commander ces bataillons sont tous issus des échelons de commandement de Longstreet ; au grand déplaisir de Jackson qui n'a pu choisir les commandants des bataillons parmi ses propres hommes. Il acceptera cependant le fait sans récriminations officielles.
Artilleries et batailles
Bien que toutes les batailles de la guerre de Sécession aient vu participer l'artillerie, certaines d'entre elles sont plus connues pour l'action importante de ladite artillerie.
Artilleurs réputés de la guerre de Sécession
Moins connus que d'autres officiers, fantassins ou cavaliers, un petit groupe d'hommes montra de réelles compétences dans l'organisation, l'utilisation de l'artillerie et la pratique du tir.
Nordistes
Sudistes
Unités d'artillerie notables de la guerre de Sécession
- Danville Artillery
- Batterie sudiste ayant participé à un grand nombre des batailles, sous Lee, Jackson. En 2003, une troupe de reconstitution historique l'a remis en service.
- Fluvanna Artillery
- Unité d'artillerie sudiste, de 2 batteries, levée en Virginie.
- Washington Artillery
- Levée en 1838, cette batterie rallie la Sécession en 1861. Actuellement[Quand ?], le « 141st Fied Artillery Regiment » maintient sa tradition et est basé en Louisiane.
- Pointe Coupee Artillery
- Unité d'artillerie sudiste, de 3 batteries, levée dans la région de La Nouvelle-Orléans. Elle opère sur le théâtre d'opérations occidental.
Notes et références
Notes
- Cela concerne un obus pour Hotchkiss de 14lb à une élévation de 5 degrés. Hazlettl'unique source primaire : « Abbot's Siege Artillery... » (p. 116). De son côté, Hazlett détermine le calibre et le type en s'appuyant sur la description du texte et le poids de l'obus - en correspondance avec les poids pris en compte des vestiges étudiés de nos jours (voir Dickey pp. 137-139,143-146.). La table de données de Coles', et bien d'autres, basés sur le bouquin de Peterson (1959), donne une charge poudre bien trop faible pour le poids et la distance donnée. Ultérieurement, les 14-livres de type James avec la forme de canons de l'Ordonnance montrent un tube plus long (7.5" de plus à la bouche, soit un accroissement de 13%) ; en conséquence, ils devait offrir une portée de tir plus importante
- Une pièce rayée voit l'intérieur de son tube gravé de rayures hélicoïdales, dont le but est d'imprimer au projectile un mouvement de rotation sur lui-même qui améliore et sa portée et la stabilité de sa trajectoire, augmentant ainsi la précision du tir. À l'origine, tous les canons étaient à âme lisse ; la mise en place de rayures impose aussi une fabrication beaucoup plus précise et son apparition a dépendu de l'évolution des arts métallurgiques. Les canons de Napoléon étaient tous à âme lisse.
- Ce type de canon entre en dotation en 1853 dans l'armée française, sous le nom de « canon-obusier de 12 ».
- Mais sur les 133 canons confédérés survivants de nos jours, 8 présentent une bouche évasée.
- Texte original : « Our guns were 12 pound brass Napoleons, smooth bore, but accounted the best gun for all round field service then made. They fired solid shot, shell, grape and canister, and were accurate at a mile. We would not have exchanged them for Parrott Rifles, or any other style of guns. They were beautiful, perfectly plain, tapering gracefully from muzzle to "reinforce" or "butt," without rings, or ornaments of any kind. We are proud of them and felt towards them almost as if they were human... ».
- Les canons de type Rodman, destinés à l'artillerie de siège ou de défense des côtes, étaient réputés pour leur résistance, due à un procédé de fabrication particulier.
- Le canon Whitworth avait été rejeté par l'armée britannique qui avait donné préférence au système Armstrong.
- Pour donner un exemple, à la bataille de Gettysburg, les nordistes alignent 370 pièces d'artillerie et aucun Whitworth. Les sudistes, 264 et seulement 2 Whitworth (ils sont dans la réserve d'artillerie de 3e corps, Batterie Hunt, Hardaway Artillery, Alabama).
- L'avancement était quasi inexistant dans l'artillerie de l'Union. Un officier d'artillerie désireux de faire carrière devait se tourner vers des commandements de l'infanterie ou de la cavalerie.
- C'est à dire où le projectile et sa charge de poudre sont déjà réunis dans une cartouche unique.
Références
- Cole, p. 298.
- Ripley, p. 367
- Hazlet, p. 136
- Hazlett, pp. 151-152.
- Ripley, pp. 14-15.
- Ripley, pp. 18-29.
- Ripley, pp. 18-19.
- Hazlett, pp. 181-82.
- Ripley, pp. 45-47.
- Masich, p. 88
- Hazlett, pp. 187-92.
- Ripley, pp. 48,49, 199.
- Hazlett, p. 134
- Grizzell, chapter 4
- Hazlett, p.
- Alberts, p. 38
- Grizzell, Chapter 4
- Hazlett, p. 88.
- Hazlett, pp. 100-109.
- Daniel & Gunter, p 12
- Daniel & Gunter, page 15.
- Stephenson, Philip Daingerfield, and Nathaniel Cheairs Hughes. 1998. The Civil War memoir of Philip Daingerfield Stephenson, D.D.: private, Company K, 13th Arkansas Volunteer Infantry and loader, piece no. 4, 5th Company, Washington Artillery, Army of Tennessee, CSA. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
- Hazlett, p. 113.
- Hazlett, Olmstead et Parks 2004, p. 148–150.
- Hazlett, Olmstead et Parks 2004, p. 150.
- Hazlett, Olmstead et Parks 2004, p. 147.
- Hazlett, Olmstead et Parks 2004, p. 157.
- Hazlett, Olmstead et Parks 2004, p. 51.
- Thomas, p. 43.
- Johnson et Anderson 1995, p. 129.
- Johnson et Anderson 1995, p. 22.
- Johnson et Anderson 1995, p. 23.
- Johnson et Anderson 1995, p. 25–26.
- Cole, pp. 109-10.
- Cole, pp. 245-246
- Benton, p. 463
- Ripley, p. 261
- Dickey, p. 486-494
- Benton, p. 463.
- Benton, pp. 465-467
- Benton, p. 81.
- Cole 2002, p. 112.
- Cole 2002, p. 101-102.
- Cole 2002, p. 110.
- Cole 2002, p. 113.
- Cole, p. 103.
- Cole 2002, p. 55.
- Cole 2002, p. 56.
- Cole 2002, p. 43-44.
Bibliographie
Ouvrages généraux
- (en)Benton, James G. Ordnance and Gunnery. Gettysburg, PA: Reprint, Thomas Publications (original 1862.)
- Phillip M. Cole, Civil War Artillery at Gettysburg : Organization, Equipment, Ammunition And Tactics, Cambridge, Mass., Da Capo Press, , 320 p. (ISBN 0-306-81145-6)
- (en) Ripley, Warren. Artillery and Ammunition of the Civil War. 4e éd. Charleston, SC: The Battery Press, 1984. (OCLC 12668104).
- (en)Thomas, Dean S. Cannons: An Introduction to Civil War Artillery. Gettysburg, PA: Thomas Publications, 1985. (ISBN 0-939631-03-2).
- James C. Hazlett, Edwin Olmstead et M. Hume Parks, Field Artillery Weapons of the American Civil War, Urbana, Ill., University of Illinois Press, , 322 p. (ISBN 0-252-07210-3, lire en ligne [archive])
- (en)Nosworthy, Brent. The Bloody Crucible of Courage, Fighting Methods and Combat Experience of the Civil War. New York: Carroll and Graf Publishers, 2003. (ISBN 0-7867-1147-7).
- Glen M. Williford, American Breechloading Mobile Artillery, 1875-1953, Atglen, Pennsylvania, Schiffer Publishing, , 224 p. (ISBN 978-0-7643-5049-8)
Ouvrages spécialisés
- (en) Alberts, Don E., The Battle of Glorieta: Union Victory in the West, College Station, Texas: Texas A&M University Press, 2000.
- (en) Daniel, Larry J., and Gunter, Riley W. Confederate Cannon Foundries., Union City, Tennessee: Pioneer Press, 1977.
- (en) David J. Eicher, The Longest Night: A Military History of the Civil War, New York: Simon & Schuster, 2001. (ISBN 0-684-84944-5).
- (en) Grizzell, Stephen, "Bull Pup: The 1841 Mountain Howitzer."
- Curt Johnson et Richard C. Jr. Anderson, Artillery Hell : The Employment of Artillery at Antietam, College Station, Tex., Texas A&M University Press, (ISBN 0-89096-623-0)
- (en) Masich, Andrew E., Civil War in the Southwest Borderlands, 1861-1867, Norman: University of Oklahoma Press, 2017. (ISBN 978-0-8061-5572-2)
- (en) Pfanz, Harry W., Gettysburg: Culp's Hill and Cemetery Hill, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1993. (ISBN 0-8078-2118-7).
Pour approfondir
- (en) Thomas S Dickey & Peter C George, « Field Artillery Projectiles of the American Civil War », 1980, 1993, Atlanta, Arsenal Press, 552 pages, (ISBN 978-0960902200).
- (en) Gottfried, Bradley M. « The Artillery of Gettysburg ». Nashville, TN: Cumberland House Publishing, 2008. (ISBN 978-1-58182-623-4).
- (en) Tidball, John C. « The Artillery Service in the War of the Rebellion, 1861-65. » Yardly (Pennsylvanie), Westholme Publishing, 2011. (ISBN 978-1-59416-149-0). (OCLC 760901332).
- (en) Wise, Jennings C. « The Long Arm of Lee: The History of the Artillery of the Army of Northern Virginia ». New York: Oxford University Press, 1959. (OCLC 1150741).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
Artillerie de la Garde impériale (Premier Empire)

Canonnier à pied et officier d'artillerie à cheval, dessin de Lacoste.
La Garde consulaire est constituée par Bonaparte par un arrêté du par amalgame de différentes unités chargées de protéger les institutions et corps constitués républicains. C'est un corps « inter-armes » composé d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie — en l'occurrence une compagnie d'artillerie à cheval d'une centaine d'hommes levée parmi les guides auxquels elle est rattachée.
En l'an XII, l'artillerie de la Garde consulaire, placée sous les ordres du général de brigade Nicolas Marie Songis des Courbons, compte un escadron placé sous les ordres du colonel Joseph Christophe Couin, un train sous les ordres du capitaine Edmé Devarenne1 et un parc2,3.
Garde impériale
Par décret daté du 28 floréal an XII (), l'ancienne compagnie d'artillerie à cheval de la Garde consulaire devient le régiment d'artillerie à cheval de la Garde impériale, conservant son caractère inter-armes mais avec des effectifs considérablement augmentés. Couin en reste le commandant de l'artillerie jusqu'à son remplacement en 1807 par Jean Ambroise Baston de Lariboisière.
Artillerie à cheval
Héritière de la compagnie d'artillerie à cheval de la Garde consulaire, le régiment d'artillerie à cheval de la Garde impériale est considéré comme l'élite de l'artillerie napoléonienne et est de toutes les campagnes et batailles des guerres de l'Empire : ainsi, à la bataille de Wagram, l'artillerie à cheval de la Garde subit beaucoup plus de pertes que l’artillerie à pied4. Décimée pendant la désastreuse retraite de Russie, elle est rapidement reconstituée. Enfin, lors de la phase finale de la bataille de Waterloo, ultime grande bataille des guerres napoléoniennes, l'artillerie à cheval participe avec quatre batteries à l'attaque de la Garde impériale sur le plateau du Mont-Saint-Jean.
Artilleur de formation, Napoléon se place lui-même à la tête de ses pièces à plusieurs reprises. Lors de la campagne de France de 1814, il dirige personnellement le tir des batteries lors de la bataille de Montmirail5 puis celle de Montereau6. Le , après la bataille des Quatre Bras, il mène lui-même les batteries à cheval à la poursuite des troupes britanniques se repliant sur Bruxelles7.
Artillerie à pied
Par décret impérial du , quatre compagnies d'artillerie à pied sont incorporés dans l'artillerie de la Garde. Elles sont portées à huit en 1810, à neuf en 1812 et le tout organisé en un régiment. Le , le régiment est défini par Napoléon comme faisant partie de la Vieille Garde.
L'année suivante, on créa un deuxième régiment que l'on attacha à la Jeune Garde.
Le , après la première abdication de Napoléon Ier, l'artillerie à pied de la Garde impériale est licenciée mais le , après le retour de Napoléon Ier, le régiment d'artillerie à pied de la Garde impériale est reconstituée, mais en ne comptant plus que six compagnies.
Il participe à la campagne de Belgique et se trouve aux batailles de Ligny et de Waterloo et le , après la seconde abdication de Napoléon Ier, le régiment est définitivement licencié. Il est remplacé par ordonnances royales des 1er et par le régiment d'artillerie à pied de la Garde royale durant la seconde Restauration.
Pour être admis dans ce corps d'élite, il fallait sortir de l'artillerie de ligne, avoir six ans de service et mesurer 5 pieds 5 pouces (1,76 m)8.
Train
Le train d'artillerie comprenait six compagnies formant un bataillon en 1806. L'effectif passe à huit compagnies en 1812. Pendant les Cent-Jours, le train est réorganisé en un escadron de huit compagnies9.
Équipement
Depuis la fin des années 1770, l'artillerie française est organisée selon le système mis en place par Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval. En 1803, à la suite des travaux d'études réalisés par le « Comité de l'artillerie », qu'il a institué le et présidé par le général François Marie d'Aboville, Napoléon décide de simplifier le système Gribeauval en limitant le nombre de calibres utilisés10.
Artillerie à cheval
En 1815, l'artillerie à cheval aligne quatre compagnies équipées chacune de quatre canons de six livres et de deux obusiers.
Artillerie à pied
Artilleurs à pied servant une pièce de 12 livres.
Commandement
Le , Joseph Christophe Couin est promu général de brigade commandant l'artillerie de la Garde. Le , il passe colonel en second, Jean Ambroise Baston de Lariboisière, fait général de division le même jour par l'Empereur, le remplaçant au commandement du corps. Couin passe le dans la ligne par suite de la suppression de l'emploi de colonel en 2e. Le , Antoine Drouot est désigné par l'Empereur pour prendre le commandement du régiment d'artillerie à pied qu'il réorganise l'année suivante.
En 1811, Jean Barthélemot de Sorbier succède à Lariboisière. En 1813, il est remplacé par Charles François Dulauloy.
Pendant la campagne de Belgique de 1815, l'artillerie de la Garde est placée sous les ordres de Jean-Jacques Desvaux de Saint-Maurice qui est tué pendant la bataille de Waterloo ; l'artillerie à pied sert sous le commandement de Henri Dominique Lallemand et l'artillerie à cheval sous Jean-Baptiste Duchand de Sancey11.
Batailles et pertes en officiers
- : Essling - le chef de bataillon Boulard et 1 officier blessés
- : Wagram - 1 officier tué, 1 officier mortellement blessé et 6 autres blessés - le colonel Drouot et le chef de bataillon Boulard furent blessés
- : combat de Schewardino - 2 officiers blessés
- : Borodino - 1 officier tué, 1 officier mortellement blessé et 8 autres blessés
- 16 et : Krasnoïe - 3 officiers mortellement blessés et 1 autre blessé
- : Bérézina - 2 officiers blessés
- 9 - 10 - : Vilna - 3 officiers mortellement blessés
- : Lützen - 2 officiers tués et 1 autre blessé
- : passage de l'Elbe - le chef de bataillon D'Hautpoul est blessé
- : Dresde - 1 officier blessé
- : Leipzig - 2 officiers tués, 2 officiers mortellement blessés et 2 autres blessés
- : Bar-sur-Aube - 1 officier blessé
- : La Rothière - 1 officier blessé
- : Montmirail - 2 officiers
- : Craonne - 2 officiers blessés
- : prise de Reims - 1 officier blessé
- : Paris - 1 officier mortellement blessé et 4 autres blessés
- : Waterloo - 1 officier tué, 2 officiers mortellement blessés et 5 autres blessés - le chef de bataillon Raoul est blessé12
Notes et références
Notes
Références
- Fiche biographique sur le site Les Amis du Patrimoine Napoléonien [archive].
- L'armée française en 1803-1804 [archive].
- Palasne de Champeaux 1804, p. 8-9.
- Correspondance du Capitaine Julien Bosc (Notes) [archive].
- Boudon 2014, p. 5.
- La bataille de Montereau [archive].
- Gustave de Pontécoulant, « Souvenirs militaires. Napoléon à Waterloo, ou précis rectifié de la campagne de 1815 », Paris, J. Dumaine, 1866, p. 180 et suiv.
- Liliane Funcken et Fred Funcken, L'uniforme et les armes des soldats du Premier Empire - Tome 2 "de la garde impériale aux troupes alliées, suédoises, autrichiennes et russes", Casterman,
- Funcken et Funcken 1969, p. 54.
- L'artillerie de la Grande Armée de Napoléon [archive].
- Lachouque 1972, p. 53.
- (en) Digby Smith, Napoleon's Regiments, Greenhill Books,
Voir aussi
Articles connexes
Bibliographie
- Antoine Julien Pierre Palasne de Champeaux, État militaire de la République française pour l'an douze, (lire en ligne [archive])
- Diégo Mané, Les régiments d’artillerie de la Garde impériale sous le Premier Empire (1804-1815), Lyon, , 11 p. (lire en ligne [archive]).
- Liliane Funcken et Fred Funcken, Les uniformes et les armes des soldats du Premier Empire : de la garde impériale aux troupes alliées, suédoises, autrichiennes et russes, t. 2, Casterman, , 157 p. (ISBN 978-2-203-14306-7)
- Jacques-Olivier Boudon, Napoléon et la campagne de France : 1814, , 368 p. (lire en ligne [archive])
- Cdt Henry Lachouque, Waterloo 1815, Éditions Stock,
Liens externes
Artillerie portée
L'artillerie portée est un type particulier d'artillerie française, apparue pendant la Première Guerre mondiale et également utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle consiste en le transport de pièces d'artillerie sur des camions.
Historique
Première Guerre mondiale
En 1915, l'idée est proposée de monter des canons de 75 mm modèle 1897 sur des camions. En effet, les canons de 75, prévus pour la traction hippomobile, ne peuvent rouler à plus de 8 km/h1. Les camions testés sont des Saurer type B à deux roues motrices puis des Jeffery Quad à quatre roues motrices2.
Le , deux batteries (31e et 32e) sont créées au 13e régiment d'artillerie de campagne. Le , elles sont rejointes par 33e batterie, ces trois batteries formant le Ve groupe du 13e RAC le . Un VIe groupe est créé le . Ces deux groupes forment le 213e régiment d'artillerie de campagne portée, premier de ce type d'unités2.
À partir du , les régiments d'artillerie affectés à l'artillerie de corps d'armée deviennent des régiments d'artillerie portée à trois groupes2. En juin 1918, une 5e division est créée dans la réserve générale d'artillerie avec les 18 régiments d'artillerie portée, qui quittent leur rattachement aux corps d'armée. À la fin de la guerre, 34 régiments sont opérationnels et trois en formation2.
Lors de la guerre, le principal modèle est le Jeffery Quad (et son successeur Nash Quad), ainsi que le Panhard K13 et le Latil TP, renforcés en 1918 par quelques Saurer type B3.
Entre-deux-guerres
Essai d'un tracteur Cletrac H pour la traction d'un canon de 75 au centre d'instruction automobile de
Fontainebleau, 1924.
En 1920, l'Armée française expérimente l'emploi de tracteurs agricoles pour améliorer la mobilité des canons de l'artillerie portée. Ces tracteurs doivent être transportés comme les canons sur le plateau de camions. Pour la traction des canons de 75, une dizaine de tracteurs Cletrac sont livrés en 1921, renforcés par plus d'une centaine d'Ara Alpha Prime à partir de 1923. Le Renault HI est adopté pour la traction des canons de 105 long modèle 1913 et 155 court Schneider. L'Armée recoure également au principe de véhicule primé : elle récompense un modèle de tracteur agricole destiné au marché civil afin de disposer d'une quantité suffisante de tracteurs en cas de réquisition3.
Canon de 75 porté sur un Nash Quad (version amélioré du Jeffery) en 1922.
À partir de 1922, la dotation de camions de l'artillerie portée de 75 est renforcée par des Berliet CBA, plus puissant, recarrossés pour l'emport de canons de 753. À la même date, le camion Pierce-Arrow de 5 t modèle 1918 est adopté pour l'emport du 155 C et le Saurer B pour celui du 105 L4.
Lors de la réorganisation de 1923-1924, les régiments d'artillerie portée sont renumérotés dans la série 300 à 360. Elle est équipée de canons de 75 (série 300 à 340), de 105 L modèle 1913 (série 350) et de 155 C Schneider (série 360)5,4.
Entre 1930 et 1933, les régiments d'artillerie portée de 75 en métropole sont tous transformés en régiments d'artillerie à tracteurs tous-terrains, type Citroën Kégresse, beaucoup plus faciles d'emploi. L'Armée ne compte plus que des régiments d'artillerie lourde portée, à l'exception de quelques canons de 75 portés dans les régiments d'artillerie de région fortifiée et dans les colonies3.
Seconde Guerre mondiale
Dessin d'un
Citroën 32 (de) de réquisition utilisé comme porteur de canon de 75, d'après une photographie de mai 1940.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'artillerie portée est considérée comme dépassée mais reste en service jusqu'à usure complète de ses matériels4. Une vingtaine de régiments d'artillerie portée sont recréés à la mobilisation3. Équipés de matériels anciens datant souvent de la guerre précédente, les RAP sont complétés par la réquisition de tracteurs agricoles d'origines diverses. Des camions civils sont également modifiés pour emporter des canons ou des tracteurs agricoles sur leur plateau6.
Elle reste également en service dans les colonies, à l'image du canon utilisé lors de la bataille de Koufra par la colonne Leclerc. L'Armée commande 80 Renault AGR 2 porte-canons et porte-tracteurs pour renforcer l'artillerie portée en outre-mer et peut-être également en métropole6.
Conscient que l'artillerie portée est dépassée, à cause du temps de mise en batterie des pièces, le commandement militaire lance la transformation des régiments d'artillerie portée en régiments d'artillerie tractée. Les nouveaux tracteurs sont pour partie des tracteurs tous-terrains semi-chenillés (type Unic P107) mais également des camions routiers importés, type Fiat SPA 38 et Studebaker K 256.
La transformation n'étant pas complète en mai 1940, les régiments d'artillerie portée participent néanmoins à la bataille de France. Un régiment comme le 304e RAP parvient à rester apte au combat jusqu'à la mi-juin alors qu'il s'oppose à l'avance allemande depuis le avec son matériel ancien6.
Liste des unités d'artillerie portée

- 9e régiment d'artillerie de campagne portée (1917-1923, devient 311e RAP)8,5
- 11e régiment d'artillerie de campagne portée (1917-1923, devient 302e RAP)8,5
- Ve et VIe groupes du 13e régiment d'artillerie de campagne (1915-1917, deviennent 213e RACP)2
- 14e régiment d'artillerie de campagne portée (1919-1923)9,10,5
- 23e régiment d'artillerie coloniale portée (1917-1919)3,11
- 28e régiment d'artillerie de campagne portée (1919-1923, forme le 351e RALP)12,5
- 29e régiment d'artillerie de campagne portée (1918-1923, devient 301e RAP)8,5
- 37e régiment d'artillerie de campagne portée (1918-1922)3,8
- 38e régiment d'artillerie de campagne portée (1919-1923)3
- 41e régiment d'artillerie de campagne portée (1917-1923)8,5
- 44e régiment d'artillerie de campagne portée (1919-1923, devient 303e RAP)13,5
- 45e régiment d'artillerie de campagne portée (1917-1923, forme le 355e RAP)8,5
- 46e régiment d'artillerie de campagne portée (1917-1923, devient 313e RAP)14,5
- 49e régiment d'artillerie de campagne portée (1917-1923, devient 307e RAP)8,5
- 50e régiment d'artillerie de campagne portée (1919-1923, devient 312e RAP)3
- 52e régiment d'artillerie de campagne portée (1919-1923, devient 308e RAP)15,5
- 53e régiment d'artillerie de campagne portée (1919-1923, devient 353e RAP)16,5
- 57e régiment d'artillerie de campagne portée (1918-1923, devient 304e RAP)8,5
- 59e régiment d'artillerie de campagne portée (1918-1923, devient 306e RAP)8,5
- 60e régiment d'artillerie de campagne portée (1917-1923, devient 309e RAP)8,5
- 98e régiment d'artillerie lourde portée (1921-1923, devient 361e RALP)5,17
- 99e régiment d'artillerie lourde portée (1921-1923, devient 363e RALP)5
- 201e régiment d'artillerie de campagne portée (1918-1919, fusionne avec le 272e RACP et forme le 52e RACP)18,15
- 203e régiment d'artillerie de campagne portée (1918-1919, devient 50e RACP)19
- 206e régiment d'artillerie de campagne portée (1918-1919)3,18
- 211e régiment d'artillerie de campagne portée (1918-1919)20
- 212e régiment d'artillerie de campagne portée (1918-1919, fusionne avec le 214e RACP)9
- 213e régiment d'artillerie de campagne portée (1917-1919)20
- 214e régiment d'artillerie de campagne portée (1918-1919, devient 14e RACP)10,9
- 219e régiment d'artillerie de campagne portée (1918-1919)20
- 226e régiment d'artillerie de campagne portée (1917-1919, devient 44e RACP)13
- 228e régiment d'artillerie de campagne portée (1918-1919, forme le 28e RACP)12
- 229e régiment d'artillerie de campagne portée (1918-1919)3
- 238e régiment d'artillerie de campagne portée (1917-1919)21
- 246e régiment d'artillerie de campagne portée (1917-1919)20
- 247e régiment d'artillerie de campagne portée (1918-1919)20
- 250e régiment d'artillerie de campagne portée (1918-1919, fusionne avec le 203e RACP)19,20
- 253e régiment d'artillerie de campagne portée (1918-1919, devient 53e RACP)16
- 258e régiment d'artillerie de campagne portée (1918-1919)20
- 271e régiment d'artillerie de campagne portée (1918-1919)
- 272e régiment d'artillerie de campagne portée (1917-1919, fusionne avec le 201e RACP et forme le 52e RACP)15,20
Défilé d'un Jeffery et d'un Nash du
309e RAP portant des canons de 75 à
Strasbourg le
.
- 301e régiment d'artillerie portée (1924-1930, 1939-1940, transformé en régiment d'artillerie tractée)
- 302e régiment d'artillerie portée (1924-1933, 1939-1940, transformé en régiment d'artillerie tractée)3,5,6
- 303e régiment d'artillerie portée (1924-1929, 1939-1940)5,6,22
- 304e régiment d'artillerie portée (1924-1929, 1939-1940)
- 305e régiment d'artillerie portée (1924-1931)5,22
- 306e régiment d'artillerie portée (1924-1932, 1939-1940)3,5,6
- 307e régiment d'artillerie portée (1924-1929, 1939-1940, transformé en régiment d'artillerie tractée)
- 308e régiment d'artillerie portée (1924-1929, 1939-1940)3,5,6
- 309e régiment d'artillerie portée (1924-1930)5,22
- 310e régiment d'artillerie coloniale portée (1924-1929, 1939-1940)
- 311e régiment d'artillerie portée (1924-1929, 1939-1940)5
- 312e régiment d'artillerie portée (1924-1926, 1939-1940)5,23
- 313e régiment d'artillerie portée (1924-1929, 1939-1940)3,5
- 314e régiment d'artillerie portée (1939-1940)6
- 315e régiment d'artillerie portée (1939-1940)6
- 316e régiment d'artillerie portée (1939-1940)24
- 317e régiment d'artillerie portée (1939-1940, transformé en régiment d'artillerie tractée)6
- 318e régiment d'artillerie portée (1939-1940)6
- 320e régiment d'artillerie coloniale portée (1939-1940)
- 321e régiment d'artillerie portée (1940)6
- 351e régiment d'artillerie portée (1924-1929, 1939-1940)5,24
- 352e régiment d'artillerie portée (1940)24
- 353e régiment d'artillerie portée (1924-1940)5,24
- 355e régiment d'artillerie portée (1924-1940)
- 361e régiment d'artillerie portée (1924-1935, 1939-1940)5,24
- 363e régiment d'artillerie portée (1924-1940)
- 365e régiment d'artillerie portée (1924-1929, 1939-1940)5,24
Références
- Rémy Scherer, « 1918- ... L'artillerie portée » [archive], sur artillerie.asso.fr (consulté le ).
- François Vauvillier, « Jeffery et Nash Quad : L'oncle d'Amérique débarque avant l'heure », Guerre, blindés et matériels, Histoire & Collections, , p. 24.
- François Vauvillier et Guy François, « L'artillerie de campagne de 75 portée, 3e partie : En métropole et sur le Rhin », Histoire de guerres, blindés et matériels, no 142, , p. 27-40.
- François Vauvillier et Jean-Michel Touraine, L'automobile sous l'uniforme 1939-40, Massin, (ISBN 2-7072-0197-9), « L'artillerie portée », p. 112-115.
- « Regroupement des unités d'artillerie », Revue d'artillerie, , p. 95-101 (lire en ligne [archive]).
- François Vauvillier, Rémy Scherer et Nicolas Palmier, « Les régiments d'artillerie de 75 portée en campagne, 4e partie », Histoire de guerres, blindés et matériels, no 143, , p. 40-54
- Historique du 3e régiment d'artillerie coloniale : 1914-1918, Paris, Chapelot, 52 p. (lire en ligne [archive]), p. 25.
- « Parcours et historiques des régiments d'artillerie durant 1914 1918 : N° 1 à 62 » [archive], sur chtimiste.com, (consulté le ).
- Historique du 212e régiment d'artillerie de campagne, Bordeaux, V. Cambette, , 46 p. (lire en ligne [archive]), p. 46.
- Historique du 214e régiment d'artillerie de campagne, Bordeaux, Cambette, , 87 p. (lire en ligne [archive]), p. 56.
- Historique du 23e régiment d'artillerie coloniale : 1914-1918, Paris, Librairie Chapelot, 19 p. (lire en ligne [archive]), p. 9.
- Historique des 28e et 228e régiments d'artillerie pendant la guerre 1914-1918, Paris-Nancy-Strasbourg, Berger-Levrault, 48 p. (lire en ligne [archive]), p. 33.
- Historique du 226e régiment ACP, Paris, Librairie Chapelot, 16 p. (lire en ligne [archive]), p. 5, 11.
- Historique du 46e régiment d'artillerie de campagne pendant la guerre 1914-1918, Berger-Levrault, 27 p. (lire en ligne [archive]), p. 12-13.
- Historique du 272e régiment d'artillerie de campagne, Paris, Henri Charles-Lavauzelle, (lire en ligne [archive]), p. 15.
- Lieutenant-colonel Perrier, Historique du 53e régiment d'artillerie pendant la Grande Guerre : 2 août 1914-20 janvier 1919, Clermont-Ferrand, Impr. générale de Bussac, , 107 p. (lire en ligne [archive]), p. 18.
- Pierre Briot, Naissance d'une garnison, (lire en ligne [archive]).
- Henri Kauffer, « L'artillerie », dans Pierre Guinard, Jean-Claude Devos et Jean Nicot, Inventaire des archives de la Guerre : Série N 1872-1919, vol. 1 : Introduction, guide des sources, bibliographie, Troyes, Imprimerie La Renaissance, (lire en ligne [archive]), p. 160-161.
- Historique du 203e régiment d'artillerie de campagne : campagne 1914-1919, Carcassonne, Imprimerie Gabellé, 16 p. (lire en ligne [archive]), p. 5, 7.
- « Parcours et historiques des régiments d'artillerie de campagne et portés durant 14/18 : N° 201 à 279 » [archive], sur chtimiste.com, (consulté le ).
- Historique du 238e régiment d'artillerie de campagne, Paris, Librairie Chapelot (lire en ligne [archive]), p. 8, 18.
- François Vauvillier, « Les tracteurs d'artillerie Citroën-Kégresse », Histoire de guerre, blindés et matériel, Histoire & Collections, no 139, , p. 23-32.
- Auguste Édouard Hirschauer, « Annexe 2 : Notice Historique », dans Rapport fait au nom de la Commission de l'armée, chargée d'examiner le projet de loi adopté par la chambre des députés, relatif à la constitution des cadres et effectifs de l'armée, Impressions du Sénat (no 263), (lire en ligne [archive]), p. 224-225.
Voir aussi
Articles connexes
Artillerie de campagne
Canon français du système Gribeauval (
XVIIIe siècle).
L'artillerie de campagne est une des branches majeures de l'artillerie, qui a pour vocation de soutenir et appuyer les troupes sur le champ de bataille. Pour remplir cette fonction, son matériel doit être mobile et apte à suivre des opérations mobiles. Cet impératif a tendance à lui faire adopter des pièces plus légères et moins puissantes que par exemple l'artillerie de siège ou l'artillerie de place.
Historique
Premiers exemples
Si l'artillerie est surtout dans ses débuts cantonnée aux opérations de siège, il arrive parfois qu'on essaye de la déployer lors d'une bataille — un exemple célèbre étant la bataille d'Azincourt en 1415 — mais les résultats sont peu probants. Il est impossible de déplacer les canons une fois la bataille engagée, et, au vu de la portée de l'époque, cela limite leur rôle au mieux à la défense. Les pièces sont en outre incapables de fournir un tir soutenu et explosent généralement après dix à douze coups. Leurs projectiles manquent à la fois de précision et d'efficacité. Au bout du compte, le seul bénéfice est l'effet moral, la fumée et le bruit.
Voiture-pièce de canon de campagne - Musée de l' Armée - Paris
Jean Bureau et son frère Gaspard Bureau, Grands maîtres de l'artillerie du roi Charles VII, utilisent massivement l'artillerie mobile (300 canons) lors d'une bataille rangée pour la première fois en Occident, remportant la victoire contre les Anglais à la bataille de Castillon, mettant ainsi un terme à la guerre de Cent Ans1.
Cependant, au tournant du XVIe siècle, la métallurgie et de nouvelles techniques de construction des canons permettent des progrès majeurs, qui vont commencer à rendre l'usage de l'artillerie sur le champ de bataille beaucoup moins folklorique. La première de ces innovations est la généralisation de l'affût à roue, auquel s'associent bientôt les tourillons directement coulés avec le tube, qui permettent à la pièce de reposer directement sur l'affût, tout en restant orientable en site. Le canon prend une allure qu'il va garder pendant plusieurs siècles, et gagne au passage une certaine mobilité. Deux autres améliorations sont aussi introduites à cette époque, l'usage de plus en plus fréquent du bronze pour la fabrication des pièces et de la fonte de fer pour le projectile. Le bronze, alliage de cuivre et d'étain, malgré son prix, se révèle rapidement un meilleur choix que le fer car il permet une fabrication par moulage et non plus par forgeage. L'épaisseur est plus régulière et le matériau moins cassant : les canons sont alors moins sujet à l'éclatement des tubes. Le projectile métallique, lui, n'éclate pas comme celui en pierre et permet des rebonds très meurtriers contre les formations serrées de fantassins ou de cavaliers. Un des grands précurseurs de cette nouvelle artillerie est l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg, qui est aussi un des premiers à classifier ses canons en deux grandes catégories, de siège et de campagne. Il est aussi le premier à rendre indépendants ses artilleurs en les rassemblant dans un corps spécifique.
La progression dans l'efficacité sur le terrain est très rapide. Si en 1477, à Nancy, les piquiers suisses s'emparent des trente canons bourguignons avant que ceux-ci aient eu le temps de tirer, moins de quarante ans plus tard, à la bataille de Marignan, ces mêmes piquiers doivent reculer en perdant sept mille des leurs face à soixante canons français. Comme pour celle de siège, l'artillerie de campagne est devenue un atout majeur des armées en campagne, et de nombreux théoriciens essayent de rationaliser son emploi alors que le nombre de pièces augmente rapidement. De nombreux problèmes pratiques limitent néanmoins encore son efficacité. Des progrès techniques, mais surtout d'organisation et de doctrine sont encore nécessaires.
En 1540, Georges Hastmann met au point l'échelle des calibres, une règle en métal qui fait correspondre le calibre intérieur d'un canon avec la masse de son boulet, ce qui supprime la nécessité de peser le projectile et la poudre nécessaire. Mais le progrès le plus important, et aussi le plus long, est la diminution et la rationalisation des types et des calibres des pièces d'artillerie. L'évolution est lente mais sûre, car si l'armée de Charles Quint a plus de cinquante modèles de canon en service aux alentours de 1550, l'armée française n'a plus que sept en [Quand ?] : le canon, la grande couleuvrine, la couleuvrine moyenne, la couleuvrine petite, le faucon, le fauconneau et l'arquebuse à croc. Les autres grandes armées européennes ont dans le même temps adopté des calibres similaires.
À l'époque d'Henri II, il existait, pour la France, 6 calibres pour l'artillerie de campagne :
- Le canon, dont le projectile pesait de 33 livres 4 onces à 34 livres.
- La grande couleuvrine, dont le projectile ordinaire de 15 livres 2 onces ne dépassait pas 15 livres 4 onces.
- La coulevrine bâtarde, avec un projectile, en moyenne, de 7 livres 2 onces ou 7 livres 3 onces.
- La coulevrine moyenne, avec un projectile de 2 livres.
- Le faucon, avec un projectile de 1 livre 1 once.
- Le fauconneau, avec un projectile de 14 onces.
À titre d'exemple, l'artillerie installée par les troupes françaises au siège de Thionville en 1558 est composée de
- 12 canons de calibre empereur
- 6 grandes couleuvrines de 18 pieds de chasse pour battre les défenses
- d'autres pièces de campagne
Cependant seuls les calibres sont fixés, les autres caractéristiques des canons variant d'une pièce à l'autre, ce qui complique énormément l'entretien des pièces en campagne — une roue, par exemple, n'étant pas interchangeable entre deux canons de même calibre. Les progrès sont néanmoins sensibles au niveau des performances des pièces durant le XVIe siècle. La portée du projectile a triplé, passant d'environ 100 mètres à 300, et la durée de vie des tubes a été multipliée par dix : Il devient possible de tirer une centaine de coups sans éclatement.
L'artillerie reste néanmoins une arme auxiliaire coûteuse et difficile à mettre en œuvre sur le champ de bataille.
Durant la guerre de Trente Ans, malgré l'engagement des grandes nations européennes, l'évolution de l'artillerie va être le fait de deux puissances considérées comme plutôt secondaires. La première est la Hollande, dont les innovations portant sur la standardisation de l'artillerie vont mettre longtemps à faire des émules dans les armées étrangères. Les Provinces Unies ont réduit le nombre de calibres à quatre, 48, 24, 12 et 6 livres, qui leur permettent de couvrir leurs besoin aussi bien sur terre que sur mer. Vraisemblablement du fait de la petite taille du pays, ils ont aussi réussi à standardiser l'ensemble de la fabrication, y compris celle des affûts : une flasque devient ainsi interchangeable entre deux canons de même calibre. Leurs canons sont moulés selon des plans précis, où des calculs précis du centre de gravité ont permis de placer les tourillons, mais aussi une nouveauté, les anses qui permettent de lever facilement le canon, par exemple pour le désolidariser de son affût. Pour favoriser ce genre de manœuvre, le bouton de culasse, jusqu'alors de petite taille, est aussi agrandi et rendu capable de supporter des efforts importants.
Canons allemands du
XVIIe siècle
L'autre nation qui innove beaucoup dans le domaine de l'artillerie de campagne est la Suède de Gustave Adolphe. L'apport est là plus dans la doctrine d'emploi. L'armée suédoise de l'époque répartit son artillerie en trois branches : la lourde, destinée à agir lors des sièges et des phases statiques de la guerre, celle de campagne qui accompagne les troupes, et l'artillerie légère régimentaire qui les appuie au plus près. Cette dernière est la grande innovation du roi suédois, qui lui permet d'aligner une artillerie plus nombreuse et plus efficace que ses adversaires : elle emploie des petits canons très légers, surnommés les « canons de cuir bouilli » du fait de leur mode de fabrication, une âme en cuivre encerclée par du fer et recouverte de cuir. Ces pièces, d'un calibre de quatre ou trois livres, peuvent être déplacées par un ou deux chevaux, voire à bras d'homme, et utilisent des boulets encartouchés, qui leur confèrent une cadence de tir phénoménale pour l'époque, huit coups par minute, alors qu'un bon mousquetaire ne tire que six fois. Par la suite, des canons de quatre livres en fonte de fer leur succèderont, tout en gardant leur légèreté : 625 livres affût compris. Sur le champ de bataille, Gustave Adolphe appuie son action avec son artillerie de campagne dotée de pièces de six et douze livres, qu'il place non plus en ligne devant le front des troupes, mais en fortes batteries au centre ou sur les ailes. Cette organisation lui permet de disposer d'environ un canon pour trois ou quatre cents hommes, contre un pour deux mille par exemple pour les impériaux. À la bataille de Breitenfeld (1631), il inflige ainsi aux impériaux des pertes quatre fois supérieures aux siennes.

Si la plupart des évolutions de l'artillerie sont présentes lors de la guerre de Trente Ans, elles vont néanmoins mettre longtemps à se diffuser dans toutes les armées européennes. En France, il faut attendre le 7 octobre 1732 pour qu'une ordonnance royale tente d'uniformiser les canons en service dans l'armée du roi, sous l'influence du lieutenant-général de Vallière. Pour la première fois en France, le dessin des tubes est fixé par des plans précis, mais celui des affûts, des voitures et avant-train reste libre, et les calibres sont encore nombreux : 24, 16, 12, 8 et 4 livres. Néanmoins l'artillerie française délaisse enfin les couleuvrines et adopte définitivement le canon plus court et donc léger, de même les mortiers et pierriers sont uniformisés sur deux calibres chacun.
Plus rapide, par contre, est la formation d'un corps autonome d'artilleurs : en 1668 sont créés quatre compagnies de canonniers et deux de bombardiers (utilisant des mortiers de siège), en 1671 apparaît le régiment de fusiliers du roi, qui comme son nom ne l'indique pas, a pour mission la garde et le service de l'artillerie royale. En 1676 naît à son tour le régiment des bombardiers, et en 1679, la première compagnie de mineurs rattachée à l'artillerie. Toutes ces unités sont regroupées au sein du régiment Royal artillerie, en 1693, qui en 1710 compte 697 officiers et 5 630 soldats.
Le système Gribeauval
Caisson d'artillerie Gribeauval
Le tir rapide
Le « tir rapide » fut, avec la « poudre sans fumée », un concept-clef des penseurs militaires de la Belle Époque. Il consistait dans le fait qu'une pièce d'artillerie soit capable de tirer plusieurs coups par minute. L'avènement du tir rapide résulte des progrès accomplis dans l'usinage des obus : les usines Krupp développèrent ainsi un verrou de culasse amélioré2, le C/87, qui équipa un obusier de 130 mm (1888), puis un obusier de 150 mm (1890). Ce mécanisme fut supplanté en 1895 par le verrou Leitwell, qui équipa tous les canons Krupp jusqu'en 19143. En France, il fut décliné notamment avec le verrou du canon Court à Tir Rapide (C.T.R.) 155 mm CTR Rimailho.
Motorisation et mécanisation
L'un des canons de campagne les plus célèbres de la Première Guerre mondiale est le canon de 75 Modèle 1897.
Organisation
Spécialités
Canon d'infanterie
Exemple : Canon de 5,5 pouces
Artillerie à cheval (attelage)
L'artillerie à cheval fut inventée par les Prussiens au début du XVIIIe siècle, car Frédéric II le Grand s'était rendu compte que le calibre de l'artillerie était secondaire. Il a donc créé des pièces tirées par des chevaux, sur lesquels les servants montaient : le canon était alors opérationnel en 5 minutes.
Artillerie de montagne
Elle est généralement plus courte, montée sur des affûts plus légers et démontable pour être transportée sur les terrains accidentés.
Notes et références
- Krupp 1812 bis 1912 op. cit., p. 349.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
Sur les autres projets Wikimedia :
Canon
Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.
Pour les articles ayant des titres homophones, voir Cannon et Kanon.
Sur les autres projets Wikimedia :
- canon, sur le Wiktionnaire
Le mot canon, de la famille du grec κανών (kanôn) dont le premier sens est « tige de roseau », peut désigner plusieurs choses.
Tube
De l'italien cannone, de canna « tube ».
Armes à feu
- Canon, partie d'une arme à feu constituée par le tube servant à lancer des projectiles.
- Canon, pièce d'artillerie dont la différence avec l'obusier a varié au cours des temps.
Projections dirigées d'«objets» de natures diverses
Serrurerie
Dans une serrure, le canon est le petit cylindre creux attaché sur le foncet et dans lequel entre la clef. C'est aussi la partie de la tige de la clef forée dans laquelle entre la broche. On distingue deux sortes de canons : le canon à patte et le canon tournant.
Zoologie
- Canon, partie inférieure de la jambe du cheval, au-dessus du boulet, et correspondant à la première phalange.
Unité de mesure
- Canon, unité de mesure des liquides ancienne équivalent à 1/16 de litre. Le vase cylindrique servant à mesurer les liquides était un canon au sens de tube. Le sens moderne et populaire s'en dérive par métonymie. « Boire un canon de rouge » est boire la dose de vin servie dans les débits de boisson. Par synecdoque, toute dose de boisson alcoolisée est un canon (« il boit des canons ni peu ni assez »).
Ensemble des règles régissant une discipline particulière
Dans les arts
Du latin, à partir du grec « règle ».
- Le Canon (Κανών, règle) écrit par le sculpteur grec Polyclète, est un traité perdu sur l'art de la sculpture, datant du Ve siècle av. J.-C..
- Canon en architecture, ensemble de règles ou normes architecturales liées à un style spécifique.
- Canon, création officielle dans le domaine des œuvres de fiction.
- Canon esthétique en peinture.
Domaine religieux
- Canon (religion) et canon (Bible), norme dans le domaine religieux.
- Canon de la messe, nom donné à une partie de la liturgie catholique de la messe. Voir aussi Canon de la messe également appelée « prière eucharistique » dans le rite romain.
- canons d'autel, nom donné dans la forme extraordinaire du rite tridentin aux trois recueils de textes (cartons, tableaux ou sous-verres) posés verticalement (en arrière) sur l'autel.
- Droit canon, ensemble de lois adoptées par l'Église.
- Canon, partie de l'office du matin de la liturgie byzantine (orthros), composé notamment de 9 odes bibliques, remplacées par une composition hymnique (le canon)
Règle au sens large
Dérivant de l'usage religieux du terme canon pour désigner les textes qui s'imposent à tous,
- le Canon alexandrin ou classification alexandrine est une liste des auteurs grecs les plus remarquables (fixée au XVIIIe siècle) ;
- le canon littéraire est une expression parfois utilisée pour évoquer l'ensemble des classiques de la littérature.
- le canon désigne en sinologie l'ensemble des classiques chinois, dits Jing (constant), dont le contenu est considéré comme « permanent » et orthodoxe du point de vue du confucianisme.
- Canon pāli : collection standard d'écritures dans la tradition bouddhiste Theravada, conservé en Pali. Kanjur : canon tibétain.
- le canon esthétique désigne une norme esthétique corporelle dans le domaine du spectacle, de l'habillement, etc.
Immobilier
Dans le bail emphytéotique, le canon est la redevance périodique due par l’emphytéote au bailleur.
Culture
Sport
Canon Sportif de Yaoundé : club de football camerounais fondé le 11 novembre 1930 et basé dans la ville de Yaoundé, vainqueur de 3 Ligue des champions de la CAF (1971, 1978 et 1980)
Musique
- Le canon est une forme musicale caractérisée par une polyphonie autour d'un même thème pouvant se superposer à lui-même tout en étant décalé dans le temps.
Patronyme
Canon est un nom de famille notamment porté par :
Toponyme
Canon est un nom de lieu notamment porté par :
Titres d'œuvres
Canon est un titre d'œuvre notamment porté par :
Sciences
Bande dessinée
- Canon (ou Kanon), série de manga.
- Le Canon de Kra, quinzième album de la série Yoko Tsuno, écrite et dessinée par Roger Leloup, sorti en 1985.
Cinéma
- Canon, film de Norman McLaren (1964) illustrant visuellement la notion de canon musical.
- Les Canons de Navarone, (The Guns of Navarone), film anglo-américain1 de J. Lee Thompson (1961).
Entreprises
- Canon, entreprise japonaise fabriquant des appareils photos argentiques et numériques, du matériel informatique et de reprographie.
- Canon Communications (en), entreprise des États-Unis, producteur de films indépendants.
Grenadiers à cheval de la Garde impériale
Les grenadiers à cheval de la Garde impériale sont un régiment de cavalerie lourde de la Garde impériale française, en service sous le Premier Empire. Ayant déjà fait partie de la Garde du Directoire et de la Garde consulaire, les grenadiers à cheval deviennent le plus ancien régiment de cavalerie de la Garde impériale lorsque celle-ci est créée en 1804. Leur effectif théorique maximal est alors d'environ 1 000 officiers et hommes de troupe, commandés par un général de division ou par un général de brigade expérimenté.
De 1804 à 1815, les grenadiers à cheval n'interviennent qu'occasionnellement dans les batailles, étant généralement tenus en réserve aux côtés de Napoléon. À chacune de leurs interventions, cependant, les résultats sont spectaculaires : ils contribuent à la déroute de la cavalerie de la Garde russe à Austerlitz, échappent à l'encerclement à Eylau, refoulent les Bavarois à Hanau et se distinguent encore lors de la campagne de France. Les grenadiers à cheval n'ont jamais été vaincus au combat par de la cavalerie adverse et sont considérés comme « le régiment le plus fameux de la cavalerie lourde française ».
En 1815, sous la Première Restauration, les grenadiers à cheval deviennent le Corps royal des cuirassiers de France. Ils reprennent cependant leur nom et leur rang au sein de la Garde impériale lors du retour de Napoléon la même année et sont engagés dans la campagne de Belgique. À Waterloo, le colonel Jamin de Bermuy est tué devant les carrés britanniques en menant les charges de son régiment. Celui-ci est dissous quelques mois plus tard, après la chute de Napoléon et la Seconde Restauration des Bourbons.
Organisation
Genèse

Les origines des grenadiers à cheval remontent à la Constitution de l'An III qui institue la formation d'une garde du Directoire. Un régiment de cavalerie est appelé à en faire partie et recrute ses membres au sein du 9e régiment de dragons1. Un corps de deux compagnies comprenant 112 cavaliers est créé2. Toutefois, la garde à cheval n'entre en service qu'en 1796 et l'année suivante, une circulaire instruit que les éléments montés de la garde du Directoire prendront désormais le nom de « grenadiers »note 1. Quelques jours après le coup d'État du 18 Brumaire et la mise en place du Consulat, la garde est réorganisée et le chef de brigade Michel Ordener prend le commandement du régiment qui compte à ce moment-là trois escadrons1. Un décret du donne naissance à la nouvelle Garde consulaire à laquelle les grenadiers à cheval sont intégrés avec une unité de chasseurs. Le régiment est ramené à deux escadrons de 172 cavaliers, composé de deux compagnies de 86 hommes chacun2. D'autres remaniements ont lieu en 1801 et en 1802 sous la supervision du général Jean-Baptiste Bessières, portant l'unité à quatre escadrons de deux compagnies chacun. L'état-major régimentaire est également élargi1. Au , les grenadiers à cheval alignent 31 hommes d'état-major et 960 cavaliers ; le , cet effectif passe à 55 officiers et 912 cavaliers3.
Pour être acceptées dans le régiment, les recrues doivent mesurer 1,76 m, avoir effectué dix ans de service, participé à au moins quatre campagnes et avoir été cité pour bravoure. Les récipiendaires de la Légion d'honneur sont cependant exemptés des critères d'admission4. Sous la période consulaire, le régiment se compose pour une très grande partie de vétérans de la ligne, faisant preuve de neuf années de service en moyenne. L'âge moyen des cavaliers est de 28 ans, chiffre qui tend à s'abaisser un peu pendant l'Empire, les soldats servant généralement plus longtemps dans la ligne. La taille des grenadiers varie entre 1,60 m et 1,86 m, pour une moyenne globale d'1,75 m5. Montés sur de grands chevaux noirs originaires de la région de Caen, les grenadiers à cheval sont surnommés les « chevaux noirs de Bessières », mais aussi « les Géants », « les Dieux » ou encore « les Gros Talons »6,7. L'historien de la Garde impériale Henry Lachouque écrit à leur sujet :
« Énormes sur leurs grands et magnifiques chevaux, haut bottés, fiers de leur prestance, les Grenadiers à cheval, dits « gros talons », paraissent sévères, avantageux, et un peu hautains ; la fantaisie paraît bannie de leur existence8. »
Sous l'Empire
Le , les grenadiers à cheval prennent rang dans la Garde impériale. En juillet de la même année, un décret porte l'effectif de l'état-major à 32 hommes et organise le régiment en quatre escadrons de deux compagnies chacun, avec 123 hommes par compagnie, pour un total de 1 016 officiers, sous-officiers et soldats. L'année suivante, deux escadrons de vélites (800 hommes) rejoignent le régiment qui se voit également doté d'un major en second. Les deux escadrons de vélites sont finalement supprimés en au profit d'un 5e escadron, portant l'effectif total à 1 250 cavaliers. Une énième réorganisation ramène le nombre d'escadrons à quatre juste avant la campagne de Russie. En , après le désastre subi en Russie, les grenadiers sont remaniés une nouvelle fois avec la création d'un cinquième puis d'un sixième escadron articulés en deux compagnies chacun — ces deux formations sont considérées comme appartenant à la Jeune Garde et sont aussi connues sous le nom de « 2e régiment de grenadiers à cheval ». C'est ainsi constitués que les grenadiers à cheval se battent pendant la guerre de la Sixième Coalition, avec chacun de leurs quatre escadrons de Vieille Garde formé en deux compagnies de 124 hommes chacune9. Sous l'Empire, le régiment fait brigade avec les dragons de la Garde impériale1. En 1813, le 1er régiment des éclaireurs de la Garde impériale, commandé par le colonel Claude Testot-Ferry, est rattaché aux grenadiers à cheval et prend le nom d'« éclaireurs-grenadiers »10.
Après l'abdication de Napoléon en 1814 et le retour des Bourbons sur le trône de France, le roi demande au maréchal Ney de procéder à la dissolution du régiment et de réorganiser les hommes dans le nouveau corps des « cuirassiers de France », fort de quatre escadrons. Il semble que le 6e escadron de Jeune Garde ait été transféré dans son intégralité aux carabiniers à cheval. Avec le retour de Napoléon en 1815, le régiment retrouve son ancienne identité avant d'être définitivement dissous le après la chute définitive du régime impérial9.
Chefs de corps
Frédéric Henri Walther, colonel des grenadiers à cheval de la Garde. Peinture anonyme.
Le régiment des grenadiers à cheval de la Garde est commandé par un général de division qui porte le titre de colonel commandant. Il est assisté par un général de brigade qui remplit quant à lui les fonctions de colonel-major (aussi appelé major en premier), lui-même aidé dans sa tâche par un général ou un colonel qui fait office de major en second. L'historien Alain Pigeard donne la liste complète des commandants successifs du régiment11 :
À partir du , Bessières prenant le commandement de toute la cavalerie de la Garde consulaire, c'est le très expérimenté colonel Michel Ordener qui dirige le régiment des grenadiers à cheval11. Né en 1755, il a commandé un régiment de cavalerie sous la Révolution et est promu au grade de général de division en 180512. Il quitte ses fonctions le pour se retirer du service actif. La même année, avec la création d'un deuxième régiment de grosse cavalerie au sein de la Garde — les dragons de l'Impératrice —, une brigade de cavalerie lourde est mise sur pied et placée sous les ordres d'un général de division. Le commandement en est d'abord confié à un cavalier accompli, le général Frédéric Henri Walther, vétéran des guerres de la Révolution française, qui reste à la tête de cette formation jusqu'à sa mort, le . Remplacé par le général Claude Étienne Guyot, âgé de 45 ans, ce dernier commande la brigade jusqu'à la chute de l'Empire en . Durant cette période, l'un des officiers les plus remarquables du régiment est Louis Lepic, un soldat aguerri qui sert en tant que colonel-major11.
Le premier commandant en second du corps est Antoine Oulié, un ancien du 12e chasseurs : nommé au régiment le , il le quitte le pour prendre la tête de la 18e légion de gendarmerie. Louis Pierre Aimé Chastel, son remplaçant, a notamment servi en Égypte avant de devenir major dans les dragons13. Major des grenadiers à cheval le , puis général de brigade en , il remplace Lepic dans son commandement en Espagne. Il est ensuite promu au grade de divisionnaire peu avant la campagne de Russie14. Il est successivement remplacé par le général Rémy Joseph Isidore Exelmans puis par le général Bertrand Pierre Castex11. Celui-ci a été auparavant colonel du 20e chasseurs et s'est illustré à Iéna et à Wagram15. En 1813, les grenadiers à cheval ont pour colonel-major Louis Marie Levesque de Laferrière, un cavalier réputé qui sert dans l'armée depuis 1792. Blessé grièvement à Craonne en 181416, son commandement est relevé le de la même année par le général Jamin de Bermuy, ex-colonel dans la cavalerie de la Garde napolitaine17.
Campagnes militaires
Bataille de Marengo
Charge des grenadiers à cheval de la Garde consulaire à Marengo, le
. Illustration de
Job.
Le premier engagement véritable de l'unité a lieu dans des circonstances dramatiques pendant la guerre de la Deuxième Coalition, lors de la bataille de Marengo, le . Le soir arrive, et les grenadiers à cheval en réserve n'ont toujours pas donné. Deux escadrons de dragons autrichiens avançant sur la route de Novi sont chargés par les 360 sabres de la cavalerie de la Garde consulaire. Surpris, les dragons sont écrasés et perdent 210 hommes sur 28518. Alors que Napoléon est en train de perdre la bataille contre les Autrichiens, la division Boudet, avec à sa tête Louis Desaix, apparaît sur le champ de bataille et se lance dans le combat. Pour soutenir son mouvement, la brigade Kellermann se déploie sur le flanc droit autrichien, le charge et le renverse19. De son côté, le colonel Bessières organise une charge massive avec l'ensemble de la cavalerie de la Garde consulaire et sème la panique chez les Autrichiens. Les grenadiers à cheval culbutent les troupes qui s'opposent à eux ; tandis que le trompette Schmitt encerclé s'ouvre la route à coups de sabre, trois étendards ennemis tombent au main des grenadiers20. Les chiffres attestent néanmoins d'une résistance autrichienne sérieuse : 24 tués, 24 blessés et 48 chevaux sont hors de combat chez les grenadiers21. Après la bataille, Bessières reçoit pour son action les éloges du Premier consul, qui lui dit : « la Garde que vous commandez s'est couverte de gloire ; elle ne pouvait donner mieux à propos ». Un peu plus d'un mois après la bataille, le colonel Michel Ordener reçoit le commandement du régiment19.
Bataille d'Austerlitz
Grenadiers à cheval de la Garde. Gravure d'Hippolyte Bellangé,
XIXe siècle.
Cinq années s'écoulent avant que l'engagement suivant des grenadiers à cheval, qui se déroule pendant la guerre de la Troisième Coalition, ne se produise. La guerre ayant éclaté avec la Russie et l'Autriche, les grenadiers à cheval, faisant maintenant partie de la Garde impériale, traversent le Rhin en Allemagne le . Dix jours plus tard, ils sont à Augsbourg et le , ils sont présents à la reddition d'Ulm. Ils voient leur seule action majeure au cours de cette campagne le , sur le plateau de Pratzen, à la bataille d'Austerlitz. Au cours de cet affrontement, Napoléon prévoit de briser le centre austro-russe afin de diviser leurs forces. En milieu de matinée, la situation est à l'avantage de l'Empereur, mais une situation potentiellement dangereuse pour les Français se produit lorsque la Garde impériale russe, sous le commandement du grand-duc Constantin, attaque les soldats de la division Vandamme autour de Stary Vinohrady (« les vieilles vignes »). Dans un premier temps, un bataillon du 4e régiment de ligne français est malmené par la cavalerie de la Garde russe appuyée par l'artillerie, et les Français perdent leur aigle et plus de 400 hommes. Le 24e régiment d'infanterie légère, qui monte à l'appui du 4e de ligne, est également rejeté en arrière en désordre22.
C'est à ce moment que Napoléon envoie la cavalerie de la Garde qui se compose de quatre escadrons des chasseurs à cheval et des mamelouks, et quatre escadrons des grenadiers à cheval, avec deux batteries d'artillerie à cheval de la Garde en appui23. Un premier assaut mené par deux escadrons de chasseurs à cheval, appuyé par trois escadrons des grenadiers, disperse la cavalerie du Tsar et permet d'engager l'infanterie de la Garde russe, mais l'arrivée en renfort de sept escadrons des cosaques et des chevaliers-gardes fait tourner le combat au désavantage des Français24. Pour soutenir ses cavaliers, Napoléon envoie d'abord le reste des chasseurs à cheval et les mamelouks, puis le dernier escadron des grenadiers à cheval24. Ces derniers chargent et se mesurent avec le régiment des chevaliers-gardes russes. Après une courte mêlée, les grenadiers à cheval dispersent leurs adversaires, leur infligeant de lourdes pertes et capturant plus de 200 hommes, dont le prince Repnine avec son état-major, ainsi que 27 pièces d'artillerie. De leur côté, les grenadiers déplorent seulement 2 morts et 22 blessés (dont 6 officiers)19. Les charges de la cavalerie de la Garde permettent de repousser la dernière attaque russe sur le Pratzen, laissant les Français maîtres du plateau jusqu'à la fin de la bataille25.
Campagne de Prusse et de Pologne
En , le général Frédéric Henri Walther remplace Ordener. En raison de son ancienneté, Walther est également commandant en second de toute la cavalerie de la Garde et exerce le commandement chaque fois que le maréchal Bessières est absent. Le régiment des grenadiers à cheval ne participe pas à la campagne de Prusse. Néanmoins, la guerre continue l'année suivante en Pologne, les Français poursuivant l'armée russe26. Les rigueurs de l'hiver polonais, les routes en mauvais état et l'extrême pauvreté de certaines régions entraînent des souffrances considérables pour les deux camps et rendent pratiquement impossibles les reconnaissances et les services d'avant-poste.
Charge des grenadiers à cheval de la Garde à Eylau, le
. Peinture de
François Schommer, présentée au salon de 1857.
Après quelques manœuvres initiales et engagements mineurs, la première grande bataille a lieu à Eylau. La Grande Armée y est sérieusement en infériorité numérique27. Au début de la bataille, les grenadiers à cheval, positionnés derrière l'infanterie de la Garde au centre-gauche du dispositif français, subissent sans bouger la canonnade russe28. Voyant des cavaliers courber l'échine sous les boulets, le commandant en second du régiment, le colonel Louis Lepic, hurle : « haut les têtes, Jarnidiou ! La mitraille n'est pas de la merde ! »29. Le corps de Ney est encore loin, et la position de Napoléon est de plus en plus périlleuse. L'Empereur ordonne au maréchal Murat de lancer toute la cavalerie de réserve dans une charge massive. Dans un premier temps, Murat fait avancer les deux divisions de dragons Klein et Grouchy, et une division de cuirassiers, celle d'Hautpoul. Les cavaliers français percent la première ligne russe, puis la deuxième, avant de se retrouver derrière les rangs ennemis, menacés d'encerclement. En conséquence, l'Empereur ordonne au maréchal Bessières d'aider la cavalerie de réserve avec celle de la Garde30.
Une seconde charge de cavalerie a donc lieu, menée par les chasseurs à cheval de la Garde et suivie par la cavalerie lourde composée des cuirassiers du 5e régiment et des grenadiers à cheval. Le colonel Lepic mène l'attaque à la tête de deux escadrons, attaquant les première et deuxième lignes russes et ne s'arrêtant que devant les réserves ennemies. C'est alors qu'une bourrasque de neige a lieu et les grenadiers se perdent. Lorsque la neige retombe, le régiment est entouré par les Russes qui leur demandent de se rendre. Lepic rétorque : « Regardez-moi ces figures et dites-moi si elles ont l'air de vouloir se rendre ! », et il ordonne la charge, bouscule les Russes et parvient à regagner les lignes françaises, où Napoléon récompense Lepic en le faisant général. Le régiment compte de nombreuses pertes : 4 officiers tués et 14 officiers blessés, ainsi qu'un grand nombre de soldats, mais la charge de la cavalerie de la Garde permet à la cavalerie de réserve d'échapper à l'encerclement et de revenir à ses positions initiales. Les Français ne gagnent la bataille que tard dans la soirée30.
Le régiment assiste en à l'entrevue de Tilsit entre Napoléon et le tsar Alexandre Ier, et prend peu après ses quartiers en Allemagne. L'unité reçoit finalement l'ordre de rentrer en France au mois d'octobre31.
Guerre d'Espagne
En 1808, les troupes françaises entrent en Espagne. Les grenadiers à cheval, qui font partie du IIe corps d'armée de Bessières, sont présents à Madrid lors du soulèvement du Dos de Mayo. Leur premier chirurgien, Gauthier, y est blessé32. Ils font ensuite campagne dans le nord-ouest du pays. Le , Bessières, avec près de 14 000 hommes, fait face à deux corps d'environ 22 000 hommes à Medina de Rioseco, non loin de Valladolid. Selon Pigeard, les quelques détachements du régiment présents participent à la bataille en appuyant l'attaque de l'infanterie du général Merle33. Leur engagement lors de ce combat est cependant contesté par Hourtoulle qui note qu'aucun grenadier à cheval ne figure au corps de Bessières, mais relève par contre la présence de carabiniers à cheval dont la coiffure, semblable à celle des grenadiers, a pu prêter à confusion34. Napoléon intervient par la suite personnellement en Espagne, à la tête d'une armée qui comprend notamment trois escadrons de grenadiers à cheval. Ces derniers prennent part à la bataille de Burgos en , mais leur premier séjour en Espagne est de courte durée et ils sont de retour à Paris à la fin du mois d'35.
Campagne d'Allemagne et d'Autriche
Au début de l'année 1809, l'Empereur rappelle sa Garde au centre de l'Allemagne pour la guerre de la Cinquième coalition. Elle est présente à la bataille d'Aspern-Essling, sous le feu intense de l'artillerie autrichienne, et regarde la lutte de son armée pour contenir un adversaire largement supérieur. Lorsque Napoléon lui-même a sa botte déchirée par une balle, le général Frédéric Henri Walther, commandant de la cavalerie de la Garde, indique à l'Empereur que ses grenadiers l'emmèneront de force derrière les lignes s'il refuse de se retirer. Ce dernier obéit mais doit ordonner la retraite générale de l'armée sur l'île de Lobau, au milieu du Danube. Six semaines plus tard, Napoléon traverse le Danube à la tête d'une force considérable, pour attaquer les Autrichiens sur la plaine de Marchfeld. La bataille de Wagram qui s'ensuit voit les grenadiers à cheval en réserve lors de la première journée du combat19.
Toutefois, le deuxième jour (le ), les grenadiers à cheval, avec le reste de la cavalerie de la Garde, sont chargés de couvrir la colonne du général Macdonald qui se lance à l'attaque du centre autrichien. Après un succès initial, Macdonald voit une occasion de mettre en déroute les troupes qui se replient devant lui et, à cet effet, il demande une charge de la cavalerie de réserve de Nansouty, en invitant tous les autres commandants de cavalerie présents dans le secteur à faire de même. Les grenadiers à cheval, cependant, ne bougent pas et laissent ainsi passer l'occasion malgré la charge des chevau-légers polonais et des chasseurs à cheval de la Garde. Après la bataille, Macdonald s'emporte contre Walther et lui reproche son inaction. Ce dernier explique que ni le maréchal Bessières, ni l'Empereur, n'ont donné d'ordre pour une charge et que la Garde ne pouvait agir sans ordre direct de l'un des deux. Les tentatives de Macdonald pour expliquer qu'une telle attaque de la Garde aurait été décisive exaspèrent Walther qui salue et sort36.
Retour en Espagne
Louis Lepic (1765-1827). En 1811, il refuse de charger à la bataille de Fuentes de Oñoro, en l'absence d'ordre du maréchal Bessières. Huile sur toile de Louis-Charles Arsenne, 1842, musée de l'Armée.
Le , deux régiments provisoires de la cavalerie de la Garde sont renvoyés en Espagne, chacun d'eux comptant dans ses rangs un escadron de grenadiers à cheval. Par la suite ne subsiste qu'un seul escadron, rattaché au 2e régiment provisoire et commandé par Antoine Rémy. En 1811, il comprend 192 cavaliers et sert près de Valladolid37. Les grenadiers à cheval servent notamment sous Bessières dans le nord-ouest du pays, où celui-ci est censé soutenir l'armée du maréchal Masséna au Portugal. Ce dernier y combat le général Wellington mais il n'est pas en mesure de percer les lignes fortifiées de Torres Vedras et se retire à Almeida36.
Wellington fait l'erreur critique de le suivre et, le , il se retrouve dans une position délicate à la bataille de Fuentes de Oñoro. Masséna a besoin de Bessières et de l'ensemble de son corps d'armée pour pouvoir battre les troupes anglo-portugaises, mais Bessières n'apporte que des renforts symboliques : quelques escadrons de dragons et les grenadiers à cheval, 800 hommes en tout, sous le commandement du général Louis Lepic. Malgré cela, Masséna réussit à exploiter une faiblesse dans la ligne de Wellington, et ce dernier est sur le point d'être battu. Masséna charge son aide de camp, Nicolas Oudinot, de trouver Lepic et la cavalerie de la Garde, avec ordre de charger immédiatement. Mais Oudinot est bientôt de retour auprès du maréchal, en disant que Lepic reconnaissait seulement Bessières en tant que chef et qu'il ne chargerait pas sans son ordre. Bessières ne pouvant être trouvé, cette erreur permet à l'armée de Wellington d'échapper à la destruction36.
Campagne de Russie
En 1812, l'entrée imminente de la Grande Armée en Russie voit les grenadiers à cheval rappelés d'Espagne. Ils sont intégrés dans la 3e brigade de la cavalerie de la Garde, avec un effectif de 1 166 hommes, répartis en cinq escadrons commandés respectivement par Perrot, Mesmer, Rémy, Hardy et Morin. La première partie de la campagne de Russie, de juin à septembre, n'est rien de plus qu'une longue période de calme pour la Garde, qui n'est jamais engagée dans la bataille38 et est en mesure d'arriver sur le champ de bataille de Borodino afin d'écraser l'armée russe. Malgré les demandes insistantes des divers commandants français, Napoléon refuse d'engager la Garde si loin de la France39. À cette date, le régiment a déjà vu ses effectifs fondre de près d'un quart40.
Pendant le grand incendie de Moscou, les grenadiers à cheval sont utilisés en tant que policiers, en raison de leur réputation de discipline et de leurs normes morales élevées. À la mi-octobre, l'ensemble de la Grande Armée commence à sortir de la ville en ruine et la longue retraite vers la Pologne n'offre que des actions secondaires pour les grenadiers à cheval, qui ont pour mission d'assurer la protection du quartier général impérial38. Le lendemain de la bataille de Maloyaroslavets, l'escadron de service du régiment contribue à sauver l'Empereur d'une attaque des cosaques41. Les escarmouches, le froid et les privations pendant la retraite ont un grand impact sur le régiment et au moment de la bataille de la Bérézina, les grenadiers et les chasseurs à cheval réunis n'alignent plus que 500 combattants à cheval. Malgré cela, le moral reste bon partout38. Selon l'auteur Stephen Chappedelaine, le général Walther réussit à ramener ses grenadiers à cheval de Russie avec peu de pertes42.
Campagne d'Allemagne
Le régiment est réorganisé au début de l'année 1813 et n'est à nouveau disponible qu'en avril. Napoléon le passe en revue à Erfurt le . Trois jours plus tard, les grenadiers à cheval apprennent la mort de leur chef, le maréchal Bessières, tué au combat par un boulet à côté du village de Rippach43. À la fin mai, six escadrons de grenadiers à cheval sont présents à l'armée44. Le régiment combat brièvement à la bataille de Dresde et est impliqué dans le soutien de la Garde à pied afin de prendre le village de Reudnitz, lors de la bataille de Leipzig, en octobre43. Au cours du combat, le général Nansouty, qui commande la cavalerie de la Garde, se porte au secours de la division Durutte dont la situation se trouve compromise par la défection des unités saxonnes. Une charge menée par les grenadiers à cheval, les dragons et les lanciers de la Garde rétablit temporairement la situation dans ce secteur45.
Le seul engagement majeur de la campagne vient à la fin du mois d'octobre, lors de la bataille de Hanau. Comme les Austro-Bavarois commandés par Carl Philipp von Wrede tentent de bloquer la retraite de la Grande Armée vers la France, Napoléon est contraint d'engager ses troupes d'élite, haranguant personnellement les grenadiers à cheval au moment où ils s'apprêtent à entrer en action43. La cavalerie de la Garde charge et enfonce la nombreuse cavalerie ennemie. Une contre-charge de la cavalerie bavaroise met momentanément les grenadiers à cheval dans une situation périlleuse, mais ces derniers sont promptement dégagés par un régiment des gardes d'honneur46. Au cours de cette bataille, le colonel-major du régiment, le général Levesque de Laferrière, reçoit six coups de sabre à l'épaule et au bras, tandis que le lieutenant Guindey, célèbre pour avoir tué le prince Louis-Ferdinand de Prusse à la bataille de Saalfeld sept ans plus tôt, est tué. Un autre coup dur pour le régiment survient le , lorsque le commandant en chef du régiment, le général de division Frédéric Henri Walther, meurt d'épuisement à Kusel. Il est remplacé en décembre par le général de division Claude Étienne Guyot43.
Campagne de France
Les grenadiers à cheval de la Garde avant la charge. Peinture de
Victor Huen.
En 1814, la guerre se poursuit sur le sol français et commence dans de mauvaises conditions pour l'armée française, en sous-nombre et mal équipée. La cavalerie de la Garde, sous Nansouty, est donc mise à contribution plus souvent que jamais, jouant souvent un rôle clé dans les tentatives de Napoléon pour contrecarrer les plans de la coalition. Les grenadiers à cheval sont répartis en deux corps : l'un fort de 909 cavaliers affecté à la division de cavalerie du général Laferrière-Levesque ; l'autre comptant 401 hommes faisant partie de la cavalerie de réserve de la Garde commandée par Ney47. Ils constituent à ce moment, en terme d'effectifs, le plus gros régiment de cavalerie de la Garde impériale48. À La Rothière, en compagnie d'autres régiments de la Garde, les grenadiers se battent contre un ennemi à la supériorité numérique écrasante43. Lors de la bataille de Montmirail, ils chargent les carrés russes aux côtés des dragons de la Garde, sans grand résultat17, mais Pigeard les crédite de l'anéantissement de deux brigades russes43. À la fin de la bataille, le régiment compte 200 tués ou blessés dans ses rangs17.
Le lendemain, à Château-Thierry, ils chargent avec succès des batteries d'artillerie de l'armée de la coalition43. Deux jours plus tard, à Vauchamps, ils enfoncent les carrés de la division Kaptzevich et contribuent à la déroute de Blücher49. Ils participent ensuite à plusieurs affrontements importants, notamment à Craonne où, en s’élançant sur les troupes adverses, le colonel-major des grenadiers, le général Laferrière-Levesque, est blessé par une balle et a une jambe arrachée. Le régiment perd également l'un de ses officiers, le capitaine Kister43. Au total, 10 officiers des grenadiers à cheval sont tués ou blessés lors de cette bataille50. Leur dernière action de guerre de la campagne de 1814 a lieu à Méry-sur-Seine, où ils capturent un équipage de pont de l'armée de Bohême43.
Restauration et Cent-Jours
Après l'abdication de Napoléon et la Restauration des Bourbons, les grenadiers sont casernés à Blois, par ordonnance royale. Selon cette ordonnance, en date du , ils devaient être réorganisées en un « corps royal de cuirassiers de France »51. Sa composition est fixée par l'ordonnance du , soit un total théorique de 42 officiers et 602 hommes divisés en deux escadrons43. L'effectif est ainsi réduit de moitié tandis que la solde des cavaliers est amputée d'un quart52.
Le retour de Napoléon en France, à la fin du mois de , surprend le régiment à Arras. Celui-ci se met en route pour Paris et défile le devant l'Empereur53. Les grenadiers retrouvent peu après leur ancienne organisation et un effectif théorique de 1 042 officiers et soldats51. Cependant, au matin de la bataille de Ligny, le régiment ne compte que 44 officiers et 752 cavaliers54. Lors de la campagne de Belgique, le régiment forme, avec les dragons, la 2e division de cavalerie de la Garde commandée par le général Guyot53.
Leur seul engagement a lieu lors de la bataille de Waterloo. Le régiment y est tenu en réserve avec la cavalerie de Kellermann lorsque l'Empereur, afin de soutenir les cuirassiers de Milhaud et la cavalerie légère de la Garde aux prises avec les Anglais sur le Mont-Saint-Jean, décide d'engager la cavalerie lourde de réserve55,56. Les grenadiers à cheval, emmenés par Guyot, chargent à trois reprises les carrés britanniques mais essuient de lourdes pertes parmi lesquels le colonel-major Jean-Baptiste Jamin, tué à la tête de ses hommes par une décharge de mitraille, ainsi que deux lieutenants, Tuefferd et Moreau, et seize autres officiers blessés43.
Malgré la débâcle, les grenadiers à cheval se replient en bon ordre ainsi qu'en témoigne le capitaine Barton du 12e dragons légers britannique : « nous étions trop faibles pour faire une quelconque impression sur eux et ils se retirèrent du champ de bataille d'une manière fort majestueuse »57. Waterloo constitue le dernier fait d'armes du régiment, qui est dissous par les Bourbons à la Seconde Restauration, le 51.
Étendards
L'étendard du régiment est du modèle 1804 et a été fabriqué par la maison Picot. Le tissu est en soie et les inscriptions brodées en lettres d'or. L'emblème du 1er escadron, conservé au musée de l'Armée à Paris, porte à l'avers la mention « L'Empereur des Français au Régiment de Grenadiers à cheval de la Garde impériale » et au revers l'inscription « Valeur et discipline ― 1er escadron ». L'aigle du 2e escadron a également survécu et se trouve aujourd'hui au musée de l'Empéri de Salon-de-Provence58. En 1813, les grenadiers reçoivent un nouvel étendard qui comporte la liste des batailles et des capitales prises : Marengo, Ulm, Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland, Eckmühl, Essling, Wagram, Smolensk, Moskowa, Vienne, Berlin, Madrid et Moscou59.
-
Étendard du modèle 1804 (avers).
-
Étendard du modèle 1804 (revers).
Uniformes
Les uniformes des grenadiers à cheval de la Garde sont confectionnés par le maître-tailleur Bosquet ; les bonnets à poil et les bottes sont quant à eux fabriqués respectivement par Maillard et Fabritzius. Si, par comparaison avec d'autres régiments de cavalerie de la Garde, les grenadiers à cheval arborent des tenues plutôt simples, les dépenses consacrées aux uniformes sont très élevées, de 210 000 francs supérieures (par an et en moyenne) à celles des dragons de la Garde. Les sommes allouées pour les chevaux sont également plus importantes compte tenu de la sévérité des critères présidant à la sélection des montures60.
Troupe
L'uniforme des grenadiers à cheval est relativement semblable à celui des grenadiers à pied61. Ils portent l'habit en drap bleu impérial, à collet en drap de fond, avec revers blanc. On peut observer des parements écarlates avec des pattes blanches. Les basques sont également écarlates et les retroussis ornés de quatre grenades brodées en laine aurore sur drap blanc. Le tour des poches en long est figuré par un passepoil écarlate. Les boutons en cuivre sont estampés de l'aigle impériale. La culotte et les gants sont en peau blanche et les bottes à l'écuyère62.
Les grenadiers à cheval portent un bonnet à poil63, confectionné en peau d'ours, avec jugulaires en cuivre62. Contrairement aux grenadiers à pied, leur bonnet à poil ne comporte pas de plaque de cuivre à l'avant, mais seulement un « cul de singe » en drap écarlate sur lequel est cousu un galon aurore en forme de croix. La coiffure est dotée d'un cordon raquette en laine aurore, d'un plumet écarlate ainsi que d'une cocarde en brin de laine tricolore. Cette dernière, conçue comme un pompon, comporte l'aigle impériale brodée en fil aurore63.
En tenue de ville, les grenadiers à cheval abandonnent leurs encombrants bonnets à poil au profit de bicornes en feutre taupé, qui ne sont pas sans rappeler la coiffure de l'Empereur lui-même. Tout comme le cordon du bonnet, les aiguillettes sont en laine aurore. Les ferrets sont boutonnés sur l'épaule droite à des contre-épaulettes, également en laine aurore, et passent à travers les boutonnières des revers de l'uniforme64.
La tenue des grenadiers à cheval pendant les Cent-Jours a fait l'objet de débats. Ronald Pawly écrit que l'unité, devenue Corps royal des cuirassiers de France sous la Première Restauration, a reçu durant cette période l'uniforme des cuirassiers tout en obtenant de conserver le bonnet à poil, l'aigle présente sur les boutons étant remplacée par une fleur de lys52. Selon cet auteur, « le régiment, bien que renommé grenadiers à cheval de la Garde impériale, fit campagne dans ses uniformes royalistes »65. Cette affirmation est cependant contestée par Pierre Juhel qui montre que seuls trois habits de cuirassiers ont été confectionnés et que, en conséquence, « les 752 grenadiers à cheval en bataille au matin de Ligny devaient être très réglementairement et traditionnellement habillés, équipés et harnachés »66. Il est en revanche probable que certains effets en usage dans les derniers mois de la campagne de 1814 ont dû être retouchés sous la Première Restauration avant d'être remis à l'ancienne norme lors du bref retour de Napoléon en 181567.
Armement et équipement
Les grenadiers à cheval disposent d'un sabre, d'un mousqueton, d'une giberne et de deux pistolets62. Le sabre est pourvu d'une garde de cuivre ornée d'une grenade, ainsi que d'un fourreau de cuivre, rendu plus léger grâce à deux crevés, réalisés de chaque côté du fourreau, recouverts de cuir noir68. La dragonne de sabre est en buffle blanc62.
Chevaux et harnachement
Les grenadiers à cheval montent des chevaux noirs, bais bruns ou encore alezans foncé62. Le tapis de selle en drap bleu, bordé d'un double galon aurore et d'un passepoil écarlate, est orné aux angles postérieurs de grenades qui sont remplacées par des couronnes à partir de 180861. La bride est celle de la cavalerie lourde, le filet est en laine jaune, le mors porte une grenade sur chaque bossette, le frontal ainsi que les rosettes de tête et de queue sont en laine rouge62.
Notes et références
Notes
- Tulard 1987, p. 860 relève qu'à cette époque, les « grenadiers » ne lancent plus de grenades mais que le nom est resté, distinguant des unités d'élite.
Références
- Pigeard 2005, p. 139 et 140.
- Pawly 2009, p. 4.
- Lindsay Dawson 2011, p. 76 et 77.
- Pawly 2009, p. 10 et 11.
- Lindsay Dawson 2011, p. 57 à 61.
- Jacques Garnier, « Grenadiers », dans Jean Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, Fayard, , 1866 p. (ISBN 978-2-213-02286-4), p. 841.
- Pawly 2009, p. 10.
- Lachouque 1956, p. 49.
- Pigeard 2005, p. 141.
- Jean Brunon et Raoul Brunon (ill. Pierre Benigni et Louis Frégier), Les éclaireurs de la Garde impériale : 1813-1814, Marseille, Collection Raoul et Jean Brunon, , 72 p. (OCLC 67376767, lire en ligne [archive]), p. 15.
- Pigeard 2005, p. 147.
- Lindsay Dawson 2011, p. 74.
- Lindsay Dawson 2011, p. 24 et 26.
- Paul Guichonnet, Les Chastel : Une famille savoyarde, de l’Ancien Régime à la Révolution, de l’Empire à la Restauration, Annecy, Lolant, , 336 p. (ISBN 978-2-9532859-1-8), p. 202, 210, 213 et 214.
- Lindsay Dawson 2011, p. 26.
- Lindsay Dawson 2011, p. 25 et 202.
- Lindsay Dawson 2011, p. 202.
- Lindsay Dawson 2011, p. 65 à 67.
- Pigeard 2005, p. 142.
- Pawly 2009, p. 5.
- Lindsay Dawson 2011, p. 67.
- Castle 2004, p. 74.
- Castle 2004, p. 42 et 75.
- Castle 2004, p. 75.
- Castle 2004, p. 69.
- Pigeard 2005, p. 143.
- Hourtoulle 2007, p. 4 et 13.
- Pawly 2009, p. 15.
- Sokolov 2003, p. 450.
- Hourtoulle 2007, p. 61.
- Lindsay Dawson 2011, p. 139.
- Pawly 2009, p. 17.
- Alain Pigeard, Dictionnaire des batailles de Napoléon, Tallandier, (ISBN 2-84734-073-4), p. 534 et 535.
- François-Guy Hourtoulle (ill. Jack Girbal), Le général comte Charles Lasalle, 1775-1809 : premier cavalier de l'Empire, Copernic, , 260 p., p. 187.
- Lindsay Dawson 2011, p. 146.
- Sokolov 2003, p. 455.
- Lindsay Dawson 2011, p. 149.
- Pigeard 2005, p. 144.
- Sokolov 2003, p. 454-455.
- Lindsay Dawson 2011, p. 168.
- Lindsay Dawson 2011, p. 162.
- Tulard 1987, p. 961.
- Pigeard 2005, p. 145.
- Lindsay Dawson 2011, p. 187.
- Thoumas 2004, p. 42.
- Thoumas 2004, p. 43-44.
- Tranié et Carmigniani 1989, p. 291 et 292.
- Lindsay Dawson 2011, p. 201.
- Tranié et Carmigniani 1989, p. 118.
- Lindsay Dawson 2011, p. 28.
- Bukhari 1978, p. 3.
- Pawly 2009, p. 40.
- Pawly 2009, p. 42.
- Juhel 2009, p. 89.
- Charras et Vandermaelen 1857, p. 285.
- de la Tour d'Auvergne 1870, p. 293.
- Pawly 2009, p. 43.
- Pawly 2009, p. 13.
- Sokolov 2003, p. 538.
- Pawly 2009, p. 23-24.
- Sokolov 2003, p. 529.
- de Saint-Hilaire 1847, p. 117.
- Pigeard et Bourgeot 2013, p. 15.
- Pigeard et Bourgeot 2013, p. 16 et 20.
- Pawly 2009, p. 47.
- Juhel 2009, p. 93.
- Juhel 2009, p. 95.
Annexes
Bibliographie
 : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
- Ian Castle (préf. David G. Chandler, ill. Christa Hook), Austerlitz 1805 : le chef-d'œuvre de Napoléon, Paris, Osprey Publishing & Del Prado Éditeurs, coll. « Osprey / Armées et batailles » (no 2), (1re éd. 2002), 94 p. (ISBN 2-84349-178-9).

- Jean-Baptiste Alphonse Charras et Philippe Vandermaelen, Campagne de 1815 : Waterloo, .

- François-Guy Hourtoulle, D'Eylau à Friedland, Histoire & Collections, , 144 p. (ISBN 978-2-35250-020-9).

- Pierre Juhel (ill. Keith Rocco et Peter Bunde), De l'île d'Elbe à Waterloo : la Garde impériale pendant les Cent-Jours, Éditions de la Revue Napoléon, , 255 p. (ISBN 978-2-9524583-3-7).

- Alain Pigeard, La Garde impériale, Tallandier, , 637 p. (ISBN 978-2-84734-177-5).

- Alain Pigeard et Vincent Bourgeot, La Cavalerie de la Garde Impériale, Soteca, , 100 p. (ISBN 979-10-91561-58-7).

- Oleg Sokolov, L'Armée de Napoléon, Commios, , 592 p. (ISBN 978-2-9518364-1-9).

- Charles Thoumas, Les grands cavaliers du Premier Empire, t. 2, Librairie historique Teissèdre, , 529 p. (ISBN 0-543-96047-1).

- Édouard Louis Joseph Melchior de la Tour d'Auvergne, Waterloo : étude de la campagne de 1815, .

- Jean Tranié et Juan-Carlos Carmigniani, Napoléon 1814 : La campagne de France, Pygmalion/Gérard Watelet, , 315 p. (ISBN 2-85704-301-5).

- Jean Tulard et al., Histoire et dictionnaire de la Révolution française, Paris, Robert Laffont, , 1213 p. (ISBN 2-221-04588-2).

- (en) Emir Bukhari, Napoleon's Guard Cavalry, Osprey Publishing, , 48 p. (ISBN 978-0-85045-288-4).

- (en) Paul Lindsay Dawson, Napoleon's Gods : Grenadiers a Cheval de la Garde, Lulu.com, (ISBN 978-1-4467-4799-5).
- (en) Ronald Pawly, Mounted Grenadiers of the Imperial Guard, Osprey Publishing, coll. « Osprey / Men-at-Arms » (no 456), , 48 p. (ISBN 978-1-84603-449-7).

Articles connexes
Grenadiers à cheval de la Maison du Roi
La compagnie des Grenadiers à cheval est une unité de la Maison militaire du Roi créée par Louis XIV en 1676, principalement pour servir pour les guerres de sièges. C'est donc la seule compagnie de la Maison du Roi qui ne soit pas astreinte à servir à la cour.
Histoire
Règne de Louis XIV
Création
Au cours du XVIIe siècle, les avancées en matière de poliorcétique, notamment dues à Vauban, et la systématisation des méthodes d'approche de forteresses par les troupes assiégeantes rendent les sièges moins meurtriers. Toutefois, malgré une approche de la ville fortifiée économe en vie humaine, les assauts restent très violents. Pour être efficaces, ils doivent être effectués par quelques centaines de soldats, pour percer les lignes de défense ennemies. Les deux compagnies des mousquetaires du roi sont fréquemment utilisées pour attaquer bastions et demi-lunes. Cependant, plus de quatre-vingt mousquetaires sont tués (dont le célèbre capitaine-lieutenant de la première compagnie, D'Artagnan) au cours du siège de Maastricht. C'est trop pour un corps composé de jeunes seigneurs issus de la fine fleur de la noblesse et qui sert de pépinière d'officiers. De plus, les Gardes du corps, formant le corps le plus prestigieux de la Maison du roi, et cavaliers d'élite, se doivent de participer également aux assauts (mais à pied, comme pour les mousquetaires). Au cours d'un seul assaut à Maastricht, trente Gardes sont tués ou blessés sur la centaine engagés.
Louis XIV crée donc en décembre 1676 une nouvelle compagnie d'élite, les Grenadiers à cheval, pour servir durant les assauts aux côtés des Mousquetaires et des Garde du corps, et réduire ainsi la mortalité dans ces deux unités. La compagnie est ensuite montée dès les premiers mois de 1677, en intégrant des grenadiers d'infanterie.
Baptême du feu
Sitôt sur pied, elle effectue son baptême du feu au siège de Valenciennes, et joue un rôle décisif le 17 mars lors de la prise de la ville. Les Grenadiers à cheval attaquent avec tant d'impétuosité qu'ils devancent les autres troupes menant l'assaut avec eux, emportent l'ouvrage défensif qu'ils devaient prendre, et réussissent à gagner le rempart, et de là à abaisser le pont-levis, permettant aux Mousquetaires et au reste de l'armée d'investir la place. La compagnie participe ensuite au siège d'Ypres.
Ordonnance du roi Louis XVI du 15 décembre 1775 réformant la Compagnie des Grenadiers à cheval.
En 1691, les Grenadiers à cheval se distinguent à la bataille de Leuze. En effet, alors qu'ils sont principalement recrutés dans l'infanterie, ils chargent avec succès aux côtés des autres compagnies de la Maison militaire. Ils capturent cinq étendards aux ennemis. En récompense, le roi accorde une augmentation de l'effectif et du nombre d'officiers à la compagnie, mais également un étendard, et par conséquent une charge de porte-étendard. Dépendant administrativement des Garde du corps, ils n'en possédaient pas à leur création.
Cette bataille de Leuze voit toutefois mourir le capitaine-lieutenant de la compagnie, M. de Riotor.
Règne de Louis XV
Règne de Louis XVI
Dès le début de son règne, Louis XVI réduit les troupes de sa Maison militaire, dans un souci d'économie. La compagnie des Grenadiers à cheval est ainsi supprimée le 1er janvier 1776. Les Grenadiers sont mis à demi-solde en attendant d'être replacés dans d'autres troupes.
Composition
Le roi étant capitaine de la compagnie (comme des deux compagnies de Mousquetaires, et d'autres compagnies de sa Maison militaire), son commandant avait pour titre Capitaine-Lieutenant.
Encadrement
| | 1676 | 1691 | 1725 |
|---|
| Capitaine-Lieutenant |
1 |
1 |
1 |
|---|
| Lieutenants |
2 |
3 |
3 |
|---|
| Sous-Lieutenants |
2 |
3 |
3 |
|---|
| Maréchaux des Logis |
2 |
3 |
3 |
|---|
| Sergents |
4 |
6 |
- |
|---|
| Brigadiers |
2 |
3 |
- |
|---|
| Sous-Brigadiers |
4 |
6 |
- |
|---|
Effectifs
À sa création, la compagnie est composée de 74 simples Grenadiers, pour un effectif total de 91 maîtres. Cet effectif est ensuite augmenté en temps de guerre et réduit en temps de paix. Il atteint son maximum avec 150 maîtres avec les augmentations d'effectifs accordés par le roi à la bataille de Leuze, la compagnie s'y étant distinguée en capturant cinq étendards. Les effectifs de la compagnie varient ensuite tout au long du XVIIIe siècle, entre 130 et 150 maîtres, au gré des ordonnances royales.
Recrutement
Insignes et équipement
Uniforme
A leur création, les Grenadiers à cheval portaient un uniforme très similaire à celui des grenadiers d'infanterie. Seule la couleur rouge de leur habit permettait de les en distinguer. Toutefois, leur habillement s'est spécifié pour devenir un uniforme leur étant propre : un habit bleu avec une doublure et des parements rouges, sur une veste rouge, avec des boutons et une boutonnière argentée. Les grenadiers à cheval portaient par-dessus une bandoulière de buffle galonnée d'argent, et un ceinturon également bordé d'argent. Leur culotte et leur bas étaient rouges. Enfin, ils portaient un bonnet de drap rouge garni de poils d'ourson noir, surmonté d'une plaque.
L'étendard des Grenadiers à cheval dans l'Abrégé chronologique et historique de Le Pippre de Nœuville.
Étendard
Un étendard fut accordé à la compagnie en 1691, à la suite de la bataille de Leuze. Il s'agissait une pièce carrée de taffetas blanc, brodée d'or, et représentait une carcasse (projectile de plusieurs dizaines de kilos chargé de grenades et de poix) qui crève en l'air et jette des grenades de feu. Il portait l'inscription « Undique terror, undique lethum », « Partout la terreur, partout la mort », la devise de la compagnie.
Liste des Capitaines-Lieutenants
Notes et références
Notes
- Reconnaissable à la croix de son uniforme, le soldat à cheval n'est pas un grenadier mais un mousquetaire.
- Selon le père Daniel, dans l'ouvrage cité dans les références (1721), il n'y aurait que deux frères Riotor, le premier mourant en 1691. Toutefois, Le Pippre de Noeuville, dans l'ouvrage cité dans les références (1734), mentionne ce frère intermédiaire dans la liste des capitaines-lieutenants de la compagnie, en faisant mourir le premier frère en 1678. Le Mercure galant et le Mercure hollandais de 1678 mentionnent que le capitaine Riotor est blessé à Ypres à la tête, mais ne parlent pas de sa mort ni de son remplacement. Prière donc de bien donner sa référence avant de valider ou invalider l'existence de ce frère intermédiaire.
Références
Bibliographie
- Rémi Masson, Défendre le roi, Champ Vallon, 2017
- Simon Lamoral le Pippre de Nœuville, Abrégé chronologique et historique de l'origine, du progrès et de l'état actuel de la Maison du Roi et de toutes les troupes de France, tome 2, Liège, 1734
- Père Daniel, Histoire de la milice française, tome 2, Paris, 1721
Grenadiers de chars
À gauche, un mannequin portant la tenue d'assaut complète d'un grenadier sous "
Armée XXI". Le
SIG-552 Commando équipe seulement les unités du
DRA10.
Les grenadiers de chars sont des unités militaires d'infanterie blindée mécanisée incorporées dans les troupes blindées. Il s'agit d'un corps d'infanterie d'élite des troupes blindées de l'Armée suisse. Le terme est une traduction littérale de la dénomination allemande Panzergrenadier. Selon les pays, la désignation de ces troupes peut se nommer infanterie blindée1 ou infanterie mécanisée. Leur formation comprend une instruction adaptée à leur fonction au sein des troupes blindées en plus de leur formation d'infanterie d'élite. L'école de recrue se déroule dans les écoles de chars 21 de Thoune 2.
Mission
Les missions qui leur sont attribuées comprennent l'exploration armée, la défense des blindés, le nettoyage de poches de résistance, la fixation ou cassure d'un front, l'infiltration/exfiltration et les combats urbains3. Un accent particulier lors de l'entraînement est mis sur la lutte antichar, le combat urbain et le combat à mains nues (par exemple le close combat) et avec armes tranchantes.
Recrutement
Les critères d'incorporation dans cette troupe sont rigoureux et essentiellement fondés sur le volontariat. L'armée suisse exige un résultat d'au moins 90 points (sur 125)4 aux tests sportifs pour débuter l'école de recrue. Les abandons durant les sept premières semaines de formation sont particulièrement courants, même si le phénomène tend à s'estomper depuis la réforme "Armée XXI". En effet, en moyenne une recrue sur deux abandonne l'école de recrues de Grenadiers de char.
Description
Avec les chars de combat Leopards 2, les grenadiers de chars sont les troupes offensives des troupes blindée de l'armée suisse. Il s'agit de formations de choc et d'attaque ayant pour but de percer le front ennemi.
Ils opèrent en tête des formations mécanisées aussi bien sur un terrain découvert qu'en milieu urbain afin de faciliter le passage des troupes blindées. Équipés de lance-roquettes Panzerfaust 3, les grenadiers de chars peuvent détruire les unités blindées ennemies. Les autres armes sont le Fass 90, la grenade à main HG 85 (en), le lance-grenades additionnel (LGA), les TIFLU (tireur au fusil d'assaut à lunette), et les LMG 05 (FN Minimi). Comme l'indique leur nom, les grenadiers de chars se déplacent à l'intérieur de véhicule de combat d'infanterie. Il s'agit, depuis les années 2000, du Combat Vehicle 90 (CV9030), appelé localement char gren 2000 ou Spz 2000, qui donne une bonne mobilité tactique en zone confinée et permet un déploiement rapide des grenadiers directement à l'emplacement de la mission. L'armement embarqué de ce char comprend un canon Mk44 Bushmaster II de 30 mm, une mitrailleuse MG 51/00 (de) de 7,5 mm coaxiale et huit lance-tube nébulogènes (quatre sur les deux côtés de la tourelle). Tout cela est couplé aux divers systèmes optiques : vision nocturne, caméra thermique, caméras coaxiales. Le système d'arme embarqué est géré grâce à plusieurs joysticks et écrans plasma.
La version grenadier de ce véhicule transporte 11 hommes (1 conducteur, 1 pointeur-tireur, 1 commandant de char et 8 grenadiers embarqués). Les trois premières fonctions sont accomplies par des militaires formés au maniement du Char gren 2000, les "équipages" ou "besatze" , tandis que les 8 militaires débarqués appartiennent à des unités d'infanterie d'élite mécanisée, les "combats" ou encore "débarqués". Cette séparation dans les fonctions s'effectuent déjà lors du recrutement et les deux unités ne travaillent ensemble qu'à partir de la fin de leur école de recrue et essentiellement durant les cours de répétition.
Le char de grenadier 63/89
M113, monture des grenadiers de char de 1990 à 2005. On distingue l'emblème des grenadiers sur la tourelle.
Les grenadiers de chars subissent, depuis quelques années, de profondes modifications dans leurs méthodes d'engagement. Cela est dû à l'acquisition de nouveaux matériels. Premièrement, le vénérable char de grenadier 63/89 M113, (Spz 63/89) a été remplacé par le CV-9030, char de grenadier 2000, modifié par les suisses. L'armée suisse modifie toujours ses nouvelles acquisitions. Le CV-9030CH est maintenant plus grand (haut de plafond), a un meilleur rayon d'action et des optiques plus performantes d'origine américaine. De plus, l'État-major suit de très près les engagements de troupes similaires à l'étranger. Ainsi, de nombreuses modifications faites par l'armée américaine sur ses M2 Bradley ont été aussitôt adoptées sur le CV-9030. Deuxièmement, l'engagement de combats de nuit est devenu une constante dans l'entraînement de cette troupe. L'acquisition de lunettes ILR (Intensificateur de Lumière Résiduelle) pour chaque soldat ainsi que la dotation de caméra IR couplé au système d'arme du char a rendu possible cette évolution.
- Unités
Brigade blindée 11 sur l'aérodrome de Dübendorf en 2007
En 2018, les grenadiers de chars sont incorporés dans deux des trois brigades mécanisées. L'école de recrue se déroule à Thoune au sein de l'École de char 21 de la Formation d’application des blindés et de l’artillerie (FOAP) comme on l'a vu plus haut. chaque recrue est incorporée dans un bataillon (chaque bataillon a son écusson distinctif5).
- Brigade mécanisée 1
- Compagnie de commandement du bataillon d'état-major de la brigade mécanisée 1
- Bataillon de chars 12
- Bataillon mécanisé 17
- Bataillon mécanisé 18
- Brigade mécanisée 11 Panzerbrigade 11 (de)
- Compagnie de commandement du Mechanisierte d'état-major 11
- Bataillon de chars 13
- Bataillon mécanisé 14
- Bataillon mécanisé 29
Notes et références
- Les appuis organiques de l'infanterie : domaine d'emploi, panorama et évolution, janvier-février 2006, par Philippe Dettori-Campus [archive], Revue Militaire Suisse
- Armée suisse, « Ecole de chars 21 » [archive], sur www.vtg.admin.ch/ (consulté le )
- Armée suisse, « Grenadier de chars » [archive], sur /www.miljobs.ch/f et Armée suisse, (consulté le )
- Armée suisse, « Grenadier/grenadière de chars » [archive]

Article connexe
Garde royale (France)
Première Restauration
Portrait d'un mousquetaire du roi.
Lorsque Louis XVIII rentre en France en 1814, il entend redonner de l'éclat à sa maison. C'est avec cet objectif en tête qu'il crée un ministère de la maison du roi, confié à Pierre de Blacas. Ce dernier, secondé par Pierre Denniée, cherche alors à reconstituer la maison militaire telle qu'elle avait pu l'être sous l'Ancien Régime. L'ordonnance du entérine la création de plusieurs unités, dont certaines avaient déjà disparu avant la Révolution.
En 1814, la maison militaire du roi se compose ainsi :
La maison militaire proprement dite est ainsi formée d'environ 5 000 hommes, dont 4 629 cavaliers. Il faut également ajouter, pour la garde du roi, six régiments de corps royaux, composés de 2 758 fantassins et 2 574 cavaliers.
Louis XVIII utilise sa maison militaire pour rehausser son prestige. Par exemple, lors de la cérémonie de translation des dépouilles de Louis XVI et Marie-Antoinette, le , les mousquetaires sont employés et sont très remarqués pour leur prestance et la beauté de leur uniforme1.
Seconde Restauration
Après les Cent-Jours, la maison militaire est réorganisée et son effectif diminué. L'ordonnance du , supprime plusieurs unités, dont les gardes de la porte, les mousquetaires, les gendarmes et les chevau-légers. Les gardes de la prévôté sont licenciés le 2.
Parallèlement, Louis XVIII décide de la création d'une garde royale à partir des six régiments de corps royaux. La mission théorique de cette garde est de veiller, avec la maison militaire, à la protection du roi. Dans les faits, elle devient rapidement une unité combattante, à l'instar de la garde impériale. Réserve d'élite de l'armée, les hommes de la garde se doivent d'être irréprochables.
Les effectifs de la garde sont fixés à 25 000 hommes, organisés en huit régiments d'infanterie – dont deux suisses – avec trois bataillons chacun et huit régiments de cavalerie avec six escadrons chacun. S'y ajoute un régiment d'artillerie de huit batteries (48 bouches à feu).
Le roi conserve le commandement théorique de la garde et se réserve le titre de colonel général. Il place à la tête de la garde royale quatre maréchaux avec le titre de majors généraux : le duc de Reggio, le duc de Bellune, le duc de Tarente et le duc de Raguse.
La garde royale s'érige en modèle de l'armée. Elle participe en 1823 à l'expédition d'Espagne et se montre digne du rang qui lui est assigné. La prise du Trocadéro est un de ses faits d'armes glorieux. En 1830 la portion de la garde royale qui se trouve à Paris lutte héroïquement pour défendre la monarchie.
La garde royale est licenciée, en même temps que la maison militaire le , à la suite des Trois Glorieuses et de l'expulsion de la branche aînée des Bourbon.
Formation et recrutement
Le fait d'être admis dans la garde royale est considéré comme une des plus importantes récompenses militaires de l'armée française. Louis XVIII, qui n'a pas confiance dans ce qui lui reste d'armée, met à son commandement surtout des émigrés, comme pour la maison militaire. Les officiers sont au choix du roi.
L'uniforme de ces corps est plus brillant que celui des troupes de ligne, leur solde plus forte, leur rang plus élevé, leurs droits plus étendus : le soldat y est assimilé au caporal, le caporal au sergent et ainsi de suite jusqu'aux grades les plus élevés. Cet avantage est retiré à la garde en 1826 mais les officiers sont, après quatre ans de grade, dotés du rang supérieur et lorsqu'ils obtiennent plus tard un emploi dans cet autre grade, ils prennent rang du jour où ils avaient dépassé ces quatre années exigées.
La garde royale se compose d'hommes d'élite choisis dans les corps de l'armée.
Composition
Maison du roi (6 compagnies)
Capitaine des gardes du corps du roi.
Infanterie (8 régiments)
- 1er régiment d'infanterie de la garde.
- 2e régiment d'infanterie de la garde.
- 3e régiment d'infanterie de la garde.
- 4e régiment d'infanterie de la garde.
- 5e régiment d'infanterie de la garde.
- 6e régiment d'infanterie de la garde.
- 7e régiment suisse d'infanterie de la garde.
- 8e régiment suisse d'infanterie de la garde.
Cavalerie (8 régiments)
Cavalerie de la garde royale.
- 1er régiment de grenadiers de la garde.
- 2d régiment de grenadiers de la garde.
- 1er régiment de cuirassiers de la garde.
- 2d régiment de cuirassiers de la garde.
- Régiment de dragons de la garde.
- Régiment de chasseurs de la garde.
- Régiment de hussards de la garde.
- Régiment de lanciers de la garde.
Artillerie (1 régiment)
Artillerie de la garde royale.
Articles connexes
Notes et références
Cavalerie
La cavalerie est l'arme des militaires ou des guerriers qui combattent à cheval. Historiquement, elle est la troisième plus ancienne des armes de combat (après l'infanterie et les chariots de guerre) et la plus mobile.
L'appellation de cavalerie n'est généralement pas utilisée pour les forces militaires qui utilisent d'autres montures (chameaux ou mules par exemple). Quant au concept d'infanterie montée (qui se déplace à cheval mais combat à pied), il apparaît au XVIIe siècle avec les dragons, une arme initialement à part mais qui s'intégrera par la suite dans la cavalerie dite de « ligne ».
Dès les premiers temps de son utilisation, la cavalerie offre l'avantage de la mobilité, qui en fait un instrument de guerre redoutable car elle permet de déborder et d'éviter l'adversaire, de surprendre et de vaincre, de battre en retraite et d'échapper à l'ennemi en fonction des besoins du moment. C'est aussi l'arme de la reconnaissance et des raids dans la profondeur. La monture confère au cavalier plusieurs avantages sur son adversaire à pied : vitesse, hauteur, masse et inertie lors du choc. Un autre facteur de supériorité résulte de l'impact psychologique de l'apparition du soldat à cheval sur le fantassin.
La mobilité et la capacité de choc de la cavalerie sont grandement appréciées et exploitées dans les différentes forces armées sous l'Antiquité et au Moyen Âge ; certaines forces étant principalement composées de cavalerie, en particulier dans les tribus nomades de l'Asie, comme les Mongols. Chez ces peuples de cavaliers se développe le concept de la cavalerie légère qui prône la vitesse et la surprise, avec des combattants montés, équipés et armés légèrement . En Europe, la cavalerie se dote au contraire d'armures lourdes et pesantes et les chevaliers agissent comme une cavalerie lourde, en privilégiant la recherche d'une action décisive au moyen d'un choc frontal. Au cours du XVIIe siècle, la cavalerie européenne abandonne l'armure, inefficace contre les fusils et les canons qui font leur apparition. Néanmoins, certains corps de cavalerie tels que les cuirassiers conservent une cuirasse petite et épaisse qui bénéficie d'une protection contre les lances et les sabres et une certaine protection contre les projectiles tirés à longue distance.
Durant la période entre les deux guerres mondiales, de nombreuses unités de cavalerie sont converties en infanterie motorisée ou en unités mécanisées et blindées. Cependant, la cavalerie sert encore pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment dans les armées allemande, italienne, polonaise et soviétique, généralement sur les arrières du front. Actuellement, la plupart des unités de cavalerie montées servent dans des rôles de prestige, ou - beaucoup plus rarement - comme infanterie montée sur des terrains difficiles comme les montagnes ou les zones densément boisées. L'utilisation moderne du terme se réfère à des unités spécialisées dotées de chars (« cavalerie blindée ») ou d'aéronefs (« cavalerie de l'air »).
Historique
Origine et développement
Les Scythes, peuples indo-européens d'éleveurs nomades en Eurasie centrale dans l'Antiquité, développent la cavalerie montée légère et utilisent des arcs à la fois courts et puissants en raison de leur forme. Auparavant, les chevaux servaient surtout à tirer des chars de combat mais n'étaient pas encore montés de façon régulière. Les traditions scythiques de cavalerie montée seront reprises des siècles plus tard au Moyen Âge par les peuples turcs puis mongols, originaires d'Asie orientale, et permettront à Genghis Khan et ses troupes de conquérir l'Asie centrale à leur tour, ainsi que la Chine et une partie de l'Europe au XIIIe siècle en formant ainsi l'Empire mongol1,2.
Dans l'Antiquité, Alexandre le Grand fait usage de sa cavalerie pour manœuvrer rapidement par les flancs et attaquer le général ennemi ou l'arrière des phalanges selon la tactique du marteau et de l'enclume. Le cavalier est armé d'une lance tenue au-dessus de l'épaule avec laquelle il harponne l'adversaire, mais qui peut aussi servir d'arme de jet, la vitesse du cheval s'ajoutant à celle du lancé.
La cavalerie a longtemps été un moyen de reconnaissance ou de communication entre les différents corps d'armée plutôt qu'une réelle force de combat. Le coût de l'entretien d'un cheval était tel que bien peu de personnes étaient capables de l'assumer. La cavalerie pose aussi d'importants problèmes logistiques. La présence des animaux implique la construction d'enclos, le transport de fourrage, l'emploi de palefreniers… Mais la force d'un corps de cavalerie face à des fantassins est telle que très rapidement les armées s’organisent pour avoir un certain nombre de ces soldats en soutien des troupes plus classiques.
Les Romains recrutent ainsi l'essentiel de leur cavalerie chez les auxiliaires barbares qui sont souvent d'anciens ou futurs adversaires. Les peuples scythes, et notamment les Sarmates, ont également développé des races de chevaux plus puissantes qui permettront de développer les premières cavaleries lourdes et les premiers cataphractaires, qui seront rapidement adoptés par les Perses et les Parthes puis les Romains. Un élément de cavalerie lourde, protégé d'une épaisse cotte de maille est chargé de briser les formations d'infanterie adverse3. La cavalerie lourde, coûteuse, sera surtout le signe d'une cavalerie de guerre aristocratique et deviendra un des fondements des chevaliers du Moyen Âge européen et de la féodalité.
Avec l'apparition progressive des rênes, du mors, et surtout des étriers qui permettent de se dresser sur les jambes et donc d'avoir plus de force lors de l'impact d'une charge, la cavalerie devient un enjeu stratégique pour les armées (voir toutefois la Grande controverse de l'étrier). L'infanterie montée, bien qu'elle se batte à pied, permet aussi de déployer des troupes rapidement sur de longues distances.
Dans les armées féodales, la cavalerie était presque exclusivement composée de nobles, seuls capables d'acheter et de financer l'entretien de leurs chevaux. Cette tradition perdura assez longtemps mais finira par se restreindre au corps des officiers (toujours obligés de financer leur équipement, à l'opposé de la troupe). La cavalerie avait donc acquis un statut de prestige.
Face aux murs de boucliers et piques à une main de l'infanterie, la lance du cavalier s'allonge et se cale sous le bras. L'armure se renforce et la cotte de maille se recouvrera progressivement de plate. La charge coordonnée de chevaliers devient un outil de percussion visant à briser la ligne de l'adversaire. La cavalerie lourde sera considérée pendant tout le Moyen Âge comme une arme décisive et les batailles tournaient souvent à l'avantage du camp qui en possédait le plus grand nombre. C'était particulièrement vrai pour les batailles en plaine.
Pour contrer la cavalerie, la tactique s'oriente vers la défensive, avec des forts en pierres ou des palissades de bois temporaires. À Crécy et Azincourt, les chevaux de la cavalerie française se font massacrer par les archers anglais équipés de leur arc long (long bow) en bois d'if, et les pieux et fossés qu'ils ont placés devant eux.
Les armures lourdes se démocratisent et les boucliers deviennent moins utiles, libérant la deuxième main. La cavalerie lourde des chevaliers devient fréquemment tenue en échec par une version modernisée de la phalange grec : des masses solidaires d'infanterie lourde couvertes d'armures de plates et équipées de longues piques ou de hallebardes. Les troupes mercenaires suisses, des professionnels de la guerre, en font leur spécialité. À ces formations défensives viennent s'adjoindre les arbalètes, puis les armes à feu qui leur donnent des capacités offensives à distance.
Les armes à feu apparaissent en Europe au Moyen Âge central (XIe au XIIIe siècle) : couleuvrine, arquebuse et pistolet. La cavalerie doit évoluer, et les chevaux lourds sont écartés au profit de chevaux puissants et légers, les armures sont abandonnées au profit de cottes légères et de minces cuirasses…
XVIIe siècle
Au XVIIe siècle, avec la venue des armes à feu, apparaît l'escadron, qui se forme en profondeur (avec des tactiques comme la caracole, chaque rang se servant successivement de ses pistolets avant d'aller se reformer à l'arrière de la formation). Les évolutions se font alors surtout au pas ou au trot[réf. souhaitée]4.
Mais si l’apparition des armes à feu a semblé mettre un terme à la prééminence du choc (c'est-à-dire de la charge), à partir du XVIIe siècle5, l’arme blanche redevient progressivement l’arme de choix. et le format des escadrons évolue en conséquence. Ainsi, aux lourds escadrons « carrés » de plusieurs centaines d’hommes sur une dizaine de rangs et plus de l’époque des reîtres et de la caracole, vont succéder des escadrons sur quatre, puis trois, puis à partir de la guerre de Sept Ans, sur deux rangs.
XVIIIe siècle
Par la suite, le sabre remplace l’épée et devient l’arme principale pour la charge qui, au XVIIIe siècle, est conduite – ou achevée – au galop.
À cette époque la lance ne joue plus depuis longtemps qu’un rôle marginal (même si Napoléon, impressionné par les lanciers polonais, intégra un de leurs régiments à la Garde impériale et recréa des unités de lanciers). Enfin, tous les cavaliers sont équipés d’un ou deux pistolets et d’une carabine ou d’un mousqueton (ou d’un fusil – plus long et plus lourd - dans le cas des dragons qui étaient censés combattre aussi bien à pied qu’à cheval).
Au fil de l'histoire, différentes composantes de cavalerie sont apparues :
- Cavalerie de ligne : dans certains pays (comme notamment la France sous Napoléon), on distingue une catégorie supplémentaire, intermédiaire entre la cavalerie légère et la cavalerie lourde, orientée vers la bataille proprement dite.
- dragons pouvant à l'origine combattre à cheval (cavalerie) ou à pied (infanterie). Napoléon leur attribua définitivement un rôle de cavaliers qu'ils conserveront par la suite.
- lanciers (appelés également Uhlans ou chevau-légers lanciers) : cavaliers armés d'une lance.
XIXe siècle et XXe siècle
L’avènement des armes à tir rapide au XIXe siècle transforme profondément le caractère de la guerre à cheval en Europe (le cheval conservera néanmoins un rôle non négligeable jusqu’au XXe siècle dans certains conflits, notamment coloniaux)6.
La toute dernière charge de cavalerie effectuée en Europe occidentale fut celle de Burkel (Belgique).
La question du rôle - et même de l'utilité - de la cavalerie sur le champ de bataille se pose et la doctrine d'emploi fluctue entre le maintien et la disparition de la charge (en France, au début du XXe siècle, il est courant d'entendre que « la cavalerie manœuvre à cheval mais combat à pied »).
L'infanterie est plus lente mais elle dispose désormais des moyens de contrer n'importe quelle charge de cavalerie. Les dernières charges de cavalerie à cheval se soldent par des hécatombes qui forcent les armées à se concentrer sur l'infanterie et l'artillerie.
Le cheval prend alors un rôle nouveau dans l'armée et sert presque exclusivement au transport, avant d'être également remplacé dans ce rôle par le véhicule automobile. Quelques armées conserveront cependant des troupes à cheval jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
En France
En France, les formations héritières de la cavalerie seront regroupées dans l'arme blindée et cavalerie en 1943 (le saint protecteur de la cavalerie française reste saint Georges, de là vient le proverbe : « Par saint Georges, vive la cavalerie ! »).
De nos jours, la cavalerie est utilisée comme symbole de prestige et de nombreuses armées conservent un corps monté pour les défilés et les représentations officielles. Les régiments de l'Arme blindée et cavalerie en sont les héritiers dans les armées modernes.
La défense de Paris a toujours reposé sur un système de complexes fortifiés. Paris n'a jamais eu de grande garnison de cavalerie. Sa garnison fut principalement armée par des troupes à pied, par les servants des pièces d'artillerie et par les sapeurs et unités du génie spécialistes des fortifications7.
Cependant, la cavalerie demeura bien présente dans la capitale, le cheval étant la monture des hommes de pouvoir et de leur entourage jusqu'au maréchal de Mac-Mahon. Omis lors des émeutes populaires où elle fut combattante, la cavalerie à Paris fut d'abord un service de Cour qui assurait la sécurité, la garde et l'escorte des souverains dont elle rehaussait le prestige. L'armée montée participait aux manifestations de prestige, aux couronnements et investitures, aux réceptions de chefs d'État, ainsi qu'aux grands évènements sportifs comme les courses. Elle figurait dans les manifestations publiques tels les défilés et les revues7.
Sous l'Ancien Régime, la cavalerie à Paris se confondait avec l'organisation et le service de la Maison du roi. Lorsque Louis XIII créa en 1622 le corps des Mousquetaires, seule une partie servait à cheval. Affectés à la garde du roi, ils participaient aux campagnes militaires et quittaient alors Paris. Les chevaux étaient logés et soignés dans les deux hôtels affectés aux mousquetaires, l'hôtel des Mousquetaires gris construit en 1671 dont la façade se situait rue du Bac, et l'hôtel des Mousquetaires noirs rue de Charenton. Le licenciement des mousquetaires en 1776 par Louis XVI mit fin provisoirement à la présence d'une charge à cheval affectée au souverain. L'École de Mars créée en 1794 compta des cavaliers dans ses rangs7.
Les unités de cavaleries revinrent réellement à Paris avec la création de la Garde consulaire, remplacée par la Garde impériale. La cavalerie de la Garde préposée au service est logée dans l'abbaye de Penthémont, à l'angle des rues de Grenelle et de Bellechasse qui pouvait contenir au maximum 169 chevaux. Ces locaux furent occupés jusqu'en 1848. Les autres nombreux régiments de la Garde, dont les détachements se succédaient à Paris, y tinrent peu garnison. Ils venaient pour les revues et les réceptions aux troupes après les campagnes. Napoléon avait envisagé en 1812 de faire construire de part et d'autre du Champ de Mars une cité administrative comprenant des quartiers de cavalerie, mais n'eut pas le temps de mener ce projet à son terme7.
La cavalerie des coalisés envahit Paris en 1814. Les cosaques bivouaquèrent alors sur les Champs-Élysées.
Pendant la Restauration et la Monarchie de Juillet, la cavalerie se fixa à Versailles. Lors des émeutes parisiennes de la première moitié du XIXe siècle, les cavaliers furent guère efficaces dans une guerre de rue impossible à mener à cheval. Ils répugnaient à mener des combats contre des civils, le maintien de l'ordre étant dévolu normalement à la Garde nationale7. Jusqu'à l'avènement de la IIIe République, le souverain organisa des parades à cheval. Ainsi, Charles X et Louis-Philippe aimaient se montrer à cheval en public entourés de leur garde à cheval.
Au Second Empire, la garnison parisienne comprenait la Garde impériale et une division de cavalerie logée à Paris ou à proximité. Plusieurs unités tenaient garnison aux environs et étaient susceptibles de se déplacer pour les services et manifestations programmées. Les dragons de l'impératrice étaient ainsi à Fontainebleau ; les guides, les chasseurs et les cuirassiers se déplaçaient entre Meaux, Compiègne, Melun et Fontainebleau. Seuls l'escadron des Cent gardes et les gendarmes d'élite demeuraient en permanence dans Paris, à Penthémont, dans la nouvelle caserne de la Cité à partir de 1867 et pour un seul escadron, à Orsay et aux Célestins. La cavalerie de ligne était cantonnée dans les forts de l'enceinte et à Vincennes. Les deux régiments de dragons étaient dans Paris intra muros. L'importance des troupes montées ne cessa de grandir sous Napoléon III. Le décret du 1er mai 1854 limitait la cavalerie de la Garde à deux régiments, les cuirassiers et les guides. Dès 1855, son effectif est accru à une division de cavalerie comportant trois brigades. Elle comprit au total deux régiments de cavalerie lourde composée de cuirassiers, et quatre régiments de cavalerie légère, un de dragon, un de lanciers, un de chasseurs et un de guides. Les guides escortaient l'empereur et son entourage lors des solennités. Lors de l'attentat d'Orsini en 1858, une quinzaine de cavaliers furent blessés7.
Avec la IIIe République, les services protocolaires de la cavalerie sont plus restreints et plus distants. Les unités de cavalerie interviennent lors de l'accueil des chefs d'État étrangers ainsi que lors des déplacements des plus hautes autorités militaires. Progressivement ces services sont confiés à la seule Garde républicaine qui possède un régiment à cheval n'ayant pour autant jamais appartenu à la cavalerie. Des unités de cavalerie combattantes subsistèrent à Paris et dans sa périphérie, notamment à Vincennes, jusqu'à la fin de la IIIe République. Elles participaient aux défilés et manifestations purement militaires qui se déroulaient dans la capitale, tels la présentation à l'étendard, les revues des troupes et les défilés lors de la fête nationale7.
Le cheval de cavalerie
Le cheval de cavalerie doit être un cheval de guerre possédant une grande vitesse, une puissance de choc, une aptitude à la poursuite, à la reconnaissance et aux patrouilles. Contre une batterie ou un carré de fantassins, la cavalerie ne peut l'emporter que par une extrême rapidité dans l'approche, le contact permettant de disloquer les rangs ennemis. Pour ce faire, la cavalerie doit donc exécuter de grandes actions coordonnées8.
En France
La cavalerie légère, chasseurs et hussards, était montée en chevaux légers et la cavalerie lourde, cuirassiers et dragons, en chevaux puissants. Le travail des cavaliers se focalisait principalement sur les manœuvres et les mouvements d'ensemble9.
Jusqu'à la Renaissance, le destrier était caparaçonné, robuste et fort. Le dressage du cheval est une nécessité du commandement individuel et est basé sur la croyance que le cheval est un être pensant10.
À partir du règne de Louis XIII, les grands seigneurs abandonnent l'élevage pour fréquenter la Cour. Les races françaises de chevaux dégénèrent et se perdent, l'armée recourt aux races étrangères et notamment aux andalous. Pour remédier à cet état et normer les chevaux utilisés par les troupes à cheval, Colbert crée les étalons royaux le 17 octobre 1665. Ces étalons sont marqués d'un « L » couronné à la cuisse. Les troupes à cheval se hiérarchisent et s'uniformisent sous l'autorité du roi pour devenir un corps homogène, la Cavalerie10.
Notes et références
- Véronique Schiltz, Les Scythes et les nomades des steppes, Gallimard, 1994.
- Iaroslav Lebedynsky, Les Scythes. La civilisation nomade des steppes, VIIe-IIIe av. J.-C., Errance, Paris, seconde édition 2011.
- Iaroslav Lebedynsky. Les Sarmates, Amazones et lanciers cuirassés entre Oural et Danube, VIIe siècle av. J.-C. - VIe siècle apr. J.-C., Errance, seconde édition 2014.
- Olivier Chaline, « Au temps de la guerre de Trente Ans, 1618-1648 », in Frédéric Chauvire (dir.) et Bertrand Fonck (dir.), L'âge d'or de la cavalerie, Paris, Gallimard Ministère de la Défense, , 280 p. (ISBN 978-2-07-014684-0), p. 85.
- Daniel Roche (dir.), Le cheval et la guerre : du XVe au XXe siècle, Paris (42 rue Sibuet, 75012, Association pour l'Académie d'art équestre de Versailles, , 399 p. (ISBN 978-2-913018-02-0), p. 19
- Gervase Phillips, « La cavalerie au combat au XIXe siècle », in Frédéric Chauvire (dir.) et Bertrand Fonck (dir.), L'âge d'or de la cavalerie, Paris, Gallimard Ministère de la Défense, , 280 p. (ISBN 978-2-07-014684-0), p. 219
- Pierre Garrigou Grandchamp, Le cheval à Paris, Paris, Action artistique de la ville de Paris, , 215 p. (ISBN 2-913246-56-7), La cavalerie
- André Champsaur, Le guide de l'art équestre en Europe, Lyon, La Manufacture, 4ème trimestre 1993, 214 p. (ISBN 978-2-7377-0332-4)
- Michel Henriquet et Alain Prevost, L'équitation, un art, une passion, Paris, Éditions du Seuil, , 319 p.
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Bibliographie
Ouvrages généraux
- Frédéric Chauviré, La Charge de cavalerie des origines à nos jours, de Bayard à Seidlitz, Thèse de doctorat, Université de Nantes, 382 p., 2009, édité en 2013 chez Perrin.
- (Gal.) Louis Susane, Histoire de la Cavalerie Française, tome 1, Paris, J. Hetzel et Cie, 1874.
- (Gal. Baron) Bardin, Dictionnaire de l’Armée de terre, Paris, Coréard, 1843.
- André Corvisier, Histoire militaire de la France (4 tomes), Quadrige/PUF.
- Jean-Pierre Béneytou, Histoire de la cavalerie française des origines à nos jours, éditions Lavauzelle, Panazol, 2010.
- (Colonel Dugué) Mac Carthy, La Cavalerie au temps des chevaux, Éditions Pratiques Automobiles (EPA), 327 p., 1989. (ISBN 2851203134 et 978-2851203137) [présentation en ligne [archive]]
Ouvrages par période
- Antiquité
- Alexandre Blaineau (préf. Pierre Brulé), Le cheval de guerre en Grèce ancienne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, , 348 p. (ISBN 978-2-7535-4136-8).
- (en) Philip Sidnell, Warhorse : cavalry in ancient warfare, London New York, Hambledon Continuum, , 363 p. (ISBN 978-1-84725-023-0).
- Moyen Âge
- Philippe Contamine, La guerre au Moyen âge, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio / l'histoire et ses problèmes », , 516 p. (ISBN 978-2-13-050484-9).
- Époque moderne
- Cdt Louis-Auguste Picard, La cavalerie dans les guerres de la Révolution et de l'Empire, Paris, Teissèdre, coll. « bicentenaire de l'épopée impériale / Études », , 2 volumes, 419 et 406 pages (ISBN 978-2-912259-48-6).
- Époque contemporaine
-
Articles connexes
Liens externes
Cavalerie de la Garde impériale (Premier Empire)
La cavalerie de la Garde impériale correspond à l'ensemble des unités militaires de cavalerie appartenant à la Garde impériale de Napoléon Ier. Unité combattante d'élite, elle devient la réserve ultime de l'armée. Elle est utilisée, en dernier ressort, pour donner le coup de grâce ou débloquer une situation périlleuse.
En 1804, la cavalerie de la Garde impériale est initialement composée de trois unités : les grenadiers à cheval, les chasseurs à cheval et les mamelouks. Par la suite, d'autres corps de cavalerie intègrent la Garde impériale, comme les dragons en 1806, les lanciers polonais en 1807, les lanciers rouges en 1810, les lanciers lituaniens et les tartares lituaniens en 1812, ainsi que les éclaireurs en 1813. D'autres unités de cavalerie sont rattachées à la Garde impériale ou servent statutairement à ses côtés, comme les gendarmes d'élite, les gendarmes d'ordonnance, les chevau-légers de Berg ou encore les gardes d'honneur.
À l'apogée du Premier Empire en 1812, la Garde impériale compte environ 7 000 cavaliers, quand la Grande Armée dans son intégralité en compte approximativement 77 000. De sa création jusqu'en 1813, la cavalerie de la Garde est commandée par le maréchal Jean-Baptiste Bessières, duc d'Istrie. Tué par un boulet au début de la campagne d'Allemagne, son commandement est relevé par le général Nansouty.
Unités organiques
La Garde impériale est constituée au début du Premier Empire par décret impérial du , remplaçant la garde consulaire. Trois unités de cavalerie en font initialement partie : le régiment des chasseurs à cheval, le régiment des grenadiers à cheval et la compagnie des mamelouks (rattachée aux chasseurs à cheval). Les gendarmes d’élite font également partie de la Garde impériale, mais leur rôle et leurs missions diffèrent de ceux des autres unités. En 1806, le régiment des dragons est créé. Le régiment des lanciers polonais est formé en 1807, le recrutement étant effectué dans la noblesse polonaise. Ils ne disposent de la lance qu’en 1809, après la bataille de Wagram.
En 1810, un nouveau régiment de lanciers, les lanciers rouges, est formé à partir du régiment de hussards de la Garde hollandaise. En 1812, un troisième régiment de lanciers, les lanciers lituaniens, est recruté, ainsi qu'un escadron de tartares lituaniens. En 1813, trois régiments d’éclaireurs, armés de la lance, sont formés. Le premier est rattaché aux grenadiers à cheval, le deuxième aux dragons et le troisième aux lanciers polonais.
Les grenadiers à cheval, les chasseurs à cheval, les mamelouks, les dragons, les lanciers polonais et le 1er escadron du 1er régiment d'éclaireurs font partie de la prestigieuse Vieille Garde.
Grenadiers à cheval
L'origine des grenadiers à cheval remonte en octobre 1796, lorsque le gouvernement français décide d'incorporer à la Garde du Directoire une unité à cheval : un corps de deux compagnies, totalisant 112 cavaliers, est créé1. L'année suivante, cette unité reçoit le nom de grenadiers à cheval et après le coup d'État du 18 brumaire, elle devient la première formation de cavalerie de la Garde consulaire1.
En 1804, avec l'instauration du Premier Empire, le corps des grenadiers à cheval de la Garde des consuls devient le régiment des grenadiers à cheval de la Garde impériale, qui comprend quatre escadrons pour un effectif total de 1 018 cavaliers2. Ils participent à la campagne d'Autriche de 1805 et se distinguent particulièrement à Austerlitz, où leurs charges contre la cavalerie de la Garde russe, en compagnie des chasseurs et des mamelouks, se révèlent efficaces et permettent de repousser la contre-attaque du grand-duc Constantin3. Absents lors de la campagne de Prusse, ils se rattrapent à la bataille d'Eylau, lorsque le colonel Lepic et ses grenadiers parviennent à s'extraire de l'encerclement en se frayant un passage jusqu'aux lignes françaises4. Le régiment part ensuite pour l'Espagne mais n'y est pas beaucoup employé. En 1809, les grenadiers à cheval sont présents à Essling et Wagram. Leur effectif est porté à cinq escadrons en 1812, à la veille de la campagne de Russie5,2. Au cours de cette dernière, ils déplorent de fortes pertes et le régiment est réduit à quatre escadrons en février 18132. Il combat par la suite lors de la campagne d'Allemagne et pendant la campagne de France, notamment à Vauchamps et Craonne.
Sous la Première Restauration, les grenadiers à cheval reçoivent la dénomination de Corps royal des cuirassiers de France. Pendant les Cent-Jours, le régiment reprend son ancien nom et participe à la campagne de Belgique de 1815, où il charge les carrés britanniques à la bataille de Waterloo. Le corps des grenadiers à cheval est finalement dissous le durant la Seconde Restauration2.
Chasseurs à cheval
Chasseurs à cheval de la Garde impériale escortant l'Empereur, par
Job.
Le , pendant la première campagne d'Italie, le général Napoléon Bonaparte ordonne la création d'une compagnie de guides à cheval, chargée de sa protection et de celle de l'état-major. Le capitaine Bessières, du 22e régiment de chasseurs à cheval, prend le commandement du corps, avec la possibilité de nommer ou renvoyer des soldats pour son unité6. La compagnie des guides s'illustre notamment à Arcole, avant de prendre part à la campagne d'Égypte où elle charge au Mont-Thabor et à Saint-Jean-d'Acre. Après le retour de Napoléon en France et l'instauration du Consulat, la compagnie des guides devient la compagnie des chasseurs à cheval de la Garde consulaire ; le capitaine Eugène de Beauharnais en devient le commandant7.
En 1804, Napoléon devient empereur et instaure la Garde impériale. La compagnie des chasseurs devient le régiment des chasseurs à cheval de la Garde impériale, organisé en quatre escadrons totalisant 1 018 hommes, auxquels est adjoint la compagnie des mamelouks8. L'unité est engagée dans la campagne d'Autriche en 1805, sous le commandement du colonel Morland : à Austerlitz, ils repoussent la cavalerie de la Garde russe conjointement avec les grenadiers à cheval et les mamelouks, au prix de 22 tués dont Morland9. Le régiment ne participe pas activement à la campagne de Prusse en 1806, mais l'année suivante, il charge l'infanterie russe à Eylau sous les ordres du général Dahlmann qui est mortellement blessé. En 1808, le général Lefebvre-Desnouettes prend le commandement des chasseurs à cheval de la Garde. La même année, ces derniers prennent part à la guerre d'Espagne et contribuent à la répression du soulèvement du Dos de Mayo10. Vaincus à Benavente, les chasseurs s'acheminent vers l'Europe centrale et se distinguent à la bataille de Wagram, où ils mettent en déroute la cavalerie autrichienne en compagnie des chevau-légers polonais11.
En 1812, pendant la campagne de Russie, les chasseurs à cheval de la Garde protègent Napoléon lors du combat de Gorodnia, repoussant les cosaques avec l'aide des autres régiments de la cavalerie de la Garde12. À la fin de la campagne, l'unité ne compte plus que 209 cavaliers mais les effectifs sont augmentés et les chasseurs participent aux campagnes d'Allemagne et de France, notamment à Leipzig, Hanau, Montmirail et Craonne. À la Première Restauration, les chasseurs à cheval de la Garde deviennent le Corps royal des chasseurs de France avant de reprendre leur ancien nom durant les Cent-Jours, où ils chargent à Waterloo13. L'unité des chasseurs à cheval de la Garde impériale est finalement dissoute entre le 26 octobre et le 6 novembre 1815, lors de la Seconde Restauration.
Mamelouks
Le chef d'escadron Kirmann à la tête des mamelouks. Illustration de
Tanconville.
En 1798, pendant la campagne d'Égypte, le général Napoléon Bonaparte affronte les mamelouks, des cavaliers assujettis depuis plusieurs siècles à l'Empire ottoman. Impressionné par leurs qualités de soldats, il décide d'incorporer une unité similaire dans l'armée française14. Ces mamelouks suivent le corps expéditionnaire lors de son retour en France et, le , un décret ordonne la création d'un escadron de mamelouks de 240 soldats intégré à la Garde consulaire, chiffre qui est ensuite ramené à 150 le 15. Le commandement en revient au colonel Jean Rapp, aide de camp de Napoléon. Le , l'escadron aligne 13 officiers et 155 hommes16. En 1804, les mamelouks ne forment plus qu'une compagnie, adjointe aux chasseurs à cheval de la Garde impériale17.
Prenant part à la campagne d'Autriche de 1805, les mamelouks se distinguent particulièrement à Austerlitz : alors que l'infanterie française est malmené sur le plateau de Pratzen par la cavalerie de la Garde russe, l'Empereur ordonne au maréchal Bessières de charger avec la cavalerie de la Garde impériale, tenue en réserve. Une première attaque des chasseurs et des grenadiers ayant échoué, les mamelouks s'élancent à leur tour, enfoncent un carré russe et s'emparent d'une batterie18. Après cet engagement, Napoléon accorde une aigle à la compagnie. Les mamelouks participent ensuite à la campagne de Prusse et de Pologne où ils sont présents à la bataille d'Eylau. Lors de la guerre d'Espagne, ils jouent un rôle actif à la répression du soulèvement du Dos de Mayo, où ils s'attirent la haine des Espagnols qui voient en eux les descendants des Maures19. En 1812, la compagnie est engagée dans la campagne de Russie, toujours à la suite des chasseurs, et y subit de lourdes pertes. Réorganisés sous la forme d'un escadron en 1813, les mamelouks combattent durant la campagne d'Allemagne, à Dresde et Hanau, et celle de France, à Montmirail, Saint-Dizier et Paris.
Sous la Première Restauration, l'escadron est incorporé au Corps royal des chasseurs de France, puis est reformé par décret pendant les Cent-Jours. Après la seconde abdication de Napoléon, les derniers mamelouks regagnent le dépôt des réfugiés à Marseille où ils sont presque tous massacrés par la population royaliste20.
Dragons
Dragons de la Garde impériale. Illustration de
Job.
La création du régiment des dragons de la Garde impériale remonte au mois d'avril 1806 : satisfait de la participation des dragons de la ligne à la campagne d'Autriche de 1805, Napoléon décrète la formation d'un régiment de dragons intégré à la Garde impériale21. L'unité est organisée en quatre escadrons à deux compagnies chacun, et l'Empereur nomme personnellement les officiers du corps, issus de la Garde ou de la ligne22. Le régiment est placé sous les ordres du colonel Arrighi de Casanova23.
Quelques mois plus tard, ils sont présents à la bataille de Friedland, où ils constituent le flanc gauche de la formation de la cavalerie de la Garde24. Lors de la campagne de Russie, notamment à Maloyaroslavets et à la Bérézina, le régiment est presque entièrement décimé en couvrant les troupes françaises lors de la retraite de Russie25. En 1813, les dragons participent à la bataille de Leipzig ainsi qu'à celle de Hanau. Lors de la deuxième bataille de Saint-Dizier en 1814, accompagné d'un peloton de mamelouks, ils délogent les soldats ennemis de leurs positions et s'emparent de 18 pièces d'artillerie26.
Lors de la Première Restauration, le régiment est transformé en Corps royal des dragons de France. Au retour de Napoléon pendant les Cent-Jours, le régiment retrouve son organisation antérieure. Le , ils s'élancent sous les ordres du maréchal Ney contre les carrés britanniques positionnés sur le Mont-Saint-Jean, où ils subissent de lourdes pertes face au tir précis de l'infanterie britannique. À la fin de la campagne de Belgique, le régiment déplore la mort de 25 officiers et près de 300 soldats. Le régiment est finalement dispersé après la seconde abdication de Napoléon25.
Lanciers polonais
Officier supérieur et lancier polonais en grande tenue. Illustration de
Richard Knötel.
En 1807, après avoir battu la Prusse, Napoléon fait son entrée dans Varsovie ; il y est escorté par une garde d'honneur polonaise à l'allure fringante et composée de nobles. Séduit, l'Empereur décrète le la création d'un régiment de chevau-légers polonais intégré à la Garde impériale et placé sous les ordres du colonel Krasiński27,28. Composée de 968 hommes sans expérience militaire, l'unité est encadrée par des officiers de la cavalerie de la Garde, tels que les deux colonels-majors29.
Au fur et à mesure de leur formation, les détachements polonais se dirigent vers le dépôt de Chantilly puis en direction de l'Espagne où ils doivent combattre29. Ils sont présents à Medina de Rioseco, puis à Burgos sous les ordres du général Lasalle30. Alors que Napoléon marche sur Madrid, il est bloqué le au col de Somosierra par les troupes du général Benito de San Juan. L'infanterie se révélant incapable d'emporter la position, l'Empereur ordonne au 3e escadron des chevau-légers polonais de charger31. Commandés par Kozietulski, les Polonais subissent de lourdes pertes dues au feu de l'infanterie et de l'artillerie espagnoles, mais parviennent à capturer les batteries adverses32. Leur intervention décisive est saluée par Napoléon qui donne au régiment le rang de Vieille Garde. Rentrés en France, les chevau-légers participent à la campagne d'Autriche de 1809, en particulier à Wagram où ils culbutent les uhlans de Schwarzenberg33. Après cet affrontement, l'Empereur accède à la requête du colonel Krasiński qui souhaite doter ses hommes de lances, et l'unité prend le nom de « lanciers polonais ». En 1810, le régiment des lanciers prend le numéro 1 après la création des lanciers rouges34. Il est ensuite engagé dans la campagne de Russie, où il se distingue à Gorodnia et à Krasnoï. Après les lourdes pertes subies, les lanciers polonais sont réorganisés et prennent part aux batailles de la campagne d'Allemagne en 1813, comme à Lützen, Peterswalde et Hanau, où ils perdent le major Radziwill35. En 1814, lors de la campagne de France, ils chargent à Brienne, La Rothière, Montmirail, Berry-au-Bac, Craonne, Reims et Paris.
À la Première Restauration, le régiment des lanciers polonais est dissous et ses éléments renvoyés en Pologne, à l'exception d'un escadron sous le commandement de Jerzmanowski qui accompagne Napoléon sur l'île d'Elbe36. Pendant les Cent-Jours, cet escadron devient le 1er du régiment des lanciers rouges, avec lequel il charge à Waterloo. À la Seconde Restauration, l'escadron polonais est définitivement licencié et ses membres sont enrôlés dans l'armée russe37.
Lanciers rouges
Charge des lanciers rouges de la Garde impériale à Waterloo. Illustration de
Job.
En 1810, Napoléon annexe le royaume de Hollande et oblige son frère Louis à abdiquer. Le , un décret annonce officiellement le rattachement de la Hollande à l'Empire, et prescrit dans un même temps l'incorporation de la Garde royale hollandaise à la Garde impériale38. Le , le régiment de hussards de la Garde royale, sous le commandement du colonel Dubois, quitte le royaume et gagne Versailles, où il arrive le 30 du même mois. Organisés en quatre escadrons, les Hollandais fraternisent avec leurs camarades français. Un décret du transforme les hussards en un deuxième régiment de lanciers de la Garde impériale39. Le général Colbert-Chabanais en prend le commandement, et des sous-officiers du corps, instruits par les lanciers polonais du 1er régiment à Chantilly, apprennent le maniement de la lance à leurs hommes40.
Le régiment est engagé en 1812 dans la campagne de Russie. Placés en avant-garde, les lanciers rouges s'emparent de nombreux convois de marchandises et de provisions puis forment une brigade avec les lanciers polonais, sous les ordres du général Colbert-Chabanais41. Arrivés à Moscou en septembre, leur effectif de bataille s'élèvent à 556 cavaliers en octobre42. Après l'incendie de Moscou et la bataille de Winkowo, les lanciers de Colbert sont placés en arrière afin de couvrir la retraite. Le , ils repoussent en infériorité numérique un important parti de cosaques qui tente de s'en prendre à l'arrière-garde43. À cause des conditions climatiques, les pertes en hommes et en chevaux sont lourdes et à la fin de la campagne, seuls 60 lanciers disposent encore d'une monture44. Réorganisé, le 2e lanciers participe ensuite à la campagne d'Allemagne, où il se distingue particulièrement à la bataille de Reichenbach, le . En 1814, les lanciers rouges de la Jeune Garde se battent en Belgique, tandis que les escadrons de la Moyenne Garde affrontent les armées coalisées dans maints affrontements au cours de la campagne de France.
La Première Restauration transforme le 2e lanciers en Corps royal des chevau-légers lanciers de France. Pendant les Cent-Jours, le régiment reprend son ancien nom et accueille en son sein l'escadron des lanciers polonais de l'île d'Elbe45. Il intègre la division de cavalerie légère de la Garde en compagnie des chasseurs à cheval et prend part à la campagne de Belgique de 1815. Les lanciers rouges sont présents aux Quatre Bras et chargent les carrés britanniques à la bataille de Waterloo46. Après la seconde abdication de Napoléon et le retour des Bourbons, le régiment est dissous le .
Lanciers lituaniens
Au début du mois de juillet 1812, Napoléon décide de constituer un 3e régiment de lanciers intégré à la Garde impériale47, à effectif théorique de 1 218 hommes répartis en cinq escadrons48. Deux escadrons sont alors formés à Varsovie avec des nobles lituaniens49,50. Le commandement du régiment est confié au général Konopka, major des lanciers polonais de la Garde impériale51. Un escadron de Tartares lituaniens est attaché au corps afin d'effectuer des missions de reconnaissance52.
Ayant reçu l'ordre de se rendre à Minsk, le 3e lanciers se met en route dans le cadre de la campagne de Russie. En chemin, Konopka décide de s'arrêter dans le village de Slonim, où il installe un cantonnement53. Le colonel-major Tanski qui conseille à son chef de repartir au plus vite est renvoyé au dépôt de Grodno, mais dans la nuit suivant son départ, le général russe Czaplicz attaque le campement des lanciers avec ses soldats ; le général Konopka et 246 hommes sont faits prisonniers54. Le régiment perd également un important matériel ainsi que les registres, les papiers et la comptabilité du corps49.
Après cette défaite, les deux autres escadrons du major Tanski à Grodno constituent le 3e lanciers, mais l'unité est finalement dissoute le et ses éléments incorporés au 1er régiment de lanciers polonais de la Garde49.
Tartares lituaniens
Tartare lituanien de la Garde impériale. Par Bronisław Gembarzewski, 1897.
C'est en juin 1812 que naît l'idée de créer une unité de Tartares lituaniens. Ces derniers, membres de communautés originaires de Crimée, ont la réputation d'être d'excellents cavaliers, ce que confirme le général Michel Sokolnicki, qui assure que « leur probité, ainsi que leur courage sont éprouvés55 ». Napoléon fait alors appel au major Mustapha Achmatowicz et lui ordonne alors le recrutement d'un millier de soldats, mais en pratique, seul un escadron est mis sur pied52. L'unité est officiellement créée en octobre 1812 et est attachée au 3e régiment de lanciers de la Garde impériale56,57.
Commandés par Achmatowicz, les Tartares prennent part à la campagne de Russie à la suite des lanciers52. Ils subissent de lourdes pertes en défendant Vilna contre les Russes, dont Achmatowicz qui est tué58. À la fin de la campagne, les survivants sont incorporés dans les rangs du 3e lanciers de la Garde, puis forment la 15e compagnie du régiment de lanciers polonais de la Garde impériale 59. Malgré leur petit effectif, les Tartares lituaniens du capitaine Ulan, qui a remplacé Achmatowicz, chargent à maintes reprises lors de la campagne d'Allemagne, et se distinguent encore en France au sein du 3e régiment d'éclaireurs-lanciers60,61.
Après l'abdication de Napoléon le , les derniers Tartares lituaniens regagnent leur pays60.
Chasseurs à cheval de la Jeune Garde
Le , le régiment des chasseurs à cheval de la Garde impériale passe de cinq à neuf escadrons. Les 6e, 7e, 8e et 9e escadrons prennent le titre de « seconds chasseurs » puis de chasseurs à cheval de Jeune Garde62. À cette époque, le corps reçoit pour commandant le colonel-major Charles-Claude Meuziau avec lequel il participe à la campagne d'Allemagne de 1813. En 1814, les chasseurs sont détachés à l'Armée du Nord du général Maison où ils sont surtout chargés de missions de reconnaissance, ce qui ne les empêche pas de charger à diverses reprises comme à Courtrai le 63. Les escadrons sont dissous lors de la Première Restauration, les hommes étant pour la plupart replacés dans la ligne ou mis en demi-solde.
Pendant les Cent-Jours, les escadrons de Jeune Garde sont reformés et prennent la dénomination de 2e régiment de chasseurs à cheval de la Garde impériale. Cependant, en raison de la pénurie d'hommes et de chevaux, l'unité ne quitte pas sa garnison de Chantilly et ne prennent pas part à la campagne de Belgique de 1815. Le régiment des chasseurs de la Jeune est finalement dissous entre le et le 64.
Éclaireurs
Éclaireur-dragon du
2e régiment, 1813. Illustration d'Ernest Fort.
Avec la perspective dramatique d'avoir à se battre sur le sol français pour la première fois depuis les guerres de la Révolution, Napoléon réorganise sa Garde impériale le . Trois régiments sont alors créés : le premier, composé des éclaireurs-grenadiers, rattaché aux grenadiers à cheval ; le second, composé des éclaireurs-dragons, rattaché aux dragons ; le troisième, composé des éclaireurs-lanciers, rattaché au lanciers polonais.
Ces nouvelles unités ont le temps de participer à la campagne de France de 1814, où ils se heurtent maintes fois aux cosaques. Bien que chargés de missions de reconnaissance aux avant-postes, ils mènent aussi à plusieurs reprises des charges, comme à Brienne, Montmirail ainsi qu'à Craonne, lorsque le colonel Testot-Ferry conduit le 1er régiment à l'assaut de l'artillerie russe. Ils participent également à la défense de Paris, avant d'être dissous lors de la Première Restauration.
Unités rattachées à la Garde ou servant statutairement à ses côtés
Gendarmes d'élite
Gendarme d'élite en patrouille. Illustration de
Victor Huen.
La gendarmerie d'élite est créée au mois de et est intégrée à la Garde consulaire en , sous la forme d'un escadron65. Intégrée à la Garde impériale en 1804, la gendarmerie d'élite compte deux escadrons chacun divisés en deux compagnies, auxquels s'ajoutent deux éphémères compagnies de gendarmes à pied66. Une taille minimale de 1,76 m est exigée pour être recruté67. L'unité comprend à sa création, gendarmes à pied compris, 632 officiers, sous-officiers et soldats. Les gendarmes d'élite font partie de la prestigieuse Vieille Garde. En 1806, les compagnies de gendarmes à pieds sont dissoutes, réduisant l'effectif à 456 cavaliers66.
La gendarmerie d'élite est chargée de la sécurité des palais et des quartiers militaires impériaux, et elle protège le quartier général de Napoléon en campagne68. Elle sert aussi, mais plus rarement, à escorter l'Empereur lors de ses déplacements et à la protection de personnages importants66.
Bien qu'ayant un rôle assez minime lors des guerres du Premier Empire, les gendarmes d'élite chargent à Medina de Rioseco et à Montmirail, et participent à la campagne de Belgique de 1815. L'unité des gendarmes d'élite est finalement dissoute en septembre de la même année.
Gendarmes d'ordonnance
Par décret du , Napoléon ordonne la création d'un régiment de gendarmes d'ordonnance, rattaché à la Garde impériale69. L'Empereur espère ainsi renouer avec les membres de l'aristocratie de l'Ancien Régime, bannis au cours de la Révolution française. En théorie, chacun peut s'engager dans cette nouvelle unité mais la recrue doit dépenser la somme de 1 900 francs pour s'acheter la tenue et l'équipement70. Il doit également prouver le versement d'une pension de 600 francs par sa famille69. Au , la gendarmerie d'ordonnance aligne 216 cavaliers71.
Chevau-légers de Berg
« Le 17 décembre 1809, Napoléon adjoignit à sa garde un régiment fondé en 1807 par Murat, duc de Berg, sous le nom de chevau-légers de Berg »
— Liliane et Fred Funcken, L'uniforme et les armes des soldats du Premier Empire72
Gardes d'honneur
« L'histoire nous plonge en 1812, après les désastres de la campagne de Russie. Napoléon doit enrôler de nouvelles troupes pour affronter une nouvelle coalition. Parmi ces soldats levés en hâte, 10 000 cavaliers forment corps. Il s'agit de la Garde d'honneur. Ses effectifs devaient être constitués par les fils des familles les plus considérées des 130 départements de l'Empire. Les gardes d'honneur voient le feu pour la première fois en Saxe, en 1813. Ils chargent encore avec héroïsme durant la campagne de France, l'année suivante »
— Lt-Col. G. Houssetnote 1, La garde d'honneur 1813-1814 73
Les gardes d'honneur constituent quatre régiments de cavalerie légère levés en 1813 par Napoléon pour renforcer la cavalerie de la Garde impériale décimée pendant la campagne de Russie de 1812. Habillés à la hussarde, issus de la bourgeoisie et de la petite noblesse et s'équipant à leur frais, ils sont rattachés à la Garde le : « le 1er régiment fut attaché aux Chasseurs à cheval, le 2e aux Dragons, le 3e aux Grenadiers et le 4e aux Lanciers »74.
Commandement
Le maréchal Bessières (1768-1813), duc d'Istrie et colonel-général de la cavalerie de la Garde impériale. Illustration de Victor Huen.
De 1804 à 1813, le commandement en chef de la cavalerie de la Garde impériale est assuré par le maréchal Jean-Baptiste Bessières, duc d'Istrie. Ancien capitaine du 22e régiment de chasseurs à cheval, il prend en 1796 la tête de la compagnie des guides avec laquelle il participe aux campagnes d'Italie et d'Égypte75,76. Il charge à la bataille de Marengo avec la cavalerie de la Garde consulaire et est promu général de brigade en . Lors de l'instauration du Premier Empire en 1804, il est élevé à la dignité de maréchal d'Empire et est nommé colonel-général de la cavalerie de la Garde impériale77.
Bessières s'attelle alors à réformer ce corps et y impose une discipline stricte. Il commande la cavalerie de la Garde lors des parades, ainsi qu'au cours des campagnes militaires78. Pendant les batailles, Bessières, « officier de réserve plein de vigueur, mais prudent et circonspect » selon Napoléon, conduit personnellement les charges de ses cavaliers face à l'ennemi79. De fait, le maréchal est très apprécié par ses hommes et lorsqu'il est blessé par un boulet à Wagram, l'Empereur lui dit : « Bessières, voilà un beau boulet, il a fait pleurer ma Garde »79. Il conserve ses fonctions de commandant en chef de la cavalerie de la Garde lors de la campagne de Russie en 1812, avant de prendre part à la campagne d'Allemagne l'année suivante80. Le , près de Weißenfels, il est emporté par un boulet autrichien qui lui coupe la main et transperce sa poitrine. Sa mort est vivement ressentie par l'armée et par Napoléon81.
Le , le général Étienne Marie Antoine Champion de Nansouty succède à Bessières au poste de commandant en chef de la cavalerie de la Garde82. Considéré comme l'un des meilleurs généraux de cavalerie de l'armée, Nansouty dirige la cavalerie de la Garde pendant la campagne d'Allemagne, tout particulièrement à la bataille de Hanau où il culbute par une série de charges vigoureuses l'infanterie et la cavalerie bavaroises. Il participe encore de manière décisive aux victoires de Montmirail et de Château-Thierry en 1814 mais ses relations avec l'Empereur se dégradent et il quitte son commandement, officiellement pour raisons de santé, le , peu après la bataille de Craonne. Le général Augustin-Daniel Belliard commande alors par intérim la cavalerie de la Garde lors de la bataille de Laon avant que le général Horace Sébastiani n'en obtienne le commandement permanent jusqu'à la fin de la campagne83.
-
-
Augustin-Daniel Belliard.
-
Galerie
- Les régiments de cavalerie illustrés par Hippolyte Bellangé
-
-
Officier des chasseurs à cheval.
-
-
-
-
-
-
Notes et références
Notes
- Voir la section Bibliographie.
Références
- Pawly 2009, p. 4
- Bukhari 1978, p. 3
- Ian Castle (préf. David Chandler, ill. Christa Hook), Austerlitz 1805 : le chef-d'œuvre de Napoléon, Paris, Osprey Publishing & Del Prado Éditeurs, coll. « Osprey / Armées et batailles » (no 2), (1re éd. 2002), 94 p. (ISBN 2-84349-178-9), p. 75 et 76.
- Pawly 2009, p. 15
- Pawly 2009, p. 17-19
- Pawly 2008, p. 3 et 4
- Pawly 2008, p. 7
- Pawly 2008, p. 9
- Pawly 2008, p. 14 et 15
- Pawly 2008, p. 20
- Pawly 2008, p. 33 et 34
- Pawly 2008, p. 36
- Pawly 2008, p. 43 et 44
- Les mamelouks de Napoléon, p. 7
- Pawly 2006, p. 10
- Les mamelouks de Napoléon, p. 10
- Pawly 2006, p. 15
- Pawly 2006, p. 22
- Pawly 2006, p. 33 et 34
- Les mamelouks de Napoléon, p. 14
- Pawly 2012, p. 3.
- Pawly 2012, p. 3 et 4.
- Pawly 2012, p. 4.
- Pawly 2012, p. 7.
- Pawly 2012.
- Tranié et Carmigniani 1989, p. 221.
- Pawly 2007, p. 7
- Tranié et Carmigniani 1982, p. 21
- Tranié 2007, p. 7
- Tranié et Carmigniani 1982, p. 27, 35 et 36
- Tranié et Carmigniani 1982, p. 38
- Pawly 2007, p. 20
- Tranié et Carmigniani 1982, p. 70
- Pawly 2007, p. 24
- Tranié et Carmigniani 1982, p. 108, 113, 114 et 124
- Tranié et Carmigniani 1982, p. 160
- Pawly 2007, p. 44
- Pawly 2003, p. 4
- Pawly 2003, p. 5 et 6
- Pawly 2003, p. 6 et 7
- Pawly 2003, p. 14 et 15
- Pawly 2003, p. 16
- Pawly 2003, p. 17 et 18
- Pawly 2003, p. 19 et 20
- Pawly 2003, p. 36
- Pawly 2003, p. 38-41
- Pigeard 1999, p. 24
- Gilles Dutertre, Les Français dans l'histoire de la Lituanie : 1009-2009, Paris, L'Harmattan, , 234 p. (ISBN 978-2-296-07852-9, lire en ligne [archive]), p. 86.
- Pigeard 1999, p. 25
- Haythornthwaite 2004, p. 9
- Tranié et Carmigniani 1982, p. 79
- Bukhari 1978, p. 27
- Alphonse Marie Malibran (ill. Jan Vladislav Chelmiński), L'Armée du Duché de Varsovie : ou la contribution polonaise dans les rangs de la Grande Armée, Paris, Le Livre chez vous, (1re éd. 1913), 304 p. (ISBN 978-2-914288-02-6), p. 228.
- Tranié 2007, p. 12
- Pigeard 1999, p. 29
- Tranié et Carmigniani 1982, p. 112
- Pawly 2007, p. 40
- Pigeard 2005, p. 160
- Tranié et Carmigniani 1982, p. 111
- Pigeard 1999, p. 32
- Haythornthwaite 2004, p. 13
- Pawly 2008, p. 38.
- Descaves 1891, p. 334.
- Descaves 1891, p. 294, 297, 298 et 336.
- Haythornthwaite 2004, p. 6
- Funcken et Funcken 1969, p. 48
- Charmy 2003, p. 178
- Haythornthwaite 2004, p. 6 et 7
- Pigeard 2005, p. 176
- Henry Lachouque, La Garde impériale, Panazol, Lavauzelle, coll. « Les grands moments de notre histoire », , 504 p. (ISBN 2-7025-0001-3), p. 112.
- Pigeard 2005, p. 455
- Funcken et Funcken 1969, p. 50
- Note de l'éditeur [archive]
- Funcken et Funcken 1969, p. 58 et 59 (planche uniformologique de la page 59 [archive])
- Pawly 2008, p. 4
- Haythornthwaite 2001, p. 16
- Thoumas 2004, p. 208, 210 et 214.
- Haythornthwaite 2004, p. 17 et 20
- Capelle et Demory 2008, p. 62
- Haythornthwaite 2001, p. 16 et 17
- Thoumas 2004, p. 267 et 269
- Georges Six (préf. commandant André Lasseray), Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolution et de l'Empire, t. 2, Paris, Georges Saffroy Éditeur, , p. 249.
Annexes
Bibliographie
 : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
- Béatrice Capelle et Jean-Claude Demory, « Bessières, loyauté et droiture antiques », dans Maréchaux d'Empire, E/P/A, (ISBN 978-2-851206-98-5), p. 60-63.

- G. Charmy, Splendeurs des uniformes de Napoléon : La Garde impériale à cheval, vol. 3, Charles Hérissey, , 251 p. (ISBN 978-2-914417-10-5, lire en ligne [archive]).

- Paul Descaves (ill. Marcel de Fonrémis), Historique du 13e régiment de chasseurs et des chasseurs à cheval de la Garde, Béziers, A. Bouineau & Cie., , 399 p. (OCLC 763356561, BNF 34076124) lire en ligne [archive] sur Gallica.

- Liliane Funcken et Fred Funcken, Les uniformes et les armes des soldats du Premier Empire : de la garde impériale aux troupes alliées, suédoises, autrichiennes et russes, t. 2, Casterman, , 157 p. (ISBN 2-203-14306-1).

- Philip Haythornthwaite (ill. Richard Hook), La Garde impériale, DelPrado & Osprey Publishing, coll. « Osprey / Armées et batailles » (no 1), , 63 p. (ISBN 2-84349-178-9).

- François-Guy Hourtoulle, Jack Girbal et Patrice Courcelle, Soldats et uniformes du Premier Empire, Histoire et Collections, , 208 p. (ISBN 978-2-913903-54-8).
- Georges Housset, La Garde d'honneur de 1813-1814 : histoire du corps et de ses soldats, B. Giovanangeli, , 997 p. (extraits [archive])
- Juan María Martínez (dir.), « Les mamelouks de Napoléon », Cavaliers des Guerres napoléoniennes, Del Prado & Osprey Publishing, no 2, (ISBN 2-84349-154-1).
- Alain Pigeard, La Garde impériale : 1804-1815, Tallandier, , 637 p. (ISBN 978-2-84734-177-5).

- Alain Pigeard, « Le 3e régiment de chevau-légers lanciers », Tradition Magazine, no 8 (hors-série) « Napoléon et les troupes polonaises 1797-1815 : De l'Armée d'Italie à la Grande Armée », .

- Alain Pigeard, « Les tartares lithuaniens », Tradition Magazine, no 8 (hors-série) « Napoléon et les troupes polonaises 1797-1815 : De l'Armée d'Italie à la Grande Armée », .

- Alain Pigeard et Vincent Bourgeot, La Cavalerie de la Garde Impériale, Saint-Cloud, Soteca, , 100 p. (ISBN 979-10-91561-58-7).
- Charles Thoumas, « Nansouty », dans Les grands cavaliers du Premier Empire, t. II, Paris, Éditions historiques Teissèdre, (ISBN 0-543-96047-1).

- Charles Thoumas, « Bessières », dans Les grands cavaliers du Premier Empire, t. III, Paris, Éditions historiques Teissèdre, (ISBN 2-912259-89-4).

- Jean Tranié et Juan-Carlos Carmigniani, Les Polonais de Napoléon : l'épopée du 1er régiment de lanciers de la garde impériale, Copernic, , 179 p.

- Jean Tranié et Juan-Carlos Carmigniani, Napoléon : 1814 - La campagne de France, Paris, Pygmalion/Gérard Watelet, , 315 p. (ISBN 2-85704-301-5).

- Charles-Henry Tranié, « Les chevau-légers polonais de la Garde impériale », Soldats Napoléoniens, no 16, (ISSN 1770-085X).

- (en) Philip Haythornthwaite (ill. Patrice Courcelle), Napoleon's Commanders, vol. 1, Oxford, Osprey Publishing, coll. « Osprey / Elite » (no 72), , 64 p. (ISBN 1-84176-055-2).

- (en) Emir Bukhari (ill. Angus McBride), Napoleon's Guard Cavalry, Osprey Publishing, coll. « Osprey / Men-at-Arms » (no 83), , 48 p. (ISBN 0-85045-288-0).

- (en) Ronald Pawly (ill. Patrice Courcelle), Mounted Grenadiers of the Imperial Guard, Osprey Publishing, coll. « Osprey / Men-at-Arms » (no 456), , 48 p. (ISBN 978-1-84603-449-7).

- (en) Ronald Pawly (ill. Patrice Courcelle), Napoleon's Mounted Chasseurs of the Imperial Guard, Osprey Publishing, coll. « Osprey / Men-at-Arms » (no 444), , 48 p. (ISBN 978-1-84603-257-8).

- (en) Ronald Pawly (ill. Patrice Courcelle), Napoleon's Mamelukes, Osprey Publishing, coll. « Osprey / Men-at-Arms » (no 429), , 48 p. (ISBN 1-84176-955-X).

- (en) Ronald Pawly (ill. Patrice Courcelle), Napoleon's Dragoons of the Imperial Guard, Osprey Publishing, coll. « Osprey / Men-at-Arms » (no 480), , 48 p. (ISBN 978-1-84908-806-0 et 1-84908-806-3).

- (en) Ronald Pawly (ill. Patrice Courcelle), Napoleon's Red Lancers, Osprey Publishing, coll. « Osprey / Men-at-Arms » (no 389), , 48 p. (ISBN 1-84176-508-2).

- (en) Ronald Pawly (ill. Patrice Courcelle), Napoleon's Polish Lancers of the Imperial Guard, Osprey Publishing, coll. « Men-at-Arms », , 48 p. (ISBN 978-1-84603-256-1).

Articles connexes
Sur les autres projets Wikimedia :
Cavalerie blindée américaine
Dans la United States Army, la cavalerie blindée (Armored Cavalry en anglais) est utilisée pour des missions de reconnaissance blindée (ou mécanisée), de surveillance et de sécurité. Elle est toujours organisée en régiments, de la même taille qu'une brigade. Elle est le descendant de la Cavalerie des États-Unis.
De ce fait, la cavalerie blindée est entre la cavalerie normale (motorisée) et les bataillons d'Armor, qui sont constitués de chars type M60 ou M1 Abrams.
Les véhicules utilisés entre autres pendant la guerre du Viêt-Nam dans ces régiments sont le M551 Sheridan puis, depuis les années 1980, principalement les engins chenillés M3 Bradley (version « reconnaissance » du M2 d'infanterie) et, depuis les années 2000, les véhicules à roues Stryker, servant également à l'infanterie. La cavalerie blindée est aussi équipée d'un petit nombre de chars M1 Abrams et de nombreux véhicules plus légers tels les HMMWV.
Liste de régiments
Contremaître
Sur les autres projets Wikimedia :
Un contremaître, chef de chantier, chef d'équipe ou superviseur est un salarié qui dirige et supervise le travail d'un groupe d'ouvriers ; comme eux, il peut travailler en rotation ; on emploie ce mot en particulier sur les chantiers de construction, dans les ateliers, souvent dans d'autres domaines industriels : manufactures, entrepôts, mines, etc.
De nos jours, l'appellation manager de proximité en est un équivalent pour le travail intellectuel ou commercial.
Historique
Le mot désignait à l’origine, dans la hiérarchie militaire, le troisième officier marinier de manœuvre sur un navire — appellation remplacée par celle de « second maître » (voir les Grades de l'armée française).
Formation
Il faudra un bac +2 ( BTS ou DUT) ou un bac +3 (Licence pro) ou plusieurs années d'expérience avec un bac pour pouvoir être chef de chantier.
Emploi
Bibliographie
- Antoine Barrière, MICHELIN vu de l'intérieur. Ce que j'ai vécu de 1950 à 1961, Éditions CRÉER, 1970.
Articles connexes
Équivalents militaires
Liens externes
Inspecteur
Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.
Sur les autres projets Wikimedia :
Le terme d'« inspecteur » peut recouvrir diverses professions publiques ou privées, par exemple :
- un inspecteur de police, un fonctionnaire ayant un rang différent selon le pays (inspecteur principal, divisionnaire, honoraire) ; en France, ce terme n'est plus utilisé et est remplacé par les grades de lieutenant ou de capitaine de police ;
- un inspecteur des finances publiques fonctionnaire de catégorie A de la Direction générale des finances publiques regroupant les ex-inspecteurs des impôts et inspecteurs du trésor ;
- un inspecteur des douanes, fonctionnaire de catégorie A de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects,
- un inspecteur du Trésor public ;
- un inspecteur militaire, désignant une fonction confiée à un vieux général ou un maréchal qui doit mener des tournées d'inspection (avec revues de troupe, des équipements et des fortifications) ;
- un fonctionnaire de l'Éducation nationale, chargé d'encadrer et d'évaluer un service particulier :
- un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ;
- un inspecteur de santé publique vétérinaire ;
- un inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle ;
- un inspecteur des affaires maritimes ;
- un inspecteur des chemins, dans les îles Anglo-Normandes ;
- un inspecteur général des manufactures.
Il peut également désigner un agents salarié représentant une société d'assurances (l'« inspecteur d'assurances ») : inspecteur sinistre, inspecteur régleur, etc.
Voir aussi
Films et séries
Catégories :
État-major
D'une manière générale, un état-major est un organisme ou une équipe, chargé de conseiller et d'assister un dirigeant.
L'expression apparaît déjà sur le plan de l'école Militaire sous Louis XV. Créé par Scharnhorst et Clausewitz, dans le cadre de la grande réforme (Die Heeresreform) de l'armée prussienne à la suite de la défaite d'Iéna, le terme désigne l'ensemble des officiers et du personnel militaires attachés à un officier supérieur ou général comme agents d'élaboration et de transmission des ordres.
On l'emploie désormais dans toutes les organisations complexes, grandes entreprises, administrations ou partis politiques, pour désigner la structure de direction ou le siège social de cette organisation, et — par métonymie — le lieu où se trouve cette direction centrale.
État-major civil
Synonyme d'équipe de direction.
État-major militaire
État-major contemporain
Dans le domaine militaire, un état-major est composé pour l'essentiel d'officiers, ainsi que de personnel de soutien (secrétaires, informaticiens, transmetteurs) et est chargé de synthétiser l'information, d'aider à la décision, d'organiser, de planifier, de programmer, d'établir les ordres, d'en contrôler l'exécution, de suivre les événements et d'en tirer les enseignements1.
On trouve des états-majors à tous les échelons des forces armées, que ce soit l'unité (régiment, navire de guerre…), la force (brigade, division, escadre, armée…) ou encore au niveau central. Ils sont regroupés dans ce que l'on appelle un quartier-général.
- Au niveau de l'unité, l'état-major désigne généralement l'ensemble des officiers.
- Un état-major de force peut être permanent ou n'être constitué que pour l'opération pour laquelle la force est réunie. Il est interarmées s'il rassemble des éléments des trois armées (terre, mer, air). Il est multinational pour diriger une force rassemblant des éléments de plusieurs nations. L'état-major est constitué de bureaux (organisation, renseignement, plans, opérations, personnel, transmissions, santé, actions civilo-militaires…) ; son organisation, parmi les pays de l'OTAN est standardisée. Son domaine d'action est tactique ou opératif. L'état-major est dirigé par un chef d'état-major qui est l'adjoint direct du commandant de la force ou de l'opération.
- Au niveau central, les états-majors d'armées ou interarmées sont les organes de direction des armées, de l'Armée de terre, de l'Armée de l’air ou de la Marine. Leurs domaines d'action sont stratégiques ou politico-militaires. Ils travaillent en particulier à déterminer l'organisation générale des armées, le concept d'emploi des forces et leurs format et matériels futurs, ainsi qu'à contrôler l'exécution des programmes et du budget.
Dans la plupart des pays, les officiers se préparent à exercer des fonctions dans les états-majors en suivant les cours des collèges de défense ou écoles de guerre.
Codes OTAN
Selon la nomenclature de l'OTAN, les fonctions de l'état-major sont dénommées par une lettre - J pour Joint, interarmées - suivie d'un chiffre pour la fonction. Cette nomenclature est reprise dans les opérations de l'Union européenne2.
- J1 : personnel
- J2 : renseignement
- J3 : opérations
- J4 : logistique
- J5 : planification et politique
- J6 : systèmes d'informations et communications (Sic)
- J7 : exercices et retour d'expérience (retex)
- J8 : budget et financement
- J9 : actions civilo-militaires (Cimic)
La lettre peut être remplacée par A dans le cas d'un état-major dépendant de l'armée de l'air, G (comme ground) dans l'armée de terre (ou du corps des Marines américains), N (comme navy) dans la Marine, ou encore S dans le cas des états-majors des unités de l'US Army et l'US Marine Corps commandées par un officier supérieur (bataillons, régiments, brigades endivisionnées).
En France
Plusieurs états-majors centraux existent :
Ils sont dirigés par un officier général appelé « chef d’état-major » (« directeur général » pour la Gendarmerie nationale) secondé par un major général.
L'EMP est l'état-major particulier du président de la République, qui est le « chef des armées » selon les termes de la Constitution de la Ve République, en vigueur depuis 1958.
La Gendarmerie nationale est placée sous l'autorité de la direction générale de la Gendarmerie nationale (DGGN), direction générale dépendant depuis 2009 du ministère de l'Intérieur.
Aux États-Unis
Russie
Au Sénégal
EMGA : l’État-major général des Armées du sénégal est sis au Quartier Dial Diop à Dakar. CEMGA : le chef d'État-major général des Armées.
Notes et références
- On retrouve là les fonctions administratives d'Henri Fayol.
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Liens externes
Articles connexes
Munition
Cartouche pour arme de poing : 1 balle, 2 douille ou
étui, 3 charge propulsive, 4
culot, 5 amorce
Exemple de « caisson de munitions » transportable avec son canon (russe)
Une munition est un ensemble destiné à charger une arme à feu. Elle est constituée au minimum d'une charge propulsive et d'un (ou plusieurs) projectile (s) (grenaille, balle, obus).
À partir du XXe siècle, la munition peut être auto-propulsée (ex. : roquette, missile) et éventuellement guidée à distance, ou capable de s'orienter, par exemple vers une source chaude.
Le projectile peut être lui-même creux et empli d'un explosif équipé d'un dispositif pyrotechnique de mise à feu (détonateur réagissant à l'impact, ou retardé), projetant des éclats, des balles (plombs ronds des obus shrapnel) et plus récemment des sous-munitions. Dans le cas d'armes chimiques ou biologiques, le projectile a pu être également empli d'agents toxiques chimiques ou pathogènes, se transformant en gaz toxique ou contaminant lors de l'explosion à l'impact.
Pour des raisons de dangerosité et de sécurité, les munitions militaires sont stockées dans des lieux-dits « dépôt de munitions » (arsenal).
Étymologie
La munition (ou monition, amunition, amonition en ancien français) est originellement « la chose dont on se munit » (du latin munitionem, de munire qui signifie « munir ».
Histoire du mot
Au XVIe siècle, le Livre de canonerie (Reinaud et Favé, p. 142) explique « la façon de faire la munition et composition de feu grégeois ».
Selon le Dictionnaire de l'Académie française (4e édition de 1762, p. 187), on entendait au XVIIIe siècle par « munition » « la Provision des choses nécessaires dans une armée ou dans une place de guerre ». (Ex : munitions de bouche ; munitions de gueule, des provisions pour faire bonne chère)
Munitions de guerre
Munitions de guerre. « La place étoit pourvue de munitions de guerre & de bouche. On manquait de munitions, de toutes sortes de munitions ». En ce sens le mot ne s'emploie qu'au pluriel.
Le Pain de munition est « Le pain que l'on distribue chaque jour aux soldats dans l'armée ou dans une place de guerre. Les soldats eurent ordre de prendre du pain de munition pour trois jours » (ex : MONT., I, 261: Des gelées si aspres que le vin de la munition se coupoit à coups de hache »... Amyot, C. d'Utiq. 77: « Ce livret contenait l'estat de la munition dont il avoit fait faire provision pour la guerre, de bledz, d'armes »... M. Du Bellay, 518: « Il avoit fait faire une munition de pain pour dix jours »)
Ce n'est que dans sa 6e édition (1832-5) que le Dictionnaire de l'Académie française (p. 2:245) ajoute à la définition précédente : « Fusil de munition, Fusil de gros calibre, qui est l'arme ordinaire des soldats d'infanterie, et auquel s'adapte une baïonnette ».
Puis le mot désigne plus souvent les poudres et projectiles, pour le fusil comme pour le canon, avant que les torpilles, missiles emportés et autres roquettes entrent dans le domaine des projectiles.
Depuis le XXe siècle, on distingue aussi les munitions conventionnelles des munitions chimiques ou biologiques et depuis peu les munitions intelligentes ou munitions vertes.
Tradition :
La tradition belge perpétue le tir à la poudre noire avec championnats à la clef et permet d'observer armes et munitions anciennes ainsi que les chargements et différents types de gargousse.
La tradition allemande maintient vivace les Schutzenfest, fêtes du tir, toujours très prisées.
Munition de marine
Historique
Appareil manuel (ancien) à sertir les cartouches de chasse en carton
Les premières armes à feu tiraient de simple cailloux, ou de la grenaille de fer récupérée dans les forges (avant que cela ne soit interdit). Des balles sphériques ont rapidement été inventées, coulées en plomb, puis en plomb allié d'antimoine et d'arsenic pour le durcir. La poudre était d'abord chargée séparément par la gueule du fusil ou du pistolet ou du canon. Jusqu'au XIXe siècle, il était nécessaire de calepiner les balles de fusil, c'est-à-dire de les enrouler dans un morceau de coton, de tissu ou de papier graissé (la cartouche) afin d'assurer le meilleur rendement possible du tir en ajustant mieux le projectile à l'âme du canon par la réduction des interstices (vents) par lesquels les gaz s'échappent au lieu de pousser la balle, et pour augmenter la cadence de tir.
Avec l'apparition des poudres sans fumée ni résidu et des préparations cireuses de nitrates peu sensibles à l'eau et à l'humidité, et grâce à des capsules s'enflammant à la percussion (les amorces), les munitions ont gagné en facilité d'usage et en fiabilité. L'étui est un réceptacle muni d'une capsule pleine d’un explosif primaire à sa base (fulminate de mercure) et rempli d'une charge tandis que la balle, ayant pris différentes formes d'ogive, est enchâssée à l'autre extrémité. L'ensemble nommé cartouche est étanche et offre une facilité de chargement qui a ouvert la voie à toute une série de systèmes automatiques de chargement de l'arme, améliorant ainsi sa puissance de feu.
Les cartouches modernes présentent des calibres de plus en plus petits avec des balles plus légères mais aussi beaucoup plus rapides.
Lors de la Première Guerre mondiale, jusqu'aux animaux de cirque étaient réquisitionnés pour contribuer à l'effort de guerre, comme ici à l'usine de munitions de
Sheffield
1914-18, des dizaines de milliards de balles ont été fabriquées lors de la Première Guerre mondiale
C'est avec la Première Guerre mondiale que la fabrication maintenant devenue industrielle des munitions a été plus que décuplée en quelques mois, mobilisant une grande partie des ressources financières, industrielles et minières des belligérants. Plus d'un milliard d'obus et des dizaines de milliards de balles de pistolet, de fusil et de mitrailleuse, torpilles et autres grenades ont ainsi été fabriqués en quatre ans.
À la fin de la guerre, un tiers des obus qui sortaient des chaînes de fabrication étaient des munitions chimiques dont une faible partie a été utilisée.
Un quart environ des obus fabriqués à la chaîne n'explosaient pas à l'impact, contribuant aux séquelles de guerre. Lors de la Seconde Guerre mondiale, ce seront dix obus sur cent qui n'exploseront pas à l'impact, et 50 % environ des munitions incendiaires. Nombre d'entre eux sont encore dans les sols où ils se décomposent lentement en libérant leur contenu (dont des nitrates, du mercure et d'autres composés toxiques).
Désignation
Les munitions sont généralement désignées par un chiffre correspondant le plus souvent au calibre (au moins approximatif) du projectile, suivi d'un nom propre. Un second système de notation, plus rigoureux, exprime le calibre et la longueur de l'étui, plus éventuellement quelques lettres établissant diverses caractéristiques.
Mécanique de la munition
La plus importante caractéristique d'une arme à feu est la munition pour laquelle elle est chambrée. Elle détermine le calibre de l'arme. La masse de la balle (en grammes (g)) et la quantité de poudre (en grains (gr) ou en grammes (g)) déterminent la puissance de la munition et le recul de l'arme.
La qualité de la poudre et sa composition permettent de distinguer les poudres lentes (canons de marine, gros calibres pour éviter les dégâts lors du recul), et les poudres rapides.
En usage d'artillerie, par exemple les 155 AuF1 français, la munition est séparée en deux : le projectile et la gargousse contenant la charge propulsive sous forme d'un sac de combustible. La charge par gargousse permet de varier et d'adapter la portée. L'ensemble brûle complètement à l'allumage et la combustion lors du tir.
Énergie
L'énergie d'un projectile en mouvement correspond à son énergie cinétique et augmente sa portée et son efficacité. La formule en mécanique classique est :
- E c = 1 2 m v 2

où m est la masse de la balle, v est sa vitesse. Une balle lourde et rapide aura plus d'énergie qu'une balle lente et légère.
L'énergie donnée au moment du tir dépend de la charge propulsive et du frottement dans le canon (donc de sa longueur), mais pas de la masse du projectile ; ainsi, pour une charge propulsive donnée, un projectile plus lourd ira moins vite qu'un projectile léger, mais les deux auront la même énergie cinétique.
Il existe également une énergie cinétique dite de rotation pour les balles tournant sur elles-mêmes. Une balle tournant sur elle-même a plus d'énergie qu'une balle de même masse ne tournant pas, à la même vitesse (Il en va de même pour les obus). Les canons rayés ou la forme de certaines balles entraînent leur rotation. À titre d'informations, certains obus anti-aériens de calibre 20 mm tournent à plus de 80 000 tr/min à la sortie du tube, cette vitesse permettant d'armer la fusée qui, pour des raisons évidentes de sécurité, était maintenue inerte avant le départ du coup par un mécanisme interne.
Recul
Le recul d'une arme est une poussée inverse à celle de la balle, selon le principe d'action-réaction. Elle est fonction de la quantité de mouvement p développée par la balle soit :
- p → = m v →

Là encore, m est la masse de la balle et v sa vitesse. La vitesse n'a pas plus d'influence sur le recul développé par la munition que la masse. Notons que la quantité de mouvement ressentie au départ de la balle est équivalente, et même supérieure si l'on tient compte des frottements qui freinent la balle sur son trajet, à celle imprimée à la cible. En bref, il n'y a que dans les films où un coup de fusil de chasse propulse sa cible trois mètres en arrière. Une arme dont la munition développerait une telle quantité de mouvement ferait subir le même sort au tireur.
À la quantité de mouvement de la balle partant dans un sens correspond, pour l'arme dont le coup est parti, une quantité de mouvement identique en sens contraire.
- m1 v1 = m2 v2
où m1 et v1 sont la masse et la vitesse de la balle, m2 v2 celles de l'arme. Cette dernière, étant nettement plus lourde que la balle, acquiert une vitesse beaucoup plus faible, mais significative : elle correspond au recul. Pour une arme donnée, une balle plus lourde engendrera plus de recul ; réciproquement à munition égale, une arme plus lourde présentera un recul plus faible. D'où l'importance de bien épauler (ou appuyer sur un support fixe) l'arme, ce qui permet d'ajouter la masse du tireur (ou celle du support) à celle de l'arme et donc de réduire le recul, alors que mal épaulée l'arme peut acquérir une vitesse suffisante pour blesser le tireur (risque de fracture de la clavicule par exemple) en plus de perdre en précision.
Trajectoire du projectile
La gravité terrestre entraîne le projectile vers le sol et la trajectoire d'un projectile prend la forme d'une courbe tombante. Les tirs à longue distance nécessitent de compenser cette chute en visant au-dessus de la cible. Plus la balle aura de vitesse, plus sa trajectoire semblera plate pour une distance donnée. Le vent devra être compensé de la même manière en décalant la ligne de visée sur le côté. Pour les tirs à grande portée, il faudra également tenir compte de l'effet Magnus et de la force de Coriolis.
La plupart des armes à feu présentent un canon pourvu de rayures internes destinées à imprimer un mouvement de rotation au projectile pour améliorer la stabilité de sa trajectoire.
La vitesse à la bouche d'une balle est très variable en fonction des munitions et de la longueur de canon des armes. Les munitions d'armes de poing sont relativement lentes, leurs vitesses ne dépassent guère celle du son soit environ 340 m/s. Les munitions d'armes d'épaule sont nettement plus rapides, entre 400 et 1 000 m/s. Un tir à longue distance implique également un décalage temporel entre le tir et l'arrivée du projectile qu'il peut être nécessaire de compenser.
Les projectiles (balles, obus...) entrant en contact avec des objets (pierre, arbre, mur, surface de l'eau) sont susceptibles de ricocher et de connaître d'importants changements de trajectoire. C'est une source d'accidents non négligeable.
Voir aussi Balistique et Trajectoire parabolique.
Dégâts, traumatologie
Les dégâts infligés par une arme à feu dépendent de l'arme mais surtout de la munition. Les problématiques liées aux dommages créés par les munitions varient en fonction du contexte d'utilisation. Dans les milieux civils (police, autodéfense), les engagements ont généralement lieu à très courte portée et le pouvoir d'arrêt est fondamental. La munition doit mettre immédiatement hors combat la cible pour lui interdire toute riposte. Dans un contexte militaire, la problématique est différente, les critères sont beaucoup plus nombreux (un soldat doit, par exemple, pouvoir emmener un nombre important de munitions avec lui) et les blessés chez l'ennemi représentent un handicap logistique tout à fait intéressant.
Il existe de nombreux débats d'experts sur l'efficacité des munitions. Les approches sont multiples, par exemple tests effectués dans des blocs homogènes (glaise ou gel spécifique) pour étudier l'effet des impacts, études statistiques et études médicales sur des cas réels. Plusieurs explications sont généralement avancées et font l'objet de débats animés.
Les blessures infligées sont essentiellement des plaies (perforation de la peau et des tissus sous-jacents), dont les conséquences dépendent essentiellement de la partie touchée et de la profondeur de pénétration. L'énergie cinétique libérée à l'impact est parfois considérée comme source de dégâts locaux et distants sur les tissus et sur l'organisme ; c'est le « choc hydrostatique », provoqué par l'onde de choc (onde mécanique de pression) qui en est à l'origine.
La forme du projectile influe sur le type de dégâts. Les conventions internationales ou les valeurs d'usage ont interdit l'usage de balles militaires modifiées pour augmenter l'étendue des dommages causés.
Les balles de métal mou (plomb ou contenant plus de 80 % de plomb) libèrent aussi à la pénétration une quantité faible mais mesurable de plomb toxique qui est immédiatement diffusé sous forme moléculaire ou de minuscules fragments dans le corps par le flux sanguin.
Dans le cas des munitions telles que grenades et obus, l'enveloppe fragmentée par l'explosif est elle-même vulnérante, en plus de l'onde de choc. Il faut y ajouter les effets du contenu chimique toxique pour les munitions chimiques et/ou ceux des centaines de fragments métalliques projetés dans toutes les directions (couramment appelés shrapnel).
La première conséquence est la douleur. En fonction du moral de la victime, le résultat peut aller de sa mise hors combat en raison de l'angoisse à une dangereuse réaction de colère sous l'effet de l'adrénaline.
Si un muscle ou un tendon est touché, cela va provoquer une impotence fonctionnelle (mouvement gêné ou impossible). Des vaisseaux sanguins seront probablement touchés, provoquant des hémorragies pouvant entraîner rapidement la mort. La destruction partielle ou totale d'organe peut provoquer une mort immédiate (cœur, cerveau) ou retardée (poumons et système respiratoire) ou des infirmités (paralysie ou troubles mentaux en cas d'atteinte du cerveau ou de la moelle épinière, troubles divers selon l'organe atteint, amputation). Comme toutes les plaies, elles présentent un risque d'infection. La munition peut également provoquer une fracture osseuse avec dispersion d'esquilles osseuses aggravant le traumatisme.
Le type de munition dépend du but recherché :
- Maintien de l'ordre : on va plutôt s'orienter vers des munitions provoquant de la douleur, avec un faible risque de pénétration (munitions dite « sub-létales » utilisées par les lanceurs de balle de défense), comme des balles en caoutchouc de petit diamètre (chevrotine) ou des balles en caoutchouc de plus gros diamètre (Balle libre en mousse pour le Flash-Ball, balle gomme ou mousse pour le LBD). Les munitions classiques seront le plus souvent des balles blindées conventionnelles, probablement pour une raison plus liée au coût qu'à l'efficacité. Pour la police, l'arme est symbolique et dissuasive plus que pratique.
- Chasse : le but est soit de stopper et tuer rapidement un petit animal en mouvement, à relativement faible portée, pour protéger les biens et personnes situés dans la direction du tir, avec des projectiles généralement non profilés et multiples (grenaille) pour maximiser les chances de toucher et limiter la portée. Pour les gibiers de plus grande taille, on tire depuis des armes à canon rayé des balles profilées et rapides, proches des munitions militaires. On cherchera alors à augmenter l'effet de choc et à briser les os avec des balles dont l'ogive est moins profilée que les munitions militaires. La longue portée et l’énergie cinétique très élevée de ces munitions comparables aux munitions de guerre sont à l'origine de certains accidents.
- Intervention : lors des opérations d'intervention lors d'arrestation à risque, de prise d'otage ou de protection de personnalités ou encore pour l'autodéfense, le but recherché est de mettre la cible hors d'état de nuire au plus vite. Ce pouvoir d'arrêt peut être obtenu par un projectile expansif pour augmenter le volume de tissus détruits et maximiser les chances de toucher un organe vital ou provoquer une hémorragie importante. Une munition à projectiles multiples peut être utilisée, avec des risques de toucher d'autres cibles, mais leur capacité de pénétration plus faible est présentée par leurs promoteurs comme étant un gage de sécurité.
- Maîtrise d'un animal dangereux : pour des animaux dangereux et/ou protégés, des fléchettes garnies d'un somnifère sont efficacement utilisées, généralement par des vétérinaires. Elles peuvent cependant être vulnérantes pour des animaux petits ou fragiles si elles touchent un organe vital. Ce type de munition n'a jamais été adapté à la chasse ni aux armes de poings ni aux usages militaires en raison de sa portée très réduite et la lenteur de son effet.
- Guerre : les munitions de guerre sont encore plus variées que les armes qui les mettent en œuvre (de la balle de pistolet à la bombe nucléaire). Les contraintes logistiques, de réactivité, de poids, de coût et de vitesse de production ont conduit les pays dits « riches » à coupler la production industrielle de munitions pour armes lourdes à la production par milliards d'unités de munitions individuelles légères, peu encombrantes et faciles à acheminer vers les combattants, tout en cherchant à développer leur portée et leur capacité de perforation alors que les blindages et protections individuelles se multipliaient et alors que les armes ennemies devenaient toujours plus puissantes et précises, dans une coûteuse course aux armements qui n'est toujours pas maîtrisée. La stratégie militaire trouve plus « rentable » de blesser un ennemi que de le tuer ; chaque blessé mobilisant une importante logistique (récupération, transport, soins, convalescence) en générant un impact qu'on espère démobilisateur dans les troupes et sur la population à l'arrière, capable d'infléchir les choix politiques. La protection de ses propres soldats compte aussi. À partir de 1855, lors de la guerre de Crimée, puis surtout en 1914-1918, les soldats se sont enfoncés sous terre pour se protéger des munitions devenues très performantes, développant une guerre dite des tranchées. Les marchands d'armes ont alors produit des obus shrapnels à sous-munitions avec un système de retardement de l'explosion, de manière à programmer celle-ci au-dessus des tranchées pour y tuer ceux qui s'y protégeaient. De même les munitions chimiques étaient-elles capables de libérer des toxiques invisibles, parfois persistants et s'insinuant dans les casemates (et au travers des protections en caoutchouc naturel dans le cas de l'ypérite). Ensuite, ce sont les bombardiers à grande capacité puis les missiles qui ont rendu les tranchées inutiles, eux-mêmes de peu de poids face à l'arme nucléaire, avant que ne se profilent les bombes à neutrons, de nouvelles munitions non toxiques ou « intelligentes » et la guerre des étoiles qui rend la notion de munition plus floue, avec par exemple l'utilisation du laser ou d'autres types d'ondes ou champs électromagnétiques, quand il ne s'agit pas simplement de virus informatiques chargés de déprogrammer les armes ennemies[réf. nécessaire].
Voir ci-après Efficacité des munitions.
Munition et environnement
Pollution et risques écosystémiques
Une grande quantité de métaux et produits toxiques sont mobilisés pour fabriquer les munitions dont la fabrication a été dopée par la
course aux armements, depuis la préparation de la Guerre 1914-18.
Tour à plomb de l'usine
Metaleurop Nord (
Pas-de-Calais), où ont été fabriquées des dizaines de milliards de billes de grenaille de plomb de chasse.
Les vapeurs et
fumées de tir émises lors du tir peuvent contenir des produits et métaux toxiques
Les sites de fabrication et dépôt abandonnés (Ici à Sangamon,
Illinois,
États-Unis) ont parfois été
pollués à la suite d'accidents, fuites, ou bombardements.
Une cartouche classique de 30 à 35 grammes contient 200 à 300 billes de plomb. Depuis 2005, en France, les cartouches au plomb ne sont plus autorisées pour les tirs dirigés en direction d'une zone humide.
Pour améliorer les caractéristiques cinétiques des projectiles, des métaux lourds ont été utilisés dans la plupart des munitions. Or, tous ces métaux sont toxiques, et en particulier le plomb auquel on ajoute généralement 7 à 10 % d'antimoine et d'arsenic également toxiques. Il est présent dans les balles, ou dans certaines amorces (azoture de plomb remplaçant le fulminate de mercure). Le plomb est l’un des éléments les plus toxiques en termes de risque/quantité, avec le mercure (présent sous forme de fulminate de mercure dans les anciennes amorces). Le cadmium, également très toxique est également présent dans certaines munitions (militaires).
Évolutions et tendance : De nombreux pays depuis les années 1980 ont interdit ou réduit l'utilisation du plomb dans les cartouches de chasse au profit de cartouches moins toxiques ou dites non-toxiques. Mais outre que d’autres métaux moins toxiques, mais néanmoins toxiques sont utilisés (bismuth notamment), si le cuivre ou laiton des chemisages ou douilles est peu toxique pour les animaux, il l’est, et à très faible dose, pour certains végétaux (algues) et pour beaucoup d'organismes aquatiques. Par ailleurs les nitrates ont été très utilisés dans les charges propulsives. Ce sont des eutrophisants de l'environnement et ils peuvent contribuer à acidifier l'air (sous forme d'acide nitrique ou comme précurseurs de l'ozone ou de gaz à effet de serre). Cet effet est négligeable comparé aux autres effets et aux quantités rejetées par l'agriculture. L'effet sur le corps humain des nitrates est complexe même positif par certains aspects (sportifs).
Les munitions peuvent polluer d'au moins six manières :
- lors de leur fabrication (ex : Metaleurop Nord en France produisait du plomb pour les munitions et formait des billes pour les cartouches dans sa tour à plomb. Comme d'autres sites industriels ou artisanaux, l'usine après sa fermeture et une coûteuse dépollution est encore source de problèmes majeurs de saturnisme et de pollution durable des sols et sédiments);
- lors d'accidents dans les usines de munitions, lors du transport, ou dans les dépôts de munitions. Par exemple, en , l'office suisse de l'environnement du canton de Schwyz a détecté une pollution inexpliquée à la surface de plusieurs lacs en Suisse (Est et centre). La Centrale nationale d'alarme (CENAL) a montré par des analyses et modèles de dissémination météorologique, qu'il s'agissait de retombées de fines particules de métaux lourds provenant de l'incendie accidentel d'un dépôt de munitions en Ukraine. En Allemagne on traite encore les pollutions graves laissées par un accident dans une usine de munition et l'explosion d'un train de munition, ce qui invite à réévaluer rétrospectivement les retombées d'accidents tels que l'explosion du dépôt de munitions du col du Susten en 1992, ou celui du dépôt de munition des dix-huit ponts qui a soufflé en 1916 une partie de la ville de Lille;
- lors de leur utilisation (émission de vapeurs de mercure, de plomb, de cuivre et d'imbrûlés), les problèmes directs de santé se posant surtout en salle de stand de tir, pour les entraineurs militaires ou de la police);
- lors de l'abandon ou de la perte de projectiles dans la nature (le plomb de chasse pose un réel problème dans la nature1 en France ; mais sur les terrains d'opération, d'autres métaux toxiques sont dispersés par les munitions militaires, dont de l'uranium appauvri) pour des questions de poids ou même pour polluer ou rendre non opérationnel intentionnellement en cas de conflit (projectiles sales).
Ce sont 5 000 à 8 000 tonnes de plomb qui étaient annuellement éparpillées dans l'environnement rien que par la chasse et le tir aux pigeons en France à la fin du XXe siècle en France, soit 500 à 700 fois les émissions annuelles de l'Usine Métaleurop-Nord avant sa fermeture (usine alors réputée la plus polluante par le plomb en France) ;
- lorsque les munitions non explosées sont perdues, oubliées lors de combats ou entraînements (une partie non négligeable des obus et d'autres munitions militaires n'explosent pas à l'impact) ;
- lors de leur démantèlement ou destruction finale ou rejet dans la nature (ex : munitions immergées), pour les munitions périmées, munitions chimiques interdites ou munition non-explosées récupérées et traitées dans de mauvaises conditions, tout particulièrement pour les armes chimiques.
Certains sites de tir aux pigeons, champs et prés périphériques se sont avérés plus pollués que des sites industriels à risque, nécessitant de coûteuses dépollutions.
Pour toutes ces raisons, les armées, les forces de l'ordre et les instances responsables de la chasse, dans certains pays commencent à imposer des munitions moins toxiques ou dites "non toxiques" et des conditions au traitement des déchets militaires issus du démantèlement d'armes et matériels militaires2.
Les quantités de munitions non utilisées à détruire peuvent être importantes et les autorités doivent à la fois éviter de les perdre vers des filières illégales, gérer les questions de confidentialité et de sécurité sanitaire et pyrotechniques.
La France et les pays ayant ratifié le traité d’interdiction des armes à sous munitions3 doivent rapidement (dans les 8 ans suivant l'entrée en vigueur du traité) détruire leurs stocks (dont environ 160 000 roquettes MLRS (contenant chacune 644 petites grenades) à éliminer, ce qu'en 2008 seuls les Pays-Bas et le Royaume-Uni avaient commencé à faire.
En France
La France doit ainsi éliminer 22 000 roquettes MLRS à sous-munitions (soit un total de 6 600 tonnes), ainsi que des munitions complexes dont missiles, torpilles, 50 000 obus OGRE (Ou OGR ou OGRE F1) à sous-munitions ; chacun de ces obus contient 63 grenades contenant un mécanisme d'autodestruction, pouvant couvrir une surface de 10 000 à 18 000 m2)2.
S'y ajoutent :
- 2 927 missiles Roland retirés du service2
- un stock de missiles, torpilles et autres munitions en attente d’élimination ou démantèlement pour recyclage2.
- un flux annuel d'environ 2 000 tonnes de munitions conventionnelles (torpilles et missiles non compris) à éliminer (les 3/4 venant de l’armée de terre)2.
- des missiles Hot (3 200, 74 t), Mistral (600, 11 t), RS530 (360, 70 t) et Magic (400, 43 t)... soit une centaine de tonnes par an2, hors roquettes à sous munitions lancées par le MLRS (déjà cités ci-dessus avec 22 000 engins et une masse de 6 600 tonnes).
Pourraient éventuellement à l'avenir s'ajouter l'obus d'artillerie Bonus (à deux sous-munitions antichar à guidage terminal) et le missile anti-pistes Apache (à charges éjectables ; 10 sous-munitions Kriss) de l'armée de l'air que la France en 2008 ne voulait pas considérer comme concernés par le traité sur les armes à sous-munitions4.
Pour en savoir plus sur les risques sanitaires et environnementaux, voir l'article Toxicité des munitions.
Risque d'explosion
Ce risque concerne surtout les munitions militaires anciennes manipulées par les agriculteurs, pêcheurs, forestiers qui les trouvent lors de leur travail dans les zones de stockage ou ayant subi des guerres. Des collectionneurs, curieux ou enfants cherchant à démonter des munitions sont souvent victimes d'accident. Des munitions explosent aussi parfois dans des centres d'incinérateurs de déchets ou de recyclage de métaux (par exemple le , un ouvrier français a été tué par l'explosion d'un obus qui avait été introduit dans les métaux d'une entreprise de recyclage à Vierzon et quatre de ses collègues ont été blessés, dont un grièvement. D'autres obus destinés au recyclage ont été pris en charge par le service de déminage)5.
Bois mitraillés
Lors des dernières guerres, des forêts entières ont vu leurs arbres prendre des éclats. Le bois s'est reformé dessus. L'acier a alors pollué le bois (discolorations principalement, réactions avec les tanins etc). Lors de l’abattage ou du sciage, le danger est grand de casser la chaîne, la scie ou le ruban. Certaines parcelles ont ainsi été abandonnées à l'exploitation. Pour les moins problématiques avait été créé le Centre des Bois Mitraillés à Bruyères (Vosges), lieu d'une bataille importante qui avait rendu beaucoup de parcelles inexploitables. Cette région subit actuellement une fermeture des paysages à cause d'une augmentation de la surface forestière. L'exploitation y est vitale. Le centre bénéficiait d'un banc de scie complètement amagnétique pour permettre une détection et une localisation grâce à une source gamma, et le purgeage avant sciage. Son activité a cessé ces dernières années après avoir accompli le travail.
Classification
Le mode de percussion déterminait originellement quatre types de munitions :
- centrale, étui métallique
- centrale, étui/douille non métallique : pour arme à canon lisse,
- à aiguille ou à broche, étui métallique et percussion latérale (XIXe siècle)
- annulaire
S'y sont ajoutés de nouveaux types dont ceux utilisés par les armes à sous-munitions et armes anti-personnels.
Boulets
Cartouches
Efficacité des munitions
Masse et vitesse du projectile
L'énergie cinétique augmentant en fonction du carré de la vitesse, alors que son influence sur la quantité de mouvement n'est pas supérieure à celle de la masse, il est intéressant, lors de la conception de la munition, de la privilégier si l'on souhaite offrir un meilleur rapport entre énergie et recul. Cela mène à préférer une balle légère et rapide.
À titre d'exemple, une 9 mm Parabellum standard de 8 g et présentant une vitesse à la bouche de 350 m/s aura une énergie de 490 joules tout comme une .45 ACP standard de 14,90 g avec une vitesse de 260 m/s (504 joules). Mais le recul développé par les deux munitions est en revanche très dissemblable puisque la quantité de mouvement de la 9 mm Parabellum est de 2,8 kgm/s contre 3,86 kgm/s pour la .45 ACP. Cette affirmation reposant sur des calculs est cependant à nuancer: le "recul" ressenti des munitions à basse pression (comme le 45ACP) est beaucoup plus doux et progressif que celui des munitions à haute pression (comme les 9mm Parabellum) qui est "sec" et rapidement fatigant pour le tireur. En termes de rapport entre énergie conférée au projectile et recul, l'avantage est très nettement en faveur des balles légères et rapides.
De telles balles nécessitent néanmoins des poudres performantes donc de hautes pressions en chambre ainsi que des canons longs, ce qui explique qu'il ait fallu du temps avant de développer des balles rapides et que les munitions d'arme de poing restent relativement lentes. Le poids de la tradition joue néanmoins un rôle important en la matière puisque qu'une 9 mm Parabellum THV (Très Haute Vitesse, qui pouvait atteindre selon le fabricant une vitesse maximale de 1 000 m/s) a été développée par une entreprise française sans rencontrer un succès commercial significatif. Les armées se sont progressivement dotées de munitions légères et rapides à partir des années 1960 et on note également l'apparition de munitions rapides et légères dans des pistolets mitrailleurs récents correspondant au concept de PDW. L'un d'entre eux, le P90 s'accompagne même du Five-SeveN, un pistolet chambré pour ce même genre de munition.
Onde de choc
En théorie, une onde de choc naît dans le sillage d'un projectile progressant hors du vide à plus de Mach 1. De surcroît, l'inertie et la résistance mécanique des tissus leur permet de reculer lors d'une poussée donc d'absorber une partie de l'énergie qui anime le projectile. Leurs caractéristiques physiques, en particulier leur densité, causeraient de plus une rapide dissipation d'une onde de choc par élévation de la température et dommages mécaniques au milieu immédiatement environnant et non à une part importante de l'ensemble. C'est pourquoi certains affirment qu'aucun projectile d'arme à feu contemporaine ne provoque d'onde de choc dans des tissus vivants où les cavités observées relèvent des ondes de pression.
Pouvoir perforant
Le pouvoir perforant d'un projectile est fonction de sa densité sectionnelle: il est fonction de la masse du projectile par rapport à sa surface au contact du corps à perforer. C'est pourquoi les projectiles perforants sont longs et denses.
Caractéristiques des balles
Mais l'énergie et le recul ne suffisent pas à rendre compte de l'efficacité des munitions. La capacité de mise hors combat d'un humain, par exemple, est particulièrement difficile à établir car des tests empiriques sont exclus. Plusieurs notions émergent toutefois :
- la capacité de perforation exprime l'aptitude d'une balle à traverser des obstacles et à pénétrer profondément dans la cible. Une munition blindée d'arme de poing est généralement capable de traverser la carrosserie d'une voiture (pas le moteur ni les roues) de part en part mais un gilet pare-balles relativement léger la stoppera. Une munition d'arme d'épaule présente généralement une capacité de perforation supérieure, face à laquelle les gilets pare-balles légers sont sans effet à moins de les renforcer de lourdes plaques (métal ou céramique). Ces protections individuelles sont de plus en plus répandues, c'est pourquoi les munitions de petits calibres utilisées dans les PDW ont pour objectif de les traverser. Certains résument la perforation en divisant l'énergie de la balle par sa surface frontale sans négliger la dureté de son noyau (densité sectionnelle).
- le pouvoir d'arrêt est la capacité d'une munition à mettre un adversaire hors de combat dès le premier impact. Un pouvoir d'arrêt supérieur est l'un des critères qui justifient pour certains l'emploi d'une munition de fort calibre, telle que le .45 ACP, alors même qu'elle présente un mauvais rapport entre l'énergie dissipée lors de l'impact et le recul produit mais également un encombrement et une masse plus importants que ceux des petits calibres.
- le pouvoir vulnérant correspond à la quantité de dommages qu'une balle occasionne dans des tissus vivants. Une balle de gros diamètre s'enfonçant profondément dans sa cible en expansant autant que possible détruira un plus grand volume de tissus.
- la morphologie du projectile, améliorant ou réduisant les autres paramètres.
Types de balles
Balles blindées
Il s'agit d'une configuration simple dans laquelle le noyau, souvent en plomb, est entièrement chemisé d'un métal dur. Ces balles simples présentent un coût réduit et réduisent l'emplombage. Leur efficacité limitée a également été perçue comme un avantage par les militaires, considérant qu'il était préférable de blesser un soldat ennemi qui monopolise beaucoup plus de ressources logistiques à transporter et à soigner que s'il est simplement mort. Leur utilisation dans un contexte civil, par exemple par des policiers, pose un problème car elles traversent souvent les corps et ricochent facilement, donc peuvent atteindre des innocents.
Balles perforantes

Elles présentent généralement une forme profilée (ogive) et sont composées d'une chemise classique en métal tendre (cuivre) et d'une ogive interne en métal très dur et très dense (tungstène, acier durci) pour augmenter leur densité sectionnelle. Une pellicule de plomb peut être coulée entre la chemise et l'ogive interne afin de lubrifier lors de l'impact. Lorsque la balle touche une surface dure, le nez de l'ogive s'écrase sur la surface et crée une zone de contact. L'ogive interne beaucoup plus dure glisse sur l'intérieur de la chemise (a fortiori si du plomb fondu par la chaleur de la balle est présent entre l'ogive interne et la jupe), bien calée par la chemise écrasée, l'ogive interne s'enfonce droit dans la surface dure tandis que la chemise vide reste contre la paroi. L'ogive pointue aura tendance à glisser le long des obstacles plutôt que de les fracasser. Certaines balles sont même recouvertes de Teflon pour faciliter leur pénétration. De telles balles perdent en puissance d'arrêt car n'expansent pas lors de l'impact. Une balle dont l'ogive est bien ronde aura en revanche tendance à conserver une trajectoire plus droite dans la cible et à briser les os si toutefois elle possède suffisamment d'énergie.
Balles à tête creuse ou molle, balles dum-dum
444 Marlin tête creuse (HP)
Ces balles sont conçues pour se déformer lors d'un impact sur un organisme vivant, donc « s'épanouir » ou « champignoner » afin d'augmenter leur efficacité. Les tissus vivants sont aqueux, or l'eau est (quasi) incompressible de sorte que ces balles molles sont déformées lors de l'impact, surtout si elles sont rapides, par la résistance rencontrée. Elles perdent en perforation mais augmentent les dommages causés à la cible par simple augmentation de leur surface frontale. Avant l'apparition de ce type de balles, certains entaillaient la tête de leur balle en forme de croix pour obtenir un effet équivalent ou encore l'éclatement de la balle en fragments dans la cible. Les balles dum-dum, produites dans l'arsenal du même nom près de Calcutta, furent les premières spécifiquement conçues pour obtenir cet effet. Ce type de balle est très répandu, dans le monde civil notamment6, bien qu'elles fussent interdites lors de la première conférence internationale de la paix de la Haye en 1899.
Chevrotine et Glaser
La chevrotine et la Glaser Safety Slug (en) sont des munitions composées de projectiles multiples. Les fusils de chasse à âme lisse l'utilisent pour augmenter la probabilité de toucher une petite cible en mouvement, mais qui occasionnent également à courte portée des impacts multiples sans toutefois provoquer une sur pénétration.
La Glaser (marque commerciale) est une munition très spécifique utilisée dans les situations de prise d'otage. La balle contient un ensemble de projectiles qui s'égaillent dans la cible à l'impact, occasionnant des dommages immédiats et considérables, notamment au système nerveux, destinés à interdire toute réaction de la cible. Les Glaser nécessitent un tir parfaitement localisé pour être efficaces, un impact à l'abdomen pourrait par exemple rester sans effet immédiat, donc exposer un otage[réf. nécessaire]. Ces deux types de munitions sont très efficaces à courte portée mais présentent une capacité de perforation très faible.
Munitions militaires
Les munitions modernes utilisées par les armées (5,56 mm Otan, 5,45 russe) présentent malgré leur faible diamètre des potentiels de destruction importants. Trois phénomènes concourent à cette efficacité. Là encore, les données sont contestées, notamment parce qu'elles contreviennent parfois à des accords signés par les gouvernements qui les mettent en œuvre mais aussi parce qu'il est très difficile de faire la part entre la légende et la réalité dans un domaine aussi controversé.
- Leur barycentre est excentré vers l'arrière qui a donc tendance, lors de l'impact, à « dépasser l'avant ». La balle bascule donc lorsqu'elle touche la cible, ce qui augmente sa surface donc les dommages occasionnés.
- Certaines, en particulier le 5,56 mm Otan, peuvent se fragmenter en plusieurs éclats dans la cible grâce à leur grande vitesse d'impact et de rotation.
- Outre la capacité de destruction correspondant au diamètre de la balle, leur grande vitesse crée une onde de choc si rapide et puissante qu'elle déchire les tissus dans lesquels elle se propage au lieu de les déformer temporairement.
Les abréviations présentées dans les tableaux ci-dessous correspondent aux balles suivantes :
- LRN : Lead Round Nose ; balle de plomb simple et peu onéreuse non chemisée à ogive arrondie pour une meilleure pénétration dans l'air.
- FMJ : Full Metal Jacket ; balle chemisée, c'est-à-dire recouverte d'un revêtement de métal dur. Ce type de balle est peu déformable.
- FMC flat : Full Metal Case ; balle à tête plate utilisé plus pour le tir en stand que pour la chasse, moins onéreuse et moins lourde que sa grande sœur.
- JSP : Jacketed Soft Point ; balle chemisée à tête molle. La balle est entourée d'une couche de métal dur sauf la tête destinée à expansée.
- JHP : Jacketed Hollow Point ; balle chemisée à tête creuse, la balle est recouverte d'un revêtement de métal difficile à déformer sauf pour la tête qui comprend une dépression en son centre pour permettre une meilleure expansion.
- SJ ESC : Semi Jacketed Exposed Steel Core ; noyau en acier semi-chemisé. Balle développée autour d'un noyau dur perforant conçu pour passer les gilets pare-balles.
- LSW : Lead Semi-Wadcutter ; balle en plomb à tête tronconique. La tête de la balle est une ogive plate, peu onéreuse et présentant des qualités balistiques améliorées par rapport à une balle à la tête totalement plate............................................................................................................................................................
Comparaison de quelques munitions
Quelques munitions d'armes de poing
Les vitesses et énergies indiquées correspondent aux tirs exécutés avec l'arme appropriée la plus courante. Un canon plus long ou plus court peut modifier ces chiffres.
Ce tableau présente les caractéristiques balistiques des munitions d'armes de poing les plus connues. La performance utile typique* se base sur les caractéristiques des munitions standard du marché les plus fréquemment rencontrées, ceci à titre de comparaison.
La performance d'une munition, c'est-à-dire son impact sur la cible s'exprime en Joules selon la formule E = 1/2 M.V2 où M est la masse et V la vitesse de la balle
Le recul ressenti dans l'arme, se mesure lui par la quantité de mouvement exprimée en kg m/s selon la formule Q = M.V
Ainsi une munition de calibre .45 ACP a une performance comparable à une munition de 9 mm Luger (environ 510 J), mais provoque un recul supérieur (3,87 kg m/s contre 2,89 kg m/s)
Performance des munitions d'armes de poing les plus répandues
| | Données balistiques (munitions du marché) | performance utile typique* |
|---|
| Caractéristique | Diamètre
balle
| Diamètre
balle
| longueur
cartouche
| longueur
douille
| poids
balle
| poids
balle
| vitesse
min
| vitesse
max
| Energie
min
| Energie
max
| Poids | Vitesse | Energie | Recul |
|---|
| unité |
mm |
pouce |
mm |
mm |
g |
Grain |
m/s |
m/s |
J |
J |
grain |
m/s |
J |
kg m/s |
| Munitions de pistolet semi-automatique |
|---|
| .22 LR |
5,56 |
.223 |
25,40 |
15,60 |
1,9 - 2,6 |
30 - 40 |
370 |
500 |
180 |
260 |
32 |
440 |
200 |
0,91 |
| 7,65 mm Browning |
7,94 |
.313 |
25 |
17,30 |
4-5 |
62-77 |
280 |
335 |
170 |
240 |
73 |
318 |
239 |
1,50 |
| 9 mm court |
9,01 |
.355 |
25 |
17,30 |
6 |
90 |
290 |
350 |
280 |
360 |
90 |
300 |
260 |
1,72 |
| 9 mm Luger |
9,01 |
.355 |
29,70 |
19,15 |
8-12 |
124-180 |
330 |
400 |
480 |
550 |
124 |
360 |
520 |
2,89 |
| 9 mm Imi |
9,01 |
.355 |
29,70 |
21,15 |
8-12 |
124-180 |
330 |
400 |
480 |
550 |
124 |
360 |
520 |
2,89 |
| .38 super auto |
9,04 |
.356 |
32,51 |
22,86 |
8-10 |
124-154 |
370 |
430 |
570 |
740 |
130 |
370 |
580 |
3,12 |
| .357 SIG |
9,06 |
.357 |
28,96 |
21,97 |
6,5-8 |
100-124 |
410 |
490 |
690 |
820 |
125 |
413 |
692 |
3,34 |
| .40 S&W |
10,17 |
.400 |
28,80 |
21,60 |
8,7-13 |
135 - 200 |
300 |
340 |
500 |
700 |
180 |
295 |
510 |
3,44 |
| 10 mm Auto |
10,17 |
.400 |
32,00 |
25,20 |
9-15 |
140 - 230 |
350 |
490 |
680 |
960 |
180 |
380 |
996 |
4,82 |
| .45 ACP |
11,43 |
.450 |
32,40 |
22,80 |
11-15 |
170 - 230 |
255 |
340 |
480 |
670 |
230 |
260 |
510 |
3,87 |
| .45 GAP |
11,43 |
.450 |
27,20 |
19,20 |
11-15 |
170 - 230 |
255 |
340 |
480 |
670 |
200 |
310 |
624 |
4,03 |
| .454 Casull |
11,48 |
.452 |
45,00 |
35,10 |
16 - 26 |
240 - 400 |
430 |
580 |
2300 |
2600 |
300 |
500 |
2460 |
9,72 |
| .50 AE |
12,70 |
.500 |
40,90 |
32,60 |
19 - 21 |
300 - 325 |
440 |
470 |
1900 |
2200 |
300 |
470 |
2150 |
9,13 |
| Munitions de revolver (ou mixtes : rarement utilisées dans des Pistolets) |
|---|
| .22 LR |
5,56 |
.223 |
25,40 |
15,60 |
1,9 - 2,6 |
30 - 40 |
370 |
500 |
180 |
260 |
32 |
440 |
200 |
0,91 |
| .22 Magnum |
5,56 |
.223 |
34,30 |
26,80 |
1,9 - 3,2 |
30 - 50 |
470 |
700 |
410 |
440 |
40 |
572 |
430 |
1,48 |
| .38 Special |
9,06 |
.357 |
39,00 |
29,30 |
8-10 |
124-154 |
270 |
350 |
300 |
450 |
158 |
295 |
435 |
3,02 |
| .357 Magnum |
9,06 |
.357 |
40,00 |
33,00 |
8-12 |
124-180 |
380 |
520 |
780 |
1090 |
158 |
395 |
796 |
4,04 |
| .41 Magnum |
10,40 |
.410 |
40,40 |
32,80 |
11 - 17 |
170 - 260 |
380 |
480 |
900 |
1800 |
210 |
375 |
956 |
5,10 |
| .44 Magnum |
10,90 |
.429 |
41,00 |
32,60 |
16 - 22 |
240 - 340 |
350 |
450 |
1000 |
1800 |
240 |
360 |
1010 |
5,59 |
| .460 S&W Magnum |
11,48 |
.452 |
58,40 |
46,00 |
13 - 26 |
200 - 400 |
465 |
700 |
2700 |
3800 |
260 |
630 |
3340 |
10,64 |
Quelques munitions d'armes d'épaule
Performance des munitions d'armes d'épaule les plus répandues
| | Données balistiques (munitions du marché) | performance utile typique* |
|---|
| Caractéristique | Diamètre
balle
| Diamètre
balle
| longueur
cartouche
| longueur
douille
| poids
balle
| poids
balle
| vitesse
min
| vitesse
max
| Energie
min
| Energie
max
| Poids | Vitesse | Energie | Recul |
|---|
| unité |
mm |
pouce |
mm |
mm |
g |
Grain |
m/s |
m/s |
J |
J |
grain |
m/s |
J |
kg m/s |
| .22 LR |
5,60 |
.223 |
25,40 |
15,60 |
1,9 - 2,6 |
30-40 |
370 |
500 |
180 |
260 |
32 |
440 |
200 |
0,91 |
|---|
5,56 × 45 mm Otan
.223 Remington |
5,69 |
.224 |
57,40 |
44,70 |
3 - 4 |
30-60 |
850 |
993 |
1670 |
1890 |
55 |
988 |
1740 |
3,52 |
|---|
| .222 Remington |
5,69 |
.224 |
54,10 |
43,20 |
4-5 |
50-77 |
890 |
1090 |
1450 |
1600 |
50 |
957 |
1485 |
3,10 |
|---|
| .243 Winchester |
6,20 |
.243 |
68,83 |
51,90 |
4 - 6 |
62 - 90 |
920 |
1240 |
2500 |
2900 |
90 |
945 |
2600 |
5,51 |
|---|
| .270 Winchester |
7,00 |
.275 |
84,80 |
64,50 |
6 |
90-130 |
910 |
1100 |
3500 |
4000 |
130 |
933 |
3670 |
7,86 |
|---|
| 7x57 mm Mauser |
7,24 |
.285 |
78,00 |
57,00 |
8-12 |
124-180 |
700 |
900 |
3000 |
3700 |
160 |
765 |
3035 |
7,93 |
|---|
| 7x64 mm Brennecke |
7,24 |
.285 |
84,00 |
64,00 |
8-12 |
124-180 |
820 |
920 |
3300 |
4000 |
162 |
800 |
3360 |
8,40 |
|---|
| 7 mm Rem Mag |
7,20 |
.284 |
84,00 |
64,00 |
8-10 |
124-154 |
870 |
1100 |
4000 |
4400 |
150 |
945 |
4340 |
9,18 |
|---|
7,62 x 51 mm Otan
.308 Winchester |
7,80 |
.308 |
69,90 |
51,20 |
6,5-8 |
124-150 |
780 |
860 |
2900 |
3600 |
150 |
860 |
3594 |
8,36 |
|---|
| 7,62 × 54 mm R |
7.90 |
.308 |
76.2 |
53.5 |
24.3 |
|
|
870 |
|
3500 |
|
|
|
|
|---|
| .300 Win Mag |
7,80 |
.308 |
85,00 |
67,00 |
8,7-13 |
135-200 |
900 |
990 |
4500 |
5000 |
180 |
900 |
4725 |
10,50 |
|---|
| 30-06 Springfield |
7,80 |
.308 |
85,00 |
63,00 |
9-15 |
140-230 |
750 |
890 |
3800 |
4000 |
180 |
825 |
3970 |
9,62 |
|---|
| 7,92x57 mm Mauser |
8,22 |
.324 |
82,00 |
57,00 |
11-15 |
170-230 |
720 |
800 |
4800 |
4800 |
200 |
740 |
3550 |
9,60 |
|---|
| .338 Win Mag |
8,60 |
.338 |
84,80 |
64,00 |
11-15 |
170-230 |
760 |
900 |
3500 |
5300 |
200 |
900 |
5250 |
11,66 |
|---|
| 9,3x62 mm Mauser |
9,30 |
.366 |
83,60 |
62,00 |
16-26 |
240-350 |
720 |
800 |
4300 |
5200 |
250 |
745 |
4495 |
12,06 |
|---|
| .375 H&H |
9,50 |
.375 |
91,00 |
72,40 |
16-26 |
240-350 |
700 |
882 |
5500 |
6300 |
270 |
800 |
5600 |
14,00 |
|---|
Coûts
En France, selon une étude nationale commandée en 2006 par la fédération nationale des chasseurs7, un chasseur français moyen dépense chaque année 180 euros d'achat de munitions, soit plus que son budget annuel (150 €) d'achat d'arme et accessoires (sur une dépense annuelle totale moyenne de 1 250 €/an).
Fléchettes
Obus
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Bibliographie
- Gérard Henrotin, Les fusils de chasse à percussion et à broche expliqués, Éditions H&L HLebooks.com - 2010
Articles connexes
Notes et références
- Ian J. Fisher, Deborah J. Pain, Vernon G. Thomas (2006), A review of lead poisoning from ammunition sources in terrestrial birds [archive] ; Biological Conservation, Volume 131, Issue 3, aout 2006, Pages 421-432 (résumé [archive]), PDF, 12p
- Synthèse de 20 pp. du Rapport (200 pp.) sur le « démantèlement des matériels d'armement » [archive], faisant suite à une mission sur le démantèlement des matériels d’armement conduite en 2008 par le CGARM (Xavier Lebacq, Franck L’hoir) et le Bureau-Environnement de la DMPA (avec états-majors et services concernés).
- À la suite de la réunion de Dublin du 30 mai 2008, la France et d’autres pays européens ont ratifié en décembre le traité d’interdiction des armes à sous munitions
- Article du Point de Jean Guisnel "Défense ouverte" ; La France retire un obus à sous-munitions de son arsenal du 2008/11/28 [archive]
- Journal des accidents et catastrophes [archive](Consulté 2008 06 17)
- http://dailycaller.com/2012/08/17/who-does-the-government-intend-to-shoot [archive]
- CSA 2006 ; enquête nationale estimant les dépenses annuelles consenties par les chasseurs, réalisée par téléphone, par système CATI, du 27 février au 6 mars 2006, auprès des chasseurs ayant validé leur permis pour l'année cynégétique 2005-2006
Liens externes
Munition au phosphore blanc
Des roquettes
Hydra-70 au phosphore en 1996.
Les munitions au phosphore blanc sont des armes qui utilisent l'un des allotropes courants de l'élément chimique phosphore : le phosphore blanc.
Parfois aporté sur les plages à partir de containers ou de munitions immergées dégradées, sa couleur jaune translucide peut le faire confondre avec des morceaux d'ambre. Il ne doit pas être touché car source de graves brûlures (de même pour le phosphore rouge).
Utilisation
Rideau de fumée créé par des roquettes au phosphore blanc lors d'un exercice en Thaïlande en 2010.
Le phosphore blanc est utilisé dans l’agrochimie (fabrication d’engrais phosphorés ou d’insecticides dits « organophosphorés »1,2,3.
On le retrouve dans certains feux d'artifice3.
Il est aussi utilisé par les armées dans les munitions destinées à produire de la fumée, éclairer et incendier (munitions incendiaires). Il est aussi généralement l’élément brûlant des munitions traçantes4.
D'autres noms communs incluent « WP » et le terme d'argot « Willie Pete » ou « Willie Peter » dérivé de William Peter, l'alphabet phonétique de la Seconde Guerre mondiale pour WP, qui est encore parfois utilisé dans le jargon militaire. Le phosphore blanc est pyrophorique (s’enflamme au contact de l’air), brûle très fort et peut enflammer les tissus, le carburant, les munitions et d’autres combustibles.
En plus de ses capacités offensives, le phosphore blanc est un agent de fumée extrêmement efficace qui réagit avec l'air pour produire immédiatement une couche de vapeur de pentoxyde de phosphore. Les munitions au phosphore blanc génératrices de fumée sont très courantes, en particulier comme grenades à fumée pour l'infanterie, chargées dans des lance-grenades défensifs sur des chars et d'autres véhicules blindés, et dans le cadre du lot de munitions destinées à l'artillerie ou aux mortiers. Ils créent des écrans de fumée pour masquer le mouvement, la position, les signatures infrarouges ou les positions de tir des forces amies. Ils sont souvent décrits comme des obus fumigènes/marqueurs en raison de leur fonction secondaire consistant à marquer des points d'intérêt, comme l'utilisation d'un mortier léger pour désigner une zone cible pour les observateurs d'artillerie5.
Le phosphore rouge est également utilisé pour cette utilisation ; le rideau de fumée d'un obus de mortier de 81 mm tient environ deux minutes6.
Dangerosité
En 2022, la dose létale précise du phosphore blanc est encore inconnue3 (comprise entre 50 et 100 mg)7. Ce produit présente au moins quatre facteur de dangerosité.
Brûlure thermique
Ayant la consistance d'une cire à température ambiante, le phosphore blanc s’auto-enflamme au dessus de 30°C et en présence d’oxygène3. Sa combustion est très exothermique (jusqu'à 1 300°C) et source de flammes et à des fumées denses et jaunes ; et il continuera à brûler tant qu'il reste de l'oxygène et des restes de phosphore3.
Brûlure chimique
En se combinant avec l’oxygène de l'air, le phosphore blanc produit deux pentoxydes de phosphore (P2O3 et P2O5)3. Au concact de l'eau (ou de l'humidité de la blessure), ils s'hydrolysent en acide phosphorique, hautement corrosif et donc source d'une aggravation de la plaie par brûlure chimique.
Le phosphore blanc, parce qu'il est hautement lipophile pénètre en outre rapidement et profondément dans la chair (et s'y fixe en saponifiant les graisses, en continuant à détruire les cellules qu'il touche au fur et à mesure qu'il entre en contacgt avec de l'oxygène8.
Les pansements gras sont à proscrire car le phosphore est liposoluble3.
brûlure extensive
Selon une revue de la littérature récente (2022), le phosphore blanc cause de graves brûlures, profondes, extrêmement douloureuses et ayant la caractéritique d'être « extensives » (c'est à dire qui s'autoentretiennent si la plaie n'est immédiatement abondamment lavée à l’eau stérile ou idéalement au sérum physiologique et très vite débarassée des restes de particules de phosphore blanc)3.
Toxicité systémique
Le phosphore (y compris gazeux, dans le fumées de combustion), aisément absorbé par la peau (sébum, cheveux...) et les poumons, est en outre responsable d’une toxicité systémique, possible même à partir d'une petite brûlure. Cette toxicité générale est notamment médiée par une hypocalcémie, source possible de troubles du rythme cardiaque parfois assez graves pour induire une mort subite3. Le phosphore est aussi et notamment source de nécroses hépatique et rénale.
Cette toxicité se manifeste en 3 étapes :
- lors des 8 premières heures : problèmes oculaires parfois très sévères(blépharospasme, photophobie et/ou larmoiements) ; problèmes digestifs se traduisant par des douleurs abdominales, nausées, vomissements et/ou diarrhées (parfois à odeur d’ail) et phosphorescents dans le noir3 ;
- de la 8 ème heure au 3ème jour : régression temporaire des symptômes dans 50% des cas, faussement rassurante car les symptômes réapparaîssent ensuite avec parfois une ou des défaillance(s) d’organe(s), pouvant éventuellement induire un coma, un choc cardiogénique, une insuffisance rénale, des hémorragies graves, etc. 3 ;
- entre le 4ème et 8ème jour : défaillance multiviscérale, éventuellement mortelle, impliquant une surveillance clinique et biologique rapprochée durant une dizaine de jours3.
Soins
La blessure était autrefois chirurgicalement réparée sous de l'eau javelllisée, ce qui est impossible quand il s'agit des poumons.
La physiopathologie des brûlures au phosphore étant très particulière, source de complications spécifiques, elle imposant une prise en charge également particulière. Aprè lavage et décontamination soigneuse de la plaie et des brûlures (les particules de phosphores en surface de la peau, de vêtement ou d'une blessures ont visibles sous lumière ultraviolette), un ou plusieurs parages de la plaie sont suivis de la couverture des pertes de substance qui ont été brûlées ou rongées par l'acide phosphorique (chirurgie plastique et réparatrice)3.
Histoire
On pense que le phosphore blanc a été utilisé pour la première fois par des incendiaires fenians (nationalistes irlandais) au 19e siècle, sous la forme d'une solution de disulfure de carbone. Lorsque le sulfure de carbone s'est évaporé, le phosphore s'est enflammé. Ce mélange était connu sous le nom de « feu de Fenian »9.
En 1916, au cours d'une lutte acharnée autour de la conscription pour la Première Guerre mondiale, douze membres du Syndicat des travailleurs de l'Industrie du Monde, opposés à la conscription, ont été arrêtés à Sydney, en Australie, et condamnés pour avoir utilisé ou comploté d'utiliser du matériel incendiaire, notamment : phosphore. On pense que huit ou neuf hommes de ce groupe, connu sous le nom de Sydney Twelve, ont été arrêtés par la police. La plupart ont été relâchés en 1920 après une enquête10.
Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale
L'artillerie française pendant la Première Guerre mondiale dispose à partir de 1915 pour le canon de 75 mm modèle 1897 des nouveaux obus spéciaux baptisés no 2 et no 3 mis au point sur la base de l'obus de 75 explosif. L'obus spécial no 2 est un obus incendiaire-suffocant composé de phosphore et de sulfure de carbone, l'obus spécial no 3 est un obus incendiaire-fumigène chargé uniquement de phosphore.
À la fin de 1916, les forces armées britanniques introduisit les premières grenades à main au phosphore blanc fabriquées en usine. Pendant la Première Guerre mondiale, les États-Unis, le Commonwealth et, dans une moindre mesure, l'empire du Japon, utilisèrent des obus à mortier au phosphore blanc, des obus, des roquettes et des grenades, à la fois de production de fumée et de rôle antipersonnel. L'armée britannique a également utilisé des bombes au phosphore blanc contre des villageois kurdes et Al-Habbaniyah dans la province d'Al-Anbar pendant la Grande Révolution irakienne de 192011.
Dans l'entre-deux-guerres, l'armée américaine s'est entraînée au phosphore blanc, au tir d'obus d'artillerie et au bombardement aérien.
Mortier incendiaire monté sur un châssis de
char Valentine, tirant des obus au phosphore durant des essais à Barton Stacey, 20 avril 1944. C'est un Valentine à tourelle remplacée par un
mortier lourd destiné à projeter des obus incendiaires de
25 livres (11,3
kg) de
TNT pour démolir les fortifications. Le
Petroleum Warfare Dept procéda seulement à des essais, de 1943 à 1945. La portée maximale était de 1,8 km, mais la portée efficace ne dépassait pas 360 m.
En 1940, lorsque l'invasion des îles britanniques semblait imminente, la société de phosphore Albright et Wilson suggère au gouvernement britannique d'utiliser un matériau similaire au feu Fenian dans plusieurs armes incendiaires appropriées. L'une d'elles est la grenade incendiaire spéciale incendiaire no 76, qui consistait en une bouteille en verre remplie d'un mélange semblable au feu Fenian, ainsi que du latex. Elle est proposée en deux versions, l’une avec un capuchon rouge destiné à être lancé à la main et une bouteille légèrement plus résistante avec un capuchon vert, destinée au Northover Projector (un lanceur brut de 2,5 pouces utilisant de la poudre noire comme agent propulseur). C'étaient des armes anti-chars improvisées, déployées à la hâte en 1940 par le Petroleum Warfare Department, alors que les Britanniques attendaient l'invasion allemande après avoir perdu l'essentiel de leurs armes modernes lors de l'évacuation de Dunkerque.
Au début de la bataille de Normandie, 20 % des munitions de mortier américaines de 81 mm étaient constituées d'obus de fumée M57 utilisant un agent de remplissage au phosphore blanc. Au moins cinq citations de la Medal of Honor américaine mentionnent que leurs destinataires ont utilisé des grenades au phosphore blanc M15 pour dégager les positions ennemies. Lors de la seule libération de Cherbourg en 1944, un seul bataillon de mortiers américain, le 87e, a tiré 11 899 obus de phosphore blanc dans la ville. L’armée américaine et les Marines ont utilisé des obus M2 et M328 WP dans des mortiers de 107 mm (4,2 pouces). Le phosphore blanc était largement utilisé par les soldats alliés pour mettre fin aux attaques allemandes et semer le chaos parmi les concentrations de troupes ennemies au cours de la dernière partie de la guerre11.
Les chars Sherman portaient le M64, un obus au phosphore blanc de 75 mm destiné au blindage et à la détection d’artillerie, mais les équipages de chars trouvèrent utile contre des chars allemands, tels que le Panther, que leurs munitions APC ne puissent pas pénétrer à grande distance. La fumée des obus tirés directement sur les chars allemands serait utilisée pour les aveugler, permettant ainsi aux Sherman de se rapprocher d'un champ de tir où leurs obus perforants seraient efficaces. De plus, en raison des systèmes de ventilation de la tourelle aspirant les émanations, les équipages allemands étaient parfois obligés d'abandonner leur véhicule : cela s'avérait particulièrement efficace contre les équipages inexpérimentés qui, voyant la fumée à l'intérieur de la tourelle, présumaient que leur char avait pris feu. La fumée était également utilisée pour « profiler » les véhicules ennemis, les obus étant tombés derrière pour obtenir un meilleur contraste pour les armes à feu.
Utilisations ultérieures
Le phosphore blanc est courant dans les arsenaux militaires.
Les munitions au phosphore blanc ont été largement utilisées en Corée, au Vietnam, durant la première guerre d'Afghanistan12 et, plus tard, par les forces russes dans les deux Guerres en Tchétchénie.
Les grenades au phosphore blanc ont été utilisées au Vietnam pour détruire les complexes de tunnels du Viet Cong, car elles allaient brûler tout l'oxygène et étouffer les soldats ennemis se réfugiant à l'intérieur. Les soldats britanniques ont également beaucoup utilisé des grenades au phosphore pendant le conflit des Malouines pour détruire les positions argentines, car le sol tourbeux sur lequel ils étaient construits tendait à atténuer l'impact des grenades à fragmentation.
Selon GlobalSecurity.org, lors de la bataille de contre Grozny en Tchétchénie, entre un quart et un cinquième des obus d'artillerie ou de mortier russe tirés était des obus fumigènes ou de phosphore blanc.
Il aurait été utilisé au Sud-Liban en 2006 et dans la Bande de Gaza en 200912.
Durant la seconde guerre d'Afghanistan, en mai 2009, on fait état de quarante-quatre cas d'utilisation ou de possession de phosphore blanc par les talibans : onze cas de tirs d'obus au phosphore blanc, huit incidents concernent du phosphore retrouvé sur des bombes artisanales. Dans les 25 autres cas, le combustible a été retrouvé inutilisé, souvent dans des caches d'armes13.
En 2020, les seuls obus de 155 mm de l’artillerie de armée de terre française utilisant du phosphore sont deux types obus fumigènes. Le modèle F1A peut être tiré depuis un AMX AuF1 et camion équipé d’un système d’artillerie (CAESAR) et le F2A réservé au CAESAR.
Utilisation en Irak
En , lors de la première bataille de Falloujah, Darrin Mortenson du North County Times, en Californie, signalait que le phosphore blanc était utilisé comme une arme incendiaire. Mortenson a décrit une équipe de mortiers de la marine utilisant un mélange de phosphore blanc et d'explosifs puissants pour pilonner un groupe de bâtiments où des insurgés avaient été repérés tout au long de la semaine. En , lors de la deuxième bataille de Fallujah, les journalistes du Washington Post incorporés à la Task Force 2-2, l'équipe de combat régimentaire 7, ont déclaré avoir été témoins de tirs d'artillerie par des projectiles WP.
Le , le lieutenant-colonel Barry Venable, porte-parole du Département de la défense américain, a confirmé à la BBC que le phosphore blanc avait été utilisé comme arme incendiaire anti-personnel à Falloujah. Venable a déclaré : « Lorsque vos forces ennemies sont dans des positions couvertes sur lesquelles vos obus d'artillerie à haute explosion n'ont aucun impact et que vous souhaitez les faire sortir de ces positions, une technique consiste à tirer un obus de phosphore blanc dans la position. Les effets combinés du feu et de la fumée — et dans certains cas de la terreur provoquée par l'explosion au sol — les chasseront des trous pour vous permettre de les tuer avec des explosifs puissants. »
Le , le gouvernement irakien a annoncé qu'il enquêterait sur l'utilisation du phosphore blanc dans la bataille de Falloujah. Le , le général Peter Pace a déclaré que les munitions au phosphore blanc étaient un « outil légitime de l'armée » utilisé pour illuminer des cibles et créer des écrans de fumée, affirmant que « ce n'est pas une arme chimique, c'est une arme incendiaire. droit de la guerre d'utiliser ces armes au fur et à mesure de leur utilisation, de les marquer et de les filtrer »14.
Dans le conflit Azerbaïdjan/Arménie
Plus récemment, en 2020 lors du conflit armé opposant l’Arménie et l’Azerbaïdjan, des blessés de guerre arméniens ont présenté des brûlures apparemment causées par du phosphore3
Notes et références
- Loai Nabil Al Barqouni, Sobhi I Skaik, Nafiz R Abu Shaban et Nabil Barqouni, « White phosphorus burn », The Lancet, vol. 376, no 9734, , p. 68 (ISSN 0140-6736, DOI 10.1016/s0140-6736(10)60812-4, lire en ligne [archive], consulté le )
- Uri Aviv, Rachel Kornhaber, Moti Harats et Josef Haik, « The burning issue of white phosphorus: a case report and review of the literature », Disaster and Military Medicine, vol. 3, no 1, (ISSN 2054-314X, DOI 10.1186/s40696-017-0034-y, lire en ligne [archive], consulté le )
- Lacroix, G., Martinot-Duquennoy, V., Ngo, B., Knipper, P., & Pasquesoone, L. Revue de la littérature sur les brûlures au phosphore (PDF) Annals of Burns and Fire Disasters - vol. XXXV - n. 2 - June 2022 ; url=http://www.medbc.com/annals/review/vol_35/num_2/text/vol35n2p152.pdf [archive] .
- http://www.faqs.org/docs/air/ttpyro.html [archive]
- http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4442988.stm [archive]
- « Munitions d’infanterie de 81 mm » [archive], (consulté le ).
- WILLIAM T. SUMMERLIN, ARNOLD I. WALDER et JOHN A. MONCRIEP, « WHITE PHOSPHORUS BURNS AND MASSIVE HEMOLYSIS », The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care, vol. 7, no 3, , p. 476–484 (ISSN 0022-5282, DOI 10.1097/00005373-196705000-00012, lire en ligne [archive], consulté le )
- A. Eldad et G.A. Simon, « The phosphorous burn - a preliminary comparative experimental study of various forms of treatment », Burns, vol. 17, no 3, , p. 198–200 (ISSN 0305-4179, DOI 10.1016/0305-4179(91)90103-n, lire en ligne [archive], consulté le )
- (en) Niall Whelehan, The Dynamiters, , 341 p. (ISBN 978-1-139-56097-9, lire en ligne [archive]), p. 58.
- http://members.optushome.com.au/spainter/Turner.html [archive]
- Alan Axelrod, Little-Known Wars of Great and Lasting Impact, Fair Winds Press, (ISBN 9781616734619, lire en ligne [archive]).
- F. Ceppa, A. Gollion, H. Delacour, P. Burna, « Le phosphore blanc : une arme chimique « autorisée » ? », Médecine et armée, , p. 240 (lire en ligne [archive]).
- « Les Taliban démentent utiliser du phosphore blanc » [archive], sur France 24 (consulté le ).
Arme chimique
Une arme chimique est une arme spécialisée qui utilise des substances conçues pour infliger des blessures ou pour tuer des êtres vivants du fait de leurs propriétés chimiques ou de leur toxicité.
Selon l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), « le terme arme chimique peut également s'entendre pour tout composé chimique toxique, ou les précurseurs d'un tel composé, susceptibles de provoquer la mort, des blessures, une incapacité temporaire ou une irritation sensorielle par son action chimique. Les munitions et les équipements associés conçus pour produire et disperser ces armes chimiques, qu'ils soient chargés ou vides, sont également considérés eux-mêmes comme des armes »1. Une arme chimique est dite unitaire lorsque sa substance active est stockée telle quelle avant utilisation, à la différence d'une arme binaire, dont le principe actif doit être préparé avant utilisation en faisant réagir deux ou plusieurs précurseurs plus stables généralement moins toxiques. Les plus dangereux d'entre eux sont notamment les agents innervants, comme le sarin et le VX, et les vésicants, comme la lewisite et le gaz moutarde.
Les armes chimiques sont classées parmi les armes de destruction massive (ADM) aux côtés des armes bactériologiques et des armes nucléaires, l'ensemble étant désigné collectivement par le sigle NBC, par opposition aux armes conventionnelles. Ces dernières agissent avec leur potentiel cinétique ou leur puissance explosive, tandis que les armes chimiques peuvent être largement dispersées sous forme de gaz ou d'aérosols liquides ou solides, et ainsi toucher des cibles bien au-delà de celles initialement visées. Le chlore, les gaz lacrymogènes et les moutardes azotées sont des exemples d'armes chimiques contemporaines.
L'usage massif d'armes chimiques est apparu lors de la Première Guerre mondiale. La charge toxique, du chlore dans un premier temps, a d'abord été diffusée sous forme gazeuse dispersée par les vents vers l'ennemi, puis a été envoyée vers sa cible par un vecteur, généralement des obus ou des bombes, voire des grenades chimiques dès 1914-1918.
Le gaz CS et le gaz poivre sont les plus utilisés pour le maintien de l'ordre. Le CS est considéré comme une arme non létale, mais le gaz poivre est connu pour ses risques d'accidents létaux. Les armes chimiques sont contrôlées au niveau mondial par l'OIAC, chargée de vérifier l'application des dispositions de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques.
Types d'armes chimiques
Plusieurs dizaines de substances ont été utilisées ou stockées à des fins militaires au cours du XXe siècle.
Incapacitants
Armes non létales, les incapacitants n'ont pas vocation à tuer ni à blesser et peuvent être employés par les forces de l'ordre lors d'opérations de police. Ils peuvent également avoir une utilité tactique pour forcer des combattants à s'exposer hors de leurs positions couvertes. Leur utilisation militaire est cependant prohibée par la Convention sur l'interdiction des armes chimiques afin de prévenir les risques d'escalade conduisant à l'emploi d'armes létales en réponse à l'utilisation d'armes non létales sur le champ de bataille.
Les incapacitants sont généralement des substances irritantes ou incommodantes dont l'effet disparaît quelques minutes après la fin de l'exposition et dont les effets secondaires se résorbent sous 24 heures sans intervention médicale. Se rangent dans cette catégorie :
- les malodorants, comme le skunk, dont l'utilisation militaire n'est pas encadrée ;
- les vomitifs, comme l'adamsite et la chloropicrine, qui irritent les muqueuses pour produire inflammations, toux, éternuements et finalement des nausées, utilisés par exemple au cours de la première Guerre mondiale pour contraindre les soldats à ôter leur masque à gaz pour vomir, ce qui permettait de leur faire respirer directement des gaz toxiques pour les mettre hors de combat ;
- les gaz lacrymogènes, comme le gaz CS, largement utilisé de par le monde pour le maintien de l'ordre.
Certaines substances employées comme incapacitants ont des effets plus durables avec un risque limité de séquelles permanentes ou de décès. Une prise en charge médicale peut cependant être utile pour faciliter la récupération. C'est le cas par exemple des psychotropes comme le BZ et le LSD, voire d'antalgiques et d'anesthésiants comme ceux entrant dans la constitution du cocktail russe dit Kolokol-1.
Armes létales
L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques classe les différentes substances qu'elle contrôle selon les catégories suivantes :
- Asphyxiants — Armes létales, ils visent à interrompre la possibilité de respirer afin de provoquer la mort par asphyxie. Ce sont notamment le chlore, employé dès la Première Guerre mondiale jusqu'à nos jours ; le phosgène, qui se décompose dans les poumons pour y libérer de l'acide chlorhydrique ; le diphosgène, équivalent liquide du phosgène ; la chloropicrine, un pesticide encore employé en fumigation.
- Vésicants — Ils attaquent les tissus en formant notamment des cloques sur la peau. Il s'agit souvent de composés organosulfurés ou organo-arséniés qui sont cytotoxiques notamment par alkylation de résidus de guanine sur l'ADN dans les cellules. Leur effet ne se fait sentir qu'après plusieurs heures, ce qui permet d'exposer les victimes à leur insu de façon prolongée. Les vésicants les plus connus sont la lewisite, employé au cours de la première Guerre mondiale ; le gaz moutarde, probablement employé dans les années 1980 contre l'UNITA lors de la guerre civile angolaise [réf. nécessaire] ; les moutardes azotées, qui ont également un usage médical comme anticancéreux en chimiothérapie ; l'oxime de phosgène, à l'effet immédiat et davantage urticant que vésicant.
- Poisons respiratoires — Ils interfèrent avec les globules rouges et la respiration des tissus. Ce sont notamment : le cyanogène, qui libère rapidement l'anion cyanure, lequel bloque la respiration cellulaire par inhibition de la cytochrome c oxydase, complexe IV de la chaîne respiratoire ; le bromure de cyanogène ; le chlorure de cyanogène ; le cyanure d'hydrogène (principe actif du Zyklon B) ; l'arsine, qui provoque une hémolyse par formation d'un précipité de méthémoglobine par réaction avec l'hémoglobine oxydée.
- Agents innervants — Ils interrompent la transmission de l'influx nerveux aux organes. Ce sont des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, dont l'action conduit à la mort par arrêt respiratoire ou cardio-circulatoire à la suite d'une crise cholinergique. On distingue :
- la série G, constituée de substances volatiles dont l'effet se dissipe assez rapidement, comme le tabun, le sarin, le soman, le cyclosarin ;
- la série V, constituée de substances faiblement volatiles à effet persistant typiquement par contact cutané, comme le VE, le VM ou le VX ;
- les agents Novitchok, à volatilité intermédiaire et parmi les plus toxiques de tous, comme le A-234 ;
- les carbamates, qui sont des solides utilisables sous forme aérosolisée, deux à trois fois plus toxiques que le VX, et à l'effet plus rapide, comme l'EA-3990 et l'EA-4056.
Les premiers agents innervants (série G) ont été développés en Allemagne dans les années 1930 par IG Farben à partir de recherches sur des insecticides, et certains pesticides de la famille des organophosphates ou des carbamates utilisés dans le monde sont suffisamment toxiques pour l'homme pour être potentiellement militarisés, comme le déméton ou le diméfox.
Outre ces composés synthétiques, diverses neurotoxines d'origine biologique ont fait l'objet de recherches en vue de les utiliser à des fins militaires, notamment la saxitoxine et la ricine.
Autres substances
Certaines substances ne sont pas à proprement parler des armes chimiques et ne sont pas contrôlées par l'OIAC mais ont pu être utilisées à des fins militaires.
Par exemple, l'agent orange, utilisé notamment par les États-Unis lors de la guerre du Viêt Nam dans les années 1960, était un défoliant à base de 2,4-D et de 2,4,5-T, ce dernier étant contaminé par une dioxine de type Seveso (TCDD, particulièrement cancérogène et tératogène, avec une nocivité durable) ; c'est cette substance qui a été utilisée pour la tentative d'empoisonnement de Viktor Iouchtchenko en 2004 alors qu'il était l'un des leaders de la révolution orange en Ukraine.
L'agent bleu, autre défoliant utilisé pendant la guerre du Viêt Nam, était quant à lui constitué d'un mélange d'acide cacodylique (CH3)2AsO2H et de cacodylate de sodium (CH3)2AsO2Na, avec un effet génotoxique sur les cellules humaines.
Le phosphore blanc a été utilisé sur divers théâtres d'opérations depuis la Première Guerre mondiale, par exemple par la Royal Air Force en 1920 contre les Kurdes d'Habbaniya, dans la province d'al-Anbar, lors de la révolte irakienne contre les Britanniques (en)2, ou en 1982 contre les Argentins lors de la guerre des Malouines3.
Droit international relatif aux armes chimiques
Le droit international coutumier encadre progressivement l'usage des armes chimiques depuis la première conférence de La Haye du 29 juillet 1899 : l'article 23 des Conventions relatives aux lois et coutumes de la guerre terrestre (La Haye II), entrées en vigueur le 4 septembre 1900, interdisait explicitement « d'employer du poison ou des armes empoisonnées »4. Une déclaration séparée5 précisait qu'en cas de guerre entre les puissances signataires les parties s'abstiendraient d'utiliser des projectiles « destinés à diffuser des gaz asphyxiants ou délétères »6.
Le protocole de Genève, signé le 17 juin 1925 et entré en vigueur le 8 février 1928, est le premier traité international d'envergure interdisant l'emploi d'armes chimiques et d'armes bactériologiques. Actant que les armes chimiques et biologiques sont « justement condamnées par l'opinion générale du monde civilisé », il interdisait l'usage de « gaz asphyxiants, empoisonnés ou assimilés, et de tous liquides, substances ou équipements analogues » ainsi que de « méthodes de guerre bactériologique », mais n'interdisait pas de produire, stocker ni d'exporter de telles armes.
La Convention sur l'interdiction des armes chimiques, signée à Paris le 13 janvier 1993 et entrée en vigueur le 29 avril 1997, entend précisément couvrir l'ensemble du cycle de vie des armes chimiques, depuis leur conception jusqu'à leur utilisation en passant par leur fabrication, leur transport et leur stockage. Intitulée Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'usage des armes chimiques et sur leur destruction, elle vise leur éradication complète des arsenaux de toute la planète. Sa mise en œuvre est contrôlée par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), organisation indépendante basée à La Haye. En mai 2018, 192 États adhéraient à la Convention et en acceptaient les dispositions ; la Corée du Nord, l'Égypte, l'État de Palestine et le Soudan du Sud ne l'avaient pas signée, tandis qu'Israël ne l'avait pas ratifiée.
L'agence des matériels chimiques de l'armée des États-Unis a annoncé que les États-Unis ont détruit, au , 75 % de leur stock qui était en 1997 de 31 100 tonnes. En 2015, les stocks restants en attente de destruction sont concentrés sur deux sites et comprennent environ 3 100 tonnes qui doivent être éliminés d'ici 20237.
La Russie annonce le 27 septembre 2017 avoir terminé de détruire les 40 000 tonnes qu'elle a reconnu posséder8.
Histoire
Des bonbonnes de gaz chlorés toxiques ont été utilisées avant une production massive d'
« obus à gaz » lors de la
Première Guerre mondiale.
Il est probable que les sociétés préhistoriques de chasseurs-cueilleurs utilisaient des armes chimiques consistant en des flèches ou des javelots empoisonnés par du venin de serpent, scorpion ou des plantes toxiques9.
Dès l’Antiquité, en Chine ou en Inde plusieurs siècles avant notre ère, les traités militaires, chroniques ou manuels mentionnent la préparation ou l'emploi d'armes chimiques : bombes irritantes, fumées toxiques. En Grèce antique, Pausanias décrit l’empoisonnement des eaux de la rivière Pleistos avec des racines d’hellébore lors de la première guerre sacrée en Thucydide relate l'emploi de vapeurs sulfureuses lors de la guerre du Péloponnèse grâce à des chevaux que l'on fait courir sur des tapis de cendres toxiques. De même, Polybe rapporte le siège d'Ambracie en au cours duquel le général romain Marcus Flavius envoie sur les assiégés, acculés dans un tunnel, des engins incendiaires faits de fagots de bois imprégnés de poix et de soufre, leurs fumées étant poussées par les vents dans ce couloir souterrain, prototype de la guerre souterraine10. Des légionnaires romains auraient été victimes d'une attaque chimique, approximativement vers l'an 100. Selon l'archéologue britannique Simon James (en) qui a revisité les résultats de fouilles réalisées en Syrie au siècle dernier, la mort de légionnaires basés à Doura Europos lors d'une attaque ennemie, s'expliquerait par une amphore contenant du bitume et des cristaux de soufre. Les Perses auraient su que, parce que les Romains se trouvaient à ce moment dans un espace confiné, en leur expédiant cette mauvaise surprise et en bloquant leur sortie, ils les condamnaient à l'asphyxie11. L'emploi de ces armes est très tôt condamné par le droit, comme en atteste la formule des juristes romains armis bella non venenis geri (« la guerre est menée par les armes et non par les poisons »)12.
Le feu grégeois, développé aux alentours de 672, est utilisé par les Byzantins contre les Turcs pendant cinq siècles. La poudre à canon, dont l'invention est située durant la dynastie Han ( à 220 ap. J.-C), se développe en Occident durant tout le Moyen Âge13.
Au Moyen-Âge, Frédéric Barberousse aurait conquis la ville de Tortona, en 1155, en empoisonnant les réserves d'eau de la Ville14. En 1346, le khan turco-mongol Djaniberg, qui assiégeait la ville génoise de Caffa (aujourd'hui Théodosie) en Crimée, depuis deux ans, et alors que son armée est décimée par la peste noire, jette des cadavres pestiférés par-dessus les murailles, contaminant ainsi la ville, constituant un des premiers exemple d'attaque bactériologique. Les marchands, fuyant la ville, vont contaminer le rester de l'Europe15.
La Renaissance voit l'emploi de barriques de chaux vive aveuglante projetée par catapulte, de grenades ou de chiffons imbibés d'arsenic. Le XVIe siècle voit apparaître les bombes arsenicales et au XVIIe se développe l'emploi de « pots puants16 »17. Le premier accord bilatéral interdisant l'utilisation d'armes chimiques lors des conflits est l'Accord de Strasbourg en 1675 tandis que La Déclaration de Bruxelles en 1874 est le premier accord multilatéral à cibler les armes chimiques. Depuis, des accords internationaux reliés aux armes chimiques (en) sont régulièrement signés, le dernier entré en vigueur en 1997 étant la Convention sur l'interdiction des armes chimiques18.
Cependant, l'emploi de ce type d'armes continue à être condamné moralement, le juriste suisse Emerich de Vattel les considérant « contraires aux lois de la guerre, et unanimement condamné par les lois de la nature et la volonté des nations civilisées », ce qui explique que les autorités politiques ordonnent le plus souvent au XVIIIe siècle d’abandonner les projets militaires et les expériences sur les armes chimiques (à l'arsenic, orpiment, plomb, céruse, minium, vert-de-gris, antimoine avec adjonction de belladone, euphorbe, hellébore)19.
Bien que la priorité soit donnée aux canons au XIXe siècle, les armes chimiques sont encore envisagées. Lors de la guerre de Crimée entre 1853 et 1856, les belligérants envisagent d’utiliser des obus remplis d’oxyde de soufre. Durant la Guerre de Sécession entre 1861 et 1865, les Nordistes mettent au point des obus de chlore mais n'en font pas usage20. La guerre des Boers à la fin du XIXe siècle voit l'utilisation par les Britanniques d'obus d'artillerie de gaz d'acide picrique et donne lieu à la première véritable controverse internationale à propos de l’usage militaire de gaz nocifs entre des belligérants21.
Première Guerre mondiale
Tableau consolidé des « pertes » de l'US Army par gaz asphyxiants et toxiques ("guerre chimique") de la première guerre mondiale ; nombre de victimes par unités auxquels elles appartenaient.
N'y figurent que les soldats soignés dans les hôpitaux en France, venant exclusivement des champs de bataille, ainsi que morts et blessés du corps des marines. (Archives US : Otis Historical Archives nat'l Museum of Health et medicine).
Le début de la guerre chimique moderne se situe pendant la Première Guerre mondiale avec la production industrielle d'armes chimiques13.
Les Français utilisaient déjà, depuis le début de la guerre, des projectiles chargés de produits lacrymogènes et suffocants, des grenades et des projectiles lancés par un pistolet, chargés d’éther bromacétique. Après plusieurs mois d’utilisation, cette substance fut remplacée par de la chloracétone et un deuxième type de grenade suffocante apparaît en avril 191522. Les Allemands, qui disposent alors de la première industrie chimique au monde, expérimentent des projectiles à chargement spécial dès les premiers mois de guerre. Le 29 octobre 1914, ils envoient 3 000 obus « Ni » de 105 mm contenant du chlorosulfonate de dianisidine sur Neuve-Chapelle, lors d’une offensive. Ce produit, irritant pour les yeux et le nez, ne semble pas avoir été suffisamment efficace puisque l’expérience ne sera pas réitérée22.
Bien que le fait soit rarement évoqué, l'armée allemande employa pour la première fois des obus à gaz, le 31 janvier 1915, sur le front de l'Est en Pologne contre l'armée impériale russe, mais le froid intense les rendit absolument inefficaces23,22.
Le 22 avril 1915, la première attaque chimique massive a eu lieu lors de la deuxième bataille d'Ypres durant la Première Guerre mondiale par l'armée allemande. 6 000 bouteilles d'acier ouvertes sur place (30 000 selon d'autres auteurs) libèrent 180 tonnes de chlore sous forme de nuage dérivant sur les lignes alliées. L'attaque fit environ 10 000 victimes (morts ou hors de combat).
Il s'ensuivit une course aux protections (masques anti-gaz) et aux produits de plus en plus toxiques avec une accumulation de stocks considérables (qui n'ont que peu été utilisés après 1919). La ville d'Ypres a ainsi donné son nom à l'un des plus célèbres gaz de combat, l'ypérite ou gaz moutarde, utilisé pour la première fois sur le front le 11 juillet 1917 lors de la troisième bataille d'Ypres, ou bataille de Passchendaele24. Le 31 mai 1915 : des attaques plus meurtrières se font avec des mélanges chlore-oxyde de carbone ou phosgène (12 000 bouteilles de gaz) sur le front russe, sur la Bsura-Rumka, qui font environ 9 000 victimes, dont 6 000 morts. Dès le mois de mai 1915, les Allemands introduisent de nouvelles substances agressives. Le brome en premier lieu, chargé en grenades et en projectiles de Minenwerfer. D’autres substances, comme l’éther bromacétique et surtout un mélange d’anhydride sulfurique et de l'acide chlorosulfonique, sont également utilisés. C’est également à la fin du mois de juin que les Allemands utilisent pour la première fois la substance qui restera la plus dangereuse de toutes celles utilisées en projectile, pendant l’année 1915. Ce nouveau produit, extrêmement toxique est le chloroformiate de méthyle chloré, envoyé dans des obus de 170 mm, le 18 juin 1915 à Neuville-Saint-Vaast. C’est un dérivé du phosgène qui constitue un lacrymogène énergique et qui possède des effets suffocants puissants. On considère que sa toxicité est environ dix fois supérieure à celle du chlore. Le produit utilisé par les Allemands n’est pas le chloroformiate de méthyle chloré pur, mais un mélange de celui-ci avec des dérivés plus chlorés qui accroissent les propriétés lacrymogènes. Les lésions déterminées par ces produits sur les poumons, apparaissent soit immédiatement, soit au contraire assez tardivement, mais, dans un cas comme dans l’autre, sont en général très graves25,26. Juillet 1915 : 100 000 obus « T » (bromure de benzyle) sont tirés au canon de 155 en Argonne25,26. La deuxième partie de l’année 1915 est marquée par l’utilisation des obus spéciaux de type T (bromure de benzyle et de xylyle) et par ceux de type K (K1 : dérivés bromés et dibromés de méthyléthylcétone (Bn Stoff) et K2 : chloroformiate de méthyle chloré ou palite (K Stoff)), de façon sporadique27. Ces deux dernières substances possèdent des propriétés lacrymogènes et suffocantes importantes, leur conférant un pouvoir létal. Puis, à partir d’octobre 1915 par le retour des vagues gazeuses dérivantes sur le front Ouest28. Cette même année 1915, la plupart des pays riches lancent une production industrielle de gaz de combat et d'armes chimiques. Par exemple en France, la « Société du chlore liquide » construit à Pont-de-Claix dans la vallée du Drac, une usine qui produira industriellement du chlore et ses dérivés afin de fabriquer des armes chimiques (en réponse à ceux de l'armée allemande). C'est ce site qui deviendra l'actuelle plate-forme chimique Rhodia qui conserve de lourdes séquelles de pollution (pollutions du sol, pollution de l'eau, engins militaires abandonnés29,30).
En février 1916, les Français introduisent des obus de 75 mm chargés au phosgène, premières munitions alliées avec un effet létal. Les troupes allemandes furent fortement impressionnées par cette réplique française et demandèrent à disposer de munitions aussi toxiques, relançant ainsi la production des munitions chimiques allemandes. Les obus K2 utilisés par l'Allemagne depuis juin 1915 avaient cependant un pouvoir létal équivalent. Le 29 juin 1916, première attaque au gaz sur le front italien de la part de l'Autriche-Hongrie sur le Monte San Michele (it) (Vénétie), faisant au moins 6 000 victimes dans l'armée italienne dont 5 000 morts. Juillet 1916 : la bataille de la Somme inaugure l'usage de nouveaux obus à l'acide cyanhydrique. Juillet 1917, l'ypérite est massivement utilisée dans la région d'Ypres - d'où son nom. Elle induit des brûlures intolérables avec un effet psychologique important (9 500 t de ce gaz sont fabriquées). En septembre 1917, les « Clarks » à base d'arsines apparaissent, non filtrés par les cartouches des masques, ils provoquent des vomissements dans les masques que les soldats sont obligés d'ôter, ce qui les force à respirer sans masque.
En 1918, la dernière année de guerre voit l'utilisation d'un nombre croissant de munitions chimiques (25 % environ des projectiles utilisés de part et d'autre sont des obus chimiques). Avant l'armistice, un obus sur quatre sortait des chaînes de fabrication muni d'une charge chimique. À la fin de ce conflit, de 110 000 à 130 000 tonnes d’agents de guerre chimiques avaient été utilisés sur le front de l'Ouest, causant 1,2 million de victimes et de 90 000 à 100 000 morts31,32 tandis que l'on estime les pertes humaines à 180 000 sur le front de l'Est33. Grâce aux masques anti-gaz et à un assez mauvais pouvoir de dispersion, seuls 7 % des tués furent victimes de ces armes sur le front de l'Ouest contre 11 % de tués dans l'armée impériale russe mal équipés, mais elles ont fait de nombreux blessés, et on s'est rendu compte plusieurs décennies après que l'ypérite était également cancérigène, comme probablement les arsines et d'autres toxiques, qui pourraient par ailleurs être un facteur supplémentaire de risque pour la Maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, ou responsables de troubles de la fertilité et de la reproduction. L'horreur inspirée par ces armes s'est traduite par des dispositions visant leur interdiction dans les traités internationaux, dont notamment l'article 171 du Traité de Versailles et l'article V du Traité relatif à l'emploi des sous-marins et des gaz asphyxiants en temps de guerre qui prohibent l'usage des gaz toxiques, sans paradoxalement en interdire la fabrication et le stockage en masse, qui fut une réalité jusqu'à la fin de la guerre froide dans nombre de nations.
Entre les deux Guerres mondiales
Bombardement du
cuirassé américain
USS Alabama (BB-8) lors d'un test d'une bombe au gaz de 300 livres le 23 septembre 1921 (gaz asphyxiants et toxiques).
« La guerre du futur est une guerre chimique. » Affiche soviétique de 1925.
- Entre 1921 et 1927, lors de la troisième guerre du Rif au protectorat espagnol au Maroc, l'armée espagnole d'Afrique a utilisé des armes chimiques afin d'écraser la rébellion berbère rifaine menée par Abdelkrim al-Khattabi, chef de la guérilla34.
- De 1935 à 1936, lors de la Seconde guerre italo-éthiopienne, l'armée italienne procède à des bombardements chimiques d'artillerie et par avions employant un total de 350 tonnes d'armes chimiques.
- Selon les historiens Seiya Matsuno et Yoshiaki Yoshimi35, l'empereur Showa autorisa en dépit de ces traités et dès 1937, durant la guerre sino-japonaise, l'usage d'armes chimiques contre les troupes ennemies et les populations civiles. À titre d'exemple, des gaz toxiques furent autorisés à 375 reprises par le prince Kotohito Kan'in lors de la bataille de Wuhan, d'août à octobre 1938, et ce, en dépit de la résolution du 14 mai de la Société des Nations condamnant l'usage de gaz toxiques par l'armée impériale japonaise. Ces armes ne furent toutefois jamais autorisées sur le champ de bataille contre des nations occidentales mais seulement contre les populations locales jugées « inférieures » et des prisonniers de guerre.
- Dès 1937, l’Allemagne exploite les propriétés neurotoxiques d'un insecticide organophosphoré, le tabun, mis au point par le chimiste Gerhard Schrader, qui travaille pour l'IG Farben ; puis en 1939, le sarin ; et en 1944, le soman. Après guerre, les amitons furent développés, les trois derniers produits agissant même à travers l’épiderme. L’ypérite a continué à être utilisée dans des conflits « périphériques » malgré les dénégations de leurs utilisateurs.
Au Royaume-Uni, Winston Churchill, ministre de la Guerre de 1919 à 1921, préconise l'usage des gaz de combat pendant la troisième guerre anglo-afghane mais le vice-roi des Indes, Lord Chelmford, et le commandement militaire s'y opposent. Pendant la révolte irakienne contre les Britanniques (en), en 1920, Churchill propose l'emploi de gaz asphyxiants non létaux mais la formule n'est pas au point et le projet est abandonné36.
La France a également poursuivi un programme de recherche sur les armes chimiques durant l'entre-deux-guerres, ce programme s’intensifiant progressivement à partir des années 1930, avec le durcissement des relations internationales. De nouvelles substances, toujours plus toxiques furent découvertes et synthétisées, comme le trichloréthylamine (vésicant et suffocant insidieux puissant), de nombreux dérivés proches des arsines, et une substance proche des organophosphorés aux propriétés neurotoxiques, un éther carbamique de la choline.
Dans les années 1930 et 1940, des centaines de recrues indiennes de l’armée britannique ont été utilisés afin de déterminer quelle quantité de gaz était nécessaire pour tuer un être humain. Les quantités utilisées sur les soldats indiens n'étaient pas mortelles, mais ces derniers ne disposaient pas de protections adéquates et n'étaient pas informés des risques qu'ils encouraient. Beaucoup ont souffert de graves brulures et développés des maladies37.
Seconde Guerre mondiale
Des soldats de l'armée impériale japonaise portent des masques à gaz lors d'un assaut chimique pendant la
bataille de Shanghai.
En 1940, un stock important de munitions chimiques avait été constitué dans l’objectif de mener une guerre chimique. Ce stock était essentiellement constitué de munitions d’artillerie et de bombes d’aviation, chargées en phosgène, en ypérite, en trichloréthylamine, en léwisite, en adamsite.
Plus de 2 300 000 tirs d'obus étaient disponibles pour les Alliés au mois de mai 1940, reliques de la Première Guerre mondiale. Un groupement spécialisé dans ce genre d’opérations fut rendu opérationnel à partir du mois d’avril 1940 ; la suite précipitée de la campagne mit fin à ce projet38. À partir de 1942, l'Allemagne produit des neurotoxiques à l'échelle industrielle39.
Les infrastructures de production d'engrais et de pesticides ont respectivement pu fournir de grandes quantités d'explosif (nitrates) et de neurotoxiques et autres produits chimiques pour la guerre. Le non-emploi des produits stockés, pendant la Seconde Guerre mondiale est mal expliqué : efficacité du protocole de Genève ? Les Allemands pensaient-ils que les Alliés avaient eux aussi découvert les organophosphorés40? Ils ont en tous cas laissé des stocks importants qui attendent qu'on les traite ou qui n'ont pas jusqu'à un passé récent[Quand ?] été correctement éliminés (c'est-à-dire éliminés sans impacts écologiques ou sanitaires ni définitivement pour les toxiques non dégradables).
Depuis 1945
Depuis 1945, de nombreux pays ont fait des recherches sur les possibilités d'utiliser des produits chimiques dans le cadre militaire. Ils ont donc développé, étudié et stocké des quantités, parfois très importantes, de ces substances toxiques qui sont souvent très délicates à détruire.
Ainsi la France a continué de produire des armes chimiques jusqu'en 1987. Un des sites les plus sensibles, géré par la Société Nationale des Poudres et Explosifs (Groupe SNPE)41, ne fut toutefois définitivement rasé qu'en 199542. Il se trouvait à l'extrémité sud-est de l'usine AZF de Toulouse qui a explosé le 21 septembre 2001.
L'utilisation d'armes chimiques après la Seconde Guerre mondiale fut relativement limitée, quoique les arsenaux des grandes armées du Monde en soient toujours pourvus jusqu'à la fin de la guerre froide.
- L'épandage de défoliant chimique par l'agent orange44 (herbicide contaminé à la dioxine dosé à 40 fois son emploi en usage civil, pour détruire les cultures vivrières) a lieu à partir de 1952 lors de l'insurrection communiste malaise par les forces britanniques. Elle est reprise durant la guerre du Viêt Nam par les États-Unis et visait à affamer la population vietcong. En termes de quantité mise en œuvre sur les rizières du delta du Mékong, cette guerre est considérée comme la plus grande guerre chimique de l'Histoire45. C'est un véritable écocide qui a détruit la flore. La population a subi de graves brûlures à l'épiderme46, Les épandages se sont étendus sur les terres du Laos et du Cambodge. Plus de 3 000 villages ont été arrosés, et certaines personnes ont mangé des céréales enduites d'herbicide ; les conséquences génétiques sur les populations ayant été en contact avec la défoliation se sont transmises aux générations ultérieures, engendrant des enfants subissant des anomalies considérables lors de leur développement in utero47.
- La guerre Iran-Irak vit l'utilisation massive de ces armes par l'Irak, on estime que ces attaques chimiques ont causé 60 000 victimes iraniennes, dont 10 000 morts48. Le 16 mars 1988, l'armée irakienne a bombardé à l'arme chimique la ville kurde d'Halabja, il y eut plus de cinq mille morts et environ sept mille blessés et handicapés à vie49,50.
- La Libye employa en outre de l'ypérite dans le nord du Tchad durant le conflit tchado-libyen jusqu'en 198751,52
- La crainte d'un terrorisme chimique se concrétise avec les attentats au sarin commis au Japon par la secte Aum Shinrikyō en 1994 et 1995.
- À partir de janvier 2007, pendant la guerre d'Irak, des attentats à l'explosif combiné avec du chlore atteignent la population53.
- Pendant la guerre civile syrienne, du sarin et du chlore sont utilisés par l'armée syrienne, notamment lors des attaques de la Ghouta, d'Ouqayribat, de Khan Cheikhoun et de Douma, causant la mort d'au moins 2 000 personnes54,55. Au cours du conflit syrien et de la seconde guerre civile irakienne, l'État islamique effectue également quelques attaques au gaz moutarde et de chlore, provoquant au moins la mort d'un nouveau-né et faisant plus d'une centaine de blessés56,55,57.
- Le 11 octobre 2013, le prix Nobel de la paix est décerné à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques qui a supervisé, depuis sa création en 1997, la destruction de 80 % des stocks d’agents chimiques déclarés (environ 60 000 tonnes), ainsi que près de 60 % des 8 millions de munitions58.
- La Russie est soupçonnée d'avoir eu recours à l'arme chimique pour éliminer le marchand d'armes Emilian Gebrev, en 2015 en Bulgarie, le transfuge russe Sergueï Skripal, en 2018 en Grande-Bretagne, et l'opposant russe Alexeï Navalny, en 2020 en Russie59.
Effets
Les chiffres du tableau sont exprimés en hectares couverts par tonne de produit toxique répandue à densité uniforme sur des objectifs matériels ou du personnel sans protection. Par exemple, par une journée chaude et un temps couvert, 5 kg de Sarin par hectare, mettraient hors de combat 50 % des personnes supposées sans masque (attaque surprise).
| Type de gaz | Effets de contamination sur les matériels et le terrain | Effets directs de mise hors de combat des personnel |
|---|
| Gaz moutarde (Ypérite-Lewisite) |
5 ha/t |
30 ha/t |
|---|
| Tabun (GA américain) |
7 ha/t |
50 ha/t |
|---|
| Sarin (GB américain) et Soman (GD américain) |
fugace |
200 ha/t |
|---|
| Gaz VX, VR 65 (soviétique), SOMAN épaissi |
25 ha/t |
25 ha/t |
|---|
Parades
Pour se protéger des agents chimiques, il n'existe que trois types de parades :
- la combinaison étanche de protection comprenant un masque à gaz adapté aux risques NBC (Nucléaire, Biologique, Chimique), c’est-à-dire conçue pour empêcher l'inhalation ou le contact avec les agents de l'un ou de l'autre type (hormis le rayonnement radioactif). Il faut porter l'équipement de protection préventivement. Or, plusieurs types de gaz de combat n'ont ni goût ni odeur, ou n'induisent des symptômes évidents qu'après un certain temps (plusieurs heures pour l'ypérite).
- Curativement : antidote (à injecter ou ingérer, s'il en existe un et qu'il est disponible) dans les minutes qui suivent l'exposition, sachant que certains toxiques chimiques font aussi vomir.
- Décontaminer le corps, les objets et lieux avec des produits adaptés (ce qui demande de connaitre le type d'agent en question)
Armes chimiques dites non conventionnelles
Personnels de l'
USAF en tenue NBC durant un exercice sur un aéroport en 1985.
Depuis les années 1990, il existe des recherches sur une arme chimique capable de dissoudre les caoutchoucs, naturel et synthétique. La destruction des pneus, des joints et des durits entraînerait la paralysie d’une armée. En 1914-1918, l'ypérite était déjà capable de passer au travers du caoutchouc naturel (latex). Dans la même logique, des agents aptes à dégrader le cuivre ou le silicium auraient des effets similaires en détruisant les systèmes de communications. Les armes phéromoniques ont également été évoquées ; un laboratoire de l'US Air Force aurait demandé un financement en 1994 pour une arme capable de plonger les troupes visées dans un véritable état de transe sexuelle, celui-ci a été refusé par le Département de la Défense60.
Problèmes environnementaux
Certains de ces produits ne se dégradent pas, ou ne se dégradent que très lentement et les amorces des munitions anciennes contiennent par ailleurs du mercure toxique (sous forme de 2 grammes de fulminate de mercure) et un explosif souvent également toxique. Les stocks de munitions chimiques ou de toxiques de guerre sont un danger permanent exposant à un risque croissant de fuites et de contacts dans le cas des munitions anciennes qui se dégradent inéluctablement. De nombreuses munitions non explosées ont été détruites dans de mauvaises conditions après guerre sur terre, ou en mer, ou persistent dans les sols, notamment en Belgique et en France, dans la zone rouge la plus touchée par la Première Guerre mondiale. Les stocks de munitions non explosées ou non utilisées ou immergées, avec plusieurs dépôts de dizaines de milliers de tonnes, contribuent aux séquelles durables des guerres mondiales et de la guerre froide (eau, air et sols pollués, écosystèmes dégradés, menace permanente pour les ressources en eau potable et en produits de la mer, problèmes de santé).
La Convention d'interdiction des armes chimiques oblige ses États parties à éliminer leurs stocks d'armes chimiques avant 2007, mais cette date n'a pas été respectée par plusieurs pays ayant des stocks importants. Des pays ont construit des usines spécialisées dont le SECOIA en France pour éliminer ces munitions chimiques. La résolution du problème des nombreux dépôts immergés en mer - et dont on ne connaît pas toujours l'emplacement exact ni l'état de dégradation - n'est pas incluse dans la convention. La commission OSPAR et la commission HELCOM y travaillent également dans le cadre de deux conventions régionales, mais sans que ce sujet semble prioritaire pour leurs États membres, bien que les pays de la Baltique s'en inquiètent sérieusement depuis la découverte par les pêcheurs d'un nombre important d'obus ou de contenants fuyants dans leurs filets (au Danemark notamment, où 400 pêcheurs au moins auraient été brûlés par de l'Ypérite).
Notes et références
- (en) « Chemical Weapon as defined by the CWC » [archive], sur https://www.opcw.org/ (consulté le ).
- (en) Alan Axelrod, Little-Known Wars of Great and Lasting Impact, Fair Winds Press, 2009, p. 246. (ISBN 9781616734619)
- (en) Graham Bound, Falkland islanders at war, Leo Cooper, 2002. (OCLC 48570819)
- (en) « Laws of War: Laws and Customs of War on Land (Hague II); July 29, 1899 » [archive], The Avalon Project, sur http://avalon.law.yale.edu/, Lillian Goldman Law Library, (consulté le ).
- « Traités, États parties et Commentaires - Déclaration (IV,2) de la Haye interdisant les gaz asphyxiants, 1899 » [archive], sur ihl-databases.icrc.org (consulté le )
- (en) « Laws of War: Declaration on the Use of Projectiles the Object of Which is the Diffusion of Asphyxiating or Deleterious Gases; July 29, 1899 » [archive], The Avalon Project, sur http://avalon.law.yale.edu/, Lillian Goldman Law Library, (consulté le ).
- « US to restart chemical weapon neutralisation » [archive]
- Vladimir Isachenkov, « Russia reports destruction of all remaining chemical weapons » [archive], sur defensenews.com,
- (en) S.k. Prasad, Biological Weapons, Discovery Publishing House, , p. 125
- Olivier Lepick, La Grande Guerre chimique : 1914-1918, Presses universitaires de France, , p. 17
- (en) Simon James, « Stratagems, Combat, and "Chemical Warfare" in the Siege Mines of Dura-Europos », American Journal of Archaeology, vol. 115, no 1, , p. 69–101
- Annales de droit international médical, no 34, 1987, p. 140
- Daniel Iagolnitzer et Vincent Rivasseau, La science et la guerre : la responsabilité des scientifiques, Éditions L'Harmattan, , 265 p.
- « Interroge - Quand les armes chimiques ont-elles été inventées et à partir de quand ont-elles été utilisées ? » [archive], sur institutions.ville-geneve.ch (consulté le )
- Nicolas, « Pluie de Cadavres à Caffa : La Peste Noire Catapultée en Europe » [archive], sur Le Fil de l'Histoire, (consulté le )
- À noter que ces pots fumigènes sont toujours utilisés dans les manœuvres militaires.
- Marc Lemaire, De la menace terroriste au traitement des victimes, Éditions L'Harmattan, , p. 26-27
- « Accords internationaux reliés aux armes chimiques. Les premiers efforts de contrôle des armements » [archive], sur international.gc.ca
- Les armes chimiques avant 1914 [archive], sur defense.gouv.fr
- Michel Veuthey, Guérilla et droit humanitaire, Comité international de la Croix-Rouge, , p. 83
- Olivier Lepick, op. cité, p. 23
- « Introduction à la Guerre des Gaz - Premières recherches visant à développer l'arme chimique - Ypres, 22 avril 1915 » [archive], sur guerredesgaz.fr
- Histoire de la guerre terrestre : tous les conflits du XXe siècle, les guerres classiques, le terrorisme, les guérillas (trad. de l'anglais), Paris, Elsevier Séquoia, Bruxelles, , 248 p. (ISBN 978-2-8003-0227-0, BNF 34595265)
- Daniel Riche, La guerre chimique et biologique, Paris, Belfond, , 309 p. (ISBN 978-2-7144-1518-9), p. 104
- « La guerre des gaz – Les munitions chimiques allemandes 1914 - 1915 » [archive]
- « La Genèse des premiers masques à gaz et la diversification des premières substances agressives » [archive], sur guerredesgaz.fr
- « Les munitions chimiques allemandes en 1915 » [archive]
- « Les vagues gazeuses dérivantes allemandes » [archive], sur guerredesgaz.fr
- Fiche Rhodia [archive] « Copie archivée » (version du 30 mai 2018 sur l'Internet Archive) sur Basol
- La plate-forme chimique du Pont de Claix [archive], vue par des riverains
- « Les armes chimiques dans l'Histoire »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • http://www.irsn.fr/FR/base_de_connaissances/Nucleaire_et_societe/non-proliferation/chimique/Pages/1-armes_chimiques_dans_l_Histoire.aspx" rel="nofollow" class="external text">Google • Que faire ?) Page sur la Non prolifération, IRSN (consulté le 25 janvier 2009)
- Dossier de présentation du groupe Australie
- Maurice Bresson, « Les armes de destructions massive », Science et Vie, no Trimestriel 157, , p. 65
- Kunz et Müller 1990
- Yoshimi and Seiya Matsuno, Dokugasusen Kankei Shiryō II, Kaisetsu, Hōkan 2, Jūgonen sensō gokuhi shiryōshū, Funi Shuppankan, 1997.
- (en) Edward M. Spiers, A history of chemical and biological weapons, Londres, Reaktion, , 223 p. (ISBN 978-1-86189-651-3, BNF 42292096), p. 70-72
- (en-GB) Rob Evans, « Military scientists tested mustard gas on Indians », The Guardian, (ISSN 0261-3077, lire en ligne [archive], consulté le )
- « Les services chimiques francais dans l'entre-deux guerre - Un bref aprcu de la question des gaz de combat pendant la campagne de 1939-1940 » [archive], sur guerredesgaz.fr
- « Les neurotoxiques » [archive], sur www.guerredesgaz.fr (consulté le )
- « Guerre chimique et bactériologique » [archive], sur France Culture, (consulté le )
- [1] [archive]
- Pierre GRESILLAUD, « AZF : Un détail militaire caché par le Grand Toulouse à la justice » [archive]
- « Les armes chimiques dans l'Histoire » [archive], sur non-proliferation.irsn.fr, Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (consulté le )
- Développé par la contribution de sept entreprises chimiques dont les multinationales Monsanto et Dow Chemical durant les années 1940.
- Source : Patrick Pesnot, L'Agent Orange au Viêt Nam [archive].
- Voir : UN OU DEUX VIETNAM ? L’HISTOIRE [archive], émission le Dessous des cartes, sur Arte.
- 200 000 naissances anormales en 1975 au Viêt Nam.
- « Armes chimiques, un vieil usage de guerre » [archive], sur La Croix,
- Françoise Brié : L’utilisation des armes chimiques contre les Kurdes, in Le livre noir de Saddam Hussein, Chris Kutschera (sous la dir.), On Édition, 2005, p. 408.
- L’Irak gaze les Kurdes in Libération du
- Stéphane Mantoux, Les guerres du Tchad, 1969-1987, Paris, 978-2917575499, , 108 p. (ISBN 979-10-210-0264-7, BNF 43655121), p. 97
- Colonel Petit, « 53) Les bombardements du 10 septembre 1987 » [archive], sur air-insignes.fr (consulté le ).
- « Irak : nouveaux attentats à Bagdad » [archive], sur RTBF,
- René Backmann, Comment Bachar al-Assad a gazé son peuple: les plans secrets et les preuves [archive], Mediapart, 1er juin 2017.
- Armes chimiques en Syrie : la confusion de Franz-Olivier Giesbert dans « On n’est pas couché » [archive], Les Décodeurs, Le Monde, 8 mars 2017.
- Du gaz moutarde a été utilisé dans la guerre en Syrie [archive], AFP, 5 novembre 2015.
- Madjid Zerrouky, Les armes chimiques de l’État islamique, entre réalité et propagande [archive], Le Monde, 21 février 2016.
- « Quelles armes chimiques détient la Syrie et comment les détruire ? » [archive], sur liberation.fr,
- (ru) « Кто и где мог произвести «Новичок» для Навального » [archive], sur NEWSru.com, (consulté le ).
Annexes
Sur les autres projets Wikimedia :
Bibliographie
- Olivier Lepick, La Grande Guerre chimique 1914-1918, PUF, coll. « Histoires »,
- André Bouny (préf. Howard Zinn et William Bourdon), Agent Orange, Apocalypse Viêt Nam, éditions Demi-Lune
- (de) Rudibert Kunz et Rolf-Dieter Müller, Giftgas gegen Abd el Krim : Deutschland, Spanien und der Gaskrieg in Spanisch-Marokko, 1922-1927, Fribourg-en-Brisgau, Verlag Rombach, , 239 p. (ISBN 978-3-7930-0196-6, BNF 35533422, présentation en ligne [archive])
- Polat S, M. Gunata, H. Parlakpinar (2018) {http://www.annalsmedres.org/articles/2018/volume25/issue4/776-782.pdf [archive] Chemical warfare agents and treatment strategies] |J. Turgut Ozal Med. Cent., 25 (4)
- « 100 armes qui ont fait l'histoire », Guerre et Histoire, no hors série n°1, , p. 60-71 (ISSN 2115-967X).
Filmographie
Articles connexes
Liens externes
Munition anti-char
Obus-flèche soviétique 3BM-42 « Mango » formé de deux barreaux en tungstène.
Une munition antiblindage est une munition spécialisée contre les blindages.
Se déclinant sous de nombreuses formes, elle est adaptée aux armes d'épaule, aux obus d'artillerie ou aux ogives de missiles.
La munition antiblindage est basée sur les mêmes principes que ceux généralement adoptés pour les obus, répartis en deux catégories :
- les obus perforants (aussi appelés obus de rupture) ;
- les obus explosifs.
Types
Munitions de la Seconde Guerre mondiale
Si les munitions pleines, sans charge explosive, sont apparues avec l'artillerie, les obus dits « de rupture » le sont avant la création des blindés. À côté des obus brisants, explosant à l'impact ou par délai, ils sont conçus pour percer les ouvrages d'art ou les blindages des fortifications et des navires cuirassés. Durant la Première Guerre mondiale qui voit l'apparition et l'usage massif des chars de combat, peu de munitions spécifiquement antichars voient le jour : les blindages des tanks demeurent assez minces pour être vaincus par des obus classiques. Seuls les calibres les plus petits, accueillant une charge explosive trop faible sont dotés de munitions antiblindages, sans être des créations originales : par exemple, le Tankgewehr allemand utilise une balle renforcée pour la lutte antichar, reprenant le principe des Elephant guns (en) contre les blindages de tranchées ; les canons français de 37 mm et 75 mm peuvent tirer des obus de rupture créés avant la Grande Guerre (respectivement les modèles 1892 et 1910 « non coiffés », ce dernier modifié en 1916 et 1918, dits André Lefevre selon leurs fusées1). Durant l'entre-deux-guerres, le développement des blindés entraine celui des munitions destinées à les vaincre. Celles utilisées durant le second conflit mondial sont toutes issues de recherches effectuées avant 1939.
Boulets perforants non coiffés

La plus simple des munitions dites de rupture selon la nomenclature française est un obus plein (AP pour armor-piercing dans la nomenclature internationale. La plupart (comme pour les autres types mentionnés plus bas) comportent en leur sein une cavité (schématisée ici en rouge) contenant une charge explosive (armor piercing high explosive ou APHE / AP-HE), explosant quelques millisecondes après pénétration dans l'intérieur du véhicule pour accroitre les dégâts antipersonnel, ou incendiaire (Armor Piercing Incendiary ou API). De plus, de nombreuses munitions comportent un traceur marquant la course du projectile ; il est alors marqué -T (tracer). La désignation internationale complète d'un obus peut donc être APCBC-HE-T dans le cas d'un PCOT traçant explosif.
Seuls les Britanniques durant le conflit utilisent des obus totalement pleins, dits shot par opposition aux obus shell.
Les munitions AP ont laissé place à des modèles plus élaborés.
Boulet perforant coiffé

Le boulet plein est doté d'une coiffe de pénétration pour réduire les chances de ricochet lors d'un impact sur un blindage incliné (APC pour armor-piercing capped).
Boulet perforant avec fausse ogive

L'obus plein est coiffé d'une fausse ogive (APBC ou armor-piercing-ballistic-capped) favorisant sa pénétration dans l'air, sa vitesse et par conséquent son énergie cinétique. Les Soviétiques l'utilisent en particulier pour la munition BR-350 A du T-34/762.
Boulet Perforant Coiffé à fausse Ogive (PCOT)

L'obus antichar APCBC (armor-piercing capped ballistic capped en nomenclature internationale) comporte une coiffe pénétrante et une ogive balistique. Il s'agit du type « classique » le plus usité durant le conflit, par exemple avec la panzergranate 39 allemande.
Projectiles à perforateur lourd sous calibré en carbure de tungstène
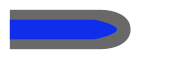
Aussi nommé HVAP (High Velocity Armour Piercing) dans l'Armée américaine ou Hartkern (HK, noyau dur) dans la Wehrmacht, l'obus APCR (armor-piercing composite rigid) est composé d'un noyau au carbure de tungstène sous calibré, enserré dans un métal léger tel l'aluminium.
Doté d'une forte vitesse initiale qui donne d'excellentes performances antichars à courte et moyenne distance, il demeure rare du fait de la matière stratégique et provoque une usure prématurée du tube. Chaque Sherman M4(76) n'en reçoit qu'un par mois en moyenne, en 19452 et la production des panzergranaten 40 allemandes est stoppée en 1943. Peu utilisé car inefficace, les Allemands ont aussi fabriqué un APCR-ersatz à cœur de fer doux (dit panzergranate 40 W) qui a davantage un effet HESH3.
Plus efficaces encore que le tungstène, des munitions à uranium appauvri ont été conçues durant le conflit () par les ingénieurs allemands pour une PzGr. 40 de 5 cm4 ; la matière a été plus tard largement utilisée pour des obus-flèches (voir plus bas) et médiatisée durant la guerre du Golfe.
Projectiles à noyau lourd montés avec des jupes déformables
Schéma des APCNR du PaK 41 : obus sous-calibré au tungstène et ersatz en fer doux (Weicheisen).
Cette munition particulière (désignation internationale armor-piercing composite non-rigid ou APCNR) ne peut s'utiliser sur un canon conventionnel : il s'agit d'un obus sous-calibré doté d'une enveloppe malléable qui se resserre dans le tube du canon « conique » spécialement conçu, à âme se rétrécissant selon le système Gerlich. Ce resserrement accroit la vitesse initiale ; combiné à une munition au tungstène, il permet une forte pénétration à courte et moyenne distance. La nécessité d'un tube spécial fait qu'il n'a été que relativement peu utilisé, par les Britanniques avec le système Littlejohn du 2 pounder (la munition étant nommée APSV pour Armour-piercing super velocity) et surtout les Allemands avec trois canons à âmes coniques, les s.PzB 41, le.PaK 41 et PaK 41. La France, avant la défaite de 1940, avait testé un prototype danois, le 29/20 mm Larsen2.
Obus perforant sous-calibré à sabot détachable
Obus perforant sous-calibré à sabot détachable de 76,2
mm SV Mk.1 britannique avec son noyau en carbure de tungstène.

Semblable à l'obus APCR, la munition à sabot détachable APDS (Armor-piercing discarding-sabot) s'en distingue par son enveloppe enserrant l'obus. Elle s'en sépare au départ du coup, laissant le projectile sous-calibré doté de la forte puissance propulsive. Bien que testé par les ingénieurs allemands (obus TS ou Treibspiegel)4, seuls les Britanniques en firent usage pour leur OQF 17 pounder.
Obus à Charge Creuse (OCC) ou Obus Explosif à Charge Creuse (OECC)

Développée d'après l'effet Munroe, les premières munitions à charge creuse HEAT apparaissent en 1940. Différentes des munitions précédentes utilisant l'énergie cinétique, la charge creuse est plus efficace à faible vitesse initiale, à toutes distances, de préférence pour des obus d'un calibre supérieur à 70 mm. Schématiquement, il s'agit d'une charge explosive dont la pointe est creusée en entonnoir ; à l'explosion, celui-ci concentre un jet de métal en fusion perçant le blindage.
C'est le seul type de munition, en dehors des balles de fusils antichar (assimilées à des AP), à être utilisé individuellement par des soldats, sous la forme de grenades antichar à main et à empennage (tels les RPG-43 et panzerwurfminen), grenades à fusil (Grenade à fusil modèle 1941 antichar, Number 68 anglaise, panzergranaten de 30 et 40 millimètres, la première étant le plus petit calibre usité pour une charge creuse, sans grande efficacité), roquettes (celles du bazooka américain, du Panzerfaust et du Panzerschreck allemand, du PIAT britannique), charges magnétiques (Hafthohlladung) ou de contact (première utilisation de charges creuses contre le fort d'Ében-Émael en 1940, arme-suicide japonaise mine lunge).
Après-guerre, de nombreux missiles destinés aux cibles terrestres sont pourvus de charge creuse. Les missiles antinavire sont dotés de charges brisantes.
Munitions explosives
Le tableau serait incomplet sans la mention des munitions explosives (HE) dont la charge n'a aucun dispositif antiblindage, mais dont l'effet soufflant, ou « brisant », est susceptible de vaincre la paroi (faiblement) blindé d'un véhicule. La plupart des nations belligérantes de la Seconde Guerre mondiale usent de munitions antitank explosives, l'Angleterre dès 1940 (grenades numéros 73, 74 et 75 ; munition AT du Smith gun), le Japon (« mine tortue » MineType 99, mines humaines ou Hook charge), l'Allemagne (Tellerminen employées manuellement, grenades à manche multiples, charges concentrées geballte ladungen)5. Il est à noter que si les obus explosifs (HE) de 75 mm n'ont qu'un faible pouvoir perforant d'environ 20 mm2, les munitions plus lourdes telles celles des 122 et 152 mm soviétiques occasionnent des dommages structurels aux chars les plus lourds comme le Tigre.
Le cocktail Molotov incendiaire demeure une arme antichar, mais non à proprement parler « antiblindage ».
Loin d'être obsolètes et visant les organes sensibles des chars (optiques de visée, chenilles, ouvertures ou grilles d'aération), ces charges sont toujours d'actualité sous la forme des Engins explosifs improvisés, et sont prises en compte dans l'élaboration des futurs MBT.
Munitions de l'après-guerre et contemporaines
En dehors des munitions d'un calibre inférieur à 40 mm, celles développées durant la Guerre froide jusqu'à nos jours sont de types plus élaborés. Les APCR et APDS sont néanmoins toujours d'actualité, mais l'exception principale est le système HEAT, fortement amélioré jusqu'à faire croire dans les années 1960 à la fin du blindage lourd et la conception d'autres contre-mesure : la vitesse du véhicule par exemple pour l'AMX-30, la conception de blindages spécifiques (blindage composite et Chobham) ou ajoutés (blindage réactif). Pour les contrer ont été développées des charges creuses « doubles », en « tandem ».
Obus à tête d'écrasement
Nommé aussi HEP pour High Explosive Plastic par les américains, il s'agit d'un obus explosif non rigide, s'écrasant à l'impact (HESH pour high-explosive, squash-head) et générant une onde de choc qui se répand au travers du blindage. Le réfléchissement de l'onde crée une tension détachant des éclats, voire une « galette » de métal sur la paroi interne (effet spalling). Il n'y a pas pénétration proprement dite. Apparu après-guerre, le principe de ces obus se retrouve néanmoins avec certaines munitions de la Seconde Guerre mondiale, telles la balle du Maroszek ou les obus EP italiens (effetto pronto), des charges creuses « primitives » (les réelles charges creuses italiennes étant les EPS, « spéciale »)2.
Obus-FLèche (OFL)

L'obus-flèche, développement de l'obus à sabot APDS, est un pénétrateur à énergie cinétique APFSDS (armor-piercing, fin-stabilized, discarding sabot). Ces munitions sont dotés d'un fin perforateur au tungstène, mais aussi à l'uranium appauvri. C'est avec les HEAT le principal type de munitions anti-blindage utilisé dans les années 2000.
Obus
Obus perforants
Pour percer les blindages épais, il fallut trouver un obus résistant, capable de transpercer la cible avant d’exploser. Lors de la Seconde Guerre mondiale, des obus dits « de rupture » ont été mis au point pour couler les navires fortement blindés (cuirassés ou porte-avions). Ils furent également utilisés pour détruire les batteries côtières ou bunkers. Ces avancées technologiques ont encouragé une escalade dans la course au blindage ; « Les cuirassés rapides de la classe Iowa, lancés pendant la guerre mais sur plans de 1938, reçurent 3 ponts blindés : supérieur, de 38 mm, moyen de 153 mm et inférieur de 16 mm. Les géants japonais de la classe Yamato, 74 000 t en charge, plans de 1937, un seul pont : de 230 mm. »6
Le principe de l’obus de rupture consiste à percer le blindage et à utiliser les morceaux de blindage pulvérisés par le choc comme de nouveaux projectiles, en complément du projectile initial. Ensuite, il se passe un effet « boule de neige » puisque ces nouveaux projectiles incandescents et projetés à une vitesse très élevée vont transpercer d’autres parois etc. Le personnel se trouvant dans les pièces touchées est donc neutralisé par les fragments souvent improprement nommés « shrapnels ». Pour être efficace, il faut que sa densité sectionnelle soit maximale.
Un autre principe est de consolider un obus explosif pour qu’il puisse traverser un blindage avant d’exploser (100 millisecondes après par exemple).
Obus explosifs
En 1708, l'officier de marine Masson proposa le premier boulet creux d'artillerie. À cette date, l'armée enterra son exposé, classé sans suite.
Au cours des décennies suivantes, plusieurs artilleurs se sont intéressés à l'idée de propulser un boulet creux, chargé de matières incendiaires destinées à éclater dans le flanc d'un vaisseau, pour y mettre le feu et le couler.
Le colonel de Bellegarde fit procéder à des recherches et des tirs de tels boulets, avant d'émigrer et d'emporter avec lui le fruit de ses expériences.
Deux officiers d'artillerie ayant supervisé les travaux du colonel de Bellegarde (le lieutenant François Fabre et le capitaine Pierre Choderlos de Laclos) vont poursuivre ces recherches, mais il se trouve que des éléments vont les mettre rapidement dos à dos et non côte à côte. En 1803, une maladie mortelle frappe Choderlos de Laclos tandis que Fabre est nommé directeur général des Forges.
Jamais la marine française ne voudra utiliser cette arme jugée trop meurtrière pour l'ennemi, qui ne tarderait pas à la fabriquer et à l’utiliser à son tour contre ses vaisseaux, inférieurs en nombre. « Ce qui privera Paris d'une place Trafalgar… Mais, grâce à la pugnacité de Fabre, Berthier les acceptera pour l'armée de terre »7.
Selon le type d’obus, l’explosion détruit un bâtiment classique, met le feu à un véhicule ou projette des balles intégrées dans l'obus. L’obus explosif peut détruire toute cible classique non protégée par un blindage (maison, véhicule, groupe d'êtres humains), mais sera moins efficace contre un char ou un bunker (plusieurs coups portés au même endroit seront nécessaires pour atteindre l’intérieur de la cible).
Conduite de tir
Incendie et explosion
Les premiers moteurs fonctionnant à l’essence favorisaient les incendies. Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'usage du moteur diesel dans les véhicules blindés a rendu les chars moins vulnérables à l'explosion de leur carburant, le fioul s'enflammant moins facilement, sauf en cas de coup direct dans la réserve de munitions.
En ce qui concerne le char Abrams, le magasin à munitions est situé à l'extérieur du blindage, derrière la nuque de tourelle. En cas de coup au but, les munitions stockées ne provoquent plus l'explosion du char.
Pour diminuer le risque d’incendie, un dispositif d'extinction à base de halon est présent à l’intérieur du char, mais ceci ne constitue pas un rempart à un coup mortel.
Ogives
Énergie cinétique et obus flèche

Toutes les pièces fonctionnent sur le même modèle. Un obus et une charge propulsive sont placés au fond d'un long tube (Canon). La base du tube est fermée, l'autre bout, non. La charge propulsive crée un gaz chaud en expansion. Il propulse l'obus hors du tube à grande vitesse. À la sortie du tube, les obus à haute vélocité atteignent une vitesse de 1 000 à 2 000 m/s. Les obus antichars « à l'ancienne », dans les années 1940 et 1950, avaient une tête renforcée. Ils étaient destinés à frapper le blindage avec suffisamment de force pour pénétrer à l'intérieur et alors faire exploser la charge creuse qui se trouvait dans leur tête. La recherche balistique a ensuite démontré que la fragmentation du blindage et la force du cône avant étaient beaucoup plus destructrices que l'explosion qui suivait. En d'autres termes, les dommages étaient causés par le transfert de l'énergie cinétique de l'obus vers le blindage. En conséquence, les obus perforants actuels sont entièrement fait de métal extrêmement dur, sans aucune charge intérieure. Quand il pénètre, des morceaux du blindage et les restes de l'obus volent à l'intérieur du char, détruisant et l'équipage et l'équipement.
Il a fallu encore plus d'esprit créatif pour imaginer le dernier‑né des obus pénétrants : l'obus flèche. Cet obus composite est assemblé autour d'une sorte de mince barreau de métal extrêmement dense. Ce barreau qui constitue la flèche est entouré d'un sabot en deux ou trois morceaux qui permet de le fixer à l'avant d'une douille normale, afin d’adapter le diamètre de la flèche au diamètre de la douille de façon à pouvoir être tiré par un canon de 120 mm par exemple. Quand le coup est tiré, la charge dans la douille explose propulsant le tandem flèche‑sabot le long du tube. Dès qu'il en sort, les morceaux du sabot se séparent en l'air et la flèche continue seule son chemin à une vitesse très élevée. Au départ, les obus flèches étaient tirés par des canons rayés dont les rainures faisaient tournoyer et le sabot et la cheville (qui alors n'avait pas d'ailettes). Comme la plupart des chars ont maintenant des canons lisses, ces flèches ont de petites ailettes pour des raisons de stabilité en vol.
Les « flèches » sont généralement en alliage de tungstène (comme le carbure de tungstène) qui est plus dur que l'acier, ou des flèches dont le cœur est en uranium appauvri plus dense que l'acier, et concentrant donc dans son centre plus de puissance (ce matériel est toutefois moins puissant). Le tungstène possède une température de fusion de 3 400 °C et d’ébullition de 5 700 °C. L’uranium appauvri possède quant à lui un point de fusion à 1 130 °C et d’ébullition à 3 850 °C mais il a l’avantage d’être fourni gratuitement. Le tungstène est d’autre part deux fois plus dur que l’uranium appauvri, avec une dureté de 500 Vickers contre 250 Vickers seulement pour l’uranium appauvri). Ceci permet d'augmenter considérablement leur densité sectionnelle et donc leur pouvoir perforant.
Densité des matériaux pour comparaison : Eau, 1 ; Acier, 7,8 ; Bronze, 8,4 à 9,2 selon le mélange ; Plomb, 11,3 ; Uranium, 18,7 ; Uranium appauvri, 19,1 ; Tungstène, 19,3.
L'uranium appauvri des obus flèches est accusé de provoquer des maladies graves à moyen et long terme, bien que les armées du monde, notamment celle des États-Unis affirment le contraire.
Obus à charge creuse
Les têtes HEAT, (antichar à explosif brisant) connues aussi sous le nom de têtes « à énergie chimique », « à charge profilée » ou « à charge creuse », ont été développées pendant la Seconde Guerre mondiale pour les pièces à basse vélocité, et presque aussitôt utilisées également pour les roquettes anti‑chars légères.
La charge explosive des munitions HEAT possède un évidement de forme conique (parfois semi-hémisphérique) à son extrémité dirigée vers la cible. Ce cône inversé est recouvert d'une mince paroi métallique (à ne pas confondre avec la coiffe - ou « pointe » - de la munition) dont l'épaisseur, l'angle et le matériau (le plus souvent du cuivre rouge) seront très précisément calculés et déterminés en fonction de la vitesse de détonation de l'explosif utilisé et de la nature de la cible à détruire.
À l'impact, un contacteur placé au sommet du projectile déclenche l'explosion du détonateur situé à l'arrière de la charge, entraînant du même coup la détonation de celle-ci.
L'onde de choc engendrée se propage d'arrière en avant au sein de la charge et exerce sur la mince paroi de cuivre une pression telle que cette dernière est quasiment forgée, fond et se retourne un peu comme une chaussette, formant un dard de métal à haute température dont la vitesse peut atteindre, en théorie, deux fois celle de la vitesse de détonation de l'explosif utilisé (soit environ 18 000 m/s pour une charge à l'octogène-cire).
La charge creuse sera d'autant plus efficace que le dard de métal en fusion ne se dispersera pas et restera bien concentré. Il importe donc que le dard formé de métal en fusion soit le plus fin et rectiligne possible ; d'où un réel savoir-faire d'artificier pour calculer le bon compromis, les bonnes quantités, les bonnes matières, les bons explosifs et les bonnes formes qui rendront le dard le plus efficace possible.
Le dard de métal en fusion possède un pouvoir perforant considérable (environ huit fois le diamètre de la charge dans l'acier et beaucoup plus dans le béton), et sa température (plusieurs milliers de degrés) provoque, après avoir percé le blindage, un incendie à l'intérieur de la cible transpercée. La distance séparant le sommet de la coiffe et la base du cône est nommée « distance de stand-off » ; elle est nécessaire à la formation du jet et sera comprise entre 2 et 3 fois le diamètre de la charge.
Toutes les têtes HEAT fonctionnent de la même manière quelle que soit leur vélocité. Ce sont donc des missiles et des obus relativement lents dont le pouvoir de pénétration est le même que les munitions cinétiques à haute vélocité. En pratique, la plupart des missiles et des obus HEAT de fort calibre peuvent pénétrer une épaisseur d'acier supérieure à celle que peuvent percer les plus puissants des obus à haute vélocité.
Les obus HEAT étaient si efficaces que certains canons de chars furent redessinés pour ne tirer qu'eux. Les têtes HEAT ont plus de pouvoir pénétrant si elles ne tournoient pas, ce qui donne encore un avantage aux missiles et aux fusées par rapport aux obus tirés par un canon rayé. Un pays alla même jusqu'à imaginer une tête HEAT montée sur roulements pour contrebalancer l'effet de ses canons rayés. C'était finalement une bonne raison pour passer au canon à âme lisse.
Les charges creuses ne se forgent pas forcément sur l'axe du vecteur qui les propulse ; elles peuvent être orientées de différentes manières ; latéralement en usage antichar, pour percer le haut du blindage d'une tourelle de char, là où il est moins épais ; ou bien à 90 degrés par rapport à leur trajectoire afin littéralement de « trancher » un secteur latéralement, pour une utilisation en défense antiaérienne, en conjonction avec détonation initiée par une fusée de proximité.
La parade à une charge creuse consiste à dévier le dard de métal en fusion. Des blindages dits « réactifs » ont été mis au point. Ils portent sur leur surface une petite couche d'une matière explosive dont la mise à feu sera initiée par le dard lui-même, et qui soufflent ledit dard par une contre-explosion, le rendant inopérant.
La contre parade à ces blindages réactifs est la double charge creuse ou charge tandem : une première (petite) charge creuse excite le blindage réactif et le fait exploser ; puis quelques millisecondes après, la deuxième (principale) charge creuse se forme et perce le blindage qui vient juste d'être mis à nu.
Blindage
Balistique des munitions et effet sur les blindages
Obus-flèche de 120
mm M829 américain contenant un barreau en
uranium appauvriBleu : amorce
Orange : charge de propulsion
Vert : sabot
Blanc : flèche
À la suite de l’apparition de blindages de plus en plus consistants ou résistants, de moins en moins traversables, que des munitions explosives ou cinétiques ne pouvaient plus traverser, sont apparues les munitions à l’uranium appauvri. Ces munitions sont effilées longues et denses de manière à augmenter au maximum leur densité sectionnelle et donc leur pouvoir perforant. En fait, il s’agit du même métal que celui composant le blindage Chobham (blindage Chobham : le blindage contient une couche d'uranium appauvri devant une couche de céramique insérée dans de l'acier).
En 2008, on fabrique des balles, obus, bombes ou missiles à l’uranium appauvri. Le principe est simple et avantageux. Lorsque la flèche en uranium entre en contact avec un solide, celle-ci grâce à sa dureté va dans un premier temps percer le solide, puis s’échauffer, atteindre sa température de fusion, faire fondre le solide tout en continuant sa trajectoire grâce à son importante énergie cinétique (fournie au moment du tir). Ensuite, la flèche va s’auto-aiguiser, va projeter les morceaux incandescents du solide (blindage, béton armé) à l’intérieur de la cible tout en brûlant tout ce qui se trouvera sur son passage en raison des caractéristiques pyrophoriques de l'uranium. Cet obus remplit donc la fonction d’un obus explosif à tête renforcée, tout en étant assez peu cher grâce à sa flèche de petit diamètre dont seul le noyau est constitué de l'isotope 238 d’uranium (obtenu après extraction de l'isotope 235 utilisable pour faire des bombes atomiques), recouvert d’une protection.
L’obus est tiré par un canon standard (de 120 mm par exemple, à âme lisse). Il possède une vitesse initiale lui fournissant la force cinétique nécessaire pour percer tout type de blindage (ils auraient pu couler les cuirassés géants utilisés lors de la Seconde Guerre mondiale).
- Un obus APFSDS (pour Armor-Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot) possède une vitesse initiale de 1 661 m/s, mais sa capacité de pénétration diminue en fonction de la distance du but.
- Un obus HEAT a une vitesse initiale de 1 330 m/s, mais sa capacité de pénétration diminue en fonction du type de blindage de la cible. La faible vélocité d’un obus explosif fait qu’à longue distance, la cible a le temps de changer de position et éviter un tir efficace (la limite de portée est de quatre à cinq kilomètres).
Des missiles et bombes à uranium appauvri (dits « munitions perce-bunkers ») peuvent théoriquement percer les parois d'un bunker enterré (il peut percer plusieurs dizaines de mètres de solide).
Principe : On fait prendre de l’altitude au missile pour qu'il consomme moins de carburant pour une vitesse de descente maximale, afin d'augmenter son énergie cinétique. Lors de la pénétration vers un bunker enterré par exemple, il va comprimer la terre, roche ou autre élément constituant le sol puis percer la paroi du bunker en projetant les constituants du sol et de la paroi à l’intérieur du bunker. Si le missile est équipé d’un étage « explosif » et que ce dernier explose avec un temps de décalage, les dégâts sont augmentés.
Personne ne dispose officiellement de ce type de munition mais les États-Unis auraient un programme de recherche allant dans cette direction.
Les autres missiles sont souvent à basse vélocité, donc souvent à tête HEAT (sauf les missiles antiaéronefs, qui doivent avoir une vitesse — ou vélocité — plus importante que leur cible — avions, hélicoptères, missiles… — et qui doivent faire exploser la cible, sans pour autant avoir de tête renforcée). Un obus HEAT est tout autant adapté qu’un obus sabot pour détruire un hélicoptère (en théorie, car un HEAT est moins rapide qu’un sabot, donc laisse plus de temps à la cible pour changer de position).
Les différents types de blindés modernes
Le char de combat principal tel le M1 Abrams est le char standard, descendant de l'esquisse pensée pendant la Première Guerre mondiale. Actuellement[Quand ?] doté d’une tourelle et d’un canon principal de calibre compris entre 120 et 125 mm généralement, de fort blindage, de chenilles et de moyen de communication.
Ce char a généré des variantes, car il est devenu nécessaire de transporter les hommes de manière rapide tout en étant à l’abri. Ainsi sont nés les véhicules de transport de troupes qui ne possèdent pas d’arme de haut calibre. Puis sont apparus les véhicules de combat d'infanterie tel le M2 Bradley possédant un canon de faible calibre (25 mm) tirant des munitions perforantes ou explosives ainsi qu’un double lanceur de missiles TOW 2 (antichars, à tête HEAT) monté en série, possibilité d’adapter un second lanceur double, possédant la capacité de se défendre contre les avions surtout grâce à un lance-missiles Stinger (portatif) et possédant des meurtrières pour permettre à l’équipage de se servir de ses armes légères – les M3 sont des M2 de cavalerie emportant seulement deux passagers contre sept pour le M2 mais davantage de missiles TOW 2 et Stinger – le but de ce genre de véhicule est de protéger son équipage, y compris lorsque celui-ci est à l’extérieur du blindé.
En fait, le tandem Bradley-infanterie a le même dessein qu’une mère protégeant ses enfants. Les soldats bénéficient d’un bunker mobile avec toutefois les inconvénients du volume de ce blindé (surtout de sa hauteur) qui n’est pas négligeable et de la faiblesse de son blindage, ce qui va plutôt dans le mauvais sens. D’autres types de chars ont été créés, dans le but de transporter un poste de commandement, de remplir une fonction spécifique telle qu’être une « plate-forme » lance-missiles. Des outils peuvent s’adapter sur les chars de façon à détruire les mines pouvant se trouver au-devant du char par exemple.
Le canon n’est plus réputé être une arme d’avenir, celui-ci se verra remplacé par le missile, capable de corriger un tir manqué ou d’atteindre une cible cachée ou à une distance hors de portée par les canons ; même si le prix des missiles empêche les petits pays de suivre les grands, ils sont obligés de s’aligner par la force des choses (ou alors – comme nous l’a démontré le cas irakien – sont balayés en quelques jours de combats) et alors, ne sont pas capables de rivaliser avec eux. Mais il existe un inconvénient majeure pour un missile. Son système de guidage (filoguidé, infrarouge, laser ou radar) peut être contrecarré par l'ennemi visé. Un exemple avec les systèmes de brouillage russe Shtora et Tshu qui brouillent le guidage du missile attaquant. De plus un missile se déplace sur le champ de bataille à une vitesse pouvant aller de 100 m/s à 700 m/s environ. Il est donc plus facile à neutraliser ou à éviter qu'une simple flèche de métal ultra-lourd lancée à haute vélocité (1 800 m/s). Le missile transporte une charge militaire vulnérable aux éclats, pas la flèche. En 2020, aucun des pays de l'OTAN n'utilise de missile avec ses chars, la Russie en emploie toujours de plusieurs types et Israël met en œuvre le LAHAT (en).
La guerre en Irak de mars 2003 et la guerre civile syrienne laisse penser qu’on entre dans une nouvelle ère. Les chars et les stratégies devront être réadaptés à un combat de rues, les protections individuelles devront parer à une attaque kamikaze, le personnel devra être formé au combat contre des civils terroristes au milieu de civils pacifiques et les idéologies et stratégies politiques devront évoluer de façon à pouvoir adopter la meilleure défense contre le terrorisme.
Il ne faut pas pour autant abandonner les tactiques et matériels développés depuis les années 1980, car un conflit conventionnel peut toujours éclater comme durant la guerre du Donbass.
Impacts sanitaires et environnementaux
L'ampleur de ces impacts et leur explication précise (toxicité chimique de l'uranium ou radioactivité8 ou effet combiné ?) sont encore discutées, mais non leur existence.
Depuis ce qu'on a appelé le syndrome de la guerre du Golfe, de nombreux indices laissent penser que les munitions à uranium appauvri ont des impacts sur la santé et l'environnement qui ont peut-être été sous-estimés. À l'impact l'uranium est vaporisé ou pulvérisé en nanoparticules qui pénètrent facilement l'organisme si elles sont inhalées.
Avoir séjourné à proximité d’un impact causé par des munitions à l'uranium neutralisé augmente de risque de problèmes de santé, ce qui n’est pas surprenant étant donné les caractéristiques toxicologiques de l'uranium. Une polémique existe cependant quant à la gravité du risque et des séquelles de guerre, certains incriminant aussi les autorités pour ne pas avoir insisté sur le fait qu'un risque cancérigène était lié à l’exposition aux poussières d’uranium dit « inerte » (Cf. syndrome de la guerre du Golfe). À titre de comparaison, un gros fumeur aurait autant de risque de développer un cancer en fin de vie (après soixante ans et s’il a commencé à fumer avant l’âge de vingt ans) qu’un soldat non fumeur s’étant trouvé à côté d’une carcasse détruite par munition à l’uranium inerte pendant une durée d’une douzaine d’heures (à condition que l’impact ait eu lieu dans la même journée et qu’il ne pleuve pas (les poussières potentiellement dangereuses sont maintenues au sol par la pluie). [réf. souhaitée]
Avec le vent, la pluie et le temps, une partie de la poussière est disséminée. Les particules les plus lourdes retombent a priori plus près de l'impact ou peuvent se concentrer localement (sol, dépression, sédiments). On connait mal la toxicité des faibles doses d'uranium, et on connait également mal la cinétique de la vapeur et des nanoparticules d'uranium après l'impact.
Certains[Qui ?] estiment que la dilution dans l'environnement atténue les risques sanitaires, mais on sait que certains métaux ou radionucléides peuvent être efficacement reconcentrés (bioconcentration) par la chaine alimentaire (plancton, champignons).
Notes et références
- « Fusées françaises » [archive].
- « Canons antichar de la Seconde Guerre mondiale » [archive] [PDF], .
- Loïc Charpentier, « 7,5 cm Panzerjägerkanone 40 », Trucks & Tanks magazine, (ISSN 1957-4193).
- Yann Mahé et Laurent Tirone, Wehrmacht 46 : l'arsenal du Reich, vol. 1, Aix-en-Provence, Caraktère, , 160 p. (ISBN 978-2-916403-12-0), p. 93.
- « Panzerknacker - Histoire du combat antichar allemand 1939-1945 », Batailles & Blindés, no H.S. 21, (ISSN 1950-8751).
- Fonction Protection, Stratic.org (extrait).
- Chantal Helain, Historia 687.
- La directive 96/29/Euratom[3] impose que tout produit de plus de 10 000 Bq/kg (becquerels par kilogramme) soit confiné. Or, l'uranium appauvri peut avoir une concentration 4 000 fois supérieure à cette limite, mais a été disséminé dans l'environnement par des munitions antiblindage.
Annexes
Bibliographie
Sources utilisées pour cet article :
- Advanced Technology Warfare
- Modern Land Combat
- The modern US Army
- Weapons and Tactics of the Soviet Army – New Edition
- USAREUR
- Armor
- International Défense Review
- Jane’s All the World’s Aircraft
- Jane’s Armor & Artillery
- Jane’s Defence Weekly
- Jane’s Infantry Weapons
- Soviet Military Power
- Operator’s Manual, Tank, Combat, Full-Tracked, M1
- Organizational & Tactical Reference Data for the Army in the Field
- Tank Combat Tables
- The Tank & Mechanized Infantry Battalion Task Force
- Tank Platoon
- Historia 687
- RMC Vol. 4 no 1 et 2
Sources externes
Articles connexes
Munition rôdeuse
HERO (UVision Air Ltd, Israël), exposé au DSEI 2019, Londres.
UVision Hero-30 avec lanceur de type lance-missile portatif.
Une munition rôdeuse (de l'anglais : loitering munition), aussi appelé drone kamikaze ou encore drone suicide, est un drone de combat aérien contenant une charge explosive : il est conçu pour évoluer au-dessus du champ de bataille et détruire des cibles en plongeant sur elles lors de missions de recherche d'opportunité, c'est-à-dire à la fois de reconnaissance et de combat. Le drone revient à sa base si aucune cible n'a été engagée (l'engagement entraîne la destruction potentielle de la cible et celle, certaine, du drone). La cible est choisie par un opérateur qui en a la vision directe grâce au drone.
Plutôt que d’emporter une charge offensive, ce drone est en fait la munition principale, capable d'emprunter des itinéraires complexes pendant plusieurs heures : c'est pourquoi il est nommé « munition rôdeuse » ou encore « munition vagabonde » (en anglais « loitering munition »)1. Il convient pourtant de séparer nettement les deux concepts2 : la cible de la munition vagabonde n'est pas désignée directement par son opérateur propre, mais par d'autres opérateurs.
Histoire
Les premiers drones suicide ont été conçus en Israël dans les années 19803,4. Ils n'étaient pas toujours désignés sous ce nom, mais parfois comme des missiles de croisière d'un type particulier5.
Un des premiers usages de drones suicides au combat a eu lieu en avril 2016 lors de la Guerre des Quatre Jours au Nagorno-Karabagh. Les Harop fournis par Israël à l'Azerbaïdjan ont été utilisés contre des bus amenant des soldats arméniens sur le front6. Ces drones auraient aussi été utilisés pour détruire un poste de commandement arménien.
À la suite de leurs interventions en Syrie à partir de 2015 les Russes demandent à leur industrie de la défense la création de nouveau types de drones suicides à partir de 2018. Ils se sont inspirés des tactiques de l’État Islamiste qui utilisait des drones commerciaux modifié comme drone kamikaze. Les Russes ont testé leurs drones suicides lors de la bataille d'Idleb de 2020.
L'armée azerbaïdjanaise a utilisé à nouveau le Harop lors de la guerre du Haut-Karabagh de 2020 ; cette arme a alors été appelée une innovation stratégique majeure (en anglais : game changer, litt. un changeur de jeu).
Des drones suicides sont engagés en Ukraine en 2022 par les deux camps. Les Russes utilisent leurs drones de fabrication locale comme le ZALA Lancet et le ZALA KUB-E7. Les Ukrainiens utilisent le Switchblade, un drone de fabrication américaine8. Des drones commerciaux modifiés sont également utilisés par les deux camps. Leur efficacité est toutefois relative dans ce conflit, en effet la très faible charge explosive de ces armes les rend quasi inutiles contre des véhicules blindés (si les écoutilles sont fermées) qui sont présents en très grand nombre dans ce conflit. De plus, dans un conflit de haute intensité où les deux protagonistes font appel à des moyens de guerre électroniques très sophistiqués, l'utilisation de petit drones devient très compliqué car ces modèles ne possèdent pas de liaisons radio ou GNSS cryptées, qui pourrait les protéger des attaques électroniques9,10.
Utilisateurs et producteurs
En 2020, des drones suicides sont utilisés ou produits dans les pays suivants :
Malgré le débat éthique sur l'utilisation des drones armés par la Bundeswehr, l'Allemagne s'est doté, en 2009, des drones suicides Harop de l'industriel israélien IAI11.
En production locale le HRESH, BEEB 180012
IAI Harpy, IAI Harop, Orbiter 1K13, STM Kargu14,15
IAI Harpy, CH-901, WS-43, ASN-30116,17
Devil Killer18,19, IAI Harpy
AeroVironment Switchblade, Raytheon Coyote (en)20
IAI Harop21,22
Qasef-1, Raad 85 (UAV) et potentiellement d'autres23,24,25
Shahed 136
Programme d'achats de drones commerciaux et de leur transformation en drones suicides26,27,28
Le IAI Harop a été développé à l'origine pour la suppression de défense aérienne ennemie (SEAD) et est doté d'une très faible signature radar. Il est capable de fonctionner de manière totalement autonome en utilisant son mode de guidage antiradar, ou être guidé par un opérateur humain depuis une station de contrôle.
IAI Harpy, IAI Harop, IAI Green Dragon, IAI Rotem L, Aeronautics Defense Orbiter, Delilah, SkyStriker29. — Fabrication locale d'autres types par Israel Aerospace Industries30, UVision31,32, Aeronautics Defense33, Elbit Systems34, et Israel Military Industries35
en production locale, sans nom particulier36
37
WB Electronics Warmate38
MSP Warblefly39
NCSIST Chien Hsiang (en)43, NCSIST Fire Cardinal
STM Kargu44, STM Alpagu, IAI Harpy45
IAI Harpy, IAI Harop37
Rebelles Houthis - Qasef-146
Notes et références
- https://www.areion24.news/2021/01/26/munitions-rodeuses-leurope-deja-depassee/ [archive].
- Yannick Smaldore, Israël fait l'acquisition de munitions vagabondes FireFly pour soutenir ses forces spéciales et son infanterie [archive], Meta-Défense.fr, 6 mai 2020 (consulté le 24 novembre 2020).
- (en) Loitering Weapons are making a Comeback [archive], Defense Update, June 2009 (consulté le 24 novembre 2020).
- (en) Drone Strike!: UCAVs and Aerial Warfare in the 21st Century [archive], By Bill Yenne, (ISBN 9781580072526), pages 106-107 (consulté le 24 novembre 2020).
- (en) James W. Canan, "Unmanned Aerial Vehicles." [archive] Air Force Magazine (1988), page 87 (consulté le 24 novembre 2020).
- (en) « Azerbaijan Used IAI's Harop UCAV » [archive], sur Israel Defense (consulté le ).
- https://www.army-technology.com/projects/zala-kyb-strike-drone-russia/ [archive].
- https://defence-blog.com/ukrainian-soldiers-show-switchblade-suicide-drone-in-action/ [archive].
- https://www.thedrive.com/the-war-zone/this-is-whats-happened-so-far-in-ukraines-electronic-warfare-battle [archive].
- https://thehill.com/opinion/national-security/3532612-ukraine-war-shows-limits-of-drone-warfare/ [archive].
- (en) Germany signs contract for Harop loitering munition [archive], FlightGlobal, September 2009.
- (en) « Armenian manufacturer boasts cutting-edge multifunctional combat UAVs and loitering munitions » [archive], sur armenpress.am (consulté le ).
- (en) Thomas Gibbons-Neff, « Israeli-made kamikaze drone spotted in Nagorno-Karabakh conflict », The Washington Post, (lire en ligne [archive], consulté le ).
- (tr) « STM'nin yerli kamikaze İHA'sı KARGU Azerbaycan'da görüldü » [archive], .
- (tr) « İlk kez Libya'da kullanılmıştı! Bu kez Azerbaycan'da görüntülendi » [archive], CNN Türk, .
- (en) DSA 2016: China details CH-901 UAV and loitering munition [archive], Janes, April 2016.
- (en) IDEX 2017: CATIC reveals details about Harpy-type loitering munition [archive], Janes, March 2017.
- (en) South Korea's Kamikaze UAV Could Scare the Ojom Out of Kim Jong-un [archive], Gizmodo, October 2012.
- (en) South Korea developing 'kamikaze' attack drone [archive], Fox News, October 2012.
- (en) Surface Navy 2017: Coyote earmarked for ISR and offensive roles [archive], Janes, January 2017.
- (en) Harop Loitering Munitions System for the IAF [archive], India Defence Review, January 2014.
- (en) « Laser weapons, swarm drones on DRDO menu » (Special Correspondent), The Hindu, (ISSN 0971-751X, lire en ligne [archive], consulté le ).
- (en) Iran's navy touts 'suicide drone' [archive], USA Today, October 2016.
- (en) Iran Tests 'Kamikaze' Suicide Drone [archive], 'Te National Interest, December 2014.
- (en)Iranian army tests home-made suicide drone [archive], Trend news agency, December 2016.
- (en) David Grossman, « ISIS Using Kamikaze Drones in Iraq » [archive], sur popularmechanics.com, (consulté le ).
- (en) Papers Offer a Peek at ISIS' Drones, Lethal and Largely Off-the-Shelf [archive], New York Times, January 2017.
- Portable Attack Drones or Loitering Munitions [archive], SP'S Landforces, September 2016.
- (en) Elbit announces new SkyStriker loitering munition [archive] Yaakov Lappin, Tel Aviv - IHS Jane's Defence Weekly 08 September 2016.
- (en) SINGAPORE: IAI reveals new family of loitering munitions [archive], FlightGlobal, February 2016.
- (en) UVision loitering munitions to undergo anti-tank testing [archive], Flight Global, April 2016.
- (en) Israeli companies pitching loitering munitions for US Army programme [archive], FlightGlobal, April 2016.
- (en) Aeronautics introduces Orbiter 1K loitering munition [archive], FlightGlobal, May 2015.
- (en) Elbit announces new SkyStriker loitering munition [archive], Jane's Defence Weekly, September 2016.
- (en) Vietnam Eyes Israel's Delilah Standoff Missile, and F-16s Could Be Next [archive], The Warzone, March 2017.
- (en-US) « Artsakh to mass produce combat drones, trials successfully completed » [archive], sur Public Radio of Armenia (consulté le ).
- (en) Loitering Munitions - In Focus [archive], Center for the Study of the Drone, Feb 2017.
- (en) Warmate expendable UAV in production for two customers [archive], Flight Global, April 2016.
- (en) « Showing the destruction of the van a Polish drone bombers » [archive], sur weaponews.com (consulté le ).
- « La Russie entre sur le marché mondial des drones kamikazes » [archive], (consulté le ).
- https://nationalinterest.org/blog/reboot/flying-kalashnikov-russias-new-drone-has-ukraine-worried-196841 [archive].
- Arnaud, « Qu'est-ce que le drone Shahed 136 utilisé par la Russie contre les civils ukrainiens ? » [archive], sur avionslegendaires.net, (consulté le ).
- (en) Kelvin Wong, « TADTE 2019: Taiwan's NCSIST rolls out indigenous anti-radiation loitering munition » [archive], sur www.janes.com, Janes (consulté le ).
- « Turkey's STM delivering Kargu loitering munitions to TSK | Jane's 360 » [archive], sur www.janes.com (consulté le ).
- (en) IAI Gets $100 Million Contract for HAROP Killer Drones [archive], Defense Update, 2009.
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Munition à uranium appauvri
Pénétrateur de l'obus PGU-14/B API utilisé dans le canon
GAU-8 Avenger.
Les munitions à uranium appauvri sont des munitions employant l'uranium appauvri, matériau très dense, afin de perforer les blindages.
La densité élevée de l'uranium en fait un matériau de fabrication d’obus antichar, et notamment dans les « obus-flèches » utilisés lors de la première guerre du Golfe, la guerre du Kosovo et durant les premières phases de la guerre d'Irak.
Actions des munitions à l'uranium appauvri
Les « flèches » des munitions antiblindage sont généralement en alliage de tungstène (comme le carbure de tungstène) qui est plus dur que l'acier, ou des flèches dont le cœur est en uranium appauvri plus dense que l'acier, et concentrant donc dans son centre plus de puissance (ce matériel est toutefois moins puissant). Le tungstène possède une température de fusion de 3 400 °C et d’ébullition de 5 700 °C. L’uranium appauvri possède quant à lui un point de fusion à 1 130 °C et d’ébullition à 3 850 °C mais il a l’avantage d’être disponible en grandes quantités (lors de l'enrichissement de l'uranium pour son utilisation comme combustible, il reste environ 6/7e d'uranium non utilisable en l'état, sous cette forme dite appauvrie – fin 2013 on comptait environ 290 000 tonnes de cet uranium stocké en France)[Quoi ?]. Le tungstène est d’autre part deux fois plus dur que l’uranium appauvri, avec une dureté de 500 Vickers contre 250 Vickers seulement pour l’uranium appauvri). Ceci permet d'augmenter considérablement leur densité sectionnelle et donc leur profondeur d'impact.
Action mécanique
Obus-flèche perforant américain M829 ; la
flèche (en blanc) est composée d’un alliage d’uranium.
Dans le cas d'un obus de char, le « pénétrateur » est une barre affutée longue d'environ 25 cm, composée d'uranium appauvri, sans explosif et à la vitesse initiale élevée (de l'ordre de 1 500 m/s). Lors de l'impact, son énergie cinétique est dissipée sur une surface d'environ 40 mm2, ce qui crée une pression énorme et participe à la pulvérisation du blindage en ménageant un trou.
Certaines bombes anti-bunker sont soupçonnées d'utiliser des pénétrateurs à uranium appauvri1,2.
Action eutectique et explosive
Pendant l'impact, l'uranium s'échauffe et atteint sa température de fusion, qui est inférieure à celle de l'acier ; il crée avec le fer du blindage un eutectique, ce qui provoque la fusion du blindage et participe à la perforation, en projetant le métal liquide dans l'habitacle. Cela se propage dans la cible et tout ce qui est inflammable va s'enflammer voire exploser ; par ailleurs, l'uranium pulvérisé qui pénètre dans l'habitacle s'enflamme également, d'où l'explosion des chars de combat environ 5 secondes après l'impact3.
Dispersion d'uranium
Si l'uranium appauvri provenant de l'impact d'un pénétrateur de 4,85 kg (dont on suppose qu'il est volatilisé à 50 %) est dispersé uniformément dans un rayon de 10 m du point d'impact et pénètre le sol4 sur une profondeur de 10 cm, il conduira au départ à une concentration d'approximativement 96 mg/kg, près de 50 fois plus que le taux moyen naturel du sol (de l'ordre de 2 mg/kg) mais qui peut se rencontrer dans certains sols naturellement radioactifs (dans les poussières de la région d'Amman, en Jordanie par exemple5). On a montré au milieu des années 1990 après la guerre du Golfe au Koweït6 qu'une partie de cet uranium et d'autres métaux provenant de l'obus se disséminaient ensuite dans l'environnement via les retombées de l'aérosol dégagé au contact de la munition avec sa cible, puis par les réenvols de particules et molécules, éventuellement adsorbées sur des poussières ou gouttelettes d'eau (contamination dite « aéroportée »7), le ruissellement de l'eau ou la bioturbation. Ainsi en Bosnie-Herzégovine après la guerre, une enquête du PNUE a pu utiliser des écorces d'arbres et des lichens (ayant fixé ces particules acquises à partir de l'air ou de la pluie) comme bioindicateurs de cette contamination ; les lichens, même s'ils ne fixent pas 100 % de l'uranium qui se dépose sur eux (une partie étant lessivée par les pluies8, mais pouvant être retrouvée sur les écorces), sont considérés comme de bons bioindicateurs des pollutions aéroportées9, métalliques notamment10 et à ce titre déjà très utilisés pour le biomonitoring de l'environnement11,12 par ce qu'ils sont de bons biointégrateurs des particules de leur environnement13 (avec possibilité de transplanter des lichens propres dans un environnement contaminé pour mesurer en combien de temps ils intègrent des polluants14 ou évaluer la part de polluant provenant du sol et de l'air15). L'analyse des ratios de concentration uranium 234/uranium 238 permettant de bien différencier l'uranium apporté par les munitions de l'uranium naturel également trouvé dans les lichens, jusque dans les régions les moins industrialisées (Nunavut16 par exemple). Les lichens ont ainsi été utilisés pour suivre le devenir de radionucléides émis par l'accident de Tchernobyl ou l'uranium émis par les munitions utilisées en 1999 dans la région des Balkans (via l'étude du ratio isotopique uranium 235/uranium 238)17.
Au point d'explosion, les anomalies de concentration en uranium sont d'autant plus perceptibles que le métal a été faiblement dispersé. Un volume de sol naturel dans un rayon de 20 m et sur une profondeur de 80 cm (toujours à raison d'une moyenne de l'ordre de 2 g/t) contient en moyenne une masse de 4 kg d'uranium, ce qui est l'ordre de grandeur typique d'une munition militaire : à ces niveaux de dilution, si l'uranium provenant de la munition n'est pas plus mobile et bioassimilable, on ne peut parler de « pollution » au sens technique du terme, du fait que la teneur en uranium du sol reste dans les limites du normal. L'uranium dispersé sous forme de vapeur ou nanoparticule peut ne pas être aussi bien fixé ou adsorbé dans le sol que l'uranium naturel, et alors plus facilement dispersé par l'air ou retrouvé dans l'eau18. Plus de 10 ans après le conflit de Bosnie-Herzégovine les taux d'uranium trouvés dans l'eau étaient jugés très bas (0.27-16.2 m Bq l(-1) pour (238)U, 0.41-15.6 m Bq l(-1) pour (234)U et 0.012-0.695 m Bq l(-1) pour (235)U) et seuls quelques échantillons gardaient trace d'uranium appauvri militaire. L'uranium naturel et "militaire" étaient cependant bien plus présent dans les lichens mousses et écorces d'arbres (0.27 à 35.7 Bq kg(-1) pour (238)U, 0.24 à 16.8 Bq kg(-1) pour (234)U et 0.02-1.11 Bq kg(-1) pour (235)U), que dans l'eau, à des niveaux cependant jugés encore faibles par rapport aux valeurs seuil en vigueur.
Les études disponibles suggèrent qu'il faut une durée de l'ordre de 100 à 1 000 ans pour que les munitions ou les blindages en uranium appauvri se dégradent et soient dispersés chimiquement par oxydation, érosion éolienne, hydrique, etc.5.
Sites au Kosovo et en Serbie où l'aviation de l'OTAN a utilisé des munitions avec l'uranium appauvri pendant les bombardements de 1999.
Les métaux lourds empoisonnent l'air. Selon ses opposants, l'uranium appauvri est le cheval de Troie de la guerre nucléaire car il continue d'irradier et de tuer après les combats. Il est impossible de s'en débarrasser, il agit ainsi comme une bombe radiologique.
Après la campagne du Kosovo en 1999, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a réclamé l’interdiction de la fabrication, des essais, de l'utilisation et de la vente d'armes à l’uranium appauvri afin de préserver les générations présentes et futures (Conseil de l’Europe 24/01/2001).
En outre, la directive 96/29/Euratom19 dispose que tout produit dépassant une concentration de 10 000 becquerels par kilogramme doit être confiné. Or, bien que l'uranium appauvri ait une concentration 1 500 fois supérieure à cette limite, il est toujours disséminé dans l'environnement par le biais de ces munitions.
Aux termes de la loi fédérale américaine (50 U.S.C. 2302 - Definitions), les armes à uranium appauvri correspondent à la définition des armes de destruction massive pour deux des trois critères20, à savoir qu'elles "sont conçues pour causer la mort ou blesser gravement un nombre significatif de personnes, par dissémination ou impact: (A) d'une substance toxique ou ses précurseurs, et (C) de radiations ou de radioactivité".
Contamination à l'uranium 234
Des études en laboratoire effectuées par le Dr Asaf Durakovic et son équipe de l'Uranium Medical Research Center21 indiquent une forte contamination à l'uranium 234 en Irak. Les niveaux d'uranium 234 retrouvés sont proches de ceux de l'uranium naturel, soit 5 à 6 fois plus que l'uranium appauvri. Ceci implique que la radioactivité de l'uranium détecté est double de celle de l'uranium appauvri.
Effet sur la santé
Corrélation avec le « syndrome de la guerre du Golfe »
Le rôle qu'a joué l’uranium appauvri dans le syndrome de la guerre du Golfe est sujet à controverse. Les différentes études faites à ce jour avancent des résultats contradictoires.
Un rapport écrit par un ingénieur pétrochimique irlandais fait état d’une augmentation du taux de décès pour 1 000 enfants irakiens de moins de 5 ans, qui passe de 2,4 en 1989 à 16,6 en 1993 et de cas de leucémies qui ont plus que quadruplé dans les régions où des projectiles contenant de l’uranium appauvri ont été utilisés. Même si la famine et le manque de médicaments liés à l’embargo imposé par le conseil de sécurité de l’ONU sont des facteurs d’augmentation de la mortalité infantile, cela n’expliquerait pas les leucémies[réf. souhaitée].
Le docteur Richard Guthrie, expert en armement chimique à l’Université de Sussex au Royaume-Uni, argue que la preuve du lien entre l’utilisation d’uranium appauvri et les maladies natales ne peut être établie. Le gaz moutarde, utilisé par l’armée irakienne durant la guerre avec l’Iran, pourrait en être la cause. L’ypérite est également connue pour provoquer des cancers, des leucémies et des malformations chez les nouveau-nés, même après une courte exposition. Les enfants des résidents d’Halabja, ainsi que ceux des vétérans iraniens de la guerre Iran-Irak, ont développé des cancers et des malformations natales. Ce second groupe n’a pas été exposé à l’uranium appauvri mais souffre de ces maladies.
Ce rapport ne prend pas en compte les vétérans des différentes guerres où l’uranium appauvri a été utilisé et qui n’ont pas été exposés au gaz moutarde[réf. souhaitée].
Une étude du New England Journal of Medicine, qui porte sur 34 000 bébés de vétérans de la guerre du Golfe22, ainsi que le département chargé des vétérans Department of Veterans Affairs (en)23, n’ont trouvé aucune augmentation des risques de malformations du nouveau-né parmi les enfants engendrés par un vétéran de la guerre du Golfe.
Le centre de recherche médicale sur l’uranium (Uranium Medical Research Centre) aux États-Unis d'Amérique et au Canada a publié une étude sur 27 vétérans de la guerre du Golfe24 affichant les symptômes typiques du syndrome de la guerre du Golfe. Seuls ceux qui avaient des fragments d’uranium appauvri logés dans le corps avaient des traces d’uranium appauvri dans l’urine. L’étude du département des Anciens combattants des États-Unis conclut que, pour cet échantillon, les vétérans qui avaient de l’uranium appauvri dans le corps ne présentaient pas de déficience des fonctions reproductrices et rénales.
L'uranium contenu dans les obus a tendance à s'éparpiller rapidement dans l'air, ce qui étend les zones de contamination par des particules d'uranium et augmente l'exposition à l'uranium. Certaines études controversées suggèrent que l'uranium serait plus volatil qu'il n'est généralement accepté25.
Effet sur les populations civiles
Taux de malformations congénitales observé par l'hôpital Universitaire de Basorah, Irak
26.
Les armes à uranium appauvri ont été employées massivement dans les conflits récents. De grandes quantités ont été dispersées dans les théâtres de guerre (Balkans, Irak, Afghanistan…)27. Dans les zones les plus touchées, il a été constaté une hausse spectaculaire des malformations ainsi que des cancers, sans qu'aucune enquête n'ait été faite, que ce soit par les autorités locales ou l'OMS28. L'OMS a signé un accord avec l'AIEA le qui stipule que l'OMS ne doit pas faire d'étude sur les effets de la radioactivité sans l'accord de L'AIEA29. Dans les faits, l'AIEA donne rarement l'autorisation d'enquêter27. l'Independent WHO se bat contre cet accord.
Concernant la guerre d'Irak, dans les années qui ont suivi la bataille de Falloujah, le nombre de malformations congénitales graves et de cancers aurait augmenté de façon très importante d'après la maternité de l’hôpital et des médecins de Falloujah30. Selon l'enquête de la journaliste Angélique Férat, chaque famille de Falloujah a son « bébé monstre »31. Ces malformations pourraient être dues à l'utilisation de munitions à l'uranium appauvri ou enrichi31,32,33.
Cette thèse est peu crédible, même si l'uranium appauvri peut avoir des effets tératogènes34, il ne peut expliquer à lui seul des niveaux de prévalence aussi importants :
- Les composants chimiques des armes conventionnelles (plomb, mercure, divers composés des poudres explosives) sont connus pour leurs effets tératogène et cancérigène.
- Après 1995, le taux de malformation a explosé en Irak, bien avant l'invasion de 2003. L'état sanitaire très dégradé de la population irakienne (système de santé inexistant, pénurie alimentaire sous l'effet de l'embargo puis de la guerre) peuvent aussi expliquer ces malformations. Certains virus et des carences en vitamine B9 peuvent provoquer des malformations.
- Les études sur les survivants d'Hiroshima (bombe à l'uranium) n'ont pas montré de taux de malformation anormaux chez les descendants des irradiés35.
Une bombe à l'uranium ne contient que quelques dizaines de kilos d'uranium dont une partie est transformée par la fission. L'utilisation à grande échelle de munitions met en jeu des quantités d'uranium très supérieures.
- Les munitions à l'uranium appauvri sont utilisées pour la lutte contre les blindés ou éventuellement des bunkers, pas pour le combat de rue où l'infanterie alliée est engagée comme ce fut le cas durant cette bataille.
- Les lésions provoquées par l'uranium appauvri sont très différentes des malformations fœtales36. L'uranium est notamment un puissant néphrotoxique37, or aucune étude ne fait état d'une explosion des pathologies ou des atteintes rénales à Falloujah, à l'inverse de ce qui est observé chez les vétérans de la première guerre du Golfe.
- Aucune donnée ne met en évidence des effets chez les populations exposées à des forts taux d'uranium naturel dans l'eau potable.
Cette théorie a été lancée par Christopher Busby (en),[réf. nécessaire] militant antinucléaire britannique, qui s'est distingué dans le passé par des publications bidonnées sur les leucémies autour des centrales nucléaires galloises (falsifications de données)38 ou des déclarations inventées de toutes pièces sur des épandages de matériaux radioactifs organisés par le gouvernement japonais à la suite de l'accident nucléaire de Fukushima. Ces épandages auraient été destinés à fausser les résultats de futures études sur l'impact de la catastrophe en provoquant des cancers en dehors de la zone contaminée[réf. nécessaire]. Il propose aussi à la vente des kits d'analyses des radionucléides particulièrement dispendieux ainsi que des pilules antiradiations aussi coûteuses qu'inutiles39. L'article sur l'utilisation de l'uranium à Falloujah qu'il devait faire paraître dans la revue The Lancet n'a jamais été publiée.[réf. nécessaire]
La carcinogénéité des armes à uranium pourrait provenir des particules alpha diffusées par les poussières d'uranium. Inoffensives à l'extérieur du corps, elles sont extrêmement nocives une fois ingérées ou inhalées en raison du très haut coefficient d'efficacité biologique relative des particules alpha.
Notes et références
- Factfile: Bunker buster bombs [archive]
- The heavy metal logic bomb [archive]
- Rapport Maurice-Eugène André Symptomatologie et effets de la maladie de la Guerre du Golfe [archive] L’uranium contenu dans les obus ou autres projectiles, - non seulement se divise en très fines particules quand le projectile arrive dans sa phase d’impact sur sa cible -, mais que d’autre part, les particules d’U 238 (ou UA), quand elles sont finement divisées, prennent feu spontanément quelle que soit leur température, et qu’en se consumant elles se transforment en cendres radioactives : c’est « cela » être un métal « pyrophore » : il prend feu spontanément quand on le fragmente en très petites parties de l’ordre du micromètre.
- Sansone, U., Stellato, L., Jia, G., Rosamilia, S., Gaudino, S., Barbizzi, S., Belli, M. (2001), Levels of depleted uranium in Kosovo soils, Radiat. Protect. Dosimetry 97(4), 317–320 (résumé [archive]).
- Depleted Uranium: Sources, Exposure and Health Effects [archive] - WHO, Geneva 2001 (WHO/SDE/PHE/01.1)
- Bou-Rabee, F. (1995), Estimating the concentration of uranium in some environmental samples in Kuwait after the 1991 Gulf War, Appl. Rad. Isot. 46(4), 217–220
- Bellis, D., R. Ma N. Bramall McLeod, C. W., N. Chapman, K. Satake (2001), Airborne uranium contamination – As revealed through elemental and isotopic analysis of tree bark, Environ. Pollut. 114(3), 383–387
- Fahselt, D., (1997), Efflux of uranium from four macrolichens due to aqueous washing, Coenoses, 12 77–81
- Di Lella, L. A., Frati, L., Loppi, S., Protano, G., Riccobono, F. (2003), Lichens as biomonitors of uranium and other trace elements in an area of Kosovo heavily shelled with depleted uranium rounds, Atmos. Environ. 37, 5445–5449
- Garty, J. (1992), Lichens and heavy metals in the environment, in: J. P. Vernet (ed.), Heavy Metals in the Environment II, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, p. 55–131.
- Garty, J. (2001), Biomonitoring atmospheric heavy metals with lichnes : Theory and application, Crit. Rev. Plant Sci. 20(4), 309–371
- Kirchner, G., Daillant, B. (2002), The potential of lichens as long-term biomonitors of natural and artificial radionuclides, Environ. Pollut. 120, 145–150
- Jeran, Z., Jaĉimoviĉ, R., Batiĉ, F., Mavsar, R. (2002), Lichens as integrating air pollution monitors, Total Environ. 120, 107–113.
- Jeran, Z., Byrne, A. R., Batiĉ, F. (1995), Transplanted epiphytic lichens as biomonitors of air-contamination by natural radionuclides around the Žirovski Vrh Uranium mine, Slovenia, Lichenologist 27(5), 375–385.
- Loppi, S., Pirintos, S. A., De Dominicis, V. (1999), Soil contribution to the elemental composition of epiphytic lichens (Tuscany, central Italy). Environ. Monit. Assess., 58, 121–151
- Chiarenzelli, J. R., Aspler, L. B., Dunn, C., Cousens, B., Ozarko, D., Powis, K., (2001), Multi-element and rare earth composition of lichens, mosses, and vascular plants for the Central Barrenlands, Nunavut, Canada, Appl. Geochem. 16, 245–270.
- Loppi, S., Riccobono, F., Zhang, Z. H., Savic, S., Ivanov, D., Pirintos, S. A. (2003) Lichens as biomonitors of uranium in the Balkan area, Environ. Pollut. 125, 277–280 (résumé [archive])
- Jia G, Belli M, Sansone U, Rosamilia S, Gaudino S. (2006), Concentration and characteristics of depleted uranium in biological and water samples collected in Bosnia and Herzegovina. J Environ Radioact ; 89(2):172-87. Epub 2006 Jun 27 (résumé [archive]).
- Texte de directive 96/29/Euratom [archive]
- Extrait de la loi fédérale 50 USC 2302 sur le site du Government Publishing Office [archive]
- « L'uranium 234 et la radiotoxicité des armes à uranium » [archive], sur www.assopyrophor.org (consulté le )
- Étude portant sur 34 000 bébés de vétérans de la guerre du Golfe [archive]
- Étude réalisée par le département chargé des vétérans [archive]
- [PDF]Étude réalisée par le centre de recherche médicale sur l’uranium [archive]
- Rapport des docteurs Chris Busby et Saoirse Morgan (en anglais) [archive] - janvier 2006
- I. Al-Sadoon, et al., writing in the Medical Journal of Basrah University, (see Table 1 here) [archive]. This version from data by same author(s) in Wilcock, A.R., ed. (2004) "Uranium in the Wind" (Ontario: Pandora Press) (ISBN 0-9736153-2-X)
- En Afghanistan, l’Amérique sème une mort perpétuelle [archive]
- « Loi du silence sur l'uranium appauvri » [archive], Le Monde Diplomatique,
- « ACCORD ENTRE L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE ET L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (1) » [archive], sur Independent WHO
- Caroline Caldier, « L’armée américaine a-t-elle utilisé l’arme nucléaire en Irak ? » [archive], sur france-info.com, (consulté le )
- Angélique Férat, Enfans de Fallujah, France Info, 9 juin 2011
- Thomas Baïetto, « A Fallouja, les "bébés monstres" soulèvent des questions sur les armes américaines utilisées en 2004 », Le Monde,
- (en) Martin Chulov, « Huge rise in birth defects in Falluja », The Guardian,
- (en)Rita Hindin, Doug Brugge, Bindu Panikkar, « Teratogenicity of depleted uranium aerosols: A review from an epidemiological perspective » [archive], sur National Center for Biotechnology Information, (consulté le )
- Pierre Galle et Raymond Poulain, Biophysique : Radiobiologie, radiopathologie, Éditions Masson, , 253 p. (ISBN 978-2225856365)
- (en)Richard Bramhall, « Risks from depleted uranium » [archive], sur The Lancet, (consulté le )
- (en)Arzuaga X, Rieth SH, Bathija A, Cooper GS., « Renal effects of exposure to natural and depleted uranium: a review of the epidemiologic and experimental data. » [archive], (consulté en )
- (en)[PDF]John A Steward1, Ceri White, Shelagh Reynolds, « Leukaemia incidence in Welsh children linked with low level radiation—making sense of some erroneous results published in the media » [archive], sur IOP Publishing, (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Sur les autres projets Wikimedia :
Bibliographie
- (en) UNEP, 2001, Depleted uranium in Kosovo, Post-conflict environmental assessment, United Nation Environment Programme.
- (en) UNEP, 2002, Depleted uranium in Serbia and Montenegro, Post-conflict environmental assessment in FRY, United Nation Environment Programme.
- (en) UNEP, 2003, Depleted uranium in Bosnia and Herzegovina, Post-conflict environmental assessment in FRY, United Nation Environment Programme.
Références externes
Munitionnette
Munitionnettes travaillant à la production d’obus, au
Royal Arsenal en Angleterre.
Lors de la Première Guerre mondiale, dans tous les pays belligérants, les femmes deviennent un soutien indispensable à l’effort de guerre dans l’industrie de l’armement, remplaçant dans les usines les hommes partis au combat. Elles sont surnommées les munitionnettes car elles fabriquent souvent des armes, des munitions et de l'équipement militaire.
Définition
Munitionettes en mai 1917 dans une usine
Vickers.
On appelle munitionnette1 une femme travaillant dans une usine d’armement en temps de guerre. Ce surnom vient du nombre inhabituel de femmes employées dans les usines pendant la Première Guerre mondiale du fait de la mobilisation générale des hommes pour le front qui engendre d’une part des postes vacants et d’autre part le manque de ressources de leurs femmes.
L’appel aux femmes
L’appel de Viviani
« Appel aux Femmes Françaises » lancé par
René Viviani le 7 août 1914 afin de mobiliser les femmes des campagnes pour assurer les moissons et les vendanges.
En France, le , elles sont appelées à travailler par le président du Conseil René Viviani par le biais d'un communiqué officiel. On croit alors à une victoire rapide, et ce communiqué s’adresse donc principalement aux femmes d’agriculteurs. Le but est d’assurer le bon déroulement des moissons et des vendanges avant le retour des soldats.
Ce n’est qu’en 1915 qu’on se rend compte que la guerre peut durer et c’est à ce moment que l’on fait appel aux femmes pour pallier le manque de main d’œuvre dans les usines pour fabriquer des munitions, des avions ou encore des canons. Le fait de pouvoir fournir cela au front permettra aux hommes partis au champ de bataille d’emporter la victoire et de rentrer chez eux.
Les « Munitionettes » ont en particulier travaillé sur l'usine mise en place d'urgence par André Citroën à Paris, quai de Javel, produisant 10 000 obus par jour, puis 55 000 obus par jour en 1917, qui sera après la guerre reconvertie en quatre mois pour être utilisée pour la création de la société Citroën.
L'effort de guerre
Dans le but de gagner la guerre, la République française demande à la population de s’investir dans l’effort de guerre de toutes les manières possibles. C’est que l’on appelle la guerre totale. Dans cette optique, les femmes remplacent alors leurs maris et leurs frères dans le monde du travail et les enfants trop jeunes aident dans les champs. L’État fait aussi appel aux populations de l’arrière pour financer la guerre en donnant leur or par ce qui est alors appelé des « emprunts ».
Au début de la guerre, les femmes représentent 6 à 7 %2 de la main d’œuvre des usines d’armement en France. À la fin de la guerre, elles sont près de 420 000 à manipuler chaque jour des obus, soit un quart de la main d’œuvre totale. Au Royaume-Uni, elles sont plus d’un million à travailler dans des usines d’armement telle que celle de Chillwell (en), dans le Nottinghamshire.
La main d’œuvre féminine était tellement cruciale pour l’effort de guerre qu’en 1915, le général Joffre a déclaré : « Si les femmes qui travaillent dans les usines s’arrêtaient vingt minutes, les Alliés perdraient la guerre »3. En quatre années de guerre, les munitionnettes auront fabriqué trois cents millions d’obus et plus de six milliards de cartouches.
Les conditions de travail
Le travail
Munitionnettes, National Shell Filling Factory, Chilwell, en 1917.
Les conditions de travail sont particulièrement difficiles. C'est même souvent un travail à la chaîne. C’est également un travail pénible du fait du poids des obus. Ainsi, comme l’a décrit Marcelle Capy, journaliste féministe qui a travaillé dans les usines d’armement anonymement entre et publiée dans le journal La Voix des Femmes : « L'ouvrière, toujours debout, saisit l'obus, le porte sur l'appareil dont elle soulève la partie supérieure. L'engin en place, elle abaisse cette partie, vérifie les dimensions (c'est le but de l'opération), relève la cloche, prend l'obus et le dépose à gauche. Chaque obus pèse 7 kg. En temps de production normale, 2 500 obus passent en 11 heures entre ses mains. Comme elle doit soulever deux fois chaque engin, elle soupèse en un jour 35 000 kg. Au bout de ¾ d'heures, je me suis avouée vaincue. J'ai vu ma compagne toute frêle, toute jeune, toute gentille dans son grand tablier noir, poursuivre sa besogne. Elle est à la cloche depuis un an. 900 000 obus sont passés entre ses doigts. Elle a donc soulevé un fardeau de 7 millions de kilos. Arrivée fraiche et forte à l'usine, elle a perdu ses belles couleurs et n'est plus qu'une mince fillette épuisée. Je la regarde avec stupeur et ces mots résonnent dans ma tête : 35 000 kg »4,5.
Les munitionnettes travaillent debout, par périodes de 10 h à 14 h, de jour comme de nuit et tous les jours de la semaine, les réglementations du travail ayant été suspendues pour pouvoir participer à l’effort de guerre6. Le diminutif « -ette » de munitionnette minimise cependant la dureté de leur travail car, en France, les femmes ont été appelées dans les usines d’armement en dernier recours, après les civils, les hommes réformés et les « coloniaux »6. À la fin de la Première Guerre mondiale, la France compte 420 000 femmes dans les usines d’armement, contre plus d’un million au Royaume-Uni.
Le salaire
Le poste de munitionnette est le mieux payé de tous à l’époque, notamment dû à la pénibilité du travail et aux réels risques qu’engendre la manipulation des bombes. Elles sont toutefois moins bien payées que les hommes (50 % de moins en 1913 et 20 % de moins en 19177), pour le même travail. Ce salaire, plus élevé que celui d’une midinette (couturière) par exemple, était même à l’origine d’une rumeur qui disait que les munitionnettes souhaitaient une guerre longue8.
Les risques
Malgré le fait d’être bien rémunéré, la fabrication des munitions n’est pas seulement une activité pénible : il y avait de réels risques pour les employés des usines d’armement.
Tout d’abord, les armes qui sont fabriquées sont elles-mêmes un danger. La moindre étincelle pouvait faire exploser l’usine entière. Tout objet métallique était donc interdit dans l’usine : clous des chaussures à talons, épingles à cheveux, agrafes de vêtements etc.9 Les accidents de travail sont fréquents dans les usines d’armement ; l’usine de Chillwell (en) a d’ailleurs été détruite le lors d’une explosion de huit tonnes de TNT (trinitrotoluène) et a causé la mort de 134 personnes et blessé quelque 250 autres.
L’autre danger du TNT pèse sur la santé des ouvriers. En effet, il s’agit d’un produit toxique, qui rend la peau et les cheveux jaunes. Les munitionnettes britanniques étaient d’ailleurs surnommées les « canaris »10. Ce n’est cependant pas les seuls dommages que crée le TNT : les premiers signes d’une intoxication sont le rhume, le nez bouché, la toux et des maux de têtes. Enfin, une exposition prolongée au TNT atteint principalement le système sanguin et les reins et peut provoquer la stérilité.
Les munitionnettes après la Première Guerre mondiale
La fin de la Grande guerre
Les femmes ont donc participé tout au long de la Première Guerre mondiale à l’effort de guerre. Une fois l’Armistice signée en 1918, les hommes rentrent chez eux. Et les femmes rentrent chez elles.
La Grande guerre a donc permis de démocratiser le travail des femmes. La main d’œuvre d’avant 1914 était en effet déjà composée de 7 à 10 % de femmes alors qu’à la fin de la guerre, un travailleur sur quatre était de sexe féminin6.
Le travail des femmes pendant la Première Guerre mondiale n’a cependant pas toujours été vu de façon positive. En effet, la plupart des poilus revenus du front « accusaient les femmes d’avoir profité et d’avoir fait la vie » pendant leur absence11.
Enfin, notons qu’au Royaume-Uni, les femmes ont été récompensées de leur effort de guerre par le Representation of the People Act, une loi accordant le droit de vote des femmes âgées d’au moins 30 ans. Cet âge sera abaissé à 21 ans, la majorité de l’époque, en 1928. En France, il faudra attendre le pour acquérir ce droit.
La Seconde Guerre mondiale
À la fabrique de munitions John Inglis Co. de
Toronto, les ouvrières Agnes Apostle de Dauphin (Manitoba) et Joyce Horne de Toronto (Ontario) effectuent un dernier assemblage d'un pistolet semi-automatique de 9
mm pour expédition en Chine.
On a de nouveau fait appel aux femmes lors de la Seconde Guerre mondiale au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada notamment. Elles sont d’ailleurs plus de 6 millions de femmes américaines à travailler dans l’industrie militaire7.
Au Canada, les femmes constituaient le quart de la main d’œuvre dans les usines d’armement12. La chaîne Global TV diffuse d’ailleurs depuis la série Bomb Girls (Des femmes et des bombes), retraçant la vie de quatre femmes canadiennes dans une usine d’armement.
L’héritage des munitionnettes
Les munitionnettes et les autres femmes participant à l’effort de guerre sont aujourd’hui le symbole du début de l’émancipation féminine, mais aussi de l’indispensabilité de leur travail pour la Nation. Ces femmes ont découvert un sentiment d’indépendance financière et d’utilité au sein du monde du travail. Ces femmes sont aujourd’hui encore considérées comme étant à l’origine du féminisme.
Au Royaume-Uni, le Representation of the People Act 1918 accorde le droit de vote aux femmes de plus de trente ans. Ironiquement, et bien que nombre de parlementaires justifient leur revirement sur la question du suffrage féminin par le travail des munitionnettes, la majorité de celles-ci n'obtiennent pas le droit de vote : le suffrage reste censitaire pour les femmes, bien qu'il devienne universel pour les hommes.
En France où il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale pour que les femmes obtiennent le droit de vote.
Il existe aujourd’hui, à Rennes, une rue des Munitionnettes, en hommage aux munitionnettes qui ont arrêté le travail trois jours durant en 1917 pour réclamer le retour de leurs maris. Il existe aussi une rue à Toulouse.
Notes et références
- On trouve aussi parfois le terme obusette.
- L’émancipation des femmes – le rôle économique, 2011 [archive]
- Centre National de Documentation Pédagogique, Pour mémoire – l’armistice du 11 novembre 1918, 2011 [archive]
- Pierre Darnon, Vivre à Paris pendant la Grande Guerre, Hachette Littérature, 2004, extrait en ligne [archive].
- Évelyne Morin-Rotureau, « Avant-propos », dans Combats de femmes 1914-1918, Autrement, (DOI 10.3917/autre.morin.2004.01.0005, lire en ligne [archive]), p. 5–13
- Michelle Zancarini-Fournel « Travailler pour la patrie ? », Combats de femmes 1914-1918, Autrement, 2004, p. 32-45 [archive]
- L’émancipation des femmes – le rôle économique [archive]
- L’impact de la guerre sur les femmes [archive]
- Sky, The British, épisode 7, 2012 [archive]
- BBC, 1914-1918 What If… Total War, épisode 3/7, 1996 [archive]
- Jean-Yves Le Naour, « Il faut sauver notre pantalon ». La Première Guerre mondiale et le sentiment masculin d’inversion du rapport de domination », Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, 84 | 2001, 33-44 [archive]
Bibliographie
- Marie Gatard et Fabienne Mercier-Bernadet., Combats de femmes, d'une guerre à l'autre, Sceaux, Esprit des livres, coll. « Images d'histoire », , 333 p. (ISBN 978-2-915-96032-7, OCLC 610948530).
- Mathilde Dubesset, François Thébaud, Catherine Vincent, « Les munitionnettes de la Seine », 1914-1918 : L'autre front, cahier du Mouvement Social no 2, Paris, Les éditions ouvrières, 1977, p. 189-219.
Annexes
Articles connexes
Lien externe
Sur les autres projets Wikimedia :
Mitrailleuse
La mitrailleuse est une arme automatique, chambrée pour une munition de calibre inférieur à 20 millimètres, les armes similaires de calibre supérieur étant généralement appelées "canons automatiques" ou "mitrailleurs"1. Elle permet d'offrir une puissance de feu maximale par une capacité au tir en rafales soutenue, ainsi qu'une portée pratique supérieure à celle d'une arme individuelle. Son apparition est souvent considérée comme l'un des éléments majeurs marquant l'entrée de la guerre dans l'ère industrielle.
Elle est à distinguer du fusil-mitrailleur, plus léger, pouvant s’épauler et dépourvu de support fixe2.
Apparition et évolution
Dès le XIVe siècle, de nombreux inventeurs tentèrent de créer une arme de défense tirant à haute cadence des projectiles légers. Léonard de Vinci en dessina une mais aucune réalisation concrète ne semble avoir suivi, vraisemblablement faute de moyens techniques. La défense à courte portée contre l'infanterie est par la suite assurée par certaines pièces d'artillerie qui tirent, dans ces phases d'action, des projectiles multiples dits biscayens ou boîtes à mitraille, dont les effets sur les organismes vivants sont terribles. Mais la mobilité limitée de l'artillerie, surtout à cette époque, en réduit l'intérêt tactique, malgré l'emploi très audacieux des Français lors des guerres de la Révolution et de l'Empire, qui réussirent de véritables charges d'artillerie. Le besoin de grande puissance de feu antipersonnel mobile n'est comblé qu'en partie et la portée comme la précision de la mitraille laissent trop à désirer.
Premières versions utilisables
En 1708, on rapporta de Constantinople qu'un officier français avait inventé un canon très léger qui pouvait tirer d'un seul canon 30 coups en 2 minutes et demie pour une cadence de tir totale de 12 coups par minute4,5.
En 1711, un avocat français présente au parlement de Dijon une 'machine de guerre' composée de 10 canons de carabines capables de tirer en salves. On disait qu'il était précis à 400 à 500 pas et qu'il frappait avec suffisamment de force pour percer 2 ou 3 hommes à la fois lorsqu'il était proche. Il a également été affirmé qu'il était capable de tirer 5 ou 6 fois avant que l'infanterie n'arrive à portée de mousquet ou la cavalerie à portée de pistolet et sans plus d'espace entre chaque tir que le temps nécessaire pour amorcer un pistolet, l'armer et relâcher le marteau tout en étant également aussi maniable que la cavalerie. Une version alternative et plus lourde serait capable de lancer des grenades et il a également été proposé d'équiper la machine d'un soufflet pour évacuer la fumée qui s'est accumulée lors du tir.6,5.
En 1718, James Puckle dépose un brevet protégeant un canon de défense. Cette pièce au calibre d'environ trois centimètres, longue de près d'un mètre emploie des barillets préchargés à onze chambres et tire soixante-trois coups en sept minutes, soit trois fois plus vite que le mousquet d'un très bon fantassin. Destinée à offrir aux bâtiments de guerre un moyen de lutte contre les abordages, l'arme n'est cependant jamais réellement déployée ni même employée7.
En 1720, un inventeur français appelé Philippe Vayringe a inventé un petit canon qui pouvait tirer 16 coups de suite qu'il a démontré devant le duc de Lorraine8.
En 1740, le Français Chevalier de Benac a inventé un canon qui pouvait tirer 11 fois par minute9.
En 1764, le Français Ange Goudar écrivit dans son ouvrage L'espion chinois qu'il avait assisté à Paris à la mise à l'épreuve d'un 'grand canon' capable de tirer 60 fois en une minute10.
En 1775, un Français du nom de Du Perron a inventé un canon à orgue, le 'orgue militaire', qui utilisait plusieurs pièces de culasse, semblable à la mitrailleuse Reffye plus tardive, et était capable de décharger 24 barils 10 fois par minute pour 240 coups par minute11.
En 1790, un ancien officier de l'armée française connu sous le nom de Joseph-François-Louis Grobert inventa une 'machine balistique' ou 'machine pyrobalistique' actionnée par 4 hommes et un mouvement de rotation continu capable de tirer 360 coups de fusil par minute12,13.
En 1792, un artiste français connu sous le nom de Renard a inventé une pièce d'artillerie qui pouvait être actionnée par un seul homme et tirait 90 coups par minute14,15.
Toujours en 1792, un mécanicien français appelé Garnier a inventé une batterie de mousquets composée de 15 canons capables de tirer 300 coups en 2 minutes pour une cadence de tir totale de 150 coups par minute ou 10 coups par minute par canon et d'être actionné par un seul homme16.
En 1831, un mécanicien du département des Vosges a inventé un canon à levier capable de tirer 100 coups par minute17,18.
En 1832, un mécanicien français du nom de Hamel a conçu une machine capable de tirer 500 coups de fusil par minute19.
Dans les années 1830, un Suisse, Steuble, conçut une mitrailleuse et tenta de la vendre aux gouvernements anglais, russe et français. La mitrailleuse utilisait une trémie, était chargée par la culasse et consistait en plusieurs barils20,21.
En France et en Grande-Bretagne, une mitrailleuse à commande mécanique a été brevetée en 1856 par le Français François Julien. Cette arme était un canon alimenté à partir d'un type de chargeur tubulaire à extrémité ouverte, utilisant uniquement des rouleaux et une chaîne sans fin à la place de ressorts22.
Gatling
L'idée reste en sommeil jusqu'en 1862. Richard Jordan Gatling dépose alors un nouveau brevet protégeant une arme fondée sur le principe de cinq à dix canons rotatifs, ce qui permet de paralléliser les opérations nécessaires au tir et d'augmenter le temps de refroidissement sans réduire la cadence. La mitrailleuse Gatling n'est pas autonome car son servant doit tourner une manivelle afin de fournir l'énergie grâce à laquelle l'arme chambre les cartouches, les percute, extrait les étuis vides puis les éjecte. De surcroît les cartouches en papier limitent sa fiabilité.
Vue de la culasse de la mitrailleuse De Reffye au musée militaire vaudois, 1110 Morges (Canton de Vaud - Suisse).
Vue de la mitrailleuse De Reffye au musée militaire vaudois, 1110 Morges (Canton de Vaud - Suisse).
Achetée en 1865 par l'US Army, elle sera l'année suivante modifiée pour employer des cartouches à étuis métalliques, ce qui l'améliorera beaucoup. En revanche, elle conservera la taille d'un petit canon et son caisson d'approvisionnement en munitions grèvera longtemps sa fiabilité et connaitra plusieurs versions. Considérée comme une pièce d'artillerie, elle sera déployée loin des mouvements de l'infanterie. Cela limita son effet sur le plan tactique à celui d'un canon tirant de la mitraille.
Mitrailleuse de Reffye
De l'autre côté de l'Atlantique une arme belge, la mitrailleuse Montigny, est adoptée sous une forme modifiée par l'armée française qui l'utilise comme une pièce d'artillerie. Elle sera connue en France sous le nom de "canon à balles" ou de "mitrailleuse De Reffye" du nom du général Verchère de Reffye, officier responsable de sa fabrication aux ateliers de Tarbes et de Meudon. Son fonctionnement est simple car ses vingt-cinq canons sont chargés en une seule passe grâce à des blocs culasse amovibles. Les vingt-cinq cartouches de 13 mm à percussion centrale, à corps en carton et culot en laiton, sont mises à feu en courtes rafales très rapides. Les résultats pouvaient être spectaculaires comme à Saint-Privat où une batterie de six mitrailleuses put mettre à terre cinq cents chevaux en 90 secondes. Néanmoins son emploi par la seule artillerie et donc à trop grande distance des troupes adverses limite son efficacité pendant la guerre franco-prussienne de 1870. De surcroît, leur faible nombre engagé (190 pièces) n'est pas comparable à la très efficace et très nombreuse artillerie prussienne qui domine.
Au Royaume-Uni, en 1870, les autorités britanniques, impressionnées par les performances du canon de Gatling, demandent à WG Armstrong and Co. d'en obtenir la licence de production locale. L'arme est déclinée en deux versions, l'une de calibre .45 (45 centièmes de pouce, donc 11,43 millimètres) pour l'Armée de terre, l'autre en .65 (65 centièmes de pouce, donc 16,51 mm) pour la Royal Navy (marine). Lors de l'une de ses premières utilisations, lors de la bataille d'Ulundi, une unité débarquée de la Royal Navy l'opposa avec succès aux Zoulous. La cartouche cède ensuite la place à une version plus moderne entièrement métallique, supprimant ainsi bon nombre d'enrayages et autres incidents de tir. La cadence de tir atteint alors environ trois cents coups par minute.
Mitrailleuses modernisées
Les canons de type Nordenfeldt et Gardner, deux armes contemporaines d'architecture Gatling et de fort calibre, respectivement dix ou douze et comptant un ou deux canons, s'imposent dans les années 1880 dans les marines afin de lutter contre les petits torpilleurs. Le Gardner tire dix mille coups en un peu moins d'une demi-heure.
Maxim et descendance
L'Américain Hiram Maxim, résidant en Angleterre, va créer alors la première mitrailleuse réellement automatique. Elle utilise l'énergie du recul consécutive au tir pour éjecter l'étui et chambrer une nouvelle munition. L'arme tire alors tant que la détente n'est pas relâchée par le servant, qu'aucun incident ne survient et que des munitions sont disponibles. Après une démonstration en 1885, l'armée britannique en achète plusieurs exemplaires en 1889. D'autres nations européennes, comme l'Allemagne, la Russie, l'Autriche-Hongrie en achètent ensuite. L'arme prouve son efficacité lors de plusieurs batailles coloniales, comme en 1893 en Afrique du Sud, lorsque cinquante soldats et quatre Maxims tiennent en respect cinq mille guerriers Matabele.
Les états-majors européens ne lui ménagent a priori guère d'avenir car ils la considèrent comme trop peu fiable (ce qui n'est à ce moment pas abusif car l'alimentation, en particulier, cause encore souvent des enrayages) et redoutent sa consommation de munitions. Cette dernière est pourtant la condition de sa cadence de tir de cinq cents coups par minute, puissance de feu équivalente à celle de cent fusils, qui invite certains à ne pas la négliger. L'idée fait donc peu à peu son chemin et deux nations réaliseront des dérivés de la Maxim, l'Allemagne avec son Maschinengewehr M1908, et la Russie avec sa Pulemyot Maxima PM1910.
Un Autrichien nommé Adolf Odkolek (de) conçoit en 1895 une mitrailleuse à emprunt de gaz dont le brevet est acquis par la firme de Benjamin Berkeley Hotchkiss située à Saint-Denis près de Paris. Elle est essayée par l'armée française en 1897 après des modifications apportées chez Hotchkiss par Lawrence Benet et Henri Mercier. À partir de 1897, l'armée française continue l'expérimentation puis passe à l'adoption partielle en 1900 ; elle ne l'achètera cependant en très grandes quantités qu'à partir de 1916. La mitrailleuse Hotchkiss modèle 1914 finira par complètement remplacer le modèle national (la Saint-Étienne modèle 1907) dont le mécanisme compliqué et peu fiable est inversé afin de contourner le brevet Hotchkiss.
Une mitrailleuse britannique Vickers pendant le premier conflit mondial.
Au début du XXe siècle l'infanterie commença à l'employer en créant, au sein de ses régiments, des compagnies de mitrailleuses qui remplaçaient le plus gros de l'artillerie régimentaire. L'importance tactique de la mitrailleuse ainsi rapprochée de la ligne de front devient dès lors prépondérante. Les modèles de cette époque sont plus légers et manœuvrables que leur ancêtres du XIXe siècle mais restent des armes à vocation défensive donc plutôt statiques. Établies sur des trépieds ou de petits affûts à deux roues, elles ne sont pas capables de suivre à mesure tous les mouvements de l'infanterie et impliquent encore un délai de mise en batterie non négligeable. De plus, l'accent alors mis sur la permanence du tir conduit à des modèles encombrants et pesants car souvent dotés d'un système de refroidissement liquide du canon, donc d'un radiateur et d'un réservoir.
Durant la Première Guerre mondiale, l'armée belge utilisa la pratique locale des charrettes de laitiers tirées par des chiens attachés sous la charrette. Elle y installa ses mitrailleuses, résolvant ainsi le problème du déplacement rapide de ces armes, toujours montées sur leur trépied et prêtes pour le tir, alors que celles de l'ennemi étaient portées à dos d'humains et en deux à trois parties qu'il fallait réassembler après chaque mouvement. C'est avec l'aide de ce dispositif que fut conclue la bataille de Halen contre l'armée allemande, d'abord gagnée par un combat de cavalerie puis parachevée quand les mitrailleuses belges déplacées rapidement d'un point à l'autre du champ de bataille, multiplièrent les interventions, trompant l'État-major allemand sur la puissance de feu des Belges.
C'est d'ailleurs en 1914 que l'apparition des mitrailleuses modifie complètement le déroulement des opérations militaires, car cette arme rend difficile, voire impossible, de se déplacer à découvert à sa portée. Paul Valéry décrit ainsi en 1931 l'action de l'engin : « Quatre hommes résolus tiennent mille hommes en respect, couchent morts ou vifs tous ceux qui se montrent. On arrive à la conclusion surprenante que la puissance de l'arme, son rendement, augmente comme le nombre même de ses adversaires. Plus il y en a, plus elle tue. C'est pourquoi elle a eu raison du mouvement, elle a enterré le combat, embarrassé la manœuvre, paralysé en quelque sorte toute stratégie » (Variété IV). Son usage pendant la Première Guerre mondiale participa à l'enlisement de la guerre des tranchées. Les Allemands disposaient leurs mitrailleuses par paire, une de chaque côté de la tranchée à défendre et visant une zone proche du milieu de cette tranchée. Ce tir croisé par le côté provoquait un mur de balles très efficace contre les assauts d'infanterie en lignes, et se révéla plus efficace que le tir de face.
Fusil-mitrailleur ou mitrailleuse légère
Le fusil-mitrailleur type 96 japonais.
Vers la fin de la Première Guerre mondiale, le fait d'accompagner les déplacements de l'infanterie grâce à des mitrailleuses était acquis. De nouvelles armes plus légères donc au déploiement plus rapide, furent conçues à cet effet. Mises en batterie sur un bipied et guère plus encombrantes que le fusil, elles utilisent uniquement le refroidissement par air et souvent des magasins plutôt qu'une alimentation par bandes de cartouches, ce qui limite leur capacité à tirer en continu mais les allège.
Ces nouvelles mitrailleuses, appelées "fusils-mitrailleurs" ou "mitrailleuses légères", sont des adaptations d'armes existantes, comme la Maxim 08/15 allemande, ou des armes nouvellement créées comme le Lewis Mark I britannique ou le Chauchat français et encore, en 1917, le Browning Automatic Rifle (dit "BAR") et le fusil automatique Huot (canadien). Après la guerre, ce type d'arme connaît un grand développement dans tous les pays, qui donne par exemple naissance au BREN, au Mac 24/29 et au Degtiarev DP 28. Il devient l'arme autour de laquelle s'organise le groupe de combat d'infanterie dont il constitue l'élément feu. Le BAR servira, après plusieurs évolutions accusant son caractère de FM, jusqu'à la fin du conflit mondial suivant et on le verra encore en action, quoique de plus en plus rarement dans les armées régulières, au début des années 1980.
Bien que souvent remplacé par des mitrailleuses polyvalentes, le fusil-mitrailleur continue à être utilisé de nos jours, principalement du fait de son faible coût. On le distingue de la mitrailleuse légère par l'absence de système de changement rapide de canon. Il s'agit souvent d'une version du fusil d'assaut réglementaire, avec un canon plus lourd pour retarder l'échauffement et plus long pour augmenter la portée, ils sont munis aussi d'un bipied pour stabiliser le tir et de magasins de plus grande capacité pour accroître la cadence pratique de tir. De bons exemples de ce type d'arme sont le Kalachnikov RPK soviétique (dérivé de l'AKM-59) et le LSW L86A1 britannique (dérivé du SA80).
Mitrailleuse lourde
Mitrailleuse Browning M2 cal. 12,7
mm sur son trépied M3.
La diversification des emplois de la mitrailleuse mena à des modèles lourds tirant des munitions plus puissantes que celle du fusil d'infanterie, afin d'équiper divers véhicules, en particulier des avions. Juste après la Première Guerre mondiale, John Browning réalise sa M2, utilisant une munition de 12,7 x 99 mm initialement destinée à un usage antiaérien mais aussi suffisamment puissante pour détruire les blindés de l'époque. Cette arme devient l'archétype de la mitrailleuse lourde et connaitra un très grand succès car elle est encore en service de nos jours. Déployées en grand nombre par les Alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale, elles constitueront pour ceux-ci un avantage certain face aux Allemands qui eux ont préféré pour leurs blindés légers des calibres supérieurs comme le 20 mm, certes efficaces, mais beaucoup moins « économiques ».
D'autres nations créent des modèles équivalents, souvent chambrés pour des munitions plus puissantes. Les Britanniques adoptent la Besa tchécoslovaque de 15 x 104 mm, les Italiens et les Japonais, une cartouche de 13,2 x 99 mm, initialement conçue par Hotchkiss en France, qui sera connue par la suite comme 13,2 Breda. Ils utilisent conjointement une 12,7 x 81 mm, conçue par Vickers au Royaume-Uni, la 12,7 Breda. Les Américains emploieront beaucoup la mitrailleuse lourde. L'URSS créa quant à elle, dans les années trente, deux munitions très puissantes : la 12,7 x 108 mm, qui équipera les mitrailleuses Degtiarev et la 14,5 x 114 mm, tout d'abord destinée au fusil antichars mais qui sera en définitive celle d'une mitrailleuse mise au point à la fin des années 1940 par l'ingénieur Vladimirov nommée « KPV », rendue très efficace contre les avions et les blindés légers par l’énergie cinétique très importante du projectile (env. 22 000 J, la 12,7 x 99 mm en dissipant environ 12 000).
Mitrailleuse polyvalente contemporaine
La MG-34 sur bipied et trépied pour le tir en position.
À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, dans l'infanterie, deux types de mitrailleuses cohabitent donc, la légère sur bipied, destinée à suivre les attaques et la moyenne sur trépied, qu'on utilise par la suite pour défendre les positions acquises. L'une est facile à transporter mais son système d'approvisionnement et l'échauffement de son canon la rendent incapable de maintenir un tir soutenu, l'autre est trop peu mobile. L'armée allemande a, plus que toute autre, compris l'intérêt d'une utilisation polyvalente de cette arme et elle va développer une arme révolutionnaire : la MG34. Le problème de l'échauffement du canon est résolu comme sur les mitrailleuses lourdes, par un dispositif permettant l'échange rapide du canon ; l'alimentation par bandes métalliques est empruntée aux mitrailleuses classiques, même si ces dernières sont emportées dans des tambours. L'arme peut être déployée soit sur bipied, soit sur trépied ; si elle est légèrement plus encombrante qu'un fusil-mitrailleur, elle reste employable par un binôme au sein d'un groupe de combat : la mitrailleuse moderne est née. La MG42 perfectionne le concept en améliorant la cadence de tir et la légèreté et en apportant surtout une simplification de la fabrication.
La M249 : version américaine de la FN Minimi en calibre 5,56
mm OTAN.
Par la suite, les autres armées s'équipent d'armes de conception similaire, comme la mitrailleuse Kalachnikov soviétique, l'arme automatique modèle 1952 française ou la Saco M60 américaine. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les mitrailleuses ont peu évolué, bon nombre d'armées sont toujours équipées d'armes directement inspirées des modèles allemands conçus dès 1935. Les mitrailleuses modernes ont des caractéristiques communes : l'emploi de canons interchangeables, l'alimentation par bande de cartouches et une équipe de servants, de deux à cinq humains, emportant l'arme, les munitions, les canons de rechange et éventuellement un trépied. Le principal changement est assez récent et concerne l'emploi de munition plus légère comme le 5,56 mm OTAN comme dans l'exemple de la FN Minimi belge, ce qui maximise l'emport de munitions et permet la standardisation sur un calibre unique pour l'infanterie. Les calibres comme le 7,62 OTAN semblent en perte de vitesse, la tendance semblant être d'utiliser le 5,56 uniquement pour les armes légères ; et de laisser le traitement à longue portée des objectifs non protégés à des armes plus lourdes comme les mitrailleuses lourdes et les canons mitrailleurs sur véhicules ou les lance-grenades automatiques de 30 et 40 mm.
Véhicules
Utilisation aérienne
Un Morane Saulnier avec une mitrailleuse et les plaques déflectrices sur l'hélice.
Au cours de la Première Guerre mondiale l'emploi de la mitrailleuse se diversifie et on commence à en monter sur des avions. Le combat aérien naît, au début de la Première Guerre mondiale, de la frustration des équipages d'avions de reconnaissance croisant l'ennemi dans les airs sans pouvoir le combattre. Des expédients sont tout d'abord employés, y compris des armes de poing et d'épaule, voire des grappins. Très rapidement des Allemands utilisent la puissante mitrailleuse qui fait des ravages au sol et le deuxième homme d'équipage, dit « observateur », devient aussi « mitrailleur » après montage d'un tourelleau et d'une mitrailleuse. Le tir vers l'avant est cependant alors rendu impossible par la présence de l'hélice (sauf sur les quelques avions à hélice propulsive), ce qui interdit le tir en poursuite et l'emploi de monoplaces pourtant plus performants. Le Français Roland Garros conçoit le premier un système surmontant cette difficulté après avoir tiré au revolver à travers un ventilateur puis constaté que peu de projectiles touchèrent les pales. Il monte une mitrailleuse sur son capot moteur et place sur l'hélice de petites pièces métalliques déviant les rares balles qui risqueraient de l'endommager. Après sa capture et son interrogatoire l'idée est reprise par Anthony Fokker qui décide de l'améliorer en concevant un ensemble mécanique bloquant le tir lorsqu'une pale de l'hélice se trouve devant le canon de la mitrailleuse. La synchronisation du tir de la mitrailleuse à travers les hélices est née, et avec elle l'avion de chasse.
D'autres systèmes sont testés, en particulier une mitrailleuse placée sur l'aile supérieure tirant vers l'avant au-dessus du plan de rotation de l'hélice, comme sur le Nieuport 11. Mais les systèmes à synchronisation, bien que plus lourds et complexes, se révèlent supérieurs car, placés au plus près de l'axe de vol, facilitent la visée. On observera aussi des systèmes de tir à travers l'axe de l'hélice, creux ; cependant, outre sa complexité, un tel système ne peut concerner qu'une seule arme. Le nombre de mitrailleuses montées sur chaque appareil augmente rapidement, atteignant quatre.
Rechargement de mitrailleuse d'aile sur un P-47.
L'évolution ralentit dès la fin du conflit et ce n'est qu'au début des années trente que des mitrailleuses sont parfois montées à l'intérieur des ailes, dont l'épaisseur a depuis augmenté. Le nombre d'armes intégrées dans chaque appareil augmente encore (le Hawker Hurricane intégrera douze mitrailleuses de 7,7 mm). À l'orée de la Seconde Guerre mondiale, les armes utilisant les munitions de fusils deviennent insuffisantes car la construction métallique et les plaques de blindage protégeant le pilote et les organes essentiels des avions, les rendent beaucoup plus robustes que ceux du premier conflit mondial. L'utilisation de vannes auto-obturantes réduit par ailleurs les risques d'incendies consécutifs à un endommagement de réservoir.
Les mitrailleuses lourdes (en particulier la Browning de 12,7 mm et ses équivalentes) commencent à supplanter les modèles plus légers et la plupart des pays se tournent peu à peu vers le canon-mitrailleur dont les effets sont plus dévastateurs, notamment sur les bombardiers lourds. Les mitrailleuses sont néanmoins conservées car leur cadence de tir plus élevée (certains modèles tirent plus de mille deux cents coups par minute) augmente le nombre d'impacts durant des fenêtres de tir de plus en plus courtes. Les États-Unis choisiront même de les adopter exclusivement, délaissant presque les canons. Cette décision réduisit le nombre de types de munitions en dotation donc facilita la logistique.
Par ailleurs, le déclenchement de tir par commande électrique ou pneumatique interposée simplifia la coordination d'armes multiples et la synchronisation avec l'hélice. Les systèmes pneumatiques seront toutefois rapidement abandonnés car ils induisent une latence préjudiciable lors des combats durant lesquels la durée d'une passe de tir ne dépasse guère une seconde. La commande électrique devient elle-même moins intéressante dès 1944, avec l'apparition d'appareils à réaction qui volaient sans hélice, ainsi que par le montage dans les ailes.
La mitrailleuse armera les avions d'assaut (jusqu'à 14 sur certains modèles de B-26 "Marauder") et défendra les avions de bombardement et de reconnaissance face aux chasseurs, le léger tourelleau installé à l'arrière cédant progressivement sa place à des tourelles de plus en plus sophistiquées. Les plus lourdes doivent bientôt être assistées électriquement ou hydrauliquement, pour être pointées assez rapidement sur des chasseurs de plus en plus rapides. Pendant la Seconde Guerre mondiale ces systèmes défensifs très complets couvrent toute la périphérie de l'avion, en particulier sur la « forteresse volante » B-17. Après la guerre la télécommande se généralise car l'équipage utilise les armes à partir de compartiments pressurisés rendus nécessaires par les nouvelles altitudes de combat. Les équipements de conduite de tir assistées par radar rendent ensuite ces armes efficaces à des distances importantes, augmentant l'intérêt du canon dont la portée est supérieure, lequel finit même par remplacer la mitrailleuse lourde.
Par la suite le développement du missile air-air, en offrant le moyen à des appareils légers et rapides d'attaquer à distance de sécurité (hors de portée des canons de défense) relègue tout cela au profit des contre-mesures électroniques et de la furtivité.
Les États-Unis préféreront la mitrailleuse jusqu'à la guerre de Corée, dont la fin marque la disparition presque totale en tant qu'arme embarquée anti-aérienne au profit du canon. Seuls des appareils légers de lutte contre la guérilla, ainsi que des hélicoptères emploient à présent des mitrailleuses, dans de nombreux cas de type Gatling afin de disposer de la cadence élevée rendue possible par leurs canons et mécanismes multiples ainsi qu'afin de tolérer les ratés de percussion. Ainsi ils ne stoppent pas le tir puisque le moteur extrait puis éjecte en ce cas la munition dont l'amorce est défectueuse puis chambre la suivante, tandis qu'une arme employant l'énergie de la munition se trouve alors hors d'état de tirer sans réarmement de son mécanisme.
Char d'assaut
La version coaxiale de la mitrailleuse soviétique, Poulemiot Kalachnikov.
Lorsque le char d'assaut apparaît, la mitrailleuse devient l'une de ses armes essentielles, lui permettant de s'en prendre efficacement à l'infanterie donc de s'en protéger. Si le canon devient par la suite son arme principale, les chars embarquent encore souvent au moins une mitrailleuse pour se protéger de l'infanterie.
Ces armes y sont placées diversement, on trouve des mitrailleuses coaxiales de l'arme principale donc utilisant sa conduite de tir. Celle-ci permettait d'améliorer les succès du tir au canon. La justesse du pointage pouvait ainsi être testée par un premier tir à la mitrailleuse qui, s'il était réussi, permettait de tirer au canon en sachant que le pointage était bon. Cette méthode est devenue obsolète avec l'avènement de systèmes de conduite de tir de plus en plus sophistiqués permettant des distances de tir de plus en plus longues depuis des véhicules en mouvement avec des temps de pointage de plus en plus brefs. La mitrailleuse coaxiale permet également de « traiter » rapidement des objectifs dits « mous » (« non blindés »).
Les mitrailleuses de glacis, qui permettent de balayer l'avant du véhicule pour la défense rapprochée, restèrent très répandues jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La mitrailleuse antiaérienne, située sur le dessus de la tourelle, se révéla utile dès la guerre civile espagnole lors des combats dans les milieux boisés ou urbains, en couvrant l'ensemble du véhicule à partir d'un point en hauteur, son inconvénient principal qui était la vulnérabilité du servant, est maintenant souvent résolu par un usage télécommandé, gardant l'utilisateur sous un blindage. D'autres points de montage tels que des tourelles secondaires (très en vogue dès les années 1920) ou bien à l'arrière de la tourelle principale (chars soviétiques), sont aujourd'hui abandonnés.
Autres
Mitrailleuses jumelées M2 cal. 12,7
mm sur un patrouilleur de l'US Navy.
Outre les chars de combat, les mitrailleuses équipent de nombreux véhicules terrestres, dont un lui doit sa naissance même : l'automitrailleuse. Au début de la Première Guerre mondiale en 1914, des Belges propriétaires d'automobiles se portèrent volontaires pour équiper leurs voitures de mitrailleuses en protégeant leurs véhicules de plaques métalliques : c'est la création empirique de l'auto blindée. Dans la suite, les armées s'équiperont d'autos blindées construites spécialement. Certaines seront équipées de canons automatiques ou non, comme les auto canons des régiments belges et anglais envoyés en Russie en 1917. La mitrailleuse reste l'arme principale caractéristique de l'auto blindée, et toute auto blindée emporte au moins une mitrailleuse dans la plupart des cas. Quasiment tous les blindés de transport d'infanterie en emportent une ou plusieurs afin d'assurer leur défense rapprochée et parfois appuyer les troupes durant un assaut. On trouve aussi souvent des affûts chandelier sur les voitures tout-terrain du type Jeep servant à l'éclairage ou aux liaisons. Après la Seconde Guerre mondiale de nombreux camions furent aussi dotés d'une mitrailleuse en tourelleau pour leur autodéfense. Pour soutenir les compagnies motocyclistes, très prisées dans les années 1940, de nombreux side-car furent armés de mitrailleuses légères. Pendant la Première Guerre mondiale on avait installé des mitrailleuses sur une plateforme placée entre deux vélos au sein des compagnies cyclistes.
En Ukraine lors de la guerre civile russe, une mitrailleuse fut installée à l'arrière de tatchankas, voitures rapides typiques du pays, tirées par deux chevaux. Les partisans de Nestor Makhno en particulier appréciaient ce moyen de monter une embuscade, suivie d'une fuite rapide, voire d'un raid sur les flancs des colonnes adverses. Bien que souvent improvisées, ces actions constituèrent une réelle menace pour tous les camps.
Dans le domaine naval, la mitrailleuse est surtout utilisée sur les petites unités comme les patrouilleurs rapides et autres vedettes fluviales et côtières. Les patrouilleurs fluviaux eurent souvent de l'importance lors de guerres comme celle du Viêt Nam où, dotés principalement de mitrailleuses, ils harcelaient les objectifs sur les rives et contrôlaient la navigation. Une autre utilisation, qui tient plus des fonctions de police, est l'implantation de mitrailleuses lourdes sur les grands navires de patrouille et de surveillance de la pêche, où elles servent surtout à l'arraisonnement, de facteur de dissuasion, ainsi qu'aux tirs de semonce. Elles sont parfois aussi utilisées pour détruire des mines après dragage.
Utilisation antiaérienne
Les premières utilisations de mitrailleuses pour la défense contre les avions datent de la Première Guerre mondiale. Les affûts des armes de l'infanterie furent modifiés ou placés de façon à pouvoir mitrailler les avions survolant les tranchées. Par la suite, des mitrailleuses montées sur divers véhicules eurent souvent une fonction antiaérienne secondaire et de nombreux affûts spécialisés furent créés pour défendre des positions fixes ou mobiles contre ce danger. Les plus simples sont une simple tige plantée dans le sol sur lequel une mitrailleuse est articulée en site et en azimut. Des trépieds spécifiques, par exemple destinés à la MG34, ainsi que des affûts posés sur des véhicules tels que les Half-tracks M17 américains ou remorquables intégrant deux, trois ou quatre mitrailleuses sur une tourelle ouverte, tel l'ensemble soviétique ZPU souvent doté de la puissante KPV.
Principes de fonctionnement et technologies
Automatisation du tir
Même s'il existe quelques modèles héritiers des modèles de Gatling (les « minigun » où l'ancienne manivelle est remplacée par un moderne moteur électrique ou hydraulique), depuis les travaux de Hiram Maxim une arme automatique utilise en général l'énergie produite par le départ de la munition précédente pour réapprovisionner et tirer de nouveau.
C'est alors la pression des gaz qui permet de renvoyer la culasse en arrière et d'éjecter la douille, en comprimant un ressort, dit récupérateur. Ce dernier va ensuite ramener la culasse en position de tir, en poussant une nouvelle munition dans la chambre, celle-ci est percutée et le cycle reprend. Cependant, l'arme tirant des munitions assez lourdes et puissantes, comme celle d'un fusil réglementaire, ce procédé est peu satisfaisant et il est même dangereux d'utiliser des mécanismes simples, comme les culasses non calées des pistolets mitrailleurs. Le canon et la culasse doivent rester solidaires et étanches le temps que la pression des gaz consécutive à la combustion de la cartouche atteigne des niveaux raisonnables. Ce besoin entraîne donc la présence d'un dispositif de verrouillage, puis de déverrouillage de la culasse, plusieurs principes coexistent pour le remplir. Certaines nations furent handicapées par le choix de leur munition standard de fusil au XIXe siècle, au cours duquel elles avaient adopté des munitions avec une douille à bourrelet et non à gorge, ce type de munition posant plus de problèmes pour l'éjection des étuis et donc plus d'incidents de tir.
Un des systèmes d'automatisation les plus courants est appelé « emprunt de gaz ». Il consiste à récupérer les gaz de la charge propulsive assez loin sur la longueur du canon, par une lumière, donc quand la balle va bientôt quitter celui-ci. La pression de ses gaz qui est encore assez élevée pousse alors un piston qui entraîne le déverrouillage de la culasse. Le blocage de celle-ci peut être réalisé sous diverses formes. Il existe aussi des culasses rotatives, où le pivotement de celle-ci engage des tenons dans la carcasse de l'arme (système Kalachnikov), ou des modèles basculants. Des variantes d'emprunt de gaz n'utilisent pas de piston, mais les gaz prélevés agissent directement sur un autre point de la culasse.
Un autre système, très employé, est celui dit "à court recul du canon". Dans celui-ci, la culasse et le canon reculent ensemble sur quelques millimètres, avant d'être séparés, la culasse continuant son recul toute seule. C'est le système employé par la MG-34 et ses descendants. Des modèles avec un recul solidaire plus long seront aussi expérimentés, comme sur le Chauchat, mais les difficultés mécaniques, les rendront beaucoup moins satisfaisants même si, dans l'absolu, ils devraient être meilleurs en termes de vitesse initiale et de précision, car l'ouverture se produit après que la balle a quitté le canon.
Plus moderne et moins répandue, l'« amplification d'inertie » (qui équipe la « AA-52 »), où la culasse est composée en deux parties séparées par un levier, une tête qui obture le canon et un corps massif. La tête recule mais du fait des rapports de longueur du levier et de la masse du corps, l'ouverture est alors très lente, ce principe combine la simplicité des culasses non calées et la sécurité de celles qui le sont.
Alimentation en munitions
Autre problème à résoudre pour fournir un tir continu, l'alimentation en munitions et là encore plusieurs systèmes ont été envisagés et employés. Le plus efficace et répandu de nos jours, au moins sur les mitrailleuses moyennes et lourdes, est l'alimentation par bandes. Actuellement, celles-ci sont métalliques et dites "désintégrables", c'est-à-dire que chaque maillon utilisé se détache du suivant durant la phase d'utilisation et donc est éjecté comme l'étui au lieu de demeurer en l'état et d'encombrer. Auparavant elles pouvaient être fabriquées en tissu, selon le système mis au point par Maxim. Elles sont généralement enfermées dans des boites adaptées à l'arme, pour les utilisations mobiles, souvent appelées magasin d'assaut. À défaut, une personne, le "pourvoyeur", doit veiller lors du tir à guider la bande dans l'arme. Même si les mitrailleuses actuelles peuvent être transportées et servies par une seule personne, elle est souvent assistée d'un pourvoyeur qui transporte des canons de rechange et des munitions, et plus généralement tout le groupe de combat est mis à contribution pour l'emport des munitions destinées à leur mitrailleuse.
Les magasins sont utilisés la plupart du temps par les armes très mobiles comme les fusils-mitrailleurs. Ils sont de formes et de contenances très variables selon les pays et les époques. On trouve ainsi à côté des traditionnels modèles droits, des semi-circulaires qui gagnent ainsi en compacité en profitant du profil biseauté de la cartouche et des circulaires, sortes de tambours de grande capacité mais souvent bruyants, pesants, difficiles à charger et peu fiables. L'arme est généralement destinée à être utilisée en position allongée donc le magasin est parfois placé sur le dessus, comme sur le BREN britannique ou le Degtiarev DP 28. Les capacités des magasins vont de vingt à soixante-quinze coups. Certains systèmes inspirés de la Gatling, en particulier japonais, s'alimentaient par l'effet de la seule gravité via un entonnoir où un servant jetait les munitions. Leur fiabilité laissait à désirer et ils limitaient trop la cadence maximale.
Pointage et visée
Les organes de pointage et de visée, utilisés sur une mitrailleuse, dépendent en grande partie de l'utilisation qui est faite de l'arme. Les plus simples sont ceux utilisés dans une utilisation en tant que fusil-mitrailleur, un simple bipied souvent repliable sert à appuyer l'arme pour le tir, et la visée se fait au moyen d'une hausse et d'un guidon, certaines des mitrailleuses les plus modernes sont équipées de lunettes, mais plus dans le but de faciliter le repérage d'objectifs que d'assurer une précision de tir. L'utilisation à la hanche ou épaulée est en général proscrite du fait du recul de telles armes, qui les rendent dangereuses et complètement imprécises. Un usage souvent constaté fut par contre le tir à deux personnes, le pourvoyeur portant et calant l'arme pendant que le mitrailleur pointe et fait feu.
Destinés plus à la défense ou aux tirs d'appui, les trépieds rendent l'arme beaucoup plus stable et permettent ainsi de réaliser des tirs indirects sur une zone que l'ennemi occupe ou va traverser. Le tir dans ces conditions est alors souvent dirigé par un observateur équipé de jumelles. Certains affûts peuvent aussi se transformer pour permettre le tir contre avions, comme celui de la MG-34. Une autre variante principalement observée chez les Soviétiques est un petit affût à deux roues, qui bien que plus lourd que le traditionnel trépied, a l'avantage d'être tiré et non porté. Il est en outre plus stable et pourvu d'un petit bouclier qui abrite les deux servants pendant le tir. Son principal avantage qui était de diminuer la fatigue lors des longues marches d'approche, disparaît néanmoins avec la motorisation de l'infanterie, à laquelle il ne survit pas.
Pour les tirs à partir de positions fixes ou par exemple à partir du pont d'un navire, un affût à chandelier est utilisé, c'est un simple poteau métallique maintenant l'arme à hauteur de tir pour être servie debout. En casemate, comme sur les mitrailleuses de glacis des chars ou dans un blockhaus, on utilise alors souvent des affûts à rotules qui permettent d'orienter l'arme sur un large champ vertical et horizontal, tout en protégeant le servant. Un autre montage très courant est le tourelleau, où le mitrailleur officie au centre d'un cercle sur lequel le support de mitrailleuse peut se déplacer. On trouve ce type de support sur les toits des blindés ou de certains camions ainsi que sur des vedettes de patrouille et d'assaut, les plus modernes sont motorisés et télécommandés.
Plus complexe, la tourelle dans laquelle l'arme et le servant sont braqués ensemble, la plupart du temps de façon motorisée. Elles sont le plus souvent dotées de plusieurs mitrailleuses, généralement deux ou quatre. Une de ses principales applications fut la défense des avions multimoteurs, rôle dans lequel on trouvait de nombreux types de tourelles destinées à couvrir différentes parties du champ défensif de l'avion. La plus ancienne est la tourelle arrière, d'abord simple mitrailleuse sur pivot, placée en avant de dérive, elle céda la place à de véritables tourelles motorisées à deux ou quatre mitrailleuses situées elles derrière la dérive donc bénéficiant d'un champ de tir non obstrué par un quelconque obstacle. Les tourelles supérieures et inférieures couvraient respectivement le dessus et le dessous de l'avion avec des débattements importants en site. Le secteur le plus vulnérable fut souvent l'avant du fait des vitesses de rapprochement lors de ce type d'attaque, les tourelles de menton motorisées y apportèrent une réponse au moins partielle. On trouvait aussi des mitrailleuses de sabords pour protéger les côtés et des affûts pointés par périscope, permettant de couvrir le secteur inférieur à partir de trappes. Les tourelles furent aussi utilisées par la marine sur de petites unités souvent fluviales et côtières, les grands bâtiments utilisant plus souvent des affûts chandeliers.
Dans d'autre cas, la mitrailleuse est fixe et pointée avec l'ensemble du véhicule, c'est le cas des avions de chasse et de certains véhicules blindés.
Déclenchement du tir
Le moyen le plus courant de déclenchement du tir d'une mitrailleuse est la détente mécanique, généralement associée à une poignée pistolet. Certaines armes possèdent des sélecteurs de tir offrant un moyen d'obtenir des rafales (tir automatique) ou du tir au coup par coup (semi-automatique). Une variante de système de détente nommée "papillon" laisse le tireur pointer l'arme par deux poignées placées à l'arrière puis tirer en appuyant du pouce sur la plaque de détente afin d'ouvrir le feu.
L'utilisation d'armes éloignées du tireur, en particulier dans des avions, conduisit dans les années 1930 à des essais de solutions de déclenchement par air comprimé, mais elles induisaient une légère mais fâcheuse latence lors de la transmission de l'ordre de tir. L'électricité, agissant par l'intermédiaire de solénoïdes placés sur l'arme, se révéla plus adéquate et s'imposa pour l'utilisation sur divers véhicules (avions et mitrailleuses coaxiales de blindés).
Cadence théorique et pratique
Une arme automatique se caractérise entre autres par sa cadence de tir, souvent exprimée par le nombre de coups par minute. Généralement, on distingue deux cadences. L'une est dite « maximale » ou « théorique » et ne tient pas compte du délai d'approvisionnement en munitions (par exemple du changement de magasin) ni de l'échauffement de l'arme. L'autre, dite "pratique" ou "réelle", intègre tous les paramètres. La cadence théorique de tir d'une mitrailleuse n'est pas toujours supérieure à celle d'une arme plus légère telle qu'un pistolet mitrailleur ou un fusil d'assaut, mais sa cadence pratique est beaucoup plus élevée. Le record d'endurance en tir continu semble être détenu par une mitrailleuse britannique à refroidissement liquide Vickers, de conception très inspirée du système Maxim, qui tira plus de cinq jours sans autre interruption que les changements de magasins.
Par pays d'origine
Notes et références
- Marchant-Smith, C.J., & Haslam, P.R., Small Arms & Cannons, Brassey's Battlefield Weapons Systems & Technology, Volume V, Brassey's Publishers, London, 1982, p. 169
- « Fusil mitrailleur Chauchat » [archive], sur mitrailleuse.fr, (consulté le ).
- Mitrailleuse du temps de Louis XIII, d'après un dessin de Nicolas Grollier de Servière publié dans « Les Anciennes Mitrailleuses », Guignol Illustré, Lyon, no 31, 12 au 19 mars 1871, p. 4 (lire en ligne [archive] [sur Numelyo])
- « Inventaire sommaire des archives historiques (Archives anciennes. Correspondance) » [archive], Paris, Imprimerie nationale,
- « Le Chasseur Français N°595 Janvier 1940 Page 60 » [archive]
- « Inventaire sommaire des archives historiques (Archives anciennes. Correspondance) » [archive], Paris, Imprimerie nationale,
- Martin J. Dougherty, Armes à feu : encyclopédie visuelle, Elcy éditions, 304 p. (ISBN 9782753205215), p. 238.
- https://books.google.co.uk/books?id=byMTAAAAQAAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=Vayringe+Seize+Coups&source=bl&ots=G2PgsvUlfl&sig=ACfU3U1SM-uMGfQrltxn_3L4ME6MvbWi5w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi51uizm4v7AhWMglwKHbSMDAUQ6AF6BAgMEAM#v=onepage&q=Vayringe%20Seize%20Coups&f=false [archive]
- https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/viewer/bl/0000191/17400927/004/0002 [archive]
- (en) « The Universal Magazine of Knowledge and Pleasure » [archive],
- Nouveau Règlement pour la filature des soies, (pas de nom d'éditeur ni d'empreinte), page 25 [archive], 1775 (OCLC 405531902)
- France, Procès-verbal des séances de l'Assemblée nationale : 1789-1791, , 774 p. (lire en ligne [archive]), p. 52.
- https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nnc1.0036748811&view=plaintext&seq=302&q1=360 [archive]
- https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/viewer/bl/0000341/17920824/009/0002 [archive]

- https://babel.hathitrust.org/cgi/pt/search?q1=Renard;id=uc1.b5000169;view=1up;seq=7;start=1;sz=10;page=search;sort=seq;orient=0 [archive]
- « Archives Parlementaires » [archive]
- https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/viewer/bl/0000876/18310616/039/0004 [archive]

- https://www.retronews.fr/journal/la-tribune-des-departemens/25-mai-1831/1221/2762131/3?from=%2Fsearch%23allTerms%3D%2522Coups%2520A%2520La%2520Minute%2522%2520Vosges%26sort%3Dscore%26publishedStart%3D1830-08-09%26publishedEnd%3D1848-02-24%26publishedBounds%3Dfrom%26indexedBounds%3Dfrom%26page%3D1%26searchIn%3Dall%26total%3D15&index=1 [archive]
- « Annales » [archive],
- G Lenotre, Vieilles Maisons, Vieux Papiers, Tallandier, , 320 p. (ISBN 979-10-210-0758-1, lire en ligne [archive]), p. 81.
- « La Presse » [archive], sur Gallica, (consulté le ).
Annexes
Sur les autres projets Wikimedia :
Articles connexes
Liens externes
Chasseurs à cheval de la Garde impériale
Cet article fait partie d'un « bon thème » labellisé en 2014.
Les chasseurs à cheval de la Garde impériale sont une unité de cavalerie légère de la Garde impériale, en service dans l'armée française de 1804 à 1815. Elle prend pendant les Cent-Jours la dénomination de 1er régiment de chasseurs à cheval de la Garde impériale.
Le régiment appartient à la Vieille Garde et est formé sous le Consulat sous le nom de guides de la Garde des consuls. Il fournit ordinairement l'escadron de service auprès de l'Empereur, assurant son escorte lors des déplacements et sur le champ de bataille. Les chasseurs de la Garde ont l'occasion de sauver l'Empereur lors d'attaques (ainsi à la veille d'Austerlitz). Ils sont parmi les préférés de Napoléon1 et sont l'un des régiments les plus prestigieux de la Garde2. À cheval, l'Empereur porte souvent l'uniforme vert de colonel de ce régiment (souvent caché par sa célèbre redingote grise), le porte pendant sa captivité à Sainte-Hélène et est mis en bière dans cet uniforme3.
Le régiment est aussi une unité de combat. Tout au long de son existence, il se distingue à plusieurs reprises sur le champ de bataille, notamment à Austerlitz, Eylau, Wagram, pendant la campagne de France de 1814 ou encore à Waterloo.
Origines et organisation
Création du corps des guides
Les origines du corps des chasseurs remontent à la Révolution française, avec la création en 1792 des guides d'état-major attachés au service des généraux commandant les armées. Ces unités ne sont pas employées au combat proprement dit et remplissent davantage un rôle administratif. Les choses évoluent néanmoins lorsque le général Napoléon Bonaparte prend le commandement de l'armée d'Italie en mars 1796. Dès le , celui-ci ordonne en effet la mise sur pied d'un détachement de 30 cavaliers chargés d'assurer sa protection et celle du quartier-général4.
Guides du Premier consul en 1801, par Alfred de Marbot.
À la fin du mois de mai, l'effectif est porté à 50 hommes et complété par deux bataillons de guides à pied, sous la direction d'ensemble du colonel Jean Lannes. La compagnie montée est placée, dès le 31 mai, sous les ordres du capitaine Jean-Baptiste Bessières, du 22e régiment de chasseurs à cheval. Dans le Mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon affirme que la création des guides lui aurait été inspirée par un incident survenu au lendemain de la bataille de Borghetto, au cours duquel lui et son entourage échappent de justesse à une patrouille autrichienne, mais l'historien Ronald Pawly considère que, « comme beaucoup d'autres éléments des mémoires de Bonaparte, cette anecdote pittoresque est fausse, au moins dans ses conséquences supposées »5.
Cette filiation ancienne explique l'attachement et le dévouement de ces vétérans à la personne de Napoléon. En 1798, les guides sont intégrés à l'armée d'Orient en partance pour l'Égypte, où ils s'illustrent dans divers combats tels que la bataille du Mont-Thabor, où quatre de leurs compagnies sèment la confusion dans les rangs turcs. Deux ans plus tard, le , les chasseurs à cheval sont intégrés à la Garde des consuls sous la forme d'une compagnie de 117 hommes, qui devient un escadron le suivant6. Pour l'historien Oleg Sokolov, « la dissolution de l'ancienne escorte signifiait que la nouvelle compagnie de la Garde s'appuyait sur des principes tout à fait différents. Ce n'était plus une unité que le hasard avait mis sous les ordres du jeune général ; elle était sa clientèle personnelle, en quelque sorte une nouvelle « Maison du Roi » dont les membres devaient vouer une fidélité sans bornes à leur « suzerain »7.
L'unité sert entre-temps à la bataille de Marengo le , et y essuie de lourdes pertes. En 1801, les chasseurs se voient adjoindre, le de la même année, un deuxième escadron, ce qui porte l'effectif à 490 hommes. Ils sont officiellement convertis en régiment le suivant et passent à quatre escadrons le , pour un total de 56 officiers et 959 hommes. Le corps est augmenté le d'un élément étranger : les mamelouks, recrutés parmi les réfugiés en provenance d'Égypte8.
Organisation sous le Premier Empire
Avec la proclamation de l'Empire le , les chasseurs prennent rang au sein de la Garde impériale9. Le décret du de la même année, qui règle les modalités d'organisation, prescrit une taille minimale d'1,67 m pour intégrer le corps des chasseurs10. Le , un escadron de vélites est adjoint au régiment, puis un second le . À cette date, l'unité est forte de 70 officiers et 1 239 chasseurs11. Les vélites disparaissent toutefois définitivement au profit d'un cinquième escadron le 12.
Par décret du , le régiment est porté de cinq à neuf escadrons, les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e conservant seuls la dénomination de Vieille Garde. Les 6e, 7e, 8e et 9e escadrons forment les chasseurs à cheval de la Jeune Garde (ou « seconds chasseurs »)13. Après la première abdication de Napoléon en 1814, les chasseurs sont rebaptisés « Corps royal des chasseurs à cheval de France » le à la faveur de la Première Restauration ; dotés de quatre escadrons à deux compagnies chacun14, ils comptent 55 officiers et 774 soldats15. L'unité est envoyée en garnison à Saumur, dans le Maine-et-Loire16. À l'issue d'une inspection en , le maréchal Ney rapporte que l'esprit du corps est « excellent » et que « sa discipline et sa subordination le font aimer des habitants de Saumur »17. Ce constat est relativisé par Henry Lachouque qui note que nombreux sont les cavaliers à refuser de crier « Vive le roi ! » lors des revues18. Le régiment est finalement transféré à Cambrai le 19.
Les chasseurs reprennent leur ancienne identité durant les Cent-Jours, en même temps qu'un 2e régiment de chasseurs à cheval de la Garde impériale (rattaché à la Jeune Garde) est mis sur pied20. Sous la Seconde Restauration, les chasseurs de Vieille Garde sont définitivement dissous entre le et le 21 à Périgueux22. Le commandant Bucquoy note que « très rares furent ceux qui prirent du service dans l'armée des Bourbons »22, ce que confirme Ronald Pawly qui indique que seuls deux officiers et six hommes du rang ont accepté de servir le régime de Louis XVIII21.
Une unité de protection
Chasseur à cheval de la Garde impériale du piquet d'escorte en tenue de service (1805). Illustration de
Louis-Ferdinand Malespina.
La Garde est d'abord un corps d'élite de réserve regroupant les meilleurs éléments issus de la ligne. Les chasseurs à cheval et les grenadiers à pied de la Garde impériale partagent l'honneur d'être les véritables gardes du corps de l'empereur, en temps de paix comme en temps de guerre. Les chasseurs à cheval assurent l'escorte de Napoléon lors de ses déplacements à cheval ou en voiture. Cela peut s'avérer utile, comme au soir du , à la veille de la bataille d'Austerlitz, lorsque Napoléon s'avance en reconnaissance vers les lignes ennemies et tombe sur un groupe de cosaques. Les chasseurs à cheval de l'escorte dégagent leur maître qui peut regagner les lignes françaises.
À ce titre, un escadron du régiment est généralement de service auprès de l'Empereur. Un détachement assure l'escorte rapprochée du souverain, l'accompagnant notamment lors de ses reconnaissances des champs de bataille : un lieutenant, un maréchal des logis, deux brigadiers, 22 chasseurs et un trompette. Les chasseurs portent le mousqueton en main. Généralement, lorsque l'Empereur est à l'arrêt, un chasseur est posté en vedette à chaque point cardinal, formant ainsi un « carré d'honneur » contre les balles ou les boulets23. Lorsque les chasseurs sont à pied, ils équipent leur mousqueton d'une baïonnette et entourent l'empereur. Du fait de leur rôle de protecteurs, on les surnomme les « chevaliers servants »24. Ils sont très estimés et aimés par Napoléon qui les couvre d'honneurs, et le commandement du peloton d'escorte est une place très recherchée et chargée d'honneurs, permettant de côtoyer le souverain toute la journée.
Les chasseurs à cheval de la Garde se forgent par ailleurs une excellente réputation au combat. Philip Haynthornthwaite les décrit ainsi comme « les meilleurs cavaliers légers qui soient »25, tandis que le colonel américain John Elting affirme qu'ils sont « le modèle de la cavalerie légère française »26. Quant à l'historien de la Garde impériale Henry Lachouque, il porte à leur égard le jugement suivant :
« Le régiment des Chasseurs à cheval de la Garde a toutes les traditions de l'escadron des Guides, cavaliers émérites, rompus au service de la Cavalerie légère, débrouillards, aptes à tout faire, enjoués, dévoués corps et âmes à Bonaparte qui les a formés, choyés, habillés et qui, ils le savent très bien, s'en vantent et en profitent, a pour eux une préférence marquée27. »
Une unité de combat
Les chasseurs à cheval eurent à combattre aux côtés des autres unités de cavalerie à plusieurs reprises.
2 décembre 1805 : la grande charge d'Austerlitz
L'armée russe a porté son effort sur la droite française en sous-nombre commandée par Davout, et a ainsi dégarni le plateau de Pratzen. Le corps de Soult attaque alors et prend le plateau de Pratzen, d'où il canonne les colonnes russes qui reviennent prendre le plateau. C'est alors que la cavalerie de la Garde impériale russe tente de stopper l'attaque française après l'échec d'une attaque d'infanterie. La cavalerie russe met en déroute deux régiments d'infanterie français tandis que les autres régiments se forment en carré.
Lithographie russe représentant l'affrontement entre les chevaliers-gardes russes et la cavalerie française de la Garde impériale à Austerlitz.
Napoléon donne l'ordre au maréchal Bessières de faire donner la cavalerie de la Garde pour colmater la brèche et soulager l'infanterie. Bessières dispose de quatre escadrons de chasseurs à cheval (375 cavaliers sous le commandement du colonel Morland), de la compagnie des mamelouks (48 cavaliers commandés par le capitaine Delaitre) et de quatre escadrons de grenadiers à cheval (706 cavaliers menés par le général Ordener)28.
La première charge est menée par les 1er et 2e escadrons de chasseurs sous Morland ainsi que par les mamelouks que conduit en personne le général Rapp, aide de camp de l'Empereur. Le reste du régiment et les grenadiers à cheval s'avancent en soutien. Les gardes à cheval et les hussards de la Garde russe du général Kologrivov, demeurés immobiles à l'approche des Français, sont culbutés. Chasseurs et mamelouks se jettent ensuite sur les fantassins des régiments Préobrajensky et Semionovsky, qui tiennent cependant leur position avec l'appui d'une batterie russe de six pièces29. Oleg Sokolov précise ainsi que la première attaque de la cavalerie de la Garde est repoussée, contraignant les chasseurs à se regrouper derrière l'infanterie de Drouet d'Erlon déployée à proximité30. Au cours de l'action, le colonel Morland est mortellement blessé par une décharge de mitraille31.
Ses hommes n'en continuent pas moins de harceler, avec des alternatives de succès et de revers, la Garde russe dont les régiments cherchent à s'abriter derrière un ruisseau, le Rausnitz. À la suite des mamelouks, les chasseurs enfoncent un carré du régiment Semionovsky et lui infligent de lourdes pertes32. C'est alors que les chevaliers-gardes et les cosaques de la Garde russe se précipitent à leur tour dans le combat. La mêlée devient confuse et son issue incertaine. Le major Dahlmann, à la tête des deux derniers escadrons de chasseurs, se porte au secours de ses camarades et contribue à encercler le 5e escadron de chevaliers-gardes commandé par le prince Repnine, qui est presque entièrement détruit. Malgré l'intervention successive de plusieurs unités de cavalerie russes, l'avantage bascule du côté français avec l'entrée en lice des grenadiers à cheval de la Garde qui rejettent définitivement leurs adversaires du champ de bataille33. À l'issue du combat, les chasseurs déplorent 19 tués (dont Morland) et 65 blessés34.
Campagne de Prusse et de Pologne
Le général Dahlmann à la tête des chasseurs à cheval de la Garde à Eylau, le
. Illustration de
Victor Huen, 1910.
À l'ouverture des hostilités contre la Prusse, les chasseurs, divisés en deux régiments de marche, ne peuvent suivre la progression rapide de la Grande Armée. De fait, ils sont absents à la bataille d'Iéna, au cours de laquelle l'escorte de Napoléon est assurée par le 1er régiment de hussards. Ils sont toutefois aux côtés de l'Empereur lors de l'entrée des troupes françaises dans Berlin à la fin du mois d'octobre. Les forces napoléoniennes se portent ensuite en territoire polonais à la rencontre de l'armée russe ; le , le régiment est réuni à Varsovie. À ce stade des opérations, le service quotidien auprès de l'Empereur est rendu très difficile par le froid extrême35. Les chasseurs s'illustrent malgré tout le jour de Noël au combat de Lopaczyn, où deux escadrons sous Dahlmann se mesurent avec succès à la cavalerie russe et s'emparent de trois pièces de canon36.
À la bataille d'Eylau, le corps du maréchal Augereau, en plus d'être désorienté par des bourrasques de neige en pleine face, est décimé par l'artillerie ennemie qui le prend pour cible. Le 7e corps est hors de combat. Une énorme brèche coupe en deux les lignes françaises, isolant l'aile droite française menée par Davout du reste de l'armée. Le commandant en chef russe, Bennigsen, y engouffre une force d'infanterie et de cavalerie sur l'aile gauche pour repousser Davout, plusieurs divisions au centre et une colonne d'infanterie dans une attaque irrésistible sur la droite dans le cimetière d'Eylau défendu par les restes du 7e corps.
Napoléon, pour rétablir la situation, lance alors Murat dans la plus formidable, mais aussi la plus désordonnée des charges de toute l'histoire, à la tête de plus de dix mille hommes de la réserve de cavalerie, attaquer les divisions ennemies au centre. Les dragons buttent sur la première ligne russe, les cuirassiers en deuxième vague rencontrent plus de succès mais butent sur la deuxième ligne. À la cavalerie de la ligne menacée d'encerclement par l'infanterie russe, Napoléon y ajoute celle de la Garde commandée par le maréchal Bessières.
Le maréchal charge, traverse les deux lignes russes avec furie, élargit la brèche précédemment ouverte par les cuirassiers. À la tête des chasseurs à cheval de la Garde, le général Dahlmann est mortellement blessé. Le colonel Guyot prendra alors le commandement du régiment. Les grenadiers à cheval, quant à eux menés par le colonel-major Louis Lepic, et le 5e régiment de cuirassiers à la suite, enfoncent les Russes jusqu'à rallier les lignes françaises. La charge de la Garde a permis à la cavalerie de ligne de Murat de se replier et l'ensemble de ces charges meurtrières, au prix de près de trois mille cinq cents tués ou blessés, ont stoppé et repoussé l'attaque russe sur le centre.
Contre les grenadiers russes partis à l'assaut du cimetière, Napoléon oppose le fameux 1er régiment de grenadiers à pied de la Garde impériale sur la tête de colonne ennemie et fait charger ses flancs par les escadrons de service de la Garde à cheval. Pris à revers par les hussards et chasseurs à cheval de la ligne détachés par Murat, les grenadiers russes sont annihilés par cette triple attaque.
Outre Dahlmann, les chasseurs déplorent la perte de 51 tués et 155 blessés à l'issue des combats37.
En Espagne (1808-1809)
De retour à Paris en novembre 1807, les chasseurs à cheval de la Garde participent aux festivités organisées dans la capitale pour le succès de la campagne de Pologne. Le , le général de brigade Charles Lefebvre-Desnouettes succède au prince Eugène en tant que colonel en titre du régiment. Celui-ci fournit peu après un détachement de 216 hommes qui, avec d'autres unités de la Garde, s'achemine vers la frontière espagnole. Au mois de mars, un escadron de chasseurs commandé par Daumesnil entre dans Madrid aux côtés des troupes du maréchal Murat, mais la population hostile aux Français se soulève contre l'occupant le . Les chasseurs et mamelouks de la Garde participent activement à la répression de l'émeute, au prix de 26 tués ou blessés dans leurs rangs38.
Capture du général Lefebvre-Desnouettes par le soldat Levi Grisdale du
10e hussards britannique au combat de Benavente, le
. Peinture de
Denis Dighton.
Après les nombreux revers essuyés par les armées impériales dans la péninsule Ibérique, Napoléon se rend lui-même sur place en novembre afin de redresser la situation. Le régiment, qui compte désormais plus de 1 000 hommes déployés en Espagne, est présent à la bataille de Somosierra le , où il soutient la charge des chevau-légers polonais contre les positions espagnoles. Madrid capitule quelques jours plus tard et une course-poursuite s'engage entre l'armée de Napoléon et le corps expéditionnaire britannique du général Moore, qui se replie vers les ports de Vigo et de La Corogne avec l'intention de se rembarquer pour l'Angleterre39.
Évoluant en pointe de l'avant-garde française, les chasseurs de la Garde, conduits par le général Lefebvre-Desnouettes en personne, se présentent le sur la rivière Esla, à hauteur du village de Benavente. De l'autre côté de la rive ne sont visibles que quelques détachements de cavalerie britanniques affectés à l'arrière-garde de Moore ; sûr de sa force, Lefebvre-Desnouettes ordonne à ses hommes — trois escadrons de chasseurs et un petit détachement de mamelouks —de franchir le cours d'eau à gué et de balayer les unités adverses. Le 18e hussards anglais et le 3e hussards de la King's German Legion, après une résistance initiale, sont repoussés en direction de Benavente, mais les Français tombent alors dans une embuscade tendue par Lord Paget qui se lance inopinément dans le combat à la tête d'un troisième régiment de hussards. Chasseurs et mamelouks sont refoulés en désordre sur l'Esla et essuient des pertes importantes au moment de repasser la rivière. À l'issue de l'engagement, le régiment déplore plus de 120 tués, blessés ou prisonniers, parmi lesquels le général Lefebvre-Desnouettes, capturé par les Anglais40.
Campagne d'Allemagne de 1809
Charge des chasseurs à cheval de la Garde impériale contre les dragons autrichiens à Wagram (par
Henri-Georges Chartier, 1897).
Devant l'imminence d'une guerre avec l'Autriche, Napoléon regagne la France en toute hâte à la mi-janvier 1809 et rappelle une partie des forces qui se battent en Espagne, dont la quasi-totalité de sa Garde, en vue de la campagne qui s'annonce. Détachement par détachement, le régiment des chasseurs se met en route pour Paris en passant par Tolosa, Bayonne, Bordeaux et Poitiers. Sur le front d'Europe centrale, l'armée autrichienne de l'archiduc Charles envahit la Bavière à partir du mais les chasseurs, dirigés sur Strasbourg à la fin du mois puis Stuttgart dans les premiers jours de mai, ne participent pas à la phase initiale de la campagne41.
Ils sont cependant engagés au second jour de la bataille de Wagram le , lorsque la colonne du général Macdonald s'élance sur le centre autrichien. Afin d'appuyer ce mouvement, les chasseurs, commandés en l'absence de Lefebvre-Desnouettes par le major Claude Étienne Guyot, font le coup de sabre contre l'infanterie de Kollowrat et s'emparent de quatre canons. Aidés des chevau-légers polonais de la Garde, ils avisent ensuite un corps autrichien en retraite, dispersent quatre régiments de cavalerie ennemis et, après une tentative infructueuse, enfoncent un carré d'infanterie. Les pertes de cette journée, pour beaucoup infligées par l'artillerie, s'élèvent à 25 tués et 123 blessés42.
Retour en Espagne et années de paix (1810-1811)
De retour en France à la fin de l'année 1809, les chasseurs reprennent dès l'année suivante le chemin de la péninsule Ibérique, où leurs escadrons servent par rotation au sein du détachement de cavalerie de la Garde présent sur place, aux ordres du général Lepic43. Celui-ci dispose d'un régiment de cavalerie lourde (grenadiers à cheval et dragons) et d'un régiment de cavalerie légère (dont l'escadron des chasseurs et la compagnie de mamelouks) qui stationnent à Burgos afin d'assurer les lignes de communication avec la France44. Fort de 389 hommes (dont 24 officiers) en 1810, le contingent déployé en Espagne ne compte plus que 313 hommes à la date du 43.
Les chasseurs à cheval de la Garde impériale défilant devant Napoléon et son état-major. Gravure d'Auguste Boulard fils d'après
François Flameng.
Au cours de cette période, un officier du régiment chargé d'une escorte de prisonniers est blessé45 ; l'historien Robert Burnham fait quant à lui état de quatre officiers blessés dans des opérations de lutte antiguérilla entre 1810 et 181246. Sur la même fourchette de temps, Paul Descaves indique que les chasseurs sont impliqués dans cinq combats — dont celui d'Elione, le , au cours duquel un peloton de chasseurs sous le lieutenant Delor disperse une colonne espagnole de 400 hommes et lui inflige une cinquantaine de pertes — qui leur coûtent au total douze tués ou blessés47. Par ailleurs, une partie de la brigade Lepic, dont 235 chasseurs de la Garde, est présente à la bataille de Fuentes de Oñoro en mais n'est pas engagée48. En prévision d'un conflit imminent avec la Russie, Napoléon finit par rappeler les unités de sa Garde encore en Espagne, dont les chasseurs, en 49. Leur départ effectif de la péninsule n'intervient cependant qu'en 50.
Pour le gros du régiment resté à Paris, la période de paix qui succède à la guerre victorieuse contre l'Autriche est marquée par des cérémonies et des voyages au cours desquels les chasseurs participent à l'escorte de Napoléon, par exemple en Hollande où 335 cavaliers du corps accompagnent la visite de l'Empereur et de son épouse Marie-Louise. C'est aussi l'époque d'un certain nombre de changements dans l'organisation avec, en particulier, l'adjonction d'un 5e escadron le , l'arrivée de deux nouveaux colonels-majors — Haugéranville et Exelmans ― en remplacement des deux précédents blessés à Wagram et la promotion de Guyot au grade de général de division (le commandement du régiment lui étant conservé) en décembre suivant. Un état de situation daté du 18 de ce mois indique un effectif de 1 308 chasseurs, dont 193 absents, malades ou prisonniers de guerre, et 116 mamelouks51.
Campagne de Russie
De février à , le régiment s'achemine en plusieurs colonnes vers la frontière russe. Il est rejoint le par le général Lefebvre-Desnouettes qui, échappé de sa captivité en Angleterre, reprend la direction du corps en lieu et place de Guyot. Le mois suivant, la Grande Armée franchit le Niémen, ce qui marque l'ouverture de la campagne de Russie. Toutefois, comme pour les autres unités de la Garde impériale, les chasseurs ne prennent pratiquement aucune part aux opérations lors de l'avance des troupes françaises sur Moscou, et guère davantage au moment de la retraite qui commence à la mi-octobre52.
Un incident sérieux se produit toutefois le , au lendemain de la bataille de Maloyaroslavets : alors que Napoléon s'est aventuré en reconnaissance non loin du village de Gorodnia, lui et son entourage sont attaqués au petit matin par une nuée de cosaques. L'escadron de service des chasseurs, sous les ordres du chef d'escadron Kirmann, se jette alors dans la mêlée pour protéger l'Empereur, mais doit reculer jusqu'à l'intervention du maréchal Bessières et du reste de la cavalerie de la Garde qui écartent définitivement le danger. Les pertes des chasseurs s'élèvent à neuf tués et sept blessés, dont Kirmann53. Lorsque Napoléon décide, le 5 décembre, de quitter l'armée pour rentrer à Paris, un peloton de 30 chasseurs, sélectionnés parmi les cavaliers les mieux montés du régiment, assure sa protection pendant une partie du trajet54.
Campagne d'Allemagne de 1813
Fortement ébranlés par le désastre de Russie, les chasseurs à cheval de la Garde sont réorganisés au début de l'année 1813 par deux décrets, l'un du 18 janvier portant l'effectif à 2 000 hommes en huit escadrons, l'autre du 6 mars fixant à neuf le nombre d'escadrons — les mamelouks constituant le 10e ― pour un total de 2 500 cavaliers. Les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e escadrons, majoritairement reconstitués avec des soldats triés sur le volet parmi les régiments de cavalerie de l'armée d'Espagne, sont considérés comme étant de Vieille Garde, tandis que les 6e, 7e, 8e et 9e sont affiliés à la Jeune Garde ; les hommes qui composent ces derniers sont recrutés par conscription ou au sein des cavaliers offerts par les départements. L'arrivage de contingents de dépôt laissés en France complètent les rangs55.
Ainsi étoffés, les chasseurs ne participent pourtant pas aux premiers engagements de la campagne d'Allemagne de 1813, se contentant d'assurer l'escorte de l'Empereur. La signature de l'armistice de Pleiswitz en juin permet d'accroître l'effectif régimentaire grâce à l'arrivée de plusieurs détachements de renfort56. À la bataille de Dresde, au mois d'août, les chasseurs sont une nouvelle fois tenus en réserve malgré le feu ennemi qui cause des pertes sensibles57. Face à la menace constituée au nord par le corps franc du général saxon Johann von Thielmann, rallié aux Coalisés, Napoléon ordonne à Lefebvre-Desnouettes, commandant la 2e division de cavalerie de la Garde (lanciers polonais, chasseurs et grenadiers à chevalnote 1), de mettre ce dernier hors d'état de nuire. Le général français se dirige alors entre Leipzig et Erfurt avec sa troupe, renforcée pour l'occasion par deux brigades de cavalerie de la ligne. Les Français s'emparent le de la ville d'Altenbourg, refoulant Thielmann sur Zwickau, mais celui-ci, rejoint par les cosaques de Platov, contre-attaque le 28 ; très vite, la cavalerie française est enveloppée et doit se replier sur Zeitz puis Freyburg, non sans avoir essuyé des pertes sensibles60. Aux chasseurs de la Garde, le bilan est de quatre hommes hors de combat dont deux tués61. Lefebvre-Desnouettes souligne dans ses rapports la bonne conduite des chasseurs et des mamelouks qui ont chargé à plusieurs reprises pour couvrir la retraite de leurs camarades62.
L'affrontement décisif entre Napoléon et les Coalisés à Leipzig, en octobre, permet au régiment de se distinguer. Au premier jour de la bataille, le 16, un de ses escadrons fait partie de la colonne de cavalerie de la Garde rassemblée par le général Letort pour soutenir les troupes du maréchal Oudinot, confrontées aux forces autrichiennes de Schwarzenberg. Se déployant devant les carrés formés par les fantassins français, les cavaliers de Letort repoussent une charge de la cavalerie adverse ; l'escadron des chasseurs, conjointement avec celui des dragons de la Garde, contribue en particulier à la destruction des dragons autrichiens de Latour qui abandonnent 200 prisonniers aux mains des Français. Deux jours plus tard, le régiment tout entier fait mouvement avec le reste de la cavalerie de la Garde pour combler la brèche créée dans le dispositif français par la défection de plusieurs unités allemandes. Alors que Russes et Suédois s'apprêtent à exploiter cette situation, l'attaque subite des 8 000 cavaliers de la Garde impériale sème la confusion dans leurs rangs, même si les assaillants sont, en définitive, contraints de se replier sous le feu de l'artillerie russe. Les pertes des chasseurs lors de cette journée sont de 14 tués, sans compter les blessés63.
La défaite de Napoléon le 19 oblige son armée à se replier vers la France. Au cours de la retraite, Lefebvre-Desnouettes se porte avec 5 000 cavaliers sur Weimar, qu'il occupe dans un premier temps avant d'en être chassé par les Austro-Russes ; l'affaire coûte aux chasseurs le chef d'escadron Vanot, tué, ainsi que plusieurs officiers et hommes du rang64. La campagne s'achève par un dernier affrontement à Hanau, le , contre les forces du général bavarois Carl Philipp von Wrede, bien décidé à barrer la route aux restes de la Grande Armée. Dans son historique des chasseurs à cheval de la Garde, Paul Descaves écrit que les cavaliers de Lefebvre sont déployés sur l'aile droite française, où ils tiennent la dragée haute aux escadrons russes de Kaizarov64 ; Ronald Pawly affirme de son côté que les chasseurs, tout comme le reste de la cavalerie de la Garde, dégagent par une charge opportune l'artillerie du général Drouot, attaquée par la cavalerie bavaroise, et malmènent l'infanterie adverse prise au dépourvu. L'escadron du capitaine Schmidt capture ainsi deux bataillons bavarois pendant que le capitaine Oudinot et ses hommes reprennent la possession de six canons tombés aux mains de l'ennemi. Le régiment dénombre quatre tués et une douzaine de blessés65. Au soir de la bataille, un peloton de 25 chasseurs envoyé en reconnaissance fend un carré d'infanterie bavarois qui perd 60 hommes contre quinze chez les Français64.
Alors que les escadrons de Vieille Garde et de Jeune Garde combattent ensemble pendant toute la durée de la campagne de 1813, une séparation intervient au moment du repli vers la France : les chasseurs et mamelouks de Vieille Garde ainsi qu'une compagnie de Jeune Garde, sous le major Lion, restent auprès de l'Empereur, tandis que le reste des chasseurs de Jeune Garde et les « seconds mamelouks », commandés par le major Meuziau, sont envoyés en Belgique pour participer à la défense d'Anvers66.
Campagne de France
Au début de l'année 1814, les armées de la Coalition déferlent en masse sur le territoire français, que Napoléon est contraint de défendre avec des forces très réduites et, à l'exception de la Garde impériale, moins expérimentées. Dans ce contexte, le rôle de la cavalerie de la Garde s'avère crucial pour suppléer à son homologue de la ligne67. Au 1er janvier, les escadrons de Vieille Garde du régiment alignent 40 officiers et 638 cavaliers, non compris ceux demeurés dans les dépôts de Paris, Stenay et Saint-Mihiel68. Un état de situation du donne 585 chasseurs à la division de cavalerie de la Garde du général Levesque de Laferrière et 511 autres à la réserve de la Garde sous les ordres du maréchal Ney69.
« La dernière cartouche » : fusilier-grenadier et chasseur à cheval de la Garde (par
Horace Vernet).
Quelques jours plus tard a lieu la bataille de Brienne qui contraint les troupes prusso-russes de Blücher à évacuer cette ville après une vigoureuse résistance ; un détachement d'environ 300 chasseurs prend part aux combats en enlevant le village de Perthes avec la cavalerie de Lefebvre-Desnouettes70. Le , à Vauchamps, le général Lion se précipite dans la mêlée à la tête des escadrons de service de la Garde à cheval, dont celui des chasseurs commandé par le chef d'escadron Labiffe, et refoule les soldats coalisés aux prises avec les fantassins français de Ricard. Sur la droite, le reste du régiment emmené par Lefebvre-Desnouettes repousse les assauts de la cavalerie prussienne71. Le mois de février est également marqué par un exploit accompli le 28 à La Ferté-Gaucher par une troupe de 17 chasseurs conduite par le lieutenant Allimant, qui s'empare d'un équipage de pont après avoir dispersé l'escadron d'escorte et fait 64 prisonniers67. Le , alors que l'armée française traverse la Marne à la poursuite du corps de Blücher, un escadron des chasseurs de la Garde rafle encore une centaine de prisonniers à Oulchy-le-Château72.
Au cours de la bataille de Craonne, le , le régiment participe aux attaques et laisse une douzaine d'hommes sur le terrain, dont trois officiers73. Le capitaine Achyntre figure notamment parmi les tués74. Alors que Blücher, pressé par Napoléon, a abandonné sa position de Craonne pour se replier au nord-ouest, une manœuvre de flanc opérée par le colonel Gourgaud, officier d'ordonnance de l'Empereur, à la tête de deux escadrons de chasseurs de la Vieille Garde oblige les troupes russes à évacuer le village d'Étouvelles, en avant de Laon73. Les attaques françaises contre cette dernière ville sont cependant repoussées dans les jours suivants, ce qui force Napoléon à battre en retraite vers le sud. En dépit d'une série d'affrontements ultérieurs, les armées alliées continuent d'avancer sur Paris dont elles s'emparent le 73. Un détachement d'environ 300 cavaliers de la Garde, mêlant grenadiers à cheval, chasseurs, dragons et mamelouks, prend part à la vaine défense de la capitale en chargeant à plusieurs reprises dans les secteurs de Clignancourt, Saint-Ouen et Clichy75.
Campagne de Belgique de 1815
En , Napoléon, de retour de l'île d'Elbe, débarque en France à la tête d'une petite armée avec laquelle il entend reconquérir son trône. Sitôt informé de la nouvelle, Lefebvre-Desnouettes s'efforce de rallier le corps des chasseurs et d'autres unités à la cause de l'Empereur mais, confronté au refus d'une partie de ses officiers dont le général Lion, il ne rejoint Napoléon le qu'avec une poignée d'hommes19. L'ex-régiment des chasseurs à cheval de la Garde n'en est pas moins reconstitué et participe le à la cérémonie du Champ de mai, où il précède avec les lanciers rouges le carrosse impérial lors de son trajet vers l'École militaire76.
Composition et effectifs théoriques
- : 1 compagnie.
- : 1 escadron des chasseurs, 2 compagnies.
- : 2 escadrons, 4 compagnies.
- : 4 escadrons, 8 compagnies.
- : 4 escadrons (8 compagnies) plus l'escadron de Mamelouks.
- En 1804, le régiment se compose :
- De 1 colonel, et 1 major.
- De 1 État-major composé de 1 chef d'escadron, 1 adjudant-major, 4 porte-étendards, 1 trompette-major, 1 timbalier, 1 brigadier trompette et 4 maîtres ouvriers, soit 13 hommes.
- De 8 compagnies (en 4 escadrons), composées de : 1 capitaine, 1 lieutenant en premier, 1 lieutenant en second, 1 sous-lieutenant, 1 maréchal-des logis-chef, 4 maréchaux des logis, 8 brigadiers, 1 maréchal-ferrant, 2 trompettes et 96 chasseurs, soit 116 hommes par compagnie, pour un total de 928.
Soit un effectif théorique de 943 hommes.
- : 4 escadrons (8 compagnies), 1 escadron de Mamelouks et 1 escadron de vélites à 4 compagnies.
- : 4 escadrons (8 compagnies), 1 escadron de Mamelouks et 2 escadrons de vélites (8 compagnies).
- : 4 escadrons (8 compagnies), 1 escadron de Mamelouks et 1 escadron de vélites (2 compagnies).
- 1812 : 5 escadrons (10 compagnies), 1 escadron de Mamelouks.
- 1813 : 9 escadrons (16 compagnies), 5 de Vieille Garde et 4 de Jeune Garde, 1 escadron de Mamelouks.
- 1814 (première Restauration) : 4 escadrons (8 compagnies).
- 1815 (Cent-Jours) : 4 escadrons (8 compagnies), 1 escadron de Mamelouks.
Chefs de corps
Eugène de Beauharnais, colonel des chasseurs à cheval de la Garde impériale
Le grade de « colonel-général » du régiment est surtout honorifique et la réalité du commandement en campagne revient au colonel en second (« colonel-major »). Les soldats de la Garde ont un rang supérieur à celui de la ligne, c'est pourquoi cette fonction est souvent remplie par un officier général.
(*) Officier qui devint par la suite général de brigade. (**) Officier qui devint par la suite général de division.
Entre 1804 et 1815, deux colonels périssent à la tête du régiment : François-Louis de Morland, tué le à Austerlitz, et Nicolas Dahlmann, mortellement blessé le à Eylau. Durant la même période, 70 officiers des chasseurs sont tués au combat, 8 succombent à leurs blessures et 130 sont blessés.
Étendards
L'étendard du modèle 1804 n'était pas carré comme de coutume, mais, comme pour les chasseurs à cheval de la ligne, consistait en un guidon se terminant en deux pointes à partir de la moitié de la longueur. Le losange central blanc portait en lettres d'or l'inscription : « L’Empereur des Français au régiment de chasseurs à cheval de la Garde impériale » à l'avers, et au revers « Valeur » et « Discipline » encadrant les armes impériales, et en dessous « (N°) escadron ». Les angles étaient ornés de cors de chasse entourés de couronnes de lauriers.
L'étendard du modèle 1812, reçu en 1813, était carré et tricolore avec à l'avers « Garde impériale, l'Empereur Napoléon au régiment de chasseurs à cheval », et au revers les noms de batailles où le régiment s'était distingué et les capitales prises. Le bord du drapeau était orné de chiffres, de cors de chasse entourés de couronne de laurier et de chêne mêlés, d'aigles, d'abeilles…
Au retour de la campagne de 1807, les chasseurs à cheval de la Garde impériale font partie des régiments dont l'aigle est ornée d'une couronne de laurier en or offerte par la ville de Paris et remise par le préfet de la Seine. La couronne est passée autour du cou de l'aigle.
Les étendards du régiment furent détruits en septembre 1815 lors de la Seconde Restauration.
-
-
Guidon modèle 1804 revers
-
Étendard modèle 1812 avers
Uniformes sous le Consulat et l'Empire
Capitaine des chasseurs à cheval de la Garde impériale, par
Georges Scott.
Napoléon en habit de colonel des chasseurs à cheval de la Garde, à Wagram.
L'uniforme des chasseurs à cheval de la Garde est l'un des plus fameux de la Grande Armée, avec celui des grenadiers à pieds de la Garde, des hussards, des lanciers rouges… La grande tenue ne tenait pas des chasseurs à cheval de la ligne mais des hussards. Il s'agissait donc d'un uniforme « à la hongroise » :
- Colback noir en peau d'ours, avec un plumet vert au sommet rouge et une flamme écarlate. Colback blanc à plumet bleu au sommet rouge pour les trompettes.
- Dolman vert. Bleu pour les trompettes.
- Pelisse écarlate bordée de mouton noir (doublure rousse pour les sous-officiers et blanche pour les officiers)
- Ceinture écharpe en laine
- Culotte de daim
- Bottes « à la Souvarov »
L'armement est constitué :
- D'un sabre de cavalerie légère
- D'un mousqueton de cavalerie
- D'une baïonnette
- D'un pistolet
Comme les hussards, ils portent une sabretache, verte bordée d'or et ornée des armes impériales. Pour l'équipement du cheval, la schabraque est verte pour les soldats et sous-officiers, et en peau de panthère pour les officiers.
Emblématique de l'iconographie du régiment et parfois portée au combat, la grande tenue laissait la place en campagne à la tenue de campagne, assez variable selon l'époque et la saison : pelisse ôtée ou non, dolman pouvant être remplacé par un habit « à la chasseur », colback sans plumet ni flamme, pantalon de cheval vert à la place de la culotte de daim, housse de sabretache…
Voir aussi
Articles connexes
Notes et références
Notes
- Une incertitude demeure quant à la composition de cette division : Paul Descaves écrit qu'« un escadron de chasseurs de Vieille Garde et la 1re compagnie de mamelucks [sic] restent auprès de l'Empereur pour le service d'escorte ; les autres escadrons et la 2e compagnie de mamelucks sont avec le général Lefebvre-Desnoëttes »58. Toutefois, dans son état de situation de la cavalerie de la Garde au début du mois d', Charles Thoumas indique que les escadrons de Jeune Garde du régiment sont présents à la 2e division de Lefebvre-Desnouettes tandis que ceux de Vieille Garde font partie de la 3e division du général Walther59.
Références
- A. JOUINEAU, Jean-Marie MONGIN : « C'est pour toutes ces raisons, […], que Napoléon les aime, les choie et les préfères à tous les autres »
- Unité aimée de Napoléon, elle en assure généralement la sécurité et le sauve à plusieurs reprises. Cela et les charges décisives assurées pendant plusieurs batailles font qu'ils sont souvent représentés sur les illustrations et tableaux de cette époque.
- Albert Benhamou L'Habit de Napoléon à Sainte-Hélène [archive]
- Pawly 2008, p. 3.
- Pawly 2008, p. 3-4.
- Pawly 2008, p. 6-7.
- Sokolov 2003, p. 427.
- Pawly 2008, p. 7-9.
- Pawly 2008, p. 9.
- Sokolov 2003, p. 435.
- Bucquoy 1977, p. 15.
- Bucquoy 1977, p. 16.
- Pawly 2008, p. 38.
- Bucquoy 1977, p. 20.
- Juhel 2009, p. 103.
- Descaves 1891, p. 283.
- Descaves 1891, p. 289.
- Lachouque 1956, p. 751-755.
- Pawly 2008, p. 43.
- Bucquoy 1977, p. 22.
- Pawly 2008, p. 44.
- Bucquoy 1977, p. 23.
- Prache 1983, p. 19
- Prache 1983, p. 15
- Philip Haythornthwaite (ill. Richard Hook), La Garde impériale, DelPrado & Osprey Publishing, coll. « Osprey / Armées et batailles » (no 1), , 63 p. (ISBN 2-84349-178-9), p. 5.
- (en) John R. Elting, Swords around a Throne : Napoleon's Grande Armée, Phoenix Giant, (1re éd. 1989), 769 p. (ISBN 0-7538-0219-8), p. 186.
- Lachouque 1956, p. 49-50.
- Vassiliev 2009, p. 20 et 22.
- Vassiliev 2009, p. 23-26.
- Oleg Sokolov (trad. du russe, préf. général Robert Bresse), Austerlitz : Napoléon, l'Europe et la Russie, Saint-Germain-en-Laye, Commios, , 541 p. (ISBN 2-9518364-3-0), p. 397.
- Vassiliev 2009, p. 26.
- Vassiliev 2009b, p. 19-21.
- Vassiliev 2009b, p. 21-24.
- Vassiliev 2009b, p. 26.
- Pawly 2008, p. 16.
- Descaves 1891, p. 312.
- Pawly 2008, p. 18.
- Pawly 2008, p. 19-20.
- Pawly 2008, p. 20-21.
- Pawly 2008, p. 22.
- Pawly 2008, p. 23-24.
- Pawly 2008, p. 33-34.
- Pawly 2008, p. 34.
- Burnham 2011, p. 315.
- Young 1971, p. 8.
- Burnham 2011, p. 317.
- Descaves 1891, p. 322.
- Burnham 2011, p. 52.
- Pawly 2008, p. 35.
- Burnham 2011, p. 316.
- Pawly 2008, p. 34-35.
- Pawly 2008, p. 35-36.
- Pawly 2008, p. 36.
- Lachouque 1956, p. 430-432.
- Pawly 2008, p. 37-39.
- Descaves 1891, p. 326.
- Pawly 2008, p. 39.
- Descaves 1891, p. 326-327.
- Thoumas 2004, p. 193.
- Thoumas 2004, p. 180-185.
- Descaves 1891, p. 327.
- Thoumas 2004, p. 187-188.
- Pawly 2008, p. 39-40.
- Descaves 1891, p. 328.
- Pawly 2008, p. 40-41.
- Bucquoy 1977, p. 19-20.
- Pawly 2008, p. 42.
- Descaves 1891, p. 329-330.
- Tranié et Carmigniani 1989, p. 291-292.
- Descaves 1891, p. 330.
- Descaves 1891, p. 331.
- Tranié et Carmigniani 1989, p. 158-159.
- Descaves 1891, p. 333.
- Lachouque 1956, p. 619.
- Lachouque 1956, p. 661 ; 664-665.
Bibliographie
 : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
- Eugène-Louis Bucquoy, « Les chasseurs à cheval des Gardes consulaire et impériale », dans La Garde impériale : troupes à cheval, Paris, Jacques Grancher, coll. « Les uniformes du Premier Empire » (no 2), , 210 p..
- Paul Descaves, Historique du 13e régiment de chasseurs à cheval et des chasseurs à cheval de la Garde, Bouineau & Cie, , 399 p. (lire en ligne [archive]).

- Marcel Dupont, Guides de Bonaparte et chasseurs à cheval de la Garde, LCV, .

- François-Guy Hourtoulle et André Jouineau, La Moskowa, Borodino : La Bataille des Redoutes, Paris, Histoire & Collections, , 120 p. (ISBN 2-908182-95-5)
- François-Guy Hourtoulle et André Jouineau, Austerlitz, 1805 : Le soleil de l'Aigle, Paris, Histoire & Collections, , 128 p. (ISBN 2-913903-70-3)
- François-Guy Hourtoulle et André Jouineau, 1807, d'Eylau à Friedland : 1807, la campagne de Pologne, Paris, Histoire & Collections, , 144 p. (ISBN 978-2-35250-020-9)
- Pierre Juhel (ill. Keith Rocco et Peter Bunde), De l'île d'Elbe à Waterloo : la Garde impériale pendant les Cent-Jours, Éditions de la Revue Napoléon, , 255 p. (ISBN 978-2-9524-5833-7).
- André Jouineau et Jean-Marie Mongin, Officiers et soldats de la Garde impériale : 2. Les troupes à cheval, 1804-1815, Histoire & Collections, , 82 p. (ISBN 978-2-35250-032-2).
- Henry Lachouque (préf. Maxime Weygand), Napoléon et la Garde impériale, Paris, Bloud et Gay, , 1114 p..
- Olivier Lapray, Les chasseurs à cheval de la Garde impériale, revue Soldats Napoléoniens, .
- Denys Prache, Les soldats de Napoléon, Paris, Hatier, , 59 p. (ISBN 2-218-06647-5).

- Oleg Sokolov (préf. Jean Tulard), L'armée de Napoléon, Commios, , 592 p. (ISBN 978-2-9518364-1-9).
- Charles Thoumas, Les grands cavaliers du Premier Empire, t. III, Paris, Éditions historiques Teissèdre, (ISBN 2-912259-89-4).
- Jean Tranié et Juan-Carlos Carmigniani, Napoléon : 1814 - La campagne de France, Pygmalion/Gérard Watelet, , 311 p. (ISBN 9782857043010).
- Alexeï Vassiliev (trad. Natalia Goutina), « "Faisons pleurer les dames de Saint-Pétersbourg !" (1) », Tradition Magazine, no 246, , p. 19-27 (ISSN 0980-8493).
- Alexeï Vassiliev (trad. Natalia Goutina), « "Faisons pleurer les dames de Saint-Pétersbourg !" (2) », Tradition Magazine, no 246, , p. 19-27 (ISSN 0980-8493).
- (en) Robert Burnham (préf. Howie Muir), Charging against Wellington : The French Cavalry in the Peninsular War, 1807-1814, Barnsley, Frontline/Pen and Sword Books, , 240 p. (ISBN 978-1-84832-591-3).
- (en) Ronald Pawly (ill. Patrice Courcelle), Napoleon's Mounted Chasseurs of the Imperial Guard, Osprey Publishing, , 48 p. (ISBN 978-1-84603-257-8).

- (en) Peter Young (ill. Michael Youens), Chasseurs of the Guard : The Chasseurs à cheval of the Garde impériale, 1799-1815, Osprey Publishing, coll. « Osprey / Men-at-Arms » (no 11), , 40 p. (ISBN 085045056X).
Chasseur de chars
Le
Jagdpanzer V (Jagdpanther), un chasseur de chars allemand de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Un chasseur de chars est un véhicule blindé, type particulier de canon automoteur, destiné principalement à la lutte antichar.
Développement
À l'origine, le besoin pour ces véhicules est venu d'une supériorité matérielle de l'arme blindée ennemie. Déjà, à la fin de la Première Guerre mondiale, les ingénieurs militaires français réfléchissent à la construction d'un véhicule blindé spécialement destiné à la lutte contre les chars ennemis.
Mais ces engins sont apparus sur le champ de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. Les armées de terre se sont munies de ces véhicules spécialisés, plus particulièrement la Wehrmacht, l'Armée Rouge et l'US Army, ainsi que toutes les autres puissances alliées ayant massivement dépendu du matériel américain durant cette période. Les chasseurs de chars n'ont pas de tourelle car le canon est trop puissant et une tourelle, bien que robuste, céderait au bout de quelques tirs. Les chasseurs de chars disposent de blindages assez léger pour être assez polyvalents et d'êtres présents sur tous les fronts.
Emploi
La destination principale des chasseurs de chars est la lutte antichar. Pour accomplir efficacement sa mission, le chasseur de chars dispose des qualités nécessaires pour lutter contre un char d'assaut : mobilité, puissance de feu, protection blindée.
Ce type de blindés s'est aussi vu confier toutes sortes de missions lors des combats, notamment réduire l'infanterie, détruire les fortifications ennemies. Néanmoins, l'absence quasi systématique de tourelle — on parle d'armement en casemate — en fait des unités moins polyvalentes que les chars d'assaut.
L'importance de ce type de véhicule militaire a diminué depuis 1945. Durant la Seconde Guerre mondiale, les unités blindées étaient plus diversifiées qu'aujourd'hui, où l'on ne retrouve sur la plupart des théâtres d'opération que des chars principaux de bataille (par exemple le char Leclerc), des véhicules de combat d'infanterie, plus légers et destinés au soutien des troupes d'infanterie mécanisées, et des transports de troupes blindés. Le rôle alors dévolu aux chasseurs de chars est aujourd'hui plutôt dévolu à l'hélicoptère de combat et aux fantassins dotés, eux aussi, de missiles antichars.
Pendant la Seconde Guerre mondiale
Les chasseurs de chars allemands
Les Allemands, pourtant partisans convaincus de la guerre mécanisée et de l'usage des chars d'assaut en tant qu'ossature et fer de lance d'unités autonomes polyvalentes et combinées, les Panzerdivisionen, constatent rapidement l'infériorité de leur matériel face à leurs adversaires. Ainsi, déjà en France, les chars B1 et Somua S-35, dont on comptait plus de 800 exemplaires, sont techniquement supérieurs aux Panzers II et III alignés par la Wehrmacht, principalement en puissance de feu et en protection.
Mais c'est en U.R.S.S. que la nécessité des chasseurs de chars se fait sentir, et ce dès le début de l'opération Barbarossa. En effet, en 1941, l'armée allemande est pourvue en Panzer II, III et IV, principalement, et aucun ne fait vraiment jeu égal avec le puissant KV-1, ni même avec l'excellent char moyen russe T-34.
Le Panzer II est obsolète, son blindage sert uniquement pour arrêter les balles et les shrapnels, et son armement ne suffit pas pour pénétrer un autre blindé (canon de 20 mm). Il convient uniquement comme véhicule anti-infanterie léger .
Le Panzer III est meilleur, mais reste inférieur face au T-34. Son canon de 37 mm (pour les premières versions) puis de 50 mm manque de puissance; et ne permet de percer le blindage d'un T-34 adverse que de derrière et à bout portant. Son blindage léger, lui confie une très bonne mobilité, mais cette dernière est pourtant inférieure à celle du T-34 et est extrêmement vulnérable aux canons antichars soviétiques de 76,2 mm.
Le Panzer IV n'est pas mieux blindé, plus gros, moins mobile que le III, mais son canon court de 75 mm peut percer plus aisément le T-34 mais ne suffit pas sur le KV-1.
Les Allemands travaillent sur la construction d'un char lourd repris d'un projet enterré avec la défaite de la France, qui deviendra le célèbre char Tigre, mais la situation sur le front se dégrade, au point que seules les pièces d'artillerie comme le canon antiaérien (Flak) de 88 mm peuvent stopper les chars russes au moyen de munitions antiblindage. Les Allemands ne supportent cet état que grâce à un entraînement supérieur, de meilleures tactiques, et à une coordination efficace due à l'usage des radios dans leurs véhicules, lesquelles font défaut dans les chars russes.
Pour combler rapidement ce manque de puissance de feu, les Allemands conçoivent un blindé spécialisé pour permettre de lutter contre les T-34 et KV
À partir d'un châssis de char, ils conçoivent un véhicule bas, bénéficiant d'une protection accrue, sans tourelle, doté d'une casemate fixe basse avec un blindage incliné favorisant les ricochets, et enfin munissent le véhicule d'un blindage frontal épais et d'un canon plus gros et souvent plus long que le modèle de char de base : le chasseur de chars est né.
Cette description peut prêter à confusion entre un chasseur de chars et un canon automoteur. La différence réside dans le fait qu'un canon automoteur est un véhicule qui bombarde en arrière des lignes, doté d'un blindage faible et d'un canon de gros calibre, mais assez court, presque un obusier, qui n'est absolument pas prévu pour détruire des chars. Le chasseur de chars, lui, hérite d'un canon plus gros mais surtout plus long, afin de maximiser la vitesse initiale de ses projectiles, favorisant ainsi la pénétration de blindage, et les trajectoires tendues nécessaires à une visée correcte.
Si dans la nomenclature allemande, il est possible de nommer Panzerjäger tous chasseurs de chars, les nominations d'usage différencient les Jagdpanzer (« blindés de chasse »), chars-casemates fermés et sans tourelle, des Panzerjäger (« chasseurs de blindé », ou canon antichar automoteur), à la superstructure ouverte et faiblement blindée. Les premiers bénéficient d'un fort blindage à l'avant qui les rendent polyvalents et aptes à se mesurer en combat direct aux chars ennemis. La dénomination officielle des Jagdpanzer Elefant, Jagdpanther ou Jagdtiger oscille ainsi entre « sturmgeschütz » et « panzerjäger » selon les dates et les luttes d'influence entre Panzerwaffe et artillerie1. Le Jagdpanzer IV sera même converti en « panzer », et le Jagdpanzer 38(t) sera prévu comme remplaçant du StuG III (lui-même étant souvent employé comme chasseur). Les chasseurs automoteurs à caisse ouverte, au blindage très vulnérable, ne sont jamais dénommés « Jagdpanzer »2.
On peut citer plusieurs modèles de chasseurs de chars allemands parmi les plus connus :
- les StuG III (1940) et StuG IV (1943) à canon long de 75 mm : il s'agit à la base d'artillerie automotrice, ce qui ajoute encore à la confusion, mais ils sont munis d'un canon beaucoup plus long qui leur donne un rôle efficace en lutte anti-blindés. Le StuG III fut le véhicule militaire blindé de combat produit en plus grand nombre par l’Allemagne au cours de la Seconde Guerre mondiale (10 500 unités).
-
-
le Jagdpanzer 38(t) Hetzer (1943): basé sur le char tchèque obsolète mais fiable et éprouvé Panzer 38(t), ce chasseur de chars combine un efficace canon de 75 mm avec une très petite taille, ce qui le rend très difficile à détruire. La désignation dans l'Armée suisse est Panzerjäger G13.
- le Nashorn (1943), également sur un châssis de Panzer IV profondément modifié. Il est bien plus légèrement blindé que les autres véhicules de cette liste sans pour autant gagner en mobilité, mais a l'avantage non négligeable d'être armé d'un canon de 88 mm PaK 43, pouvant perforer toutes les cuirasses que les alliés pouvaient mettre sur leurs chars
- le Panzerjäger Tiger (P) ou "Jagdpanzer Elefant" (1943) : équipé d'un canon de 88 mm, il est construit sur la base du Tigre de Porsche à près de 90 exemplaires
- le Jagdpanzer IV (1944) L48 puis L70 basé sur le châssis du Panzer IV et doté d'un canon de 75 mm.
- le Jagdpanzer V Jagdpanther (1944), sur base de l'excellent Panther allemand. Par rapport au modèle de base, il troque son canon de 75 contre un de 88 mm, mais garde sa mobilité par l'allègement structurel dû à la perte de la tourelle et de son mécanisme.
- le Jagdtiger (1944), sur base du Tigre royal. Ce chasseur de char est le plus gros véhicule de la Seconde Guerre mondiale à être produit en série. Il pèse plus de 70 tonnes, et son canon de 128 mm est alors le plus gros canon antichar jamais installé sur un véhicule. Cependant, trop lent pour être efficace, il reste une exception et une impasse technologique. Il sera surtout utilisé en tant que canon antichar à longue portée, du fait de sa faible mobilité et de sa consommation énorme en carburant.
- on citera également le projet de chasseur de chars lourd, Sturer Emil (Emile le têtu), construit à seulement deux exemplaires.
La mobilité étant le plus grand atout du chasseur de chars, le meilleur parmi ceux cités est le Jagdpanther[réf. nécessaire]. Ces véhicules ont une utilisation particulière : sans tourelle, les canons ne bénéficient que d'un débattement latéral limité, et il faut donc orienter tout le véhicule pour tirer. C'est un inconvénient qui en fait une pure arme d'attaque, toute sa puissance de feu concentrée vers l'avant. Par contre, le fait de ne pas avoir de tourelle diminue la surface exposée aux tirs ennemis, ce qui est un avantage en combat entre blindés.
- Comparatif des principaux automoteurs antichars (Panzerjäger) allemands (1939-1945)
-
-
-
Sd.Kfz. 135 Marder I sur châssis Hotchkiss H39, ou 7,5-cm Pak 40/1 (Sf.) auf Geschützwagen 39H(f).
-
-
Un très haut Panzer Selbstfahrlafette 1 für 7.62-cm PaK 36(r) auf Fahrgestell Panzerkampfwagen II Ausf. D1 und D2 (Sd.Kfz.132).
-
Sd.Kfz. 139 Marder III Panzerjäger 38(t) für 7,62-cm Pak 36(r), souvent confondu avec le modèle précédent (ainsi que le note la légende du cliché).
-
Sd.Kfz. 138 Marder III Ausf. H, ou Panzerjäger 38(t) mit 7.5 cm PaK 40/3 Ausf. H.
-
Plusieurs Sd.Kfz. 138 Marder III Ausf. M, ou Panzerjäger 38(t) mit 7.5 cm PaK 40/3 Ausf. M , dont la superstructure ouverte est placée à l'arrière.
-
Un Sd.Kfz. 164 Nashorn, ou 8,8 cm PaK 43 (L/71) auf Fahrgestell Panzerkampfwagen III/IV (Sf.), conservé aux côtés d'un Jagdtiger.
-
Sturmkanone 40 ou StuG IIIG (Sturmgeschütz III Ausf. G, "Sturmi"). Le 4 juin 1944 lors du défilé d'anniversaire du maréchal Mannerheim à Enso, en Finlande.
-
-
Jagdpanther (Sd. Kfz. 173) en France en juin 1944.
Les chasseurs de chars américains
L'autre famille de chasseurs de chars est celle qui est née des concepteurs américains. Le principe diffère sensiblement, mais la cause est la même : la grande supériorité des chars allemands sur les chars américains en 1944-1945. En effet, ceux-ci, surtout les Panther (1943) et les Tiger (1942), sont plus lourds, bien blindés, puissamment armés, et le Panther est aussi très rapide pour l'époque.
Le Sherman M4 américain (1942), prévu pour être produit en grand nombre et surtout facilement transportable par mer, est nettement inférieur à ce char : son blindage est insuffisant et mal conçu, parce qu'il n'est pas incliné latéralement comme celui du Panther, du T-34, du Tiger Ausf. B et des chars lourds russes en service à l'époque. De plus, son canon de 75 mm est notoirement insuffisant. Il faudra attendre l'introduction en 1944 du Sherman Firefly britannique, alourdi et équipé du canon de 17 livres (76,2 mm), pour que ce char puisse rivaliser avec le Panther, et encore, ces solutions d'expédient ne rattraperont jamais la lacune technologique : Patton se plaignait de devoir sacrifier entre deux et cinq chars Sherman (selon les sources), équipages compris, pour venir à bout d'un seul Panther. Quant au Tiger, le canon de 75 mm ne perçait pas sa cuirasse frontale, même à bout portant.
La solution américaine est plus hasardeuse que celle des Allemands. Les chasseurs de chars américains ont un gros canon long, de 76,2 mm pour les M10 Wolverine (1942) et M18 Hellcat (1944), 90 mm pour le M36 Jackson (1944), ils gardent leur tourelle, mais perdent la plus grande partie de leur blindage pour conserver la cruciale mobilité qui fait le succès de ces véhicules particuliers, le M18 Hellcat fut l’engin chenillé le plus rapide du conflit culminant à 80 km/h sur route. Ces véhicules, ainsi que les quelques Sherman modifiés par les Britanniques, seront les seuls à pouvoir s'opposer correctement aux chars allemands les plus avancés, jusqu'à la tardive arrivée au front du char lourd américain M26 Pershing, en 1945.
Un projet de chasseur de char super-lourd équipé d'un canon de 105 mm a été développé par les États-Unis, aboutissant au T28, pesant 95 tonnes, mais la fin de la guerre a mis fin au projet. Son blindage de caisse était de 63 mm aux endroits les moins exposés et montait à 300 mm en frontal, le mantelet de canon atteignait 1 410 mm d'épaisseur. Un seul exemplaire subsiste de nos jours.
Les chasseurs de chars belges
T13 B2 belge durant un exercice.
L'armée belge en 1940 ne dispose pas de véritables chars de combat à la suite de sa politique neutraliste mais est équipée d'environ 200 T13 armés d'un canon antichar de 47 mm modèle 1931 lors de la campagne des 18 jours.
Les chasseurs de chars britanniques
Outre le Sherman Firefly et le M10 Achilles en 1944, les Britanniques équipèrent deux autres véhicules de leur excellent canon antichar Ordnance QF 17 pounder : En 1943, l'Archer, sur un châssis de char Valentine, et en 1944 le Challenger, un char Cromwell réarmé.
Après la guerre, ils construisirent dans les années 1950 un dernier chasseur de chars, le Charioteer, équipé du canon Ordnance QF 20 pounder, avant que les évolutions technologiques ne rendent le concept obsolète.
Les chasseurs de chars soviétiques
SU-76M sur le champ de bataille
ISU-122 passant en tête de la colonne de l'Armée rouge qui prend
Łódź aux nazis, le 18 janvier 1945.
Les soviétiques ont produit en 1941 un chasseur de chars léger sur base du tracteur d'artillerie T-20 Komsomolets, le ZiS-30 doté du canon anti-char ZIS-2 de 57 mm.
Le canon automoteur soviétique SU-76 doté du canon ZiS-3 de (76,2 mm) combinait dès 1942 trois rôles sur le champ de bataille : canon d'assaut léger, chasseur de chars léger, et batterie d'artillerie mobile pour le tir indirect. Basé sur le châssis du char T-70, il est modifié en 1943 en SU-76M qui fut produit à 13 932 unités.
En 1943 apparait le SU-152, un obusier de 152 mm monté sur une adaptation de châssis du char lourd KV-1S. Le premier modèle est réalisé le , d'après les projets de Joseph Kotine, et il connaît son baptême du feu lors de la bataille de Koursk3. Il est surnommé « Tueur de fauves » en raison de la capacité du canon ML 20 de 152 mm à détruire les chars « Tigre I » et « Panther » allemands.
Puis les Soviétiques ont développé les SU-85 (85 mm) en 1943 et SU-100 (100 mm) en 1944 qui sont des variantes des chars T-34 avec le canon en casemate. Le SU-100 se révéla performant dans la lutte antichar, son canon 100 mm D-10S (L/54) étant susceptible de pénétrer 125 mm de blindage vertical à une portée de 2 000 mètres, ou le glacis incliné de 80 mm du Panther allemand à 1 500 mètres.
Apparait également le ISU-152 (152 mm) basé sur le char JS-2 et reprenant le canon du SU-152 : canon ML 20 de 152 mm. Construit entre 1943 et 1947, avec environ 4 600 unités produites. Le ISU-122 (122 mm) en est une variante utilisée sur le front de l'Est entre 1944 et 1945 à la fois d'abord comme canon automoteur et puis comme chasseur de chars; son obus explosif de 122 mm d'une masse de 25 kg, d'une vitesse initiale de 800 m/s et équipé d'une charge de TNT de 3 kg peut en effet arracher une tourelle de char par le seul souffle de l'explosion, mettant ainsi hors de combat les blindés rencontrés lors de son avancée.
Ces chars seront utilisé longtemps après guerre par différents pays ayant des liens avec le Bloc de l'Est.
Les chasseurs de chars français
En 1918, les ingénieurs français imaginent un chasseur de chars monté sur châssis chenillé légèrement blindé et armé d'un puissant canon antichar, mais cette idée n'aboutit pas.
En 1939, les ingénieurs reprennent cette idée. Le premier modèle de chasseur de chars est le camion tout terrain Laffly W 15 TCC armé d'un canon de 47 mm SA modèle 1937. Expérimenté début 1940, le matériel est livré à partir de mai 1940. 70 exemplaires sont produits avant l'armistice.
Un autre modèle de chasseur de chars était étudié par les ingénieurs français, sur la base du châssis de la chenillette Lorraine modèle 1937, mais le projet ne verra jamais le jour à cause de la défaite française lors de la bataille de France en mai-juin 1940. Une version ad hoc sera toutefois construite à l'arrière des combats, sous le nom de Chasseur de Chars Lorraine, et les Allemands réaliseront une conversion en série de la chenillette, le chasseur de chars Marder I.
Les chasseurs de chars roumains
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Roumanie a développé plusieurs chasseurs de chars :
Un projet roumain similaire au Hetzer, et arrivé au stade de prototype, a été le chasseur de chars Mareșal.
De nos jours
Depuis les années 1970, quelques engins blindés à roues sont catalogués comme chasseurs de chars.
Espagne
L'Espagne utilise le Centauro B1 italien, armé d'un canon de 105 mm.
France
Bien que l'AMX-10 RC, entré en service en 1981, soit armé d'un canon de 105 mm moyenne pression pouvant mettre hors de combat des chars, ceci n'est pas leur fonction première, mais secondaire.
Italie
Le Centauro B1 italien, armé d'un canon de 105 mm, entré en service en 1991, et son successeur, le Centauro II, armée d'un canon de 120 mm basse pression présenté en 2016, sont des chasseurs de chars.
Suisse
Le Mowag Piranha 6x6 armé du missile TOW porte le nom de "chasseur de char 90" (panzerjäger 90).
Bibliographie
 : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
- Stéphane Ferrard, Engins Blindés Français, Éditions E/P/A, Baume-les-Dames, 1996.
- (ro) Revista Modelism, nr.66;
- (ro) Ion.S Dumitru, Tancuri in flăcări, Ed. Nemira, București, 1999;
- (en) Mark Axworthy, Cornel Scafeș, Cristian Crăciunoiu,Third Axis. Fourth Ally. Romanian Armed Forces in the European War, 1941-1945, Arms and Armour, London, 1995. (ISBN 1854092677)
- (ro) Cornel I. Scafeș, Horia Vl. Șerbănescu et Ioan I. Scafeș, Trupele Blindate din Armata Română 1919-1947, Bucarest, Editura Oscar Print,
- (en) Romanian Armoured Finger 1941 - 1945, Editura Modelism, București
Notes et références
- Laurent Tirone, « La Wehrmacht et la course au gigantisme », Batailles & blindés, Caraktère, no 83, , p. 46 (ISSN 1765-0828)
- Laurent Tirone, « Jagdpanzer : histoire des chasseurs de chars du IIIe Reich », Trucks & Tanks Magazine, Caraktère, no 48, , p. 36 (ISSN 1957-4193)
Éclaireurs de la Garde impériale
Les éclaireurs de la Garde impériale sont des régiments de cavalerie légère de la Garde impériale sous le Premier Empire, créés par décrets des 4 et .
Dès 1806, Napoléon Ier, qui a vu à l'œuvre les tactiques employées par les cosaques russes, envisage de créer dans son armée un corps capable de s'y opposer. Il projette tout d'abord la formation de quatre régiments d'« éclaireurs à cheval », mais l'idée est abandonnée au profit de la mise sur pied des chevau-légers belges d'Arenberg. Cette unité doit à la base être un contretype des cosaques, mais elle devient finalement le 27e régiment de chasseurs à cheval en 1808. Pendant la campagne de Russie en 1812, la cavalerie française, plus lourde, s'épuise à poursuivre les cosaques, qui se dérobent constamment devant elle. Le concept de cosaques français renaît donc en 1813 avec l'organisation des krakus polonais, armés de lances, montés sur de petits chevaux et vêtus d'un uniforme semblable à celui des cosaques. Ces cavaliers se distinguent pendant la campagne d'Allemagne et combattent également en France en 1814.
Entre-temps, les 4 et , Napoléon Ier décrète la création des éclaireurs de la Garde impériale, trois régiments de cavalerie destinés à s'opposer efficacement aux cosaques. Le recrutement se fait au sein de la cavalerie de la Vieille Garde et des conscrits. Ces nouvelles unités ont le temps de participer à la campagne de France de 1814, où ils se heurtent de nombreuses fois aux cosaques. Ils servent en reconnaissance et aux avant-postes, mais mènent aussi à plusieurs reprises des charges, comme à Brienne, Montmirail et particulièrement à Craonne, lorsque le colonel Testot-Ferry conduit le 1er régiment à l'assaut de l'artillerie russe. Ils participent encore à la défense de Paris, avant d'être dissous à la Première Restauration.
Projets et formations antérieurs
Cosaques
« Des cavaliers légers qui, comme les Cosaques, entourent l'Armée d'un réseau de vigilance et de défense impénétrable, qui harassent l'ennemi, qui donnent presque toujours des coups et n'en reçoivent que fort peu, atteignent complètement et parfaitement le but que doit se proposer toute cavalerie légère. »
— Antoine Fortuné de Brack, Avant-postes de cavalerie légère, 18311.
Pendant la campagne d'Allemagne de 1805, la Grande Armée se heurte notamment aux cosaques de l'armée russe. Ces cavaliers, surtout employés à la reconnaissance et aux services d'avant-garde, pratiquent des méthodes de guerre très différentes de celles des autres nations européennes. Leur tactique, appelée la Lava, prône l'assaut en dispersion, ce qui laisse à chaque cavalier une large possibilité de manœuvres. Aux avant-postes, ils harcèlent leurs adversaires en surprenant les bivouacs ou en attaquant par petits groupes2. Très mobiles, ils jouent un rôle important lors de la campagne de Russie en 1812, où ils se dérobent continuellement devant la cavalerie française, plus lente3. Ils interceptent également les courriers et les dépêches, gênant ainsi les lignes de communications comme le remarque le maréchal Berthier : « avec ces canailles de Cosaques, on ne peut tenir secret aucun mouvement. »4.
Chevau-légers d'Arenberg
Chevau-légers d'Arenberg, compagnie d'élite en reconnaissance. Illustration de
Job, collection privée.
Napoléon, souhaitant disposer d'une cavalerie capable de s'opposer aux cosaques, met à l'étude la formation de quatre régiments d'« éclaireurs à cheval ». Les montures choisies sont des chevaux de Camargue, réputés pour leur résistance physique. Le projet du prescrit donc l'organisation de ces unités d'éclaireurs, chacune divisée en quatre escadrons et armée du sabre. Toutefois, cette mise sur pied n'est pas concrétisée et les éclaireurs à cheval ne voient pas le jour. À la même période, le , l'Empereur ordonne finalement la création du régiment des « chevau-légers belges », commandé par le duc Prosper-Louis d'Arenberg, dans le but d'en faire également un contretype des cosaques. La taille des chevaux est inférieure à celle en vigueur dans la cavalerie légère française. Cependant, une fois encore, l'idée n'est pas menée à son terme, et les chevau-légers belges deviennent le 27e régiment de chasseurs à cheval par décret du 5.
Krakus
Officier et cavaliers du régiment de Krakus. Peinture de
Jan Chełmiński, publiée dans
L'Armée du Duché de Varsovie, 1913.
En 1813, après la retraite de Russie, le général Poniatowski, commandant en chef les forces polonaises, doit évacuer Varsovie et se replie vers Cracovie pour y réorganiser ses troupes. Il y décide de la création d'un nouveau régiment de cavalerie légère, entièrement formé de cavaliers issus des classes paysannes. Ce corps prend le nom de « Krakus »note 1, et l'effectif final est arrêté à 900 hommes7. Ces derniers sont d'assez petite taille, et montés sur de petits chevaux appelés « konias ». Le , à Zittau, le régiment est passé en revue par Napoléon, qui déclare à son sujet : « Je voudrais avoir dix mille hommes comme ceux-ci, montés sur des « Konias ». C'est une excellente troupe »8.
L'Empereur pense en effet avoir trouvé dans les Krakus la réponse face aux cosaques7. L'unité est donc engagée activement dans la campagne d'Allemagne. Le , lors d'une charge contre des cosaques, le maréchal des logis Godlewski capture l'un de leurs étendards6. Ils combattent à Leipzig et y subissent de lourdes pertes. Réorganisés à Sedan au début de l'année 1814, les Krakus combattent encore pendant la campagne de France, et prennent part à la défense de Paris le 30 mars6.
Organisation
Avec la perspective dramatique d'avoir à se battre sur le sol français pour la première fois depuis les guerres de la Révolution, Napoléon Ier réorganise sa Garde impériale par deux décrets des 4 et 9. Le premier article précise la création des éclaireurs de la Garde impériale. Trois régiments sont ainsi créés : le 1er régiment (les éclaireurs-grenadiers), rattaché au régiment de grenadiers à cheval de la Garde impériale10 ; le 2e régiment (les éclaireurs-dragons), rattaché au régiment de dragons de la Garde impériale11 ; et enfin le 3e régiment (les éclaireurs-lanciers), rattaché au 1er régiment de chevau-légers lanciers polonais de la Garde impériale12. Chaque régiment est composé de quatre escadrons de 250 hommes chacun. Les deux premiers régiments sont dissous pendant la Première Restauration, le 12 mai et le respectivement. Le 3e régiment suit le sort des lanciers polonais de la Garde9.
1er régiment
Sous-officier du
1er éclaireurs, en provenance des gardes d'honneur, 1814. Illustration d'Ernest Fort, établie d'après les archives du ministère de la Guerre.
Le commandement du 1er régiment est confié au colonel Claude Testot-Ferry, ancien aide de camp du maréchal Marmont et provenant des dragons de la Garde impériale. Les chefs d'escadron sont Pierre, des chasseurs à cheval de la Garde, Delavillane, Lepot, des grenadiers à cheval, et le capitaine de Waldner-Freundstein. Ce dernier est plus tard remplacé par le chef d'escadron Kister13.
L'effectif théorique est de 53 officiers, 1 005 hommes et autant de chevaux de troupe14. La plupart des officiers, « consommés et d'une bravoure à toute épreuve » selon Testot-Ferry, sont recrutés directement dans la Garde impériale. Quelques-uns sont aussi recrutés dans la ligne, dans les 4e et 13e dragons ainsi qu'au 3e hussards. De plus, un contingent de 250 hommes, issus de chaque régiment de gardes d'honneur, est théoriquement envoyé au 1er éclaireurs, mais seul un tiers de ce nombre est détaché par les 1er, 3e et 4e gardes d'honneur13. L'Empereur a donc recours à des volontaires pour compléter l'effectif ; ces nouvelles recrues prennent le rang de Jeune Garde14. Plus tard, le régiment passe de quatre à six escadrons, avec l'adjonction de deux escadrons de gardes d'honneurs, et reçoit également en renfort des cavaliers de la ligne volontaires, peu avant la bataille de Craonne15.
Les sous-officiers, les brigadiers, les vétérinaires et les maréchaux-ferrants, ainsi que les cavaliers du 1er escadron, sont de Vieille Garde, les autres escadrons sont de Jeune Garde. Les tailles des soldats sont très disparates, allant d'un mètre soixante-dix-huit pour les anciens grenadiers à cheval à un mètre soixante pour les plus petits, et sont proportionnellement plus élevées que celles de leurs chevaux, qui vont de un mètre trente-cinq à un mètre trente-huit au garrot15.
2e régiment
Le commandement du deuxième régiment est initialement confié au colonel-major Leclerc. Quelques jours plus tard, le , il est remplacé par le colonel Laurent Hoffmayer, commandant le 2e régiment de dragons. Les escadrons sont commandés respectivement par Parizot et Lebrasseur, anciens chasseurs à cheval de la Garde, Toustaint, du 13e chasseurs à cheval, et Bourbon-Busset, du 27e chasseurs à cheval. L'encadrement est surtout fourni par la cavalerie de la Vieille Garde, le reste des cavaliers étant rattaché à la Jeune Garde. Les sous-officiers sont de provenances diverses, de la Vieille Garde jusqu'à la cavalerie de la ligne ou des gardes d'honneur16.
L'effectif théorique est de 1 000 cavaliers, répartis en quatre escadrons de 250 hommes chacun, sans compter les officiers. Le recrutement doit à la base être effectué au sein des postillons, mais dans la pratique, les affectations d'origine sont très variées : en 1814, pour combler les pertes, un marin et quelques canonniers de marine sont même engagés. Toutefois, à la différence du 1er régiment, aucun garde d'honneur n'est incorporé aux éclaireurs-dragons17.
Au début de la campagne de France, à Paris, le 2e régiment ne compte que 23 officiers, 829 cavaliers et 498 chevaux. De cet effectif, seuls 502 rejoignent l'armée de Napoléon pour participer aux premiers engagements ; deux mois plus tard, il ne reste que 200 hommes sous les rangs17.
3e régiment
Trompette et maréchal des logis du
3e éclaireurs, 1813. Illustration d'Ernest Fort, établie d'après les types de la collection alsacienne Carl.
Le commandement du 3e éclaireurs incombe sur le papier au général Wincenty Krasiński, colonel des lanciers polonais de la Garde, le général Pierre Dautancourt en étant le major. Dans la pratique, le régiment est commandé par le chef d'escadron Jan Kozietulski qui a été élevé pour la circonstance au grade de major commandant. Le 1er escadron est commandé par Szeptycki, le 2e par Skarzynski, le 3e par Zaluski et le 4e par Wąsowicz12. Les officiers de l'état-major, ainsi que ceux issus directement des lanciers polonais de la Garde, font partie de la Vieille Garde, les autres étant de Jeune Garde ; les cavaliers sont tous rattachés à la Jeune Garde18. L'encadrement est à forte proportion polonaise, à l'exception de quelques officiers français et des deux chirurgiens-majors12.
Le 9 décembre 1813, le 1er lanciers de la Garde ayant été réduit de sept à quatre escadrons, le surplus d'hommes de ce régiment forme le 3e éclaireurs. Pour le compléter, les recrues du dépôt de Sedan, notamment celles du bataillon d'élite polonais, sont enrôlées. À ce contingent de 600 hommes s'ajoute un apport de 230 soldats français de la Jeune Garde, arrivés de Courbevoie19.
À la fin du mois de janvier 1814, les éclaireurs-lanciers comptent dans leurs rangs 52 officiers et 624 hommes, dont 640 au dépôt de Givet et 36 à Chantilly. Deux mois plus tard, il y a 860 hommes présents au régiment, mais après l'abdication de Napoléon, les cavaliers d'origine française s'en vont et les 597 Polonais, qui ne sont plus au service de la France, regagnent leur pays avec le chef d'escadron Zielonka20.
Campagnes militaires
Éclaireur-dragon. Illustration parue dans le second volume de l’
Histoire des armées françaises de terre et de mer, par
Abel Hugo.
Créés en décembre 1813, les éclaireurs arrivent tard sur le théâtre des opérations et rejoignent la Garde impériale en janvier 1814, juste à temps pour participer à la campagne de France. Le 28 janvier, les premiers détachements des trois régiments forment la « brigade des éclaireurs », commandée par le général Dautancourt21.
« Brigade des éclaireurs »
Les éclaireurs reçoivent leur baptême de feu à la bataille de Brienne, le , où les charges contre les troupes prusso-russes près du village de Perthes leur coûtent le capitaine Drion du 1er régiment, blessé22. Le 1er février, Napoléon, en grande infériorité numérique, livre bataille à l'armée coalisée à La Rothière. Au cours des combats, le général Nansouty fait parvenir à Dautancourt l'ordre de charger les Russes avec sa brigade. Celle-ci s'exécute et mène des attaques répétées contre la cavalerie et l'infanterie adverses, stoppant dans un premier temps leur progression avant de reculer face à la disproportion des forces23. Les éclaireurs perdent dans la mêlée le capitaine Zaluski, prisonnier, et une quinzaine d'hommes tués ou blessés22. L'Empereur ordonne la retraite sur Troyes, et le 7 février, la brigade est dissoute et chaque régiment d'éclaireurs rejoint l'unité de la cavalerie de la Garde auquel il est rattaché. Le 3e régiment se voit adjoindre deux escadrons supplémentaires, amenés depuis Paris par le chef d'escadron Skarzynski24.
De Champaubert à Craonne
Charge des lanciers polonais du général Pac au combat de Berry-au-Bac, 5 mars 1814. Gravure de
Félix Philippoteaux.
Napoléon, depuis Troyes, décide de reprendre l'offensive, et le , il attaque et bat le corps d'armée du général Olsouviev à Champaubert. Un escadron du 3e éclaireurs, mené par le chef d'escadron Skarzynski, prend part à la charge de la cavalerie française et à la destruction des carrés russes. Le lendemain, pendant la bataille de Montmirail, les 1er et 2e régiments, sous les ordres du colonel Testot-Ferry, enfoncent une nouvelle fois les formations russes avec les dragons de la Garde et font de nombreux prisonniers25. Les victoires françaises de Château-Thierry, Vauchamps et Montereau, les 11, 14 et 18 février, confortent la situation militaire française et permettent de protéger la route de Paris.
Les éclaireurs participent à la poursuite des troupes du feld-maréchal Blücher et se mesurent à plusieurs reprises à des patrouilles de cosaques. La capitulation de Soissons, le 3 mars, sauve les Prussiens qui parviennent à franchir l'Aisne et à faire leur jonction avec d'autres corps d'armée. Napoléon ordonne alors au général Nansouty, commandant la cavalerie de la Garde, de s'emparer du pont de Berry-au-Bac afin de permettre aux forces françaises de traverser l'Aisne. Le 5 mars, la division Nansouty et les lanciers polonais du général Pac arrivent devant la ville et chargent les cosaques russes qu'ils trouvent devant eux. Le chef d'escadron Skarzynski, du 3e éclaireurs, s'empare du pont de Berry-au-Bac et disperse ses adversaires, avec l'aide du reste de la cavalerie de Nansouty. Le général Dautancourt écrit à propos de cet engagement que « l'impétuosité de l'attaque fut telle que l'ennemi ne put faire qu'une faible résistance […]. Chargé de nouveau par le brave Skarzynski et voyant toute la division prête à fondre sur lui, il fut mis dans une déroute si complète que je ne crois pas qu'on n'ait jamais vu de cavalerie fuir avec un abandon aussi désespéré. »26.
À présent, Napoléon peut reprendre sa marche en avant et décide de se porter à la rencontre des armées coalisées. C'est la bataille de Craonne, le . L'infanterie du maréchal Ney s'élance à l'assaut du plateau, mais, tenue en échec par l'artillerie russe, elle subit de lourdes pertes. Pour rétablir la situation, le colonel Testot-Ferry enlève le 1er régiment d'éclaireurs et charge les canons sous le feu des bataillons russes. Son cheval est abattu, le chef d'escadron Kister est tué, et une contre-attaque de la cavalerie adverse oblige les éclaireurs-grenadiers à se replier sur leurs positions de départ27. Testot-Ferry, remplaçant le général de Levesque de Laferrière blessé, repart une nouvelle fois en avant avec ses cavaliers et réussit à capturer les batteries coalisées, au prix de nombreuses pertes. La victoire est française, et l'Empereur récompense le colonel Testot-Ferry en le faisant baron de l'Empire27.
De Laon à Arcis-sur-Aube
Napoléon au pont d'Arcis-sur-Aube. Gravure du
XIXe siècle d'après le tableau de
Jean-Adolphe Beaucé.
Le 10 mars, Napoléon attaque de nouveau l'armée de Blücher, retranché sur le plateau de Laon. Des détachements d'éclaireurs, aux côtés d'une partie de la cavalerie de la Garde, forcent les Alliés à se replier dans la ville, mais l'infanterie française est repoussée et Napoléon donne l'ordre de retraite. Le même jour, Soissons est réoccupé par un contingent français, qui comprend une centaine d'éclaireurs du 2e régiment28. Le 13 mars, l'armée française se présente devant Reims, défendue par les forces prusso-russes du général Saint-Priest. Les éclaireurs, empruntant des sentiers détournés, pénètrent dans Reims à la tête de la cavalerie française, et affrontent leurs ennemis aux côtés des gardes d'honneur du général de Ségur29. Dans l'action, le capitaine Gaiette, des éclaireurs-dragons, est tué29, tandis que le chef d'escadron Szeptycki capture un bataillon prussien avec un escadron du 3e régiment30.
Le 19 mars, alors que Napoléon marche contre l'armée de Schwarzenberg, la division Letort, qui comprend le 1er régiment d'éclaireurs, chassent les Coalisés de Méry-sur-Seine et s'empare d'un équipage de pont de l'armée de Bohême31. Le 20 mars, l'Empereur affronte Schwarzenberg à Arcis-sur-Aube. La cavalerie des Alliés charge les grenadiers à cheval, les chasseurs à cheval et les éclaireurs-grenadiers qui, submergés, reculent en direction de Méry, où ils reçoivent l'appui inopiné de la cavalerie du général Lefebvre-Desnouettes. Un moment entouré par les cosaques, l'état-major impérial est secouru par les escadrons de service et par les éclaireurs du colonel Testot-Ferry32. Dans l'engagement, ce dernier a son cheval tué sous lui et est fait prisonnier : « on ne tarda pas, dans l'entourage de l'Empereur à s'apercevoir de la disparition de l'intrépide major-colonel des Eclaireurs de la Garde ; on le crut tué et tous en exprimèrent leurs vifs regrets. »33. Les pertes au sein des éclaireurs sont élevées, en particulier chez les 2e et 3e régiments32.
Saint-Dizier et la bataille de Paris
La Barrière de Clichy, toile d'
Horace Vernet illustrant la défense de Paris le 30 mars 1814.
Le 24 mars, les Alliés décident de marcher sur Paris, toutes forces réunies. Le général Wintzingerode est chargé de faire diversion en attirant sur lui les troupes de Napoléon. Il occupe Saint-Dizier avec un petit contingent, et le 26 mars, il fait face à la cavalerie de la Garde, arrivée sur place. L'Empereur se met lui-même en tête de ses cavaliers, épée à la main, et charge les Russes qui sont rapidement enfoncés. À cette occasion, les éclaireurs se distinguent « avec l'abandon et la fureur qui les transportaient toujours à la vue de ces ennemis. »34.
Cependant, le 30 mars, l'armée coalisée se présente devant Paris et attaque les 30 000 défenseurs français. Le général d'Ornano, commandant la Garde impériale à Paris, confie le commandement de la cavalerie de la Garde au général Dautancourt. Ce corps disparate, fort de 800 hommes, comprend des grenadiers à cheval, des chasseurs à cheval, des lanciers polonais, des mamelouks, des dragons et des éclaireurs provenant essentiellement du 3e régiment35. Un détachement de ce dernier a participé le 29 mars à la bataille de Claye aux côtés des krakus polonais, et le même jour, la majeure partie des cavaliers de Dautancourt part escorter l'impératrice Marie-Louise à Blois. Réduite à 330 cavaliers, la brigade participe le lendemain à la bataille de Paris. Le major Kozietulski, commandant le 3e éclaireurs, engage les assaillants près d'Aubervilliers et s'efforce de ralentir leur progression, tandis que le reste des cavaliers de la Garde se porte vers Montmartre et se bat dans les vignes des Batignolles. Le sous-adjudant major Pélissier, des éclaireurs-lanciers, est blessé36. Trop peu nombreuse face à l'infanterie adverse, canonnée par une batterie, la brigade Dautancourt rentre dans la capitale et se regroupe sur le boulevard des Italiens, où elle apprend la capitulation de Paris37.
La brigade reçoit l'ordre de se retirer sur Villejuif, et le 31 mars, le capitaine Horaczko fait sauter les ponts de Vitry et Choisy-le-Roi avec un détachement du 3e régiment d'éclaireurs, signant ainsi « la dernière action de guerre des éclaireurs de la Garde impériale »37.
Uniformes
1er régiment
Éclaireur-grenadier, 1814. Illustration d'Ernest Fort, établie d'après les devis, fournitures et effets confectionnés pour le régiment, 1908.
Les uniformes du 1er escadron, rattaché à la Vieille Garde, reprennent en grande partie le style hussard, basés sur ceux des gardes d'honneur : un dolman vert foncé et une pelisse aux lacets blancs. Les trois autres escadrons, rattachés à la Jeune Garde, portent des uniformes se rapprochant de ceux des chasseurs à cheval de la ligne, comme l'habit-veste vert foncé, appelé aussi « Kinski ».
Troupe
La coiffure adoptée est le shako, aussi bien pour les escadrons de Vieille Garde que de Jeune Garde. Celui-ci est en cuir noir, orné en haut d'une course d'anneaux écarlates avec soutaches de même couleur. Les jugulaires sont en métal blanc, ainsi que l'aigle au centre du shako. Le plumet écarlate à plumetis noir est fixé à une cocarde38. Les gardes d'honneur incorporés au 1er éclaireurs conservent leur coiffe en drap écarlate, avec cependant une modification du galon pour se différencier de leur corps d'origine. Le bonnet de police est de couleur verte, avec galon blanc et passepoil écarlate38.
Pour les éclaireurs de Vieille Garde, l'habit comporte un dolman et une pelisse vert foncé, décorés de ganses carrées, de tresses et de soutaches en laine blanche39. Les boutons sont en métal blanc. Le dolman est à collet et parements écarlates, avec doublure blanche et basane rouge. Pour la pelisse, la fourrure est noir, avec la même doublure que le dolman39. L'uniforme porté par les cavaliers de Jeune Garde, plus sobre, comprend un habit-veste vert foncé « à la Kinski », à distinctives écarlates et garni d'une rangée de boutons blancs. Le pantalon est en drap gris, avec une bande écarlate40.
Trompettes
Les trompettes du 1er régiment d'éclaireurs portent un shako identique à la troupe, mais ne perçoivent que les pelisses. Celles-ci sont bleues célestes, couleur distinctive des trompettes de la cavalerie de la Garde, avec tresses, soutaches et ganses blanches. Les tresses du trompette-major sont à alternance bleue et blanche. La ceinture-écharpe est en étoffe blanche et cramoisie39.
Officiers et sous-officiers
Les shakos des sous-officiers sont les mêmes que ceux de la troupe. Leur pelisse a comme différence les ganses, tresses et soutaches mélangées de vert et de blanc.
Pour les officiers, la course d'anneaux et les soutaches du shako sont blanches, en lieu et place de la distinctive écarlate. Le dolman est semblable à celui de la troupe, sauf pour la fourrure et les galons de grades, blancs. Le pantalon est bleu à bande blanche39.
2e régiment
Major du
2e régiment d'éclaireurs. Illustration de
Job.
Le général Drouot écrit dans un rapport à Napoléon du : « l'habillement qui paraîtrait convenir au 2e éclaireurs est celui des chevau-légers lanciers de la Ligne ; en prenant l'habit-veste de même couleur que l'habit des dragons de la Garde, en adoptant les revers des dragons, le 2e éclaireurs serait distingué et aurait une grande ressemblance avec le corps auquel il appartient »41. Néanmoins, seule l'indication « l'habillement sera celui des chasseurs de la Ligne » apparaît dans le décret signé le surlendemain41.
Troupe
Les éclaireurs-dragons portent un shako tronconique, une innovation dans l'armée française, en drap cramoisi avec une course d'anneaux noire en haut de la coiffe, encadrée par deux soutaches de même couleur41. Le couvre-nuque, situé à l'arrière, est en cuir noir, et les jugulaires sont en laiton sur cuir. Le pompon est fixé au-dessus de la cocarde, maintenu par un bouton entouré d'une double tresse aurore42. Les cordons sont aurore et sans raquettes43.
L'habit-veste court vert foncé, avec des boutons en métal blanc et des lacets argent, est identique à celui porté par les éclaireurs-grenadiers de Jeune Garde, avec distinctive cramoisie43. Les cavaliers disposent également d'une veste d'écurie verte43. Pour le pantalon, il en existe deux sortes : le pantalon vert, sans basane, qui arbore une double bande cramoisie, et un second modèle, en drap gris basané, commun à la cavalerie légère42. Les buffleteries sont en cuir noir43.
Trompettes
L'uniforme des trompettes du 2e éclaireurs est similaire à celui de la troupe, sauf pour l'habit-veste bleu céleste43. Cette tenue est dépourvue de revers cramoisis, contrairement à celui du trompette-major. Le collet et les parements sont cramoisis, et bordés d'un galon aurore44.
Officiers et sous-officiers
L'uniforme des sous-officiers du 2e éclaireurs ne diffère pas beaucoup de celui de la troupe43. Le shako des officiers se distingue, quant à lui, par la course d'anneaux et les soutaches dorées, ainsi qu'avec le cordon à raquettes45. L'habit-veste vert est en drap plus fin par rapport aux simples cavaliers. Le pantalon de route est en drap gris, avec deux bandes en or42.
3e régiment
Éclaireur-lancier du
3e régiment, 1814. Illustration d'Ernest Fort, établie d'après les archives du ministère de la Guerre, 1908.
Les uniformes sont similaires à ceux des lanciers polonais de la Garde impériale, avec la présence d'un chapska et d'un kurtka bleu foncé.
Troupe
Le chapska, fabriqué à 830 exemplaires par le chapelier Chardon, est semblable à celui porté par les lanciers rouges de la Jeune Garde, sauf pour la couleur46,47.
Le kurtka est le même que celui des lanciers polonais de la Vieille Garde, avec toutefois un drap de moindre qualité. Ce drap est bleu foncé, avec revers, collet, passepoils et parements cramoisis. L'épaulette et l'aiguillette blanches sont seulement arborées par les éclaireurs issus du 1er lanciers de la Garde, les autres portant la contre-épaulette46. Les cavaliers du 3e éclaireurs ont également une ceinture à rayures blanches et bleues, portée habituellement par les lanciers polonais de la ligne44. Les pantalons de cheval sont en drap gris basané, mais ne présentent pas de bande cramoisie46.
Trompettes
Le chapska est en drap cannelé blanc, avec cordons, raquettes et glands en fil cramoisi et blanc. Le pompon aurore est fixé au-dessus de la croix de Malte48.
Le kurtka est en drap bleu céleste, avec distinctives cramoisies. Les épaulettes et l'aiguillette sont à alternance de fil cramoisi et blanc. Les revers, le collet et les parements sont bordés d'un galon d'argent48.
Officiers et sous-officiers
Les sous-officiers du régiment revêtent la tenue des lanciers polonais de la Garde impériale, avec distinctives d'argent46. Les officiers portent également le même uniforme que leurs homologues de la Vieille Garde : le kurtka est bleu foncé à revers cramoisis, avec les distinctives et les broderies d'argent propres aux officiers44.
Chevaux et harnachement
Cheval ardennais. Gravure parue dans l'ouvrage La connaissance générale du cheval d'Eugène Gayot, 1861.
La campagne de Russie en 1812 ayant entraîné la mort de nombreuses montures, Napoléon débute la campagne d'Allemagne avec une cavalerie à l'effectif très réduit49. Vers la fin de l'année 1813, la retraite vers la France conduit à l'abandon des plaines allemandes, riches de chevaux de grande taille destinés à la cavalerie lourde. Cet état de fait conduit l'Empereur à utiliser davantage les espèces chevalines françaises, jusque-là peu demandées pour le service de la guerre50.
Pour la remonte des éclaireurs de la Garde impériale, Napoléon prescrit des chevaux de 4 pieds 2 pouces à 4 pieds 3 pouces, et âgés d'entre cinq et six ans50. Les montures proviennent essentiellement des Pyrénées, du Massif central, des Ardennes et de la Camargue. Le colonel Testot-Ferry se déclare particulièrement satisfait des chevaux ardennais, « petits de taille, mais en général vigoureux et ayant beaucoup de fonds »51. Le harnachement des éclaireurs est repensé et conçu différemment par rapport au reste de la cavalerie légère française ; le poids est en effet allégé, avec le retrait des fontes de pistolets, de la martingale, du surfaix, du licol, du bridon et de la chabraque. Il en résulte également un prix plus modique, un éclaireur ne dépensant que 63 francs pour son harnachement, contre 113 pour les selles des chasseurs à cheval et des hussards52.
Notes et références
Notes
- Le terme « Krakus » provient de Kraków, nom polonais de la ville de Cracovie. La plupart des cavaliers du régiment sont en effet recrutés dans cette région6.
Références
- Brunon et Brunon 1962, p. 47.
- Brunon et Brunon 1962, p. 47 et 48.
- Brunon et Brunon 1962, p. 49.
- Brunon et Brunon 1962, p. 50.
- Brunon et Brunon 1962, p. 7 et 8.
- Pigeard 1999, p. 54.
- Pawly 2006, p. 6.
- Brunon et Brunon 1962, p. 10.
- Pigeard et Bourgeot 2013, p. 75.
- Brunon et Brunon 1962, p. 15 et 17.
- Brunon et Brunon 1962, p. 15 et 27.
- Brunon et Brunon 1962, p. 33.
- Brunon et Brunon 1962, p. 17.
- Brunon et Brunon 1962, p. 18.
- Brunon et Brunon 1962, p. 19.
- Brunon et Brunon 1962, p. 27.
- Brunon et Brunon 1962, p. 28.
- Tranié et Carmigniani 1982, p. 160.
- Brunon et Brunon 1962, p. 34.
- Brunon et Brunon 1962, p. 34 et 35.
- Brunon et Brunon 1962, p. 56.
- Brunon et Brunon 1962, p. 57.
- Pawly 2006, p. 20 et 21.
- Brunon et Brunon 1962, p. 57 et 58.
- Brunon et Brunon 1962, p. 58.
- Brunon et Brunon 1962, p. 60.
- Brunon et Brunon 1962, p. 62.
- Brunon et Brunon 1962, p. 60 et 62.
- Brunon et Brunon 1962, p. 63.
- Pawly 2006, p. 38.
- Brunon et Brunon 1962, p. 65.
- Pawly 2006, p. 40.
- Brunon et Brunon 1962, p. 66 et 67.
- Brunon et Brunon 1962, p. 68.
- Brunon et Brunon 1962, p. 69.
- Brunon et Brunon 1962, p. 70.
- Brunon et Brunon 1962, p. 71.
- Brunon et Brunon 1962, p. 21.
- Jaeger 2001, p. 32.
- Jaeger 2001, p. 32 et 33.
- Brunon et Brunon 1962, p. 30.
- Jaeger 2001, p. 33.
- Brunon et Brunon 1962, p. 31.
- Pawly 2006, p. 47.
- Brunon et Brunon 1962, p. 32.
- Brunon et Brunon 1962, p. 37.
- Jaeger 2001, p. 34.
- Pawly 2006, p. 32.
- Brunon et Brunon 1962, p. 38.
- Brunon et Brunon 1962, p. 39.
- Brunon et Brunon 1962, p. 39 et 40.
Annexes
Bibliographie
 : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
- Jean Brunon et Raoul Brunon (ill. Pierre Benigni et Louis Frégier), Les éclaireurs de la Garde impériale : 1813-1814, Marseille, Collection Raoul et Jean Brunon, , 72 p. (OCLC 67376767, lire en ligne [archive])

- François-Guy Hourtoulle, Jack Girbal et Patrice Courcelle, Soldats et uniformes du Premier Empire, Histoire et Collections, , 208 p. (ISBN 978-2-913903-54-8)
- Gérard Jaeger, Les éclaireurs de la Garde impériale, coll. « Tradition Magazine » (no 164), (ISSN 0980-8493)

- Alain Pigeard et Vincent Bourgeot, La Cavalerie de la Garde Impériale, Soteca, , 100 p. (ISBN 979-10-91561-58-7)

- Alain Pigeard, « Les différentes unités de l'armée du duché de Varsovie : Krakus », Tradition Magazine, no 8 (hors-série) « Napoléon et les troupes polonaises 1797-1815 : de l'Armée d'Italie à la Grande Armée », (ISSN 0980-8493)

- Jean Tranié et Juan-Carlos Carmigniani, Les Polonais de Napoléon : l'épopée du 1er régiment de lanciers de la garde impériale, Copernic, , 179 p. (OCLC 144689780)

- Jean Tranié et Juan-Carlos Carmigniani, Napoléon : 1814 - La campagne de France, Pygmalion/Gérard Watelet, , 315 p. (ISBN 978-2-85704-301-0)
- (en) Ronald Pawly (ill. Patrice Courcelle), Napoleon's Scouts of the Imperial Guard, Osprey Publishing, coll. « Osprey / Men-at-Arms » (no 433), , 48 p. (ISBN 978-1-84176-956-1, lire en ligne [archive])

Articles connexes
Garde impériale (Premier Empire)
La Garde impériale était un corps d'armée d'élite du Premier Empire, constitué de soldats vétérans et destiné à protéger fidèlement l'Empereur des Français et à servir de réserve d'élite à la Grande Armée lors des batailles. Elle fut créée par l'empereur Napoléon Ier le 18 mai 1804 à partir de l'ancienne Garde des consuls, simple unité assurant la protection du gouvernement à l'intérieur ainsi que la sécurité des consuls de la République.
Dans les faits, la Garde impériale ne servit que sous le commandement direct de Napoléon et constitua la force sur laquelle ce dernier pouvait toujours s'appuyer en toute circonstance. La Garde était composée des soldats les plus valeureux qui, initialement, avaient pour la plupart participé aux guerres de la Révolution et qui étaient totalement dévoués à la personne de l'Empereur. Son effectif ne cessa d'augmenter : de 9 798 hommes en 1804, elle atteignit celui d'une armée, 112 482 hommes en 1814, placés sous les ordres directs de l'Empereur. Lors des campagnes de 1813 à 1815, elle fut divisée en Vieille Garde, Moyenne Garde et Jeune Garde, ces dernières formées de recrues plus jeunes. Chaque corps de la Garde avait ses unités de cavalerie, d'artillerie et d'infanterie.
Genèse
Ce corps servait à l'origine de garde particulière aux gouvernements de la période révolutionnaire (Garde du Directoire mais aussi du Corps législatif) puis aux Consuls (Garde des consuls) et enfin à l'Empereur (Garde impériale). Elle était à l'origine constituée de grenadiers à pied et à cheval ainsi que de quelques unités d'artillerie. À la suite de l'intervention de Lucien Bonaparte, elle se rallie à Napoléon lors de son coup d'État du 18 Brumaire. La Garde devant servir de modèle à l'armée, elle se transforma en unité combattante d'élite et devint la réserve ultime de l'armée. Elle est utilisée, en dernier ressort, pour donner le coup de grâce ou débloquer une situation périlleuse, à l'instar de la Garde prétorienne romaine.
Mission
La mission principale de la Garde était la protection de l'Empereur, mais rapidement la Garde devint une unité combattante. Réserve de l'armée, elle forma son épine dorsale et devait être irréprochable. Passivement, elle servait également à encadrer les autres troupes et renforçait la cohésion au sein de toutes les unités par sa seule présence et son comportement. La Garde accompagnait l'Empereur dans ses déplacements en campagne et il n'était pas rare de la voir à marche forcée sur les traces de l'Empereur pour le rejoindre à tel ou tel bivouac prévu.
Quand Napoléon couchait au milieu de ses troupes, c'était invariablement au milieu de la Garde. La Garde possédait un uniforme plus prestigieux et de meilleure coupe, ainsi qu'un armement qui lui était propre. La solde y était supérieure et la nourriture meilleure. Elle était prioritaire en ravitaillement pendant les campagnes et avait souvent le privilège de cantonner à Paris en temps de paix. Elle disposait en outre de son propre corps de musiciens. Au combat, la Garde portait la grande tenue (sauf à Waterloo).
Napoléon passant la Garde en revue à la
bataille d'Iéna, le 14 octobre 1806.
La Garde comprenait également des corps de cavalerie, dont les célèbres chasseurs à cheval ainsi qu'une unité de lanciers polonais, particulièrement fidèles à l'Empereur. Les chasseurs à cheval étaient les unités favorites de l'Empereur, et s'il dormait en campagne au milieu de la Garde à pied, il portait très souvent l'uniforme vert de colonel des chasseurs à cheval de la Garde. Citons aussi les grenadiers à cheval, les dragons de l'Impératrice et la gendarmerie d'élite, etc. Dans ces régiments montés l'on peut être de Vieille Garde, de Moyenne ou de Jeune Garde, les premiers régiments ou escadrons indiquant l'appartenance par ordre décroissant. La Garde possède également sa propre artillerie, à pied ou à cheval, célèbre pour ses pièces de 12, « les plus belles filles de l'Empereur ».
La Garde compta dans ses rangs des régiments aussi hétéroclites que des mamelouks ou des éclaireurs tartares, des Gardes hollandais à l'uniforme blanc et une petite Garde attachée au roi de Rome, le fils de l'Empereur et futur Napoléon II — il était d'ailleurs consigné que pour ces enfants le port de la moustache n'était pas obligatoire. Cette unité se battit avec courage dans les vignes de Montmartre en 1814, refusant de décrocher jusqu'à l'ultime instant, pendant que les vétérans réformés de la Garde, « les vieux de la Vieille » se battaient avec acharnement autour des Invalides. Elle contint également des unités d'artillerie, redoutables et redoutées, de marins qui furent de presque toutes les campagnes en combattant à pied, remplaçant le plus souvent les artilleurs de la Garde tués au combat. La Garde a ses instructeurs et une administration qui lui est propre, ainsi qu'un service de santé dirigé par le célèbre chirurgien Dominique-Jean Larrey.
Pour l'anecdote, lorsqu'un soldat de la Vieille Garde part en retraite ou est réformé, il devient « un vieux de la Vieille », expression restée de nos jours. Napoléon est particulièrement bienveillant envers sa Vieille Garde, qui lui voue en retour une admiration sans bornes. L'Empereur, qui savait mener les hommes, utilisait fréquemment sur ces soldats des gestes symboliques qui galvanisaient ces troupes ; le fameux « tirage d'oreille », ou la remise de sa propre Légion d'honneur, appelée « La croix », à un soldat particulièrement valeureux. Ainsi, le fin du fin était de recevoir de l'Empereur sa propre croix qu'il détachait de sa poitrine pour l'accrocher lui-même à l'uniforme du soldat courageux. Hors campagne, Napoléon se promenant dans les parcs avec l'Impératrice et son fils, confiait souvent ce dernier à un vieux grenadier ou chasseur de service, qui le portait dans ses bras. C'était pour le vieux soldat la récompense suprême.
Ainsi, celui qui fut appelé ultérieurement l'Aiglon, le roi de Rome, était pour eux aussi un objet de vénération. À la Restauration de 1814, la Vieille Garde, rebaptisée « Grenadiers de France », avait une tendance à tomber subitement aphone au moment de crier « Vive le Roi ». Ces fidèles de Napoléon, pour ne pas être punis, eurent recours au subterfuge suivant : ils criaient « Vive le Roi », puis quelques-uns rajoutaient « de Rome », titre de l'Aiglon (il mourra en 1832).
Les vétérans de la Vieille Garde sont considérés comme les soldats les plus valeureux de l'histoire militaire française.
Formation et recrutement
Boucle de ceinture d'officier de la Garde.
La Garde impériale fut constituée au début de l'Empire par décret impérial du 10 thermidor an XII (29 juillet 1804). La Garde consulaire devint alors la Garde impériale, créée officieusement dès le 19 mai. Elle comprit dans un premier temps deux régiments, un de grenadiers et un de chasseurs. Chacun de ses régiments était composé de trois bataillons, deux bataillons de garde et un bataillon de vélites, et organisé comme suit :
Chaque bataillon de Garde est constitué de 8 compagnies comprenant chacune1 : 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 4 sergents, 1 fourrier, 8 caporaux, 2 sapeurs, 80 grenadiers ou chasseurs et 2 tambours.
Le bataillon de vélites était constitué de cinq compagnies comprenant chacune : 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 4 sergents, 1 fourrier, 8 caporaux, 172 vélites et 2 tambours. L'encadrement est assuré par des colonels et généraux en premier et en second, avec à sa tête un général d'armée ou un maréchal d'Empire. Le vélite était un futur garde destiné à être versé dans les effectifs des deux premiers bataillons si besoin est pour les besoins de l'encadrement (départ pour les vétérans de la Garde, pertes subies, mutations, promotions ou exclusions). Une taille minimale fut imposée, environ 1,76 m pour les grenadiers et 1,73 m pour les chasseurs (cela était valable aussi pour les unités de cavalerie).
Il fallait un minimum de 10 ans de service pour entrer au 1er régiment de grenadiers à pied de la Garde impériale, et 8 pour le second, ainsi qu'avoir eu au cours de combats un comportement irréprochable, être de bonne moralité et savoir lire et écrire. Bien que cette dernière consigne semble avoir été quelquefois oubliée, elle était néanmoins une condition d'entrée. Pour les officiers, deux ans sont ajoutés à chaque critère. La valeur de ces régiments provenait ainsi des rigoureuses conditions de recrutement. Les soldats étaient admis dans la Garde pour leurs qualités de soldat, non par qualité de naissance ou par népotisme. La discipline au sein de ce corps était dure, mais humaine. Une sanction d'expulsion vers la ligne est définitive. Chaque garde obtenait le grade supérieur dans la ligne. Un caporal de la Garde, par exemple, était caporal-chef dans la ligne.
Les châtiments corporels y étaient interdits, les gardes se vouvoyaient et s'appelaient « Monsieur ». Le port de la moustache « en crosse de pistolet » était obligatoire, ainsi que celui des pattes ou favoris. La moustache était cependant rasée pendant les quatre mois d'hiver. Les sapeurs portaient la barbe. La Vieille Garde portait les cheveux longs en deux tresses nouées sur la nuque et poudrées de blanc/gris, attachées avec un cordonnet frappé d'une grenade d'argent ou à l'Aigle. Les cheveux poudrés blancs virant au gris contribuèrent à son appellation « Vieille » Garde. Chaque soldat de la Vieille Garde portait aussi, à chaque lobe d'oreille, un anneau d'or de la taille d'un écu.
Outre la Vieille Garde, se trouve aussi la Moyenne Garde constituée en 1806 avec les vélites de la Garde et composée de fusiliers-grenadiers et de fusiliers-chasseurs, puis la Jeune Garde créée en 1808, composée de tirailleurs (futurs grenadiers) et de voltigeurs (futurs chasseurs), unités destinées à servir de pépinière à la Vieille Garde. La Moyenne Garde fut plus exposée au combat que ses aînés. Quant à la Jeune Garde, elle y était engagée sans précautions particulières, et presque systématiquement ; ils formeront la future Vieille Garde et doivent donc être des combattants expérimentés. À Waterloo, la Moyenne Garde n'existait plus car elle est officiellement intégrée à la Vieille Garde. Néanmoins, ils étaient toujours appelés Moyenne Garde par les autres troupes.
Tous les officiers de la Garde étaient de Vieille Garde, les sous-officiers montaient d'un cran dans la hiérarchie, un sous-officier de la Jeune Garde faisant partie de la Moyenne Garde, et ainsi de suite. Notons que Napoléon veillait soigneusement à ce que rien ne soit écrit sur la Garde impériale. Même le journal militaire officiel ne publia jamais une seule ligne sur elle. Ainsi, l'ennemi pouvait difficilement en pénétrer la nature, ou en savoir la composition.
Période de la liste d'adresses (conseil d'administration) (1795–1799) :
- Année 1795 - 242 hommes.
- Année 1796 - 224 hommes.
- Année 1799 - 2 089 hommes.
Période du consulat (1799–1804) :
- Année 1800 - 4 178 hommes.
- Année 1802 - 7 266 hommes.
- Année 1804 - 9 798 hommes.
Période impériale (1804–1815) :
- Année 1805 - 12 187 hommes.
- Année 1807 - 15 361 hommes.
- Année 1808 - 15 392 hommes.
- Année 1809 - 31 203 hommes.
- Année 1810 - 32 150 hommes.
- Année 1811 - 51 960 hommes.
- Année 1812 - 56 169 hommes.
- Année 1813 - 92 472 hommes.
- Année 1814 - 112 482 hommes.
- Année 1815 - 25 870 hommes.
Identité visuelle
Comme les autres unités de la Grande Armée, la Garde impériale arborait fièrement ses drapeaux et aigles confiés par l'Empereur lors d'une cérémonie, le 5 décembre 1804 et mise en peinture par Jacques-Louis David. De 1804 à 1812, les unités de la Garde vont arborer un drapeau carré bleu-blanc-rouge contenant diverses inscriptions dont la devise de la Grande Armée "VALEUR ET DISCIPLINE". À partir de 1812, Napoléon désire réformer et uniformiser les étendards, donnant naissance à la disposition contemporaine. Le drapeau tricolore moderne prend alors la suite avec, sur le revers, la liste des grandes victoires auxquelles l'unité a participé. La Vieille Garde pouvait se targuer de noms allant de Marengo (1800) à la Moskova (1812).
-
Avers du drapeau du 1er Régiment de la Garde impériale (1804-1812)
-
Revers du drapeau du 1er Régiment de la Garde impériale. Chaque bataillon possédait son propre étendard comme ici, le 1er Bataillon.
-
En 1812, l'Empire rationalise et standardise ses drapeaux régimentaires. La Garde ne fait pas exception.
-
Au revers des drapeaux modèle 1812, le nom des grandes victoires du régiment.
Combats de la Garde
Grenadier du
3e régiment de grenadiers à pied de la Garde impériale.
La Garde impériale, unité prestigieuse, sert de réserve dans les batailles : elle n’est engagée qu’au moment décisif ou même ne combat pas. Ainsi, de nombreux bulletins de victoire se terminent par les mots : « la Garde n’a pas donné ».
Campagne d’Allemagne
En 1805 en Allemagne, la Garde mène des combats sporadiques, combattant à Elchingen. À Langenau, les chasseurs à cheval chargent la division Werneck à 400 contre 1 500. À Nuremberg, les chasseurs à cheval s'emparent d'un parc d'artillerie tandis que les grenadiers marchent en tête portant chacun un drapeau pris à l'ennemi, conséquence directe de la reddition d’Ulm.
À Austerlitz, la Garde à pied ne donne pas contrairement à l'artillerie et la cavalerie. Les grenadiers à cheval exécutent une charge contre la Garde impériale russe et font prisonnier le prince Repnine, qui y sert comme chef d'escadron. Il y a au total 3 officiers (parmi lesquels le colonel Morland des chasseurs à cheval) et 22 sous-officiers et soldats tués ou mortellement blessés.
Campagne de Prusse
Les grenadiers à cheval de la Garde à la bataille d'Eylau.
La Garde ne donne pas lors de la campagne de Prusse. À Eylau, le général Dalhmann, qui a succédé à Morland à la tête des chasseurs, est tué lors d'une charge. Le général Lepic traverse avec ses grenadiers à cheval plusieurs fois les rangs des grenadiers russes. Malgré tout, les Russes progressent vers l'église d'Eylau où Napoléon se tient avec son état-major. Napoléon ordonne aux 2e chasseurs et 2e grenadiers de les attaquer. C'est à ce moment que le général Dorsenne qui les commande crie à un grenadier qui voulait se servir de son arme : « grenadiers, l'arme au bras ! La vieille garde ne se bat qu'à la baïonnette ». La Garde arrête les Russes et l'arrivée tardive de Ney sur le champ de bataille permet de remporter la victoire.
Campagne d’Espagne
En 1810-1811, la Jeune Garde est engagée dans de nombreux combats contre les Espagnols, à Luzzara, à Acedo, Santa Cruz[Laquelle ?] ou Fort Mayor. La mission de la Jeune Garde est d'assurer la tranquillité sur le Douro, de protéger la Navarre et les communications sur Valladolid.
Campagne d’Autriche
Lors de la nouvelle campagne d'Allemagne, à Essling, l'Empereur est touché à la jambe et le général Walther qui commande la Garde lui dit : « Sire, retirez-vous ou je vous fais enlever par mes grenadiers ». Alors que la bataille est indécise, le général Mouton à la tête des tirailleurs de la Jeune Garde surgit sur les Autrichiens qui menaient une attaque à l'ouest. Cette petite victoire permet de faire retraite.
À Wagram, l'artillerie de la Garde enfonce le centre autrichien et permet au général Macdonald de s'y engouffrer.
Campagne de Russie
Officier et soldat des chasseurs à pied de la Vieille Garde, vers 1811.
En Russie, la Garde ne prend pas part aux combats, mais pendant la retraite, la Vieille Garde est la seule unité qui conserve un semblant d'ordre.
Campagne d’Allemagne
En Saxe en 1813, le maréchal Bessières commandant de la cavalerie de la Garde est tué d'un boulet. La Jeune Garde combat à Lützen où elle reprend le village de Kaja, massacrant la Garde prussienne. La Jeune Garde donne à nouveau à Dresde où elle empêche les Alliés d'entrer dans la ville.
Campagne de France
C’est pendant la campagne de France en 1814 que la Garde a le plus souvent donné. À Champaubert, la cavalerie s'empare de 21 canons et de l’état-major russe. À Montmirail, l'infanterie de la Garde se distingue. La Garde, valeureuse, ne peut cependant lutter indéfiniment contre la disproportion des forces. Napoléon qui avec la Garde, remporte plusieurs batailles sur les arrières des Alliés, ne peut éviter les défaites des maréchaux défendant la route de Paris. Il abdique à Fontainebleau, où il fait les adieux à sa Garde. 600 soldats de la Vieille Garde accompagnent l'Empereur sur l'île d'Elbe.
Bataille de Waterloo
Officier des chasseurs à cheval de la Garde impériale.
À Waterloo, l'Empereur reste près de la Haye Sainte avec trois bataillons de la Vieille Garde qui sont les 2e bataillons des 2e régiments de grenadiers et de chasseurs, menés respectivement par les généraux Roguet et Christiani, ainsi que le 2e bataillon du 1er chasseurs commandé par le général Pierre Cambronne. L'Empereur les orchestra en vue d'une attaque en déployant un bataillon au centre et deux au flanc. Il peut ainsi appuyer l'attaque de Ney, quoique improbable, répéter ces attaques au centre droit anglais, ou encore les placer en vue de faire front à une offensive prussienne. Toutefois, la volonté de les ordonnancer de la sorte indique que la Garde va partir à l'attaque, car à ce moment précis Napoléon est toujours occupé à une offensive.
Pendant ce temps, Ney emmène ses bataillons toujours en carrés à l'assaut du mont Saint-Jean. La ligne reçoit l'ordre de seconder son attaque. L'artillerie à cheval de la Garde se glisse dans les espaces laissés entre les carrés, appuyés par quelques grenadiers à cheval. Cette formation s'avance contre la moitié de l'armée anglaise. Les cinq échelons se réduisent rapidement à quatre, les deux bataillons du 3e chasseurs s'étant rejoints et confondus. Sur la droite s'avancent le 1er bataillon du 3e grenadiers, puis le 4e grenadiers à un seul bataillon, et à gauche le 1er et 2e bataillon du 3e chasseurs confondus ensuite le 4e chasseurs également à un bataillon. Reille prend du retard et est distancé de trop loin pour être efficace. La Garde s'avance donc seule sur les Coalisés qui ont été prévenus et se sont préparés à cette attaque. Ney, qui vient de perdre son cinquième cheval tué sous lui, monte à pied à côté du général Friant. L'artillerie anglaise tire à double charge de mitraille et accable la Garde sous son feu.
Le 1er bataillon du 3e grenadiers emmené par Friant met en déroute un corps de Brunswick, prend deux batteries anglaises et aborde la gauche de la 5e brigade britannique du major général Colin Halkett (4 bataillons). Il repousse ensuite le 2e bataillon du 30e régiment Cambridgeshire ainsi que le 2e bataillon du 73e régiment Highland qui reculent en désordre. Le général Friant, qui vient d'être blessé, retourne près de l'Empereur pour lui annoncer que « Tout va bien », car les faits se déroulant sur une hauteur, il est impossible de les voir des lignes françaises. Cependant, le général hollandais Chassé, ancien officier de l'armée impériale, fait avancer la batterie Van der Smissen et prend de flanc le carré du 3e grenadiers de la Garde déjà mal en point. Sortant de sa réserve, la brigade Detmer, forte de 3 000 hommes, écrase le faible carré français qui contient à présent moins de 400 hommes. Les grenadiers sont refoulés et rejetés au bas de la pente.
Le bataillon du 4e grenadiers avec à sa tête le général Harlet engage pendant ce temps la droite de la brigade Halkett, composée du 2e bataillon du 33e régiment West Riding et du 2e bataillon du 69e régiment South Lincoln. Bien que fortement ébranlés, les Coalisés résistent alors que Halkett, le drapeau du 33e à la main, tombe grièvement blessé. Épisode célèbre, le bloc composé du 1er et 2e bataillons du 3e chasseurs, menés respectivement par leurs chefs, le général Michel et le colonel Mallet, s'avance en direction du chemin creux de l'Ohain, distant de quelques dizaines de mètres. Soudain, les 2 000 Guards du général Maitland, qui se sont couchés en attendant l'attaque de la Garde, se lèvent d'un bond et fusillent la Garde à moins de vingt pas. La décharge est meurtrière et met à terre presque la moitié des deux bataillons. Le général Michel est tué net. L'attaque est brisée et les rangs suivants doivent désormais enjamber les cadavres. Les batteries anglaises Ramsay et Bolton tirent à mitraille sur les flancs des Français décimés. Malgré tout, la Garde essaie de former une ligne pour répondre au feu anglais. Alors que les rangs français continuent de s'éclaircir, les soldats de Maitland, désormais rassurés à près de 10 contre 1, chargent à la baïonnette. Les survivants de la Garde attendent l'assaut, ce qui oblige les batteries anglaises à cesser le tir pour ne pas blesser les leurs, mais les débris des deux bataillons de chasseurs sont balayés du plateau et se retrouvent en bas de la pente, Anglais et Français pêle-mêle.
Le bataillon du 4e grenadiers mené par son chef, le général Henrion, débouche soudain et tente de dégager ses compagnons d'armes qui viennent d'être refoulés. Les Guards de Maitland, à sa vue, remontent les pentes en toute hâte, suivis des chasseurs survivants et des grenadiers qui se sont reformés et repartent à l'assaut. À hauteur du chemin d'Ohain, la brigade Adam, forte d'un bataillon du 52e Oxfordshire, du 71e léger Highland et de six compagnies du 95e Rifles, qui s'était portée en potence sur les flanc de la Garde, ouvre le feu. La Garde essuie de nouvelles pertes pendant que l'infanterie de Maitland, s'arrêtant de courir, fait demi-tour et recommencent à tirer sur les Français, épaulée par la brigade Halkett. Les Hanovriens de William Halkett débouchent à leur tour d'Hougoumont et fusillent dans le dos les survivants français. Le colonel Mallet tombe mortellement blessé. Les Coalisés voient néanmoins les débris du bataillon des chasseurs se déployer face aux Guards de Maitland tandis que les grenadiers se déploient face à la brigade Adam. Le colonel Colborne entraîne le 52e à la baïonnette, suivi du reste des troupes coalisées, et les chasseurs et les grenadiers sont définitivement refoulés.
Le cri de « la Garde recule » sonne le glas de la Grande Armée. Aux cris de « La Garde recule », l'infanterie et les débris de la cavalerie qui devaient seconder l'attaque s'arrêtent net et commencent à redescendre la pente. Les têtes de colonnes prussiennes abordent les fantassins de Durutte à Papelotte. Un autre cri : « sauve qui peut, nous sommes trahis ! » se fait entendre sur le champ de bataille et la déroute se propage. Quelques soldats qui se battaient encore sont balayés tandis les Prussiens se ruent à l'assaut. De la gauche à la droite, la ligne française cède et se débande. Wellington s'avance sur le bord du plateau et agite son chapeau pour ordonner l'attaque générale. 40 000 hommes se ruent sur les débris de l'armée française. À cette vue, le peu d'infanterie qui tenait encore ses lignes fait demi-tour et regrimpe vers la Belle-Alliance, abandonnant Hougoumont et la Haye-Sainte. La cavalerie coalisée sabre les fuyards aux cris de No quarter! (« Pas de quartier ! »). Dans la confusion, Napoléon, qui préparait l'attaque de la Vieille Garde, sait maintenant qu'il est vaincu mais espère organiser une retraite cohérente. Il fait rompre la colonne d'attaque de la Vieille Garde et la fait établir en carrés par bataillon à environ cent mètres sous la Haye-Sainte, le carré de droite sur la route de Bruxelles.
Les fuyards passent à côté de ces carrés, les hussards de Vivian se refusent à les combattre, les contournent pour sabrer les fuyards, proie plus facile. Napoléon lance contre eux ses escadrons de service qui sont submergés. Non loin de la route, Ney, tête nue, l'uniforme déchiré et le visage noir de poudre, n'a plus qu'un tronçon d'épée à la main. Il court rallier la brigade Brue de la division Durutte, seule troupe de ligne qui se replie en bon ordre, les jette dans la bataille en hurlant : « venez voir mourir un maréchal de France ». La brigade est dispersée rapidement. Ney refuse de quitter le champ de bataille et entre dans un carré de la Garde. Les trois bataillons de la Garde repoussent sans peine la cavalerie mais les carrés sont une proie facile pour l'infanterie coalisée. Les trois bataillons sont cernés de toute part et mitraillés par les canons. L'Empereur ordonne à la Garde de quitter cette position intenable et de battre en retraite avant de galoper en direction de la Belle-Alliance.
Les bataillons de la Vieille Garde rejoints par le bataillon du 3e grenadiers de Poret de Morvan, placé précédemment en réserve, entament leur retraite pas à pas. Les carrés sur trois rangs se reforment bientôt en triangles sur deux rangs en raison des pertes. Les soldats trébuchent à chaque pas et tous les cinquante mètres il faut s'arrêter pour repousser une charge de cavalerie ou répondre à un feu d'infanterie. La retraite est considérablement gênée par les fuyards et la marche entravée par les cadavres. La Garde est écharpée par les coalisés et bousculée par la ligne en déroute. Des officiers anglais crient aux soldats français de se rendre. Exaspéré par la situation catastrophique et les sommations de l'ennemi, Cambronne, à cheval au milieu d'un carré, leur aurait alors adressé son fameux « Merde ! ». Il est dit qu'un sous-officier rajouta : « la Garde meurt, mais ne se rend pas ». Cambronne tombe de cheval quelques instants plus tard, blessé à la tête par une balle, et est ramassé inconscient par les Britanniques.
Les carrés de la Garde qui ont maintenant rejoint le plateau de la Belle-Alliance sont presque anéantis. La confusion est telle que certains cavaliers coalisés se chargent mutuellement. La brigade Adam est prise pour cible par l'artillerie prussienne. Dans Plancenoit, la Garde demeure inexpugnable face aux Prussiens. Les divisions Hiller, Tippelkirsh et Ryssel doivent prendre le village maison par maison alors que le village brûle. La Jeune Garde est quasiment anéantie et son chef, le général Duhesme, est mortellement blessé. Le tambour-major Stubert du 2e grenadiers assomme les Prussiens avec le pommeau d'argent de sa canne. Malgré une défense tenace, ce qui reste de la Garde est chassée du village. Le général Pelet, qui se trouve au milieu de l'ennemi avec une poignée d'hommes et le porte-aigle des chasseurs de la Vieille Garde, rallie ses troupes qui reforment un carré au milieu de la cavalerie anglaise : « à moi chasseurs de la Vieille Garde, sauvons l'Aigle ou mourons près d'elle »2. Les survivants se rallient autour de leur emblème tandis que de Plancenoit déboulent pêle-mêle Français et Prussiens.
Le 1er grenadiers de la Vieille Garde à Waterloo
À Rossome, les deux carrés du 1er grenadiers de la Garde ont pris position devant la maison Decoster à gauche et à droite de la route. Autour d'eux, le sol est jonché de chevaux et de cadavres d'ennemis mais aussi de Français qui voulaient chercher protection à l'intérieur des carrés. Les carrés sont débordés par la droite ou par la gauche, mais toutes les charges ennemies sont repoussées. L'Empereur, qui à un moment a trouvé refuge dans l'un de ces carrés, ordonne de quitter la position. Le 1er grenadiers commence sa retraite, couvrant les arrières de l'armée en déroute. Il s'arrête tous les 200 mètres environ pour rectifier la face des carrés et pour repousser l'ennemi qui depuis un moment hésite à le charger. L'Empereur rejoint le 1er bataillon du 1er chasseurs de Duuring et apprend qu'il a repoussé une attaque prussienne qui visait à couper la retraite de l'armée. Il lui ordonne de suivre la colonne en marche et de se placer juste avant les grenadiers, qui ferment la marche. Plus tard, les grenadiers du 1er de la Garde se mettent en colonne par section car les Coalisés ont renoncé à les attaquer.
Bilan humain
Sans faire le détail en termes de régiments, les quatre jours de juin de la campagne de Belgique ont occasionné 11 500 morts – parmi lesquels 14 généraux – et 33 900 blessés dans les troupes françaises. D'une manière générale, avec 23 700 morts et 65 400 blessés toutes armées confondues, pertes correspondant au quart des troupes engagées, cette campagne est une des plus meurtrières campagnes militaire de la Révolution et de l'Empire en termes de victimes militaires, évidemment dépassée par les campagnes de Russie et d'Allemagne mais qui, elles, se sont déroulées sur plusieurs mois3.
Épilogue
Le retour du corps de Napoléon Ier en France en 1840 donne lieu à des scènes de ferveur. Les vieux soldats survivants ont ressorti leurs uniformes la veille, bivouaquant autour de feux de camp dans un froid intense. Ils suivent le cortège funèbre et le maréchal Moncey, âgé de 87 ans, qui depuis huit jours supplie ses médecins de le faire vivre encore un peu pour « recevoir l'Empereur », a à la fin de la cérémonie cette phrase : « à présent, rentrons mourir ».
Émile Marco de Saint-Hilaire publia une Histoire anecdotique, politique et militaire de la Garde impériale (Paris, Penaud, 1845-1847) qui fut un énorme succès.
La Garde impériale en littérature
Malgré des opinions pas toujours favorables au régime impérial, les écrivains du XIXe siècle ont souvent exprimé leur intérêt et même leur fascination pour les batailles napoléoniennes. On pense bien sûr à Victor Hugo mais Honoré de Balzac est peut-être le plus prolifique sur le sujet4 en développant souvent la thématique particulière du difficile voire impossible retour à la vie civile des soldats de l'Empire5.
Balzac avait projeté une vingtaine d'ouvrages pour constituer Les scènes de la vie militaire mais il n'en réalisa que deux : Les Chouans sur les guerres de Vendée et Une passion dans le désert, curieuse nouvelle mettant en scène un soldat de l'armée d’Égypte. Il utilisa cependant le matériau rassemblé dans nombre de ses romans et, traduisant bien le prestige des unités d'élite de l'armée napoléonienne, c'est le plus souvent à la garde impériale qu'il se réfère et à d'anciens colonels.
L'auteur de la Comédie Humaine fait d'abord une place notable aux dragons de la garde impériale :
- avec le personnage emblématique est le colonel Chabert resté pour mort à la bataille d'Eylau qui dit à son retour romanesque : « Donnez - moi le grade de général auquel j'ai droit, car j'ai passé colonel dans la garde impériale, la veille de la bataille d'Eylau ». (Le Colonel Chabert, III, page 340).
On peut raisonnablement induire que Chabert servait dans les dragons de la garde en suivant les propos de Bridau adressés à Giroudeau, ancien lieutenant-colonel des Dragons : « Que fais-tu là, toi qui as été de la charge du pauvre colonel Chabert à Eylau ? » (La Rabouilleuse, p. 45).
- avec « le vieux Giroudeau, capitaine aux dragons, parti simple cavalier à l’armée de Sambre-et-Meuse, cinq ans maître d’armes au premier hussards, armée d’Italie ! […] « un vieux capitaine des dragons de la Garde impériale, retraité chef de bataillon, entré dans toutes les capitales de l’Europe avec Napoléon… » (dans Illusions perdues, pages 205-206).
- ou encore l'ancien lieutenant-colonel des Dragons de la Garde Philippe Bridau : « un brave qui avait porté les ordres de Napoléon dans deux batailles », « ce grand frère qu’il avait vu dans le bel uniforme vert et or des Dragons de la Garde, commandant son escadron au Champ-de-Mai ! ». « Le 20 mars éclata, le capitaine Bridau, qui rejoignit l’empereur à Lyon et l’accompagna aux Tuileries, fut nommé chef d’escadron aux Dragons de la Garde. Après la bataille de Waterloo, à laquelle il fut blessé, mais légèrement, et où il gagna la croix d’officier de la Légion d’honneur, il se trouva près du maréchal Davoust à Saint-Denis et ne fit point partie de l’armée de la Loire » (page 87). Demi-solde : « elle le revit en 1816, tombé de neuf mille francs environ d’appointements que recevait un commandant des Dragons de la Garde Impériale à une demi-solde de trois cents francs par mois », il aura un destin romanesque : bonapartiste refusant de se rallier aux Bourbons, déchéance, trafics, complots, retour en fortune et mort au combat lors de la conquête de l'Algérie (La Rabouilleuse[1] [archive]).
On trouve aussi les grenadiers de la garde impériale
- avec le Maréchal Hulot : officier républicain dans Les Chouans, il devient « le célèbre général Hulot, colonel des grenadiers de la Garde impériale, que l'Empereur avait créé comte de Forzheim, après la campagne de 1809 » (La Cousine Bette VII, page 56) « le lieutenant général Hulot, le vénérable commandant des grenadiers à pied de la Garde impériale, à qui l'on devait donner le bâton de maréchal pour ses derniers jours » (idem, page 78). « Le portrait de Hulot, peint par Robert Lefebvre en 1810 dans l'uniforme de commissaire ordonnateur de la Garde impériale » (idem, page 203).
- le commandant Genestas : il a servi en Égypte, à Austerlitz, à Ulm (régiment de Murat) et à Waterloo comme chef d'escadron dans les grenadiers de la garde. Il parle à l'empereur lors des adieux de Rochefort avant le départ de Napoléon pour Saint-Hélène. (Le Médecin de campagne).
- le comte Mignon de la Bastie, le père de Pauline dans La peau de chagrin, chef d'escadron dans les grenadiers à cheval de la garde impériale : « Au passage de la Bérésina, il avait été fait prisonnier par les Cosaques ; plus tard, quand Napoléon proposa de l'échanger, les autorités russes le firent vainement chercher en Sibérie ; au dire des autres prisonniers, il s'était échappé avec le projet d'aller aux Indes (La peau de chagrin, X, page 140). Il fera fortune aux Indes.
Il est également le père de Modeste Mignon de La Bastie figure centrale de Modeste Mignon.
- Max Gilet engagé à 17 ans en 1806, il sert en Espagne et au Portugal, prisonnier de 1810 à 1814, il rallie Napoléon à son retour, capitaine des grenadiers de la garde à Waterloo équivalant au grade de commandant, demi-solde, démissionnaire, il devient le mauvais garçon d'Issoudun (« Grand Maître de l'Ordre de la Désœuvrance »), tué en duel par Bridau (La Rabouilleuse, p. 101).
L'œuvre présente encore de nombreux personnages au parcours militaire plus indéterminé ou qui ne sont parfois que des silhouettes comme :
- Général de Montriveau : artilleur puis cavalier, retraite de Russie, chef d'escadron blessé à Waterloo (colonel de la garde, il a le grade de général) – fêté dans les salons après son expédition et son évasion en Égypte, réintégré dans l'armée avec son grade – (La Duchesse de Langeais).
- Victor d'Aiglemont colonel de cavalerie, officier d'ordonnance de l'Empereur. Rallié aux Bourbons, il est fait général (La Duchesse de Langeais).
- Castagnier, ancien chef d'escadron de dragons, caissier malhonnête du baron Nucingen (Melmoth réconcilié).
- Mitouflet : « au Soleil d'or, auberge tenue par Mitouflet, un ancien grenadier de la Garde impériale, qui avait épousé une riche vigneronne » (L'Illustre Gaudissart).
- colonel Bixiou (21e de ligne) : père du caricaturiste Jean-Jacques Bixiou, il a été à la bataille de Dresde en 1813 (La Rabouilleuse).
- les vétérans Gondrin et surtout Goguelat, connu pour son portrait du « Napoléon du peuple » dans Le Médecin de campagne.
- Granson, lieutenant-colonel d'artillerie tué à Iéna (La vieille fille).
- Gravier, payeur-général des armées devient notaire par la suite (Les Paysans).
- Montefiore, capitaine, italien servant dans les armées impériales en Espagne, assassiné en 1826 (Les Marana).
- le général baron Gouraud, « ce noble débris de nos glorieuses armées » (Pierrette - Les célibataires)…
Victor Hugo a aussi puissamment participé à la gloire napoléonienne à travers ses poèmes (Souvenir d'Enfance dans Les Feuilles d'Automne, À la Colonne, Napoléon II dans Les Chants du crépuscule, À l'Arc de Triomphe dans Les Voix intérieures, Après la bataille dans La légende des siècles. Son art culmine peut-être dans L'Expiation, dans Les Châtiments quand il évoque Waterloo et le combat désespéré de la garde (« La garde impériale entra dans la fournaise »). On retrouve ce champ de bataille sinistre dans le roman Les Misérables en 1862 (tome II, Livre premier : Waterloo) avec les massacres et le détrousseur de cadavres Thénardier.
À la fin du siècle, en 1900, une figure de théâtre rappelle encore la grandeur des soldats de l’Empereur, celle de Flambeau, grenadier à pied de la Garde dans L'Aiglon d'Edmond Rostand.
Articles connexes
Citations
« La Garde meurt mais ne se rend pas », citation apocryphe attribuée au général Cambronne.
Notes et références
- Réglement concernant l'exercice et les manœuvres de l'infanterie : du 1er août 1791 ([Reprod.]), (lire en ligne [archive]).
- Le mot « Aigle » utilisé pour désigner un emblème est de genre féminin.
- Thierry Lentz, Waterloo, 1815, Perrin, , p. 281.
- Recherches sur la technique de Balzac : le retour systématique des personnages dans le Comédie humaine, Ethel Preston, éd. Slakine reprints, Genève-Paris, 1984, p. 104 : Le groupe des militaires.
- Les parents pauvres d'Honoré de Balzac : La cousine Bette, Le cousin Pons, André Lorant, Librairie Droz, 1967, p. 109 : Les inadaptés de Comédie humaine.
Véhicule militaire blindé
M109, exemple d'un véhicule militaire blindé.
Un véhicule militaire blindé ou véhicule blindé de combat est un véhicule militaire, protégé par un blindage et le plus souvent disposant d’un armement propre.
Types de blindés
Les véhicules militaires blindés sont classés en fonction de leur rôle prévu sur le champ de bataille et leurs caractéristiques. Ainsi, ils regroupent les chars de combat, automitrailleuses, véhicules de reconnaissance, véhicules de combat d'infanterie, véhicules de transport de troupes, canons automoteur, chasseurs de chars ou encore chenillettes.
Historique
Leur invention date du début du XXe siècle avec l’ajout de mitrailleuses et de plaques de blindages sur des automobiles. La Première Guerre mondiale voit apparaître les chars de combat créés à partir de tracteurs chenillés et armés de mitrailleuses et de canons. Lors de la Seconde Guerre mondiale, on développa une vaste gamme de véhicules blindés adaptés à de très nombreux usages.
Voir aussi
Articles connexes
Blindé moyen sur roues
Pour les articles homonymes, voir BMR.
| Pegaso BMR - Blindado Medio sobre Ruedas |

BMR de la Force de stabilisation en Bosnie en 2002. |
| Caractéristiques de service |
|---|
| Type |
Véhicule de transport de troupes |
|---|
| Service |
1979 |
|---|
| Utilisateurs |
 Espagne Espagne |
|---|
| Production |
|---|
| Concepteur |
Armée espagnole - ENASA |
|---|
| Année de conception |
1972 |
|---|
| Constructeur |
Pegaso |
|---|
| Production |
682 + 340 |
|---|
| Caractéristiques générales |
|---|
| Équipage |
2 + 8 |
|---|
| Longueur |
6,15 m |
|---|
| Largeur |
2,49 m |
|---|
| Hauteur |
2,36 m |
|---|
| Garde au sol |
60 cm |
|---|
| Masse au combat |
15,4 tonnes |
|---|
| Mobilité |
|---|
| Puissance |
310 ch |
|---|
| Vitesse sur route |
110 km/h |
|---|
| Pente franchissable |
60 % |
|---|
| Puissance massique |
20,12 ch/tonne |
|---|
| Réservoir |
l |
|---|
| Autonomie |
1.000 km |
|---|
| Autonomie tout terrain |
km |
|---|
modifier  |
Le Pegaso 3560 BMR (Blindado Medio sobre Ruedas), est un véhicule de transport de troupes à 6 roues fabriqué en Espagne par Pegaso. Le modèle d'origine, baptisé Pegaso BMR-600 a été fabriqué en version transport de troupes, équipé de mortier de 81 et 120 et ambulance. Il n'est pas amphibie, son prototype n'ayant pas été retenu. La version actuelle se nomme BMR M1.
Histoire1
L'étude de ce véhicule militaire a débuté en 1972 sur commande de l'armée espagnole. Il sera testé pendant 4 ans et sa production démarre en 1979.
Il fait partie des véhicules déployés par le corps expéditionnaire égyptien durant la deuxième guerre du Golfe.
Le 29 mai 1994, un programme de modernisation portant sur les 646 exemplaires en service dans l'armée espagnole a été mis en chantier, réalisé conjointement par Santa Bárbara Sistemas et Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados (PCMSA). L'objectif étant de remplacer le moteur qui équipait des véhicules, l'ancien moteur diesel turbo Pegaso 9157/8 développant 306 ch par le Scania DS9 61A MIL développant 310 ch, de cylindrée inférieure. Le programme a permis de faire rester opérationnels ces véhicules jusqu'en 2015 qui ont été renommés BMR 600M1.
Les conditions d’emploi de ces véhicules ont été significativement restreintes dans l'armée espagnole à la suite de l’explosion d'une bombe télécommandée contre un blindé de ce type du contingent espagnol de la Force intérimaire des Nations unies au Liban causant la mort de 6 soldats le 24 juin 20072.
Ils seront remplacés au début des années 2020 par le véhicule de combat d'infanterie sur roues VCR 8 × 8 « Dragón », basé sur le Mowag Piranha V3 commandé à 348 exemplaires en août 20204.
Pays de mise en service
Opérateurs du Pegaso BMR en bleu
Exporté dans différents pays et encore en service au sein des armées de :
 Espagne : 682 unités.
Espagne : 682 unités. Égypte : 260 unités livrés à partir de 1984.
Égypte : 260 unités livrés à partir de 1984. Arabie saoudite : Infanterie de marine: 140 unités livrés en 19855.
Arabie saoudite : Infanterie de marine: 140 unités livrés en 19855. Pérou : Infanterie de marine: 25 unités5.
Pérou : Infanterie de marine: 25 unités5.
Versions en Espagne
- BMR 3560.50 (BMR-PP) (Porte Personnel). Équipé d'une mitrailleuse de calibre 12,70 mm Browning M2HB montée sur une tourelle biplace TC-3A1 ou un lance-grenade automatique LAG 40. En passe d'être convertis à la version BMR-M1A.
- BMR EDEX (Équipe de désactivation d'explosifs) - Version du BMR en véhicule de déminage pour la désactivation d'explosifs (EOD/Explosive Ordnance Disposal), avec la partie arrière surélevée, tout comme les versions ambulance et poste de commandement.
- BMR C/C MILAN - chasseur de char équipé du missile filoguidé MILAN.
- BMR C/C TOW - chasseur de char équipé du lance-missile BGM-71 TOW.
- BMR VCZ (Véhicule de combat de sapeurs) - Équipé d'une lame, d'un cabestan de 7 tonnes de force de traction.
- BMR VRAC-NBQ (Véhicule de reconnaissance de zones contaminées) - Véhicule de reconnaissance de risques NRBC (Véhicule de détection, identification et prélèvement).
- BMR GEL (Guerre électronique) - Véhicule de guerre électronique.
- BMR 3560.51 (BMR-PC) (Poste de commandement) - Véhicule poste de commandement, avec la partie arrière surélevée.
- BMR 3560.53E (BMR-PM-81) (Porte-mortier) - mortier automoteur ECIA L-65/81 de 81 mm, qui pourra voir une intégration temporaire du Patria NEMO en attendant que le Dragon (véhicule blindé) soit pleinement opérationnel6.
- BMR 3560.54 (BMR AMB) (Ambulance) - Ambulance, avec partie arrière surélevée.
- BMR 3560.55 (BMR-Recup) (Dépannage) - Véhicule de dépannage léger et de maintenance, équipé de grue, de cabestan et de barres de remorques.
- BMR 3560.56 (BMR Mercurio 2000) - Véhicule de transmissions militaires.
- BMR 3560.59E (BMR-PM-120) (Porte-mortier) - mortier automoteur ECIA L-65/120 de 120 mm.
- Projets militaires avortés
Galerie d'images
-
-
BMR-M1 Mercurio 2000, Espagne
-
-
BMR-600 de l'armée égyptienne en avril 1991
-
Liens externes
Sur les autres projets Wikimedia :
Notes et références
Blindé léger sur roues
Il a été fabriqué par l'Empresa Nacional Santa Barbara avec un moteur Pegaso.
Engagement
Produit à une vingtaine d'exemplaires, et introduit en 19801, il a servi à la protection et la surveillance des bases aériennes espagnoles au sein de l'armée de l'air. Il est désormais remplacé par l'URO VAMTAC.
Utilisateurs
Liens externes
Sur les autres projets Wikimedia :
Notes et références
Articles connexes
Blindage (mécanique)
Pour les articles homonymes, voir Blindage.
En mécanique un blindage est une paroi, destinée à protéger ce qui est derrière, ou une enveloppe, destinée à protéger ce qui se trouve à l'intérieur.
Blindage militaire
Présentation
Les véhicules militaires terrestres, aériens ou nautiques, sont souvent blindés afin de fournir une protection aux équipages pendant les missions effectuées sous le feu ennemi.
Combattre en mouvement, tout en étant couvert, a toujours été un rêve pour les fantassins. Déjà, dans l'Antiquité et particulièrement dans la phalange hoplitique des cités-États grecques et du royaume de Macédoine et dans les légions romaines, les équipements et techniques de protection au combat furent inventés (cuirasse, casque, cotte, tortue, etc.). Certaines sont encore utilisées de nos jours, dans certains cas, par les forces spéciales, comme la formation de la tortue. Les chevaux ont aussi été lourdement protégés, permettant ainsi la création d’une cavalerie lourde (les cataphractaires).
Blindage des navires de guerre, les premières théories modernes
Du milieu du XIXe siècle à celui du XXe siècle, le blindage des navires de guerre a considérablement augmenté avec l'apparition des navires de ligne avant de quasiment disparaître des navires modernes avec l'apparition de l'électronique. Les théoriciens des divers marines sont les premiers à modéliser le blindage.
À la fin du XIXe siècle, l'ingénieur et capitaine de la marine française, Jacob de Marre, a modélisé les résultats de ses expériences dans une équation. Cette formule est à la base de la théorie de la résistance des blindages1.
Pour lui, l’énergie cinétique nécessaire pour percer un blindage est fonction essentiellement du diamètre du projectile, de l’épaisseur de la plaque et de sa résistance mécanique. Cette théorie est aujourd’hui toujours valable pour des projectiles classiques cylindro-coniques et à des vitesses à l’impact de l’ordre de 1 000 m/s. Cette formule n’est nullement applicable pour les obus à charge creuse2.
Ci-après un extrait du « cours d’architecture navale. Tome III, conception du navire, fascicule 1 - Projet de navire . § 1.23 ( protection) » daté de 1951 de l'école nationale supérieurs du génie maritime (ENSGM), aujourd’hui d'École nationale supérieure de techniques avancées de H. Amiot, Ingénieur en chef du génie maritime et directeur technique de la Section technique des constructions et armes navales (aujourd’hui absorbée par la Direction générale de l'Armement) : À l’égard de la protection contre l’action d’artillerie, autrefois seule à craindre, le problème est limité au caisson blindé. Il se formule de façon relativement simple.
On impose de protéger le bâtiment, entre certaines distances et certains azimuts de combat, contre une certaine artillerie (normalement d’un bâtiment de même classe que le bâtiment en projet et qui , par suite — du moins ne première approximation — est de même calibre et de mêmes caractéristiques que celle du bâtiment étudié).
On vise à éviter la pénétration des projectiles attaquants à l’intérieur du caisson blindé.
L’effet des projectiles sur les blindages dépend :
- Des caractéristiques des blindages (nature et qualité métallurgiques, épaisseur) ;
- Des caractéristiques des projectiles (fonction de leur calibre- la masse étant en particulier pour des projectiles semblables proportionnelle au cube du calibre — de leur tracé — de leurs caractéristiques métallurgiques) ;
- Des conditions d’impacts ; vitesse et angle d’inclinaison.
Les phénomènes de pénétration se résument, à première vue, en une absorption de la force vive du projectile par le travail de déformation de la plaque. Ils sont en fait très complexes et impossibles à analyser théoriquement de façon complète. Ils se différencient nettement selon qu’il y a attaque sensiblement normale du projectile — assurant perforation par poinçonnage — ou, au contraire, fortement oblique – assurant déchirement par défoncement .
Les résultats de nombreuses expériences poursuivies au polygone de Gâvres ont permis d’établir les formules empiriques suivantes.
Sous attaque sensiblement normale, on a la formule de perforation de Jacob de Marre :
- pVsp² = K a 1.5 (e /cos j)1.4
ou sous forme classique :
- Vsp² = 1530 r²( a/p) 1.5 (e /cos j)1.4
où :
- Vsp = vitesse stricte de perforation (en m /s)
- r = coefficient caractéristique de l’ensemble plaque projectile (de l’ordre de 1,2)
- a = calibre du projectile (en dcm)
- p = masse du projectile (en kg)
- e = épaisseur de plaque (en dcm)
- j = angle d’incidence (par rapport à la normale à la plaque)
Formule qui est valable pour un angle d’incidence assez faible et en tout cas inférieur à l’angle limite de ricochet (variable de 20 à 50°).
Sous attaque fortement oblique, on a la formule de déchirement de d’Aveline : Vsd = 1000 D (a0.26/p0.55) L0.5 e0.85 f (i)
où
- Vsd = vitesse stricte de déchirement (en m /s)
- D = coefficient caractéristique de l’ensemble plaque projection
- a = calibre du projectile (en dcm)
- p = masse du projectile (en kg)
- L = Longueur du projectile (en dcm)
- j = angle d’incidence (par rapport à la normale à la plaque)
- f (i) = fonction nettement décroissante de l’angle d’attaque, i=/2- j)
Formule qui est valable pour un angle d’attaque compris entre 25 et 50° c’est-à-dire un angle j compris entre 40 et 75°.
Pour la détermination d’un blindage :
- Les caractéristiques du projectile sont supposées connues
- La vitesse et l’angle d’impact sont fonction de la vitesse initiale supposée du projectile n de la portée (qui, d’après la table de tir, fixe la vitesse restante et angle d’arrivée par rapport à l’horizontale) et de l’azimut de tir. Cet azimut intervenant différemment selon l’orientation du blindage par rapport à l’axe du navire.
Une fois fixées la nature du blindage et son inclinaison éventuelle sur l’horizontale, les formules ci-dessus permettent théoriquement d’en définir l’épaisseur minimum. Toutefois, la dispersion dans les qualités individuelles des différentes plaques est si forte que la détermination des épaisseurs par ces formules ne doit pas être considérée comme rigoureuse.
Le blindage de ceinture est déterminé par le risque de perforation au tir tendu, correspondant aux distances minima de tir
Le blindage des ponts est déterminé par le risque de déchirement au tir sous grand angle correspondant aux grandes distances de tir.
Mais, l’impossibilité d’assurer une protection absolue par la seule résistance du premier blindage rencontré, amène à la conception d’un premier blindage suffisant pour faire éclater à coup sûr le projectile et d’un pont blindé inférieur pare-éclats.
De toute façon, l’accroissement progressif des distances pratiques de combat tend à accroitre l’importance relative de la protection des ponts par rapport à celle de la ceinture (et cette exigence s’accorde avec celle de la protection contre les bombes d’aviation.
L'acier
Au début du XXe siècle, les blindages d'acier étaient fabriqués en plaques, coupées aux dimensions et rivetées ensemble. Cependant, à la fin de la Première Guerre mondiale et dans les petits conflits des années 1930, les militaires découvrirent que les explosions les plus proches, ainsi que des coups superficiels, arrivaient souvent à faire sauter les rivets. Ceux‑ci étaient éjectés dans l'habitacle où ils ricochaient et provoquaient des blessures. On souda alors les plaques ensemble ou, mieux, on les coula d'une seule pièce. La construction rivetée perdura cependant durant la Seconde Guerre mondiale. Ce type de blindage est parfois également désigné « blindage acier homogène ».
Aujourd'hui, le blindage acier des chars est coulé en quelques grandes pièces de plusieurs tonnes. Le système de moulage et de traitement produit un durcissement spécial sur la surface extérieure. Ce côté durci détourne les obus ou fait éclater les plus faibles charges. La texture moins solide de l'intérieur assure qu'en cas de pénétration de la surface, l'ensemble du blindage ne va pas éclater. L'intérieur de la structure est souvent couvert de Kevlar ou d'un autre produit « balistique », qui empêche la diffusion de fragments de blindage ou d'obus à l'intérieur du char en cas de pénétration. Ce revêtement balistique est censé arrêter au moins les plus gros fragments, réduisant ainsi les dommages et les blessures infligées par une pénétration.
Un char soviétique
T-72. On note la forme très arrondie de la
tourelle.
Blindage incliné, blindage arrondi
Bien qu'il y ait eu des exemples auparavant, c'est depuis le fameux T‑34 soviétique (produit en 1941) que les chars ont utilisé efficacement le blindage incliné. Ce blindage permet d'augmenter l'épaisseur réelle de leur protection, mais aussi d'augmenter les probabilités de ricochets lors des tirs. Un des premiers remèdes contre les têtes à charge creuse de type HEAT fut de changer la forme des plaques de blindage. Au lieu de souder des plaques planes, en formant des angles, dans les années 1950, les corps et les tourelles des chars furent dessinés avec des formes arrondies, obtenues par moulage. Ce blindage permettait aux coups de mieux rebondir, ou au moins aux obus HEAT et à leur jet de gaz de frapper le blindage selon un angle qui dévierait le jet dans l'air, plutôt qu'au cœur du char. Un tir de HEAT de plein fouet reste cependant fatal.
Les blindages espacés
Le blindage espacé est l'agencement d'un blindage principal et d'un blindage secondaire, les deux blindages étant séparés par un espace creux. Le blindage secondaire peut être improvisé et ajouté après mise en service sur un véhicule existant, ou bien avoir été prévu dès la conception du véhicule. Il peut être constitué d'une plaque de blindage supplémentaire, d'une cage, et on peut considérer que les jupes ou les chenilles agissent parfois en tant que blindage espacé. Le but peut être soit de dévier un obus afin qu'il ne pénètre pas, soit de faire détonner une charge explosive à distance du blindage principal afin dans les deux cas d'épargner le blindage principal. L'apparition des charges creuses durant la Seconde Guerre mondiale a rendu ce type de blindage particulièrement intéressant, et on peut en voir trois exemples, avec les « Schürzen » (jupes) installées sur beaucoup de chars allemands dès 1942, avec les tourelles de certaines versions du PzKpfw IV, ou bien dans les flancs creux de l'IS-3 soviétique.
Les blindages composites
Les blindages composites et Chobham furent inventés dans les années 1970. Ce type de blindage, que l'on désigne parfois simplement « sandwich » (de composites), est fait de couches de métal à haute densité/haute résistance et de céramiques plastiques de haute résistance à la chaleur. Les couches non métalliques jouent le rôle de pièges à chaleur ou de réflecteurs, réduisant la température du jet de gaz beaucoup plus vite que le métal. Cela veut surtout dire que le jet pénètre moins profondément. Les parties en céramique, de par leur dureté bien supérieure aux métaux communs, agissent aussi en brisant la tête des munitions perforantes à l'impact. En effet, ces dernières (par exemple l'obus flèche General Dynamics KEW-A1 américain), agissent en concentrant toute leur énergie en un seul point minuscule (la pointe de la flèche). Si cette pointe, généralement constituée d'un matériau dur (donc cassant), se brise à l'impact, la force exercée par l'obus contre le blindage se verra répartie sur une surface d'application bien plus large, ce qui en diminuera considérablement les effets.
Habituellement, le blindage composite a une surface extérieure d'acier durci, comme les blindages normaux. Mais en dessous, on trouve des couches successives de métaux et céramiques. Sur les Abrams, la première couche, extérieure, est en uranium inerte, une substance presque deux fois et demie plus dure que l'acier. D'autres couches suivent, composées de céramique et métaux. La céramique résiste mieux à la chaleur, et les métaux résistent mieux à l'énergie cinétique. L'effet global, c'est celui d'un blindage qui résiste à l'énergie cinétique au moins aussi bien qu'un blindage classique, et qui absorbe le jet brûlant des obus HEAT si bien qu'ils en deviennent presque inutiles. La couche intérieure du blindage, est un plastique ou un métal spécial résistant à l'éclatement au moins aussi bien que le tissu « balistique ». Le mélange exact du blindage Chobham est plus complexe qu'un simple empilage. Les céramiques peuvent être coulées dans une matrice en nid d'abeille, ou le contraire. Les couches peuvent venir l'une sur l'autre ou se recouvrir selon des systèmes complexes.
Tous les blindages composites ont en commun le fait qu'ils sont fabriqués en plaques. Les chars qui « adoptent » ce nouveau blindage doivent abandonner les formes arrondies et revenir aux angles aigus. D'où le profil au couteau du char M1 Abrams, du char Leopard II et du châssis avant des séries T-72 et T‑80 russes.
Le blindage réactif
Fonctionnement de la charge creuse de la roquette du
RPG-7.
L'URSS, puis la Russie, ont développé à partir de 1977 des systèmes de protection active utilisant des systèmes de brouillage et des ogives à fragmentation, le système Arena, ayant effectué des essais depuis 1995.
De leur côté, les Israéliens ont développé une défense réactive contre les charges creuses (HEAT) en tapissant la surface extérieure du véhicule de petites boîtes (parfois appelées « tuiles ») remplies d'explosif, le système Trophée ou Trophy. Lorsqu'un projectile heurte ces boîtiers avec une énergie importante, ces derniers détonent en libérant une onde de choc et une importante quantité de souffle dans la direction du projectile. Dans le cas d'une charge HEAT, l'explosion d'une tuile réactive le « balaye » littéralement et dévie son jet incandescent, qui ne peut alors plus pénétrer le blindage.
D'autres blindages réactifs existent, avec des tuiles qui n'explosent pas, ou constitués d'une armure électrique qui entoure le char et envoie une décharge dans les charges HEAT pour les faire exploser avant l'impact.
Avantages
Insensibles aux shrapnels et aux balles, l'explosion de ces conteneurs dévie l'action d'une charge creuse, rendant inopérant le jet de gaz de la charge. Cela réduit de beaucoup la pénétration du blindage. Les Israéliens appellent cela un blindage « Blazer ». Le blindage réactif peut être adapté à presque tous les types de blindages. Il donne au véhicule une bonne protection contre les HEAT.
Inconvénients
Cette épaisseur de « boîtes » peut piéger les obus et les dévier vers d'autres parties du char, quelquefois plus vulnérables encore. Ensuite, dès qu'un conteneur a été frappé par une charge, le char perd, à cet endroit, sa protection et devient vulnérable si un tir frappe au même endroit. Enfin, dernier inconvénient, le char transporte aussi des équipements et souvent du personnel à l'extérieur, tout près de ces boîtes : si celles-ci sont du type explosif, les soldats à proximité peuvent être gravement blessés. En outre, les blindages réactifs résistent moins bien aux obus à haute vélocité, les boîtes explosent sans pouvoir vraiment arrêter la tête de l'obus, qui poursuit son chemin.
Parade : les charges améliorées
Roquette PG7-VR du lance-roquettes
RPG-7. On distingue bien la présence des deux charges HEAT en tandem, la plus petite étant exposée en premier au blindage de la cible à détruire.
Pour combattre les blindages réactifs, de nouvelles charges HEAT ont été inventées. Les charges HEAT « à deux étages », aussi désignées « en tandem », disposent d'une petite charge HEAT au bout d'une sonde, suivie par une charge HEAT bien plus massive derrière. Cette première charge, de faible puissance, est supposée faire déclencher et mettre hors d'état le blindage réactif, qui laissera donc le blindage alors fraîchement exposé subit l'assaut de la charge HEAT principale. Aujourd'hui, beaucoup de missiles antichar sont équipés de ce type de charges militaires, tels les missiles TOW 2 et Javelin.
L'autre technique consiste à augmenter le diamètre de la tête HEAT. Cela crée un jet de gaz encore plus puissant, ce qui permet de compenser l'explosion réactive, ou de pénétrer plus profondément dans des matériaux composites. La tête du missile Hellfire a été conçue dans ce sens.
Les alliages légers
Vue de l'arrière d'un
BMP-1.
Quelques chars légers et beaucoup de véhicules blindés de combat légers (transport de troupes) ont abandonné l'acier pour des alliages de métaux légers. L'aluminium est un des plus communs. Par exemple, les Américains utilisent l'aluminium pour leur transport de troupes M113 et leur véhicule de combat d'infanterie M2/M3.
L'URSS a même utilisé des alliages de magnésium pour certaines parties de ses BMP. Dans les deux cas, cela n'a pas été un franc succès. Ces métaux ont un point de fusion bien inférieur à celui de l'acier. Quand ils sont pénétrés, des fragments du blindage prennent littéralement feu, diffusant du métal en fusion autour et à l'intérieur du véhicule. En Afghanistan, les BMP en feu étaient très communs. Le mauvais choix de la place des réservoirs (intégrés aux portes arrière) a évidemment beaucoup contribué à la fâcheuse tendance qu'avaient les BMP à se transformer en torches.
Depuis la fin des années 2000, des blindages cages en textile constitués de tissu à haute résistance, bien plus légers que l'aluminium, sont apparus3.
Dommages indirects
On ne sait pas grand-chose des dommages infligés par un tir non pénétrant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un tir de ce genre pouvait très bien blesser ou tuer l'équipage, notamment pour les chars qui utilisaient un blindage à rivets. Les chars soudés ou moulés passaient certainement mieux l'épreuve, mais l'équipage était encore grièvement blessé par le choc, les éclats intérieurs de blindage filant partout dans le char à partir du point d'impact. De plus, les chars de la Seconde Guerre mondiale tiraient avec des canons de calibre compris entre 50 et 85 mm. Les obus actuels atteignent des calibres de 120 à 125 mm et emportent une charge double ou triple. Même avec des revêtements anti-éclats et de nouveaux blindages composites, un coup au but qui pénètre en partie le blindage peut provoquer des effets secondaires très destructeurs.
Les dommages indirects peuvent être importants dans le cas d'un Abrams atteint par un missile antichar ou un explosif HEAT. En négligeant les dommages indirects, l'Abrams résiste aux missiles tirés sur son avant, car ils n'ont pratiquement aucune chance de pénétrer. Il en résulte des dommages indirects, blessures ou mort des membres d'équipage.
Blindage civil
Engin de chantier
Certains engins de chantier sont pourvus d'une cage métallique permettant de protéger le conducteur de la chute de tout objet. Ceci est particulièrement important pour les engins dédiés à la démolition de bâtiments.
Serrurerie
En serrurerie, le blindage consiste à renforcer une porte, une fenêtre, un volet ou son huisserie au moyen de protections métalliques offrant une résistance accrue à l'effraction.
Les métalliers s'orientent aujourd’hui vers la fabrication de blocs-portes. Un bloc-porte est un ensemble huisserie/porte en métal avec des paumelles à billes soudées. Il existe un grand nombre de moyens contribuant au blindage d'une porte, comme les cornières anti-pinces, les plats de battements, les barres de seuil, etc.
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
Stratégie
La stratégie est un « ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis »1. Son but est d'atteindre le ou les objectifs fixés par la politique (l'idée générale) en utilisant au mieux les moyens à disposition. 2
Initiée par l'art militaire, la stratégie se décline dans de nombreux domaines d'affrontement ou de compétition tels que les entreprises en management et en marketing,la psychologie (notamment la manipulation mentale ou la séduction), l’économie, la diplomatie, l'écologie, les jeux de stratégie comme les échecs, le jeu de go ou le poker, etc.
Elle se distingue de la tactique, en ce sens qu'elle concerne des objectifs à moyen ou à long terme tels que la victoire d'une guerre ou une politique diplomatique particulière, alors que la tactique concerne des objectifs à court terme tels que la victoire dans une bataille.
Dans son approche économique, elle est l'ensemble des méthodes qui maximisent dans un univers conflictuel ou concurrentiel3 — c'est-à-dire face à un rival, un opposant, un adversaire, un concurrent ou un ennemi — les chances d'atteindre un objectif donné malgré les actions de l'autre4.
Étymologie et utilisation du mot
Le mot stratégie dérive du grec (stratos signifie « armée », ageîn signifie « conduire »).
Sur les autres projets Wikimedia :
Le mot « stratégie » et le qualificatif « stratégique » sont parfois appliqués de façon abusive à différents domaines ou notions. Ils sont ainsi souvent utilisés dans des situations où d'autres termes — plus modestes et plus spécifiques — tels que « politique », « idée », « concept », « plan », « alliance » ou « tactique » seraient plus appropriés.
- L'élaboration d'une action, notamment dans les activités économiques (d'entreprise, commerciales, industrielles, ou financières, etc.) ne relève pas systématiquement et forcément d'un niveau de réflexion ou d'une démarche « stratégiques ».
- Au jeu d'échecs, on ne peut minimiser l'importance et le rôle spécifiques de la composante tactique dans la stratégie échiquéenne.
- Il est également parfois fait état de « stratégies d'apprentissage » (en didactique) ou de « stratégies de communication » alors qu'il serait plus judicieux et plus exact de parler de « méthodes » ou de « techniques » d'apprentissage et de communication.
Parallèle entre les stratégies militaire et d'entreprise
Le parallèle entre la stratégie militaire et la stratégie d'entreprise — initié conceptuellement par Carl von Clausewitz dans De la guerre et par Théodule Ribot dans Essai sur l'imagination créatrice — a été repris de façon méthodique en 1969 par Fernand Boucquerel5 dans son livre Management. Politique-Stratégie-Technique6.
La transposition est difficile pour plusieurs raisons :
- La « guerre » entre les entreprises est médiatisée par les consommateurs ou les clients (le marché). Ce sont eux qui, in fine, décident et non pas le sort des armes7.
- La « guerre » entre les entreprises se déroule sur plusieurs niveaux (corporate, business, produit). La guerre terrestre entre belligérants aussi, mais ce ne sont pas les mêmes8.
- Les démarches stratégiques d'entreprises ne sont pas toujours concurrentielles (c'est-à-dire qu'elles ne tiennent pas forcément compte des stratégies potentielles futures des concurrents), alors que les démarches stratégiques militaires le sont toujours.
| Militaire | Niveau | Niveau | Entreprise |
|---|
Répartition et déploiement
des forces armées |
Stratégie |
Stratégie |
Portefeuille géostratégique
d'activités |
Théâtre d'opération
Campagne
Manœuvre |
Art opératif |
Tactique |
grande tactique |
Champ de bataille
Bataille |
Tactique |
Opérationnel |
Segment de marché
Stratégie produit |
Enjeux
Stratégie et anticipation
Horizons et scénarios
L'établissement d'une stratégie exige :
- d'une part, d'évaluer la probabilité de réalisation des choix susceptibles d'être faits ;
- d'autre part, d'adopter une règle ou un indicateur de préférence pour classer les résultats escomptés de différents scénarios.
Notions d'importance et d'urgence
Les responsables dans les organisations sont toujours confrontés à un certain nombre de tâches à accomplir. Ces tâches sont plus ou moins urgentes ou importantes. Les responsables commenceront toujours par les tâches urgentes et importantes, et délaisseront presque toujours les tâches qui ne sont ni urgentes, ni importantes. Les tâches urgentes et non importantes doivent faire l'objet d'une délégation de pouvoirs. Les tâches importantes et non urgentes sont le domaine de la réflexion stratégique : on n'est pas à une journée près pour s'y attaquer, et il y a toujours de bonnes raisons pour les repousser9.
Stratégie et la théorie des jeux
Dans la théorie des jeux, une stratégie désigne un processus de conduite de la décision.
Choix et tactique
1855. La charge de la Brigade légère à Balaclava illustrant le niveau tactique.
Par héritage de la terminologie militaire (qui fait la différence entre « gagner la guerre », « remporter une campagne » et « gagner une bataille ») et par extension, les termes ont une portée distincte :
- la stratégie vise un objectif global et à plus long terme (équivalent civil de gagner la « guerre ») ;
- l'art opératif et les opérations visent à aborder la bataille en position favorable ;
- la tactique vise un enjeu plus local et limité dans le temps (équivalent civil de gagner une « bataille »).
Ainsi, l'art de combiner les moyens et les ressources en fonction des contingences, relève de trois niveaux de responsabilité distincts avec une terminologie différente en stratégie militaire et en stratégie d'entreprise.
| Stratégie militaire | Stratégie d'entreprise |
|---|
| Le niveau stratégique (chef d'État et Chef d'État-Major des armées) |
Le niveau stratégique, soit le plus haut niveau de l'organisation (par exemple : conseil d'administration ou direction générale) |
| Le niveau opératif (commandant d'une opération) |
Le niveau tactique, décliné et porté par l'encadrement supérieur de l'organisation (par exemple : comité de direction) |
| Le niveau tactique (commandants des composantes terrestres, maritimes, aériennes, ...) |
Le niveau opérationnel, qui est celui de l'entité ou du service local, engagé dans une action particulière (par exemple : atelier de production) |
Stratégie, programmation et planification
La stratégie consiste en la définition d'actions cohérentes intervenant selon une logique séquentielle pour réaliser ou pour atteindre un ou des objectifs. Elle se traduit ensuite, au niveau opérationnel en plans d'actions par domaines et par périodes, y compris éventuellement des plans alternatifs utilisables en cas d'évènements changeant fortement la situation.
Le plan est un programme de mise en œuvre d'une stratégie (plan stratégique) ou d'une tactique (budget fonctionnel). Il permet de passer du niveau conceptuel à celui de l'action. Il précise son horizon temporel et est assorti d'un budget.
Le raisonnement stratégique est de nature plus complexe : il intègre les ressources dans les données du problème car le fait de disposer ou non des ressources suffisantes peut conditionner fortement la définition des objectifs. La « bonne » stratégie ne peut évacuer a priori la question des ressources : elle peut conduire en effet à renoncer à des objectifs pressentis comme « irréalistes » ou du moins à les reformuler.
Une réflexion pertinente sur les ressources porte sur les vertus de ce qui existe et sur les moyens d'en tirer parti. Elle consiste en la valorisation et la mobilisation des ressources humaines, la fertilisation des réussites et des innovations, l'optimisation de l'emploi des capacités financières et des moyens matériels, la saisie de toutes les occasions et de toute conjoncture favorable, avec la minimisation des coûts et l'économie des énergies. Quant aux contraintes et aux obstacles, on essaye de les aménager, de les contourner, et mieux encore, de les transformer en ressources.
Domaines d'application
Diplomatie
En diplomatie, les termes de plan, de doctrine, de principes, de charte, d'engagement, de protocole ou de feuille de route sont souvent préférés pour désigner les lignes directrices des relations internationales, dans un domaine donné ou le cadre plus général d'une politique internationale.
Développement durable
La politique économique se réfère au concept de stratégie de développement. Si une telle stratégie veut englober toutes les dimensions de la société civile (exigences des parties prenantes, analyse du contexte de l'entreprise, prise de responsabilité, perception précoce et conscience face aux risques…), elle ne peut se limiter aux aspects strictement économiques de la stratégie, mais doit au contraire intégrer les aspects environnementaux et sociaux dans une vision globale de la gouvernance de type développement durable.
Domaine militaire
Terrain ancien et privilégié de la réflexion et de l'application stratégique.
La stratégie militaire est dans une acception restrictive la — théorie relative à l'usage des forces armées dans l'engagement10 —. Il est dans une perception moins dévoyée, la combinaison planifiée et anticipée de forces militaires qu'elles soient terrestres, navales et aériennes, de renseignement ou de maîtrise des espaces stratosphériques ou cybernétiques en vue de l'obtention d'un effet tactique propre à soumettre l'adversaire à une volonté. Elle pense donc l'usage de la force militaire.
Management d'entreprise
La stratégie est généralement appréhendée comme la manière dont une organisation investit des ressources pour en obtenir un avantage compétitif et atteindre ses objectifs, en tenant compte des changements attendus dans son environnement. En tant qu'approche globale, cette responsabilité et cette tâche sont attribuées à la direction générale.
Divers auteurs présentent une définition de la stratégie d'entreprise :
- Pour Alfred Chandler (1960), elle consistait à déterminer les objectifs et les buts fondamentaux à long terme d’une organisation puis à choisir les modes d’action et d’allocation des ressources qui permettront d’atteindre ces buts et objectifs. En d’autres termes, c’est mettre en place les actions et allouer les ressources nécessaires pour atteindre lesdites finalités. Elle comporte de ce fait deux phases à savoir premièrement la fixation d’objectifs11[source insuffisante]. La seconde phase est donc la détermination des ressources et des moyens. Elle est donc un concept qui est fait partie du quotidien du manager et qui induit une action permanente.
- Pour Tregoe & Zimmerman (1980), la stratégie d'une entreprise est ce qu'elle veut être afin de survivre et comment elle va faire pour y arriver12.
- Henry Mintzberg (1999), quant à lui l'a appréhendée comme un plan, un modèle, une position, une perspective et un stratagème13[source insuffisante]. La stratégie est traduite par les questions suivantes. Que produire ? Comment réaliser cette production ? Avec quels moyens le faire ?
- A. Derray, A. Lusseault (2001), y voient l’art d'organiser et de coordonner un ensemble d'opérations pour parvenir à un but14.
- Pour Laurence Lehmann-Ortega et al. (2013), elle consiste à choisir ses activités et à allouer ses ressources de manière à atteindre un niveau de performance durablement supérieur à celui de ses concurrents dans ces activités, dans le but de créer de la valeur pour ses actionnaires15.
- Pour Michael Porter (De 1982 à aujourd'hui), la stratégie d'entreprise consiste à surmonter les contraintes de l'environnement concurrentiel (le modèle des 5 +1 forces) en organisant les ressources disponibles (à travers la chaine de valeur de l'entreprise) pour d'obtenir un avantage concurrentiel durable.
Selon Richard Whittington16 trois niveaux méritent d'être distingués :
- la stratégie d'entreprise, qui est le processus, la démarche ou l'ensemble des méthodologies (matrice d'analyse stratégique, etc.) qui permet d'élaborer un portefeuille d'activité et d'allouer à long terme des ressources à des secteurs d'activité géostratégiques assurant la pérennité de l'entreprise et la rémunération des actionnaires avec le maximum de chances de succès. Elle concerne « l'entreprise dans sa globalité. Elle a pour but de répondre aux attentes des actionnaires, et des autres parties prenantes en augmentant la valeur des différentes composantes de l'entreprise ».
- la stratégie par domaine d'activité ;
- les stratégies opérationnelles qui déterminent « comment les différentes composantes de l'organisation ( ressources, procédés, savoir-faire des individus...) répondent effectivement aux orientations stratégiques définies au niveau global et au niveau de chacun des domaines d'activité ».
Marketing
Poker
Écologie
En écologie, une stratégie est l'ensemble des mécanismes utilisés par des organismes pour croitre, survivre, se reproduire et coloniser l'espace.
Sur les autres projets Wikimedia :
Bibliographie
- Jean Baudrillard, Les Stratégies fatales, livre poche, 1986
- Michel Collon et co., La Stratégie du chaos, Asbl, 2012
Stratégie militaire
- Carl von Clausewitz, De la guerre (1843), Éditions Ivrea
- Antoine de Jomini, Précis de l'art de la guerre, Champ libre
- Edward Luttwak, Le Paradoxe de la stratégie, Odile Jacob, 1989
- Basil Lidell-Hart, Stratégie
- Hervé Coutau-Bégarie : Traité de stratégie, Economica, 2005
- André Beaufre (Général), Introduction à la stratégie (1963), Fayard/Pluriel, 2012
Stratégie militaire et stratégie d'entreprise
- Fernand Bouquerel, Management. Politique - Stratégie - Tactique, Dunod, 1969
- Peter Linnert, Clausewitz et le management, Éditions d'Organisation, 1972
- Gil Fiévet (Général), De la stratégie militaire à la stratégie d'entreprise, InterEditions, 1992
- Gil Fiévet (Général), De la stratégie militaire. L'expérience militaire au service de l'entreprise, InterEditions, 1993
- Frédéric Le Roy, Stratégie militaire et management stratégique des entreprises, Économica, 1999
- Roula Chebab, Stratégie militaire et stratégie d'entreprise, Faculté de gestion et de management, 32 p. (lire en ligne [archive])
- Stéphane Chalmin, Gagner une guerre aujourd'hui, Economica, 2013
Stratégie d'entreprise
- Alfred Chandler, Stratégies et structures de L'entreprise, Paris, Organisation 1964
- (en) Benjamin Tregoe, John Zimmerman, Top Management Strategy. What It Is and How to Make It Work, Simon & Schuster, 1980
- (en) Henry Mintzberg, « The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy », California Management Review, automne 1987, p. 11-24
- (en) Bruce Henderson, The Origin of Strategy, Harvard Business Review, (présentation en ligne [archive])
- Patrick Joffre, Gestion stratégique, EMS, 1992
- Michael Porter, Choix stratégiques et concurrence. Techniques d'analyse des secteurs et de la concurrence dans l'industrie (1982), Économica, 1999
- (en) Henry Mintzberg, Quinn, etc., The strategy process, Pearson Education, 1999
- Alain Derray, Alain Lusseault, Analyse stratégique, Ellipses, 2001, p. 86
- (en) Henry Mintzberg, Joseph B. Lampel, James Brian Quinn, Sumantra Ghoshal, The Strategy Process. Concepts, Context, Cases (4e édition), Prentice Hall, 2002
- Michael Porter, L'avantage concurrentiel. Comment devancer ses concurrents et maintenir son avance (1986), Dunod, 2003
- Richard Whittington, Patrick Regnér, Duncan Angwin, Gerry Johnson, Kevan Scholes et Frédéric Fréry (trad. de l'anglais), Stratégique, Montreuil, Pearson, , 12e éd., 697 p. (ISBN 978-2-326-00243-2), pp. 3-34.
- Gilles Bressy, Christian Konkuyt, Management et économie des entreprises, chap 9, 10 et 11, 11e éd., éd. Sirey, 2014
- Olivier Meier, Diagnostic stratégique, 4e éd., Dunod, 2015
- Frédéric Le Roy, Les Stratégies de l'entreprise, 4e édition, Dunod, 2012
- Laurence Lehmann-Ortega, Frédéric Le Roy, Bernard Garrette, Pierre Dussauge, Rodolphe Durand, Strategor. Toute la stratégie d'entreprise, 6e édition, Dunod, 2013
Stratégie et théorie des jeux
- John von Neumann, Oskar Morgenstern, Théorie des jeux et comportements économiques (1953), université des sciences sociales de Toulouse, 1977
- John McDonald, Strategy in Poker, Business & War (1950), Norton, 1996
Notes et références
- Informations lexicographiques [archive] et étymologiques [archive] de « stratégie » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales
- André Beaufre, introduction à la stratégie, Pluriel, , 188 p. (ISBN 978-2818502990), p. 34-35
- Sinon, il s'agit d'un « plan ».
- Voir : André Beaufre, Carl von Clausewitz, Bruce Henderson, fondateur du BCG, Michael Porter, John von Neumann, Thomas Schelling, etc.
- Professeur au Centre de perfectionnement aux affaires devenu HEC Executive Education.
- « Peut-on appliquer les arts politiques et militaires au gouvernement et à la conduite des entreprises, cellules économiques de combat ? », pp. 38-53, et « De la stratégie » et « De la tactique », pp. 142-202.
- Raymond Aron, « Le Marketing de combat », Forum IFG, 1980.
- Operation, FM-105, College of Defence
- François Collé, le guide stratégique du responsable d'entreprise, réaffirmer les priorités, faire évoluer le management des hommes, maîtriser les techniques financières, L. du Mesnil éditeur
- Benoit Durieux, Relire de la guerre de Clausewitz, Economica, 171 p. (ISBN 978-2717849875), p. 62-63.
- A. Chandler, Stratégies et structures de L'entreprise, Paris, Organisation, 1964.
- Benjamin Tregoe, John Zimmerman, Top Management Strategy. What It Is and How to Make It Work, Simon & Schuster, 1980, p. 17.
- Mintzberg, The strategy process, Harlow : Pearson Education Limited, 1999.
- Analyse stratégique, p. 86 éd. Ellipses, mai 2001.
- Laurence Lehmann- Ortega, Frédéric Le Roy, Bernard Garrette, Pierre Dussauge, Rodolphe Durand, « Stratégie, business strategy et corporate strategy », dans : Strategor. Toute la stratégie d'entreprise, 6e édition, Dunod, 2013, p. 7.
Articles connexes
Stratégie militaire
Stratégie d'entreprise
Théorie des jeux, jeux de stratégie et divers
Sur les autres projets Wikimedia :
La tactique se rapporte à l’organisation et à la marche suivie pour réussir dans quelque affaire. Initialement lié au domaine militaire, ce terme s'applique à toute confrontation (économique, commerciale, sportive, ludique, diplomatique, etc.) et décrit l'art de combiner de manière optimale les modes opératoires et les moyens dont on dispose, pour emporter un gain ou une décision.
Elle se distingue de la stratégie, en ce sens qu'elle concerne des objectifs à court terme tels que la victoire d'une bataille alors que stratégie concerne des objectifs à moyen ou à long terme tels que la victoire d'une guerre ou une politique diplomatique particulière.
Articles détaillés
Logistique
Cet article contient une ou plusieurs listes ().
Ces listes gagneraient à être rédigées sous la forme de paragraphes synthétiques, plus agréables à la lecture, les listes pouvant être aussi introduites par une partie rédigée et sourcée, de façon à bien resituer les différents items.
D'autre part, Wikipédia n'a pas pour rôle de constituer une base de données et privilégie un contenu encyclopédique plutôt que la recherche de l'exhaustivité.
La logistique est l'activité qui a pour objet de gérer les flux physiques, et les données (informatives, douanières et financières) s'y rapportant, dans le but de mettre à disposition les ressources correspondant à des besoins (plus ou moins) déterminés en respectant les conditions économiques et légales prévues, le degré de qualité de service attendu, les conditions de sécurité et de sûreté réputées satisfaisantes.
Pour le Council of Supply Chain Management Professionnals1, la logistique se définit comme : « l'intégration de deux ou plusieurs activités dans le but d'établir des plans, de mettre en œuvre et de contrôler un flux efficace de matières premières, produits semi-finis et produits finis, de leur point d'origine au point de consommation. Ces activités peuvent inclure -sans que la liste soit limitative- le type de service offert aux clients, la prévision de la demande, les communications liées à la distribution, le contrôle des stocks, la manutention des matériaux, le traitement des commandes, le service après vente et des pièces détachées, les achats, l'emballage, le traitement des marchandises retournées, la négociation ou la réutilisation d'éléments récupérables ou mis au rebut, l'organisation des transports ainsi que le transport effectif des marchandises, ainsi que l'entreposage et le stockage ».
Pour l'Association for Supply Chain Management (ASCM)2, la définition précédente est plutôt celle du Supply Chain Management. La logistique est définie comme « 1) Dans un contexte industriel, l'art et la science d'obtenir, produire et distribuer composants et produits au bon endroit et dans les quantités requises. 2) Dans un contexte militaire (qui est l'usage le plus fréquent), cela peut aussi inclure les mouvements de personnel »3.
On peut également rappeler la définition du Littré : « La logistique est l'art d'approvisionner les armées en campagne ».
Étymologie
Définition
Finalités de la logistique
En 1996, Jean-Charles Bécour et Henri Bouquin, dans Audit opérationnel : Efficacité, efficience ou sécurité, distinguent trois finalités à la logistique4.
La première finalité de la logistique se situe à court terme. Il s'agit d'optimiser les flux physiques de l'amont à l'aval, ce qui implique l'exploitation des prévisions commerciales et des carnets de commandes à très court terme, la définition des programmes d'approvisionnement et de production, la programmation des livraisons, la régulation de l'après-vente et la distribution des pièces de rechange ainsi que la continuité de l'exploitation par la mise en place d'un plan de maintenance.
La seconde finalité de la logistique se situe à moyen terme. À l'horizon des plans d'action et des budgets, la logistique vise à définir les actions qui permettent de contrôler les coûts logistiques des services que l'entreprise a choisi de développer (par exemple, si l'entreprise décide de mettre en place un processus de production fonctionnant selon le principe de la différenciation retardée, la logistique est censée appréhender et optimiser tous les paramètres de production et de stockage intervenant dans ce type d'organisation), de conseiller les dirigeants pour leur permettre de choisir les opérations que l'entreprise doit assurer en propre et celles qu'elle a intérêt à sous-traiter et de contribuer fortement à l'optimisation du coût de l'investissement ou du fonds de roulement de l'entreprise.
La troisième et dernière finalité de la logistique se situe à long terme. Dans cette perspective, la logistique cherche à aider l'organisation à maîtriser la complexité, l'incertitude et les délais résultant de la multiplication des couples produits-marchés, à actualiser en permanence la connaissance de l'impact que les aspects logistiques ont sur les coûts d'exploitation des clients et de l'organisation ainsi qu'à proposer - le cas échéant - à l'organisation un avantage concurrentiel en offrant à ses clients un service logistique optimal au coût le plus adapté et acceptable.
Histoire
Approches de la logistique
Approches conceptuelles
Concepts liés à la logistique
Catégories, métiers
- Assemblage,
- Comanufacturing (ou kitting)
- Emballage,
- Suremballage (ou copacking, ou conditionnement à façon)
- Gestion informatique : gestion de la chaîne logistique
- Supply chain management,
- Gestion de la qualité,
- contrôle de la qualité,
- Gestion de la traçabilité,
- Transport,
- Transport point à point,
- Groupage-dégroupage,
- Point de dépôt,
- Flux tendu
Certaines universités et institutions académiques forment les étudiants à devenir des logisticiens, proposant des programmes de licence, master et doctorat. L’une des universités axées principalement sur la logistique est la Kühne Logistics University à Hambourg, en Allemagne. À but non lucratif, elle est soutenue par la Fondation Kühne, créée par l’entrepreneur en logistique Klaus-Michael Kühne.
Voies de communication empruntées
Selon ce qui est transporté
Ressources, moyens et outillages
- Communication, systèmes d'informations et supports d'informations
Approches pratiques
En matière de situation et de rôle dans l'organisation
En amont du processus de production
Les activités amont comprennent :
- le développement (création ex nihilo ou modification de l'existant) et la recherche de sources d'approvisionnement(sourcing), dans ou à l'extérieur de l'entreprise cliente, par la mise en relation avec :
- les achats (purchasing) qui impliquent la notion de « contrat » et de « vendeur » (vendor) ;
- l'approvisionnement (procurement) qui induit la notion de « commande » (ouverte ou fermée) (order), de bons de commandes (à l'extérieur) (purchase order) ou de « demandes, bons ou ordres de fabrication, de livraison… » (à l'intérieur) et de fournisseurs (supplier) ;
- le transport amont et les opérations de douane5, pour acheminer les marchandises (Produit fini ou matériaux, minerais, composants…) vers un point de stockage (notion de stock) ou une plateforme de préparation de commande (notion de Juste-à-temps ou flux tendu).
En aval du processus de production
Les activités aval comprennent :
- le stockage en entrepôt (entreposage) ;
- le suremballage (copacking), la constitution de kits ou de lots (kitting), le conditionnement à façon, l'adressage, etc. ;
- la préparation de commandes qui peut porter d'autres noms ;
- la « répartition » pour les entreprises du secteur pharmaceutique (en incluant toutefois sous cette dénomination le « stockage » et le « transport aval ») ;
- « l'éclatement » pour les entreprises du secteur alimentaire frais (qui représente un seul passage à quai sans stockage, avec répartition et rechargement immédiat de véhicules),
- le transport aval (après le lieu de stockage), qui se décompose en :
- « traction », c'est-à-dire le transport jusqu'à un point de répartition ou d'éclatement ou de mise en tournée ;
- « passage à quai », pour « éclater », « répartir » ou « mettre en tournée » sur d'autres véhicules ;
- « distribution », c'est-à-dire le transport du « dernier kilomètre » (s'agissant généralement d'entreprises de livraisons avec des véhicules légers (véhicules de moins de 3,5 t de poids total en charge et/ou de livraisons urgentes ou de distribution (comme celle du courrier)), vers une entreprise (Business to business) ou vers un particulier (Business to consumer).
En retour du processus d'utilisation
On entend par « logistique retour » ou Reverse Logistics, la gestion de l'acheminement de marchandises, généralement hors d'usage, du point de fabrication (en l'occurrence, le consommateur final) jusqu'au point de réparation, de recyclage ou de destruction définitive et totale.
La gestion des flux retours est potentiellement un marché prometteur, parce qu'elle devrait, d'une part, permettre à terme, de recycler des matières premières de plus en plus rares (donc chères) et d'autre part parce qu'elle est source d'emplois.
Elle représente cependant une dépense supplémentaire, à court terme, pour les entreprises et les particuliers. Pour les inciter à alimenter ces flux retours, les pouvoirs publics de certains pays, comme la France, ont déjà instauré des taxes :
- taxe de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) (sur les produits d'emballages, payée par les entreprises) ;
- écotaxe ou éco-participation (sur les produits électroménagers, ou des éléments d’ameublement, payée par ceux qui les achètent).
Dans ces deux cas, ce sont les entreprises qui jouent le rôle du percepteur et qui reversent la taxe à l'État, qu'elles n'aient ou qu'elles n'aient pas répercuté son coût à ses clients et aux consommateurs.
Cependant, les circuits logistiques et les circuits de recyclage des marchandises et des emballages sont loin, en 2007, d'être parvenus à leur maturité. Par exemple, de nombreux déchets qui auraient donné lieu à tri sélectif seraient malgré tout mixés à l'entrée de certaines centrales thermiques, afin de les alimenter avec des mélanges de matières combustibles de qualité conforme aux spécifications des fours. Comme il n'est pas certain que toutes les piles électriques usagées collectées par la distribution soient vraiment traitées par des structures adaptées.
À défaut d'inciter les consommateurs et les industriels à réduire les quantités d'emballage consommées et de matière détruites, les « taxes écologiques » ont au moins déjà le pouvoir de contribuer au financement des interventions de l'État en faveur de l'Écologie.
En termes de type de service apporté
Par catégories des marchandises transportées ou stockées :
Par réglementations applicables aux personnes, aux marchandises, aux biens et aux services pour les activités réglementées :
- mise sur le marché de produits pharmaceutiques ;
- transport, manipulation, stockage de matières dangereuses ;
- transports, stockage d'aliments ;
- toutes activités de transport…
Par méthodes de gestion rendues obligatoires par la réglementation :
En termes de moyens mis en œuvre pour l'exploitation
Les systèmes d'exploitation :
- mise en place de systèmes de transitique ;
- suivi des véhicules par satellites ;
- gestion de parcs de matériels, et notamment suivi de la maintenance et des obligations légales (par exemple : sur chariot élévateur) ;
- préparation de commandes assistées par la voix « À la trace et à la voix »8 ;
- systèmes informatiques de gestion des commandes, des productions, des stocks, des emplacements de stockage ;
- systèmes électroniques (systèmes anti-vols, reconnaissance par code-barres, identification par RFID…) ;
- systèmes mécaniques (robotique industrielle, convoyeurs, monte-charge…).
Les outils et les ressources pour exercer l'activité logistique :
- spécialistes à la recherche de terrains hébergeant ou pouvant héberger des zones industrielles et/ou logistiques ;
- spécialistes en immobilier, en construction ou en aménagement d'entrepôts de stockage ou de messagerie ;
- spécialistes des systèmes informatiques et des modules spécialisés des progiciels de gestion intégrés ou PGI (Entreprise Resources Planning ou ERP) : « Gestion des entrepôts » - Warehouse Management Systems / « Gestion du transport » / « Gestion des Achats » / « Gestion des approvisionnements » ou « Procurement »…
- spécialistes en gestion des ressources humaines, en management ;
- spécialistes en matériel de transport, de l'élément manutention, de stockage, d'emballage…
Enjeux contemporains
Alors que l'adage « l'intendance suivra » a souvent justifié dans l'économie de pénurie d'après guerre la quasi-absence de la préoccupation logistique, la pression concurrentielle croissante que connaissent les marchés contemporains (concurrence par les prix mais aussi concurrence hors prix) a singulièrement fait évoluer les esprits9 :
- le progrès technique a permis de concevoir et de fabriquer des produits « techniquement » valides ;
- l'organisation scientifique de la production (via le taylorisme ou le toyotisme) a réduit les coûts de fabrication ;
- le marketing a contribué à mieux adapter les produits à la demande du marché.
Aujourd'hui, la discipline « Logistique » est apparue comme une occasion de faire mieux correspondre le service, au sens large du terme, aux besoins et attentes des clients :
- la notion de service devient tellement incontournable qu'il est de moins en moins envisageable d'offrir un produit hors d'un contexte de service rendu à l'un ou l'autre stade de l'échange (avant, pendant ou après la vente proprement dite) ;
- le coût de ce service peut être très important et peut fort bien représenter une part non négligeable, sinon majoritaire, du prix de revient du produit. La maîtrise de ce coût n'est pas assurée tant les différents éléments qui le composent dépendent de fonctions qui agissent indépendamment les unes des autres, sans coordination ou supervision appropriées.
Logistique et système d'information
La gestion de la chaîne logistique (supply chain management en anglais, SCM) désigne le sous-domaine du système d'information qui répond aux besoins spécifiques des opérateurs logistiques de gestion de la chaîne d'approvisionnement, prévision, planification, magasinage, transports, etc.10.
Pour ce faire, le SCM est évidemment conduit à :
- entretenir à ce titre des liens très forts avec le système d'information de l'entreprise et en particulier avec le progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP en anglais) de l'entreprise s'il existe ;
- mobiliser un grand nombre de données et de flux d'informations associés, convenablement organisés et mis à disposition par le biais d'un stockage approprié sous forme de BDD ;
- offrir une palette de traitements et d'applications logicielles, en phase avec les besoins particuliers des opérateurs logistiques (la notion de traçabilité ou de suivi en temps réel fournissant de bons exemples des exigences à servir).
Logistique et développement durable
La logistique, et plus particulièrement la gestion de la chaîne logistique, commencent à être étudiées sous l'angle du développement durable depuis les années 200011.
La recherche de solutions pour une logistique durable passe par des réflexions sur l'organisation des transports terrestres de marchandises. La France s'est dotée, depuis le début des années 1990, d'un outil de coordination des incitations pour la recherche et le développement des transports terrestres : le Programme de recherche et d'innovation des transports terrestres (Predit). Les questions d'énergie et d'environnement font l'objet du groupe opérationnel 1 de Predit, et les questions de logistique et de transport de marchandises font l'objet du groupe opérationnel 4 de Predit12.
La logistique et le transport entretiennent des relations étroites avec l'information qui s'avère centrale quand la logistique s'engage dans une démarche durable. Cela recouvre plusieurs thématiques13 :
- la collecte des données relatives aux transports de marchandises en ville ;
- la promotion du concept de veille logistique durable ;
- l'évaluation carbone de la chaîne logistique et de la relation fournisseurs ;
- l'analyse de l'influence de la qualité des données utilisées dans les systèmes d'information sur la mutualisation des opérations logistiques de la filière industriels-commerçants-consommateurs ;
- la mesure des émissions de CO2 dans le domaine du transport routier.
Les études de logistique montrent que le coût du dernier km en ville représente plus de 20 % du coût total de la chaîne14. Il est donc primordial d'optimiser la logistique urbaine (ou logistique de proximité). En France, le ministère de l'Équipement a lancé en 1993 le programme national « Marchandises en ville » pour explorer des solutions de logistique urbaine15.
Dans ce cadre, le vélo en général et le vélo cargo en particulier, apparaît de plus en plus comme une solution adaptée pour le transport de marchandises, en particulier sur le dernier km en ville. À tel point, que l'on parle parfois de « vélogistique », néologisme issu de « vélo » et « logistique »16, ou de cyclologistique17.
Le commerce électronique présente une problématique de logistique spécifique, dans laquelle la livraison finale tient également une place importante. En France, le Sénat a mis en place en 2004 un groupe de travail pour étudier la logistique dans le cadre du commerce électronique. En effet, le développement de la vente à distance, rendu possible par l'Internet, tend à transformer en profondeur les problématiques de logistique18.
En 2013, le programme européen Life + soutient le projet dit « LIFE+ Urbannecy » porté par le Cluster logistique Rhône-Alpes visant à « démontrer l'efficacité d'une approche intégrée innovante en matière de logistique urbaine qui implique une coopération entre les acteurs concernés, l’utilisation de nouveaux programmes de distribution et la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures (réglementaires, organisationnelles, opérationnelles et technologiques). Cela devrait contribuer de manière efficace à la réduction des effets négatifs sur l’environnement urbain des processus logistiques actuels »19.
Logistique et numérique
Le numérique agit également de manière profonde sur les activités logistiques. Les outils numériques sont perçus par de nombreux acteurs du secteur logistique comme un levier d’amélioration de leur efficacité opérationnelle. Nicolas Raimbault souligne que le numérique constitue un facteur important du développement des activités logistiques d’aujourd’hui, en particulier du e-commerce, du développement du drive, et de la logistique du dernier kilomètre. Les services numériques étant de plus en plus nombreux et fréquents, les infrastructures nécessaires à pour y répondre se multiplient également : entrepôts, réseaux…
Nicolas Raimbault, chercheur sur les dynamiques de gouvernance urbaine, met également en avant que les plateformes numériques sont à l’origine d’une transformation importante de la nature et de l’organisation des services logistiques et de livraison20. Par exemple, Amazon multiplie l’installation de petits entrepôts dans les villes, notamment des métropoles. Ces entrepôts, renommés par l’entreprise, « delivery stations », lui permettent de proposer des livraisons très rapides après les commande des usagers, dans la journée21. Aussi, l’entreprise a mis en place des consignes automatiques où les clients peuvent retirer leur colis de façon autonome. Le Covid-19 a certainement amplifié ce phénomène de « digitalisation du dernier kilomètre ». Depuis le début de la crise, de nombreuses enseignes multiplient le « ship from store »22. Ces services leur permettent d’accroître la qualité du service rendu, puisque la livraison est plus rapide, et également de limiter les coûts logistiques et de transport. C’est donc toute la chaîne logistique qui mute sous l’effet du e-commerce.
Notes et références
- H Maté et D.Tixier : La Logistique, Paris PUF , 1987.
- APICS Dictionary 15th edition Chicago 2017
- Texte original anglais 1) In an industrial context, the art and science of obtaining, producing, and distributing material and product in the proper place and in proper quantities. 2) In a military sense (where it has greater usage), its meaning can also include the movement of personnel.
- J. C. Becour et H. Bouquin, L'audit opérationnel, efficacité, efficience et sécurité, Éditions Economica, Paris, 1996,(collec. Gestion).
- Code des douanes [archive].
- (en) European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road [archive], sur le site unece.org du .
- Rapport d'activité 2004-2005 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments [archive], sur le site ladocumentationfrancaise.fr, consulté le 18 juillet 2015
- L'officiel des transporteurs, supplément au no 2384-2385 (2007), p. 20-21
- D. Lambillotte, La fonction logistique dans l'entreprise, Dunod, Paris, 1976.
- Voir Paché Gilles, Paraponaris Claude (2006), "L'entreprise en réseau : approches inter et intra-organisationnelles", Editions de l'ADREG, [1] [archive].
- Christine Belin-Munier, Logistique, SCM, et développement durable, université de Bourgogne, [lire en ligne [archive]].
- Site officiel du Programme de recherche et d'innovation des transports terrestres [archive].
- Predit 4 - Logistique : quelles données face aux enjeux environnementaux ? [archive].
- [2] [archive]PIPAME - Logistique et distribution urbaine, page 11, sur le site dgcis.gouv.fr.
- « Marchandises en ville » [archive], sur le site transports-marchandises-en-ville.org, non trouvé le 18 juillet 2015.
- Vélogistique [archive], Carfree France, 2013.
- « Cyclo-logistique » [archive], sur lafabriquedelalogistique.fr (consulté le ).
- Alex Türk (dir.), « Le défi logistique du commerce électronique : Comment se transforment les problématiques de logistique avec le développement de la vente à distance ? », Sénat (France) (version du 1 février 2012 sur l'Internet Archive), p. 24.
- projets soutenus par Life + [archive] élus en 2013
- Raimbault, « Le développement logistique des métropoles: des enjeux de régulation exacerbés par le numérique », Sciences Po Cities and Digital Technological Chair,
- (en) « Our Facilities » [archive], sur US About Amazon (consulté le )
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Bibliographie
Ouvrages généralistes
- Pascal Lièvre, La logistique, Paris, La Découverte, coll. « Repères », , 128 p. (ISBN 978-2-7071-4625-0)
- Hervé Mathe et Daniel Tixier, La logistique, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? » (no 2351), , 128 p. (ISBN 978-2-13-063228-3)
- Daniel Brun (dir.) et Frank Guérin (dir.), La logistique : Ses métiers, ses enjeux, son avenir, Caen, Éditions EMS, coll. « Regards sur la pratique », , 408 p. (ISBN 978-2847696813)
- Yves Pimor et Michel Fender, Logistique & Supply Chain, Malakoff, Dunod, coll. « Technique et ingénierie », , 7e éd. (1re éd. 1998), 496 p. (ISBN 978-2-10-074941-6)
Ouvrages spécialisés
- Gilles Paché (dir.) et Alain Spalanzani (dir.), La Gestion des chaînes logistiques multi-acteurs : perspectives stratégiques, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, , 256 p. (ISBN 978-2-70611380-2)
- Gilles Paché (dir.), Images de la logistique : Éclairages managériaux et sociétaux, Marseille, Presses universitaires d'Aix-Marseille, , 293 p. (ISBN 978-2-7314-1068-6)
Articles connexes
Liens externes
| [masquer]
|
|---|
| Disciplines principales |
|
 |
|---|
| Théories principales |
|
|---|
| Principaux théoriciens |
|
|---|
| Articles en rapport |
|
|---|